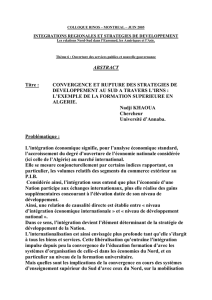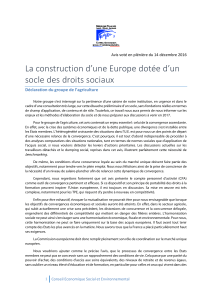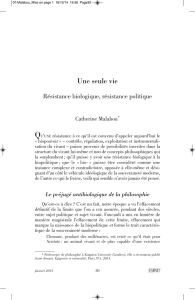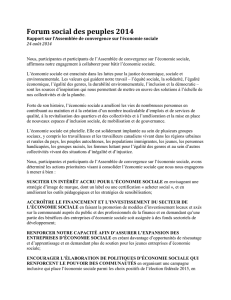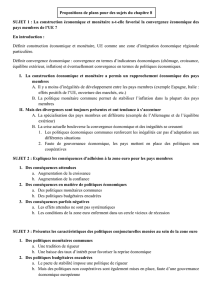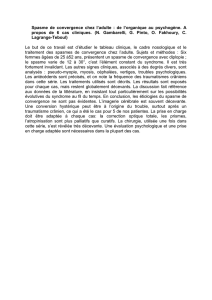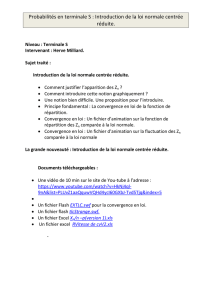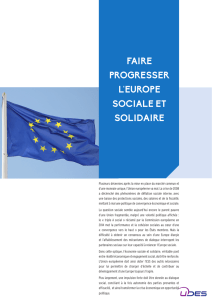Le support d`enseignement n`est pas anodin, il a sa logique propre

Le support d’enseignement n’est pas anodin, il a sa logique propre. L’introduction des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dans les salles de classe
implique nécessairement une modification du mode d’acquisition de la connaissance.
Que nous apprend donc l’ordinateur sur notre façon d’apprendre ?
Mai-juin 2001 - N°315
Noir autrefois, vert naguère, blanc le plus souvent aujourd’hui, le tableau de classe reste
l’un des objets les plus mémorables des parcours scolaires. Table de la loi comme support
des explications du maître, il est aussi le lieu de l’angoisse : « aller au tableau » pour y
écrire un calcul ou pour s’y adosser afin de réciter la leçon. C’est dire combien l’espace du
tableau représente le pouvoir, celui qui s’attache à la mémorisation (des savoirs) et à la
démonstration (faire savoir qu’on sait).
Juxtaposition et effacement : la logique du tableau noir
Ce qui nous intéresse ici est le mode de fonctionnement du tableau. Outil « technologique
» et méthodologique, cet espace ouvert à l’inscription demande rigueur dans son utilisation
et pose problème à nombre d’enseignants ; c’est qu’il existe une « gestion » du tableau
demandant de conjuguer juxtaposition et effacement, ce qui n’a rien d’évident.
Juxtaposition dans la notation progressive des axes d’un exposé, d’une « leçon »,
développement d’une règle, listage de termes, etc. Effacement dans le développement du
cours dont les séquences se succèdent par jeu de remplacement et d’enchâssement de
moments de classe dont le tableau retrace l’histoire.
Ainsi, ne pas excéder les pouvoirs de l’œil (du cadrage) et de la mémoire (de la
coordination) mène à l’exercice d’un jeu subtil où il faut savoir effacer à temps, ni trop tôt
ni trop tard ; jeu dans lequel c’est la virtualité même des traces qui assure l’usage pertinent
du support. Au vrai, ces traces se matérialisent quelque part, mais ailleurs, dans le cahier
des élèves dont les notes sont supposées valides, aptes à conserver la mémoire fugace du
tableau. Voire, tout enseignant qui a un jour regardé de près les prises de notes subsistant
de son cours sait combien une telle fidélité est aléatoire (et justifiée1).
On peut donc remarquer qu’il existe une double lecture du tableau et celle-ci combine
deux orientations apparemment contradictoires selon qu’on y repère un premier niveau de
construction (ou s’accumulent et s’ordonnent les indices utiles d’une séquence de classe)
ou un second (où se substituent les séquences). La « logique » du tableau est au final celle
du recouvrement ; logique profondément enseignante en ce qu’elle oblige l’intelligence, de
par la non disponibilité des éléments et mises en ordre effacés antérieurement, à travailler
par la mémoire sur du linéaire, en termes d’étapes, de phases successives dont la seule
lecture possible est à l’arrivée (le moment où l’on se trouve, ou la projection sur un
moment encore rêvé, celui du but à atteindre) celle d’une histoire et d’un progrès2 .
Il y a donc plus qu’une rencontre circonstancielle entre l’outil-support et le projet
d’enseignement. Le premier matérialise ce que le second retient comme son mode d’être et
sa justification : la projection dans le temps, la finalisation des parcours, la linéarisation de
la trajectoire d’accès aux savoirs. Et l’on peut alors se demander ce qu’il adviendrait de
cette logique si l’enseignement se trouvait confronté à un tableau susceptible de rendre
accessible l’ensemble de ses usages et remplissages successifs, susceptible donc de briser
l’accès seulement linéaire à l’intégration des savoirs.

L’écran, gardien du cheminement vers la connaissance
L’apparition des systèmes informatiques en matière d’enseignement et d’apprentissage a
pu susciter autant de craintes que d’espoirs : crainte d’un « remplacement » de l’enseignant
par la machine, espoir d’une « machine intelligente » infiniment disponible. A vrai dire, si
le temps des fantasmes semble aujourd’hui dépassé, c’est que l’outil informatique a trouvé
place dans notre quotidien est s’est révélé à l’usage pour ce qu’il est : un outil dont on peut
user avec talent ou non selon la maîtrise technique dont on dispose, mais aussi, et surtout,
selon la clarté des buts que l’on poursuit.
C’est donc en termes d’outil que l’on envisagera ici les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication), particulièrement dans les développements
proposés en EIAO (Environnements Interactifs d’Apprentissage avec Ordinateur). Ce qui
nous intéresse est la matérialisation des systèmes et des interfaces et architectures qu’ils
proposent. Or, c’est à un écran que se trouve confronté l’utilisateur, qu’il travaille sur un
CD Rom ou se livre aux joies et complications de la navigation sur Internet, et c’est cet
écran, mis en regard du tableau de classe, qui nous paraît actualiser et résumer les
potentialités de l’entreprise.
Il est possible de définir brièvement les caractéristiques de ce nouveau support par le
recours à trois termes : le fenêtrage, l’infini et le virtuel, mais seul le premier de ces termes
est ici décisif.
Le fenêtrage
Comme le tableau de classe, l’écran informatique connaît la logique du recouvrement: on
peut y inscrire et y effacer ; mais compte tenu de sa petite taille et de sa luminescence
(lisibilité affaiblie, fatigue de l’oeil augmentant avec le nombre d’éléments présentés), il
devient très vite insupportable de ne le gérer que par cette seule logique. On exploite donc
les ressources de la numérisation des données, la puissance de traitement des bases
mémorielles en développant dans les diverses applications proposées la capacité de mise
en mémoire d’écrans multiples, affichables de manière permanente et rapide sous une
forme graphique aisément manipulable : celle des fenêtres précisément qui enchâssent
dans le premier écran un ou plusieurs second(s) qui eux-mêmes à leur tour…etc.
Le fenêtrage peut donc rendre accessibles les diverses étapes d’un parcours, les divers
niveaux d’une coordination et d’un classement. Et c’est ici qu’on peut, en termes de
supports, parler de révolution : le fenêtrage permet de s’interroger sur les modes d’accès
au savoirs, sur les modes de construction de la connaissance, parce qu’il renvoie sans cesse
aux traces, parce qu’il double toute trajectoire linéaire finalisée vers un but de trajets
médiants, variables et multiples. En ce sens, il conjugue de manière intéressante mémoire
et intelligence.
Comme on a pu souligner la convergence entre logique du tableau de classe et perspective
d’enseignement, on pourrait remarquer combien cette logique d’enchâssement du
fenêtrage informatique rencontre la logique de l’apprentissage, aux prises, comme on l’a
souligné, avec la nécessité de réinterpréter sans cesse son parcours, de revenir toujours sur
la définition de ses étapes et de ses modes d’identification. Le mode de fonctionnement de
l’écran entretient une convergence avec le travail de la connaissance qui se développe par
enchâssements multiples et constante remise en perspective de son propre développement.
Il ne s’agit, évidemment, que d’un potentiel, mais qui vaut la peine d’être souligné dans la
perspective de développement d’outils informatisés d’aide à l’apprentissage (évaluation
des performances en langue par exemple3).

L’infini et le virtuel
Ces deux caractéristiques, abondamment soulignées4 par ailleurs, ne nous intéressent ici
qu’au regard de l’analyse de l’écran où elles prennent forme. La mise en abyme réalisée
par l’ouverture enchâssée des fenêtres mène très rapidement à une sensation de vertige et
ce, non seulement de par l’accessibilité à un nombre élevé d’écrans (voire effectivement
infini sur le réseau Internet), mais aussi de par la multiplicité des chaînages possibles (telle
fenêtre peut s’ouvrir à partir de telle autre, mais encore d’une autre qui elle-même est
susceptible de contenir la première). Telle une bibliothèque borgèsienne de Babel5 , tout
est dans tout et par le jeu des combinatoires, tout type de trajet imaginable se trouve déjà
(potentiellement) réalisé. Plus que l’infinité des sources (pourtant effective), c’est l’infinité
des trajectoires qui enrichit la relation entretenue avec le support et permet de développer
son potentiel d’interactivité.
Il ne faut pas s’illusionner sur les puissances d’un médium qui ne saurait, à lui seul, ou de
lui-même, transformer l’acte éducatif. La multiplicité des parcours virtuels, la possibilité
de les représenter à l’écran dans une quasi simultanéité peut vite prendre la forme d’un
labyrinthe où vient se noyer l’apprentissage. Cette remarque devrait rassurer les
enseignants inquiets d’une possible dépossession du rôle de l’enseignement. Tout porte à
croire que la richesse du médium enrichira d’abord le métier d’enseignant, en le faisant
évoluer sur des terrains qui lui était jusqu’alors peu accessibles: ceux du tutorat, d’un
rapport plus étroit avec la régulation des apprentissages, plus ouvert sur un échange
paritaire qui ne déconsidère aucunement l’ordre parallèle de la classe.
De plus, le support écran n’est pas sans rapport avec le tableau de classe. Travailler sur un
écran exige aussi de jouer de l’effacement (saturation lorsqu’un trop grand nombre de
données sont affichées en simultanéité) et de la mémoire (gestion des capacités de la
mémoire vive, dépôt sur disque dur, organisation des fichiers)6 . On connaît ainsi des
logiciels de traitement qui permettent de gérer l’écran sur le modèle (amélioré, il est vrai
parce que dynamique et réversible) du tableau de classe7. Mais ce parallèle n’est que...de
surface, car ce qui différencie fondamentalement l’espace virtuel du support matériel est
l’émergence d’une densité autre et autrement gérée, d’un « feuilletage » du support où
l’essentiel ne se joue peut-être plus dans la substitution des inscriptions successives
d’informations (coordination, progression), mais dans l’intégration de couches
superposées, rémanentes parce qu’affichables (comme d’une connaissance qui ne se
développerait pas en progressant uniquement, mais en s’étalant dans toutes les directions,
en s’enfonçant dans le sol graphique de l’écran, orientée autant vers l’avant que vers
l’après). Tant il est vrai que dans le domaine de la connaissance la « progression » et la «
régression » ne s’excommunient pas l’une l’autre, mais s’étayent, et qu’il faut souvent
revenir sur des questions anciennement tranchées pour dépasser, dans une construction
nouvelle, le savoir jusqu’alors dominant, mais bloqué.
C’est cette convergence qui est intéressante: la mise en question de la planification
enseignante, qui ne saurait gérer, et encore moins prévoir, l’intégralité des parcours, est
aussi l’histoire d’une construction chaotique, mais logique, d’un apprentissage qui se
reconnaît au fur et à mesure qu’il élabore et rature son plan de travail.
Anticipation ou imprévisibilité ?
Comme on a tenté de le montrer ici, la logique du support (plus proche des exigences de
l’enseignement dans le cadre du tableau de classe, plus en convergence avec les besoins de
l’apprentissage dans l’espace de l’écran) vient informer assez largement l’accès aux
savoirs et le possible développement de la construction de connaissance. La question qui
peut être posée en conclusion est donc celle d’un rapprochement à définir entre support et
situation éducative, convergence de l’enseignement et de l’apprentissage face au nouveau

médium.
Or, cette convergence n’a rien d’illusoire. Si l’on considère les CD Roms et les sites Web à
visée éducative, on peut constater combien la « scénarisation pédagogique » des activités
inscrit dans l’organisation des écrans le (ou les) cheminements(s) possible(s) de
l’utilisateur; si l’on élargit l’analyse à la fréquentation de sites non spécifiquement
éducatifs, à l’exploration d’Internet à l’aide de moteurs de recherche, on constate là aussi
que l’internaute, si aléatoire que puisse apparaître son parcours, n’est cependant pas privé
de moyens : l’architecture logicielle qui règle les voies de navigation internes (plan) et
externes (liens hypertextes par exemple) permet d’anticiper en partie les trajets effectués
et, en tous cas, d’en assurer une relecture. C’est dire qu’un retraitement de l’expérience
vécue, lorsque sont archivées (entrées en mémoire) les étapes réalisées, devient accessible
tant à un enseignant qu’à un apprenant si ce type de contrat lui est proposé8.
Reste, bien évidemment, qu’on ne touche ainsi qu’une faible partie de la fréquentation du
réseau, mais une partie susceptible de devenir significative pour l’utilisateur, et
potentiellement modélisable. L’imprévisibilité est donc malgré tout relative, de ce point de
vue; elle devient, en revanche, essentielle si l’on considère la situation sous un angle plus
général.
L’histoire récente de la didactique - suite à une (re)découverte tardive - des travaux de
Vygotsky9 a placé au centre des préoccupations le concept de « zone proximale de
développement » comme fondement possible de la réflexion développée sur
l’apprentissage. L’essentiel se joue en effet, selon Vygotsky, dans l’anticipation de ce qui,
pour l’instant encore potentiel, oriente pourtant le développement à venir, le rôle de
l’enseignement étant précisément de jouer sur cette zone proximale afin de permettre à
l’apprenant de réussir en collaboration ce qu’il sera ensuite capable de réaliser seul.
Or, la confrontation avec l’outil informatique, la logique de l’écran, nous paraissent donner
au concept de zone proximale de développement un champ d’extension intéressant. La
délinéarisation des trajectoires d’apprentissage, telle qu’elle se manifeste dans un
environnement interactif informatisé, renforce la nécessité de travailler l’ensemble des
données au delà - et en deça - de l’étape où se situe le contexte immédiat de l’activité. Sans
projection vers un avenir de la tâche, il n’est guère de lecture possible de son utilité. C’est
dire, en d’autres termes, que l’exigence de sens, maximisée par l’« autonomisation »
rendue nécessaire par la fréquentation de ce type de support, prend, dans l’apprentissage,
la place qui aurait toujours dû être la sienne: celle de l’objet réel sur lequel travaille la
connaissance.
Les Technologies de l’Information et de la Communication ne représentent donc ni la
menace d’une décrédibilisation des stratégies enseignantes, ni la panacée propre à effacer
les dysfonctionnements du système éducatif. Outils elles sont, mais outils redoutables en
ce qu’elles se révèlent être telles dans un enjeu de connaissance, c’est-à-dire d’intégration
de l’objet du savoir par le sujet connaissant.
Jean-François Bourdet
Université du Maine
Bibliographie:
LEVY P. : Les technologies de l’intelligence, La Découverte, 1990.
LINARD M. : Des machines et des hommes, L’Harmattan, 1997.
PERRIAULT J. : La communication du savoir à distance, L’Harmattan,1996.

NAYMARK J. (coord.) : Guide du multimédia en formation, Retz, 1999.
« Multimédia et français langue étrangère » dans Les Cahiers de l’ASDIFLE, n° 9. 1998.
« Multimédia, réseaux et formation » dans Le Français dans le monde, n° spécial, juillet
1997.
1
/
5
100%