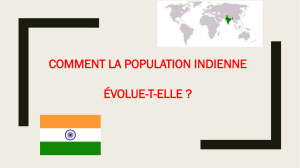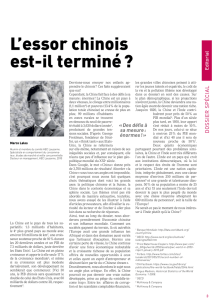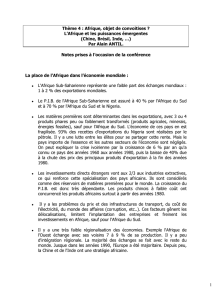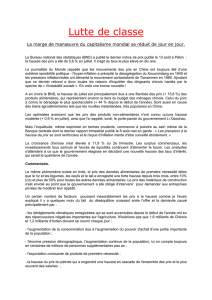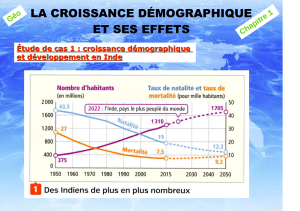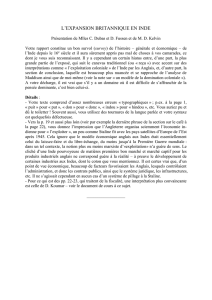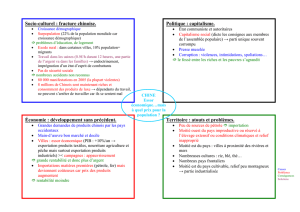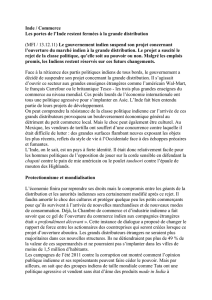ENA_435_pp41-43 Copy

dossier
41
/ octobre 2013 / n°435
Par Jean-Joseph Boillot
et Stanislas Dembinski
Coauteurs de Chindiafrique, la Chine, l’Inde
et l’Afrique feront le monde de demain1
Le front du refus d’une intervention
militaire en Syrie, au-delà de la Russie,
est passé par un nouveau triangle-clé des
relations internationales : Chindiafrique.
La Chine, l’Inde et la plupart des grands
pays africains, Afrique du Sud en tête, ont
vu d’un très mauvais œil une intervention
occidentale à Damas. Pour des raisons
différentes : la non ingérence dans les
affaires intérieures, chère à Pékin, ou plus
simplement la crainte d’un engrenage mal
maîtrisé pour Delhi ou l’Afrique du Sud,
soucieux de ne pas fragiliser leur croissance.
Un refus aussi pour des raisons communes :
les affaires du monde ne doivent plus se
régler sans leur donner droit au chapitre,
comme au temps des colonies ou de la
guerre froide. Nos trois géants veulent
reconquérir une puissance politique à
l’aune de leur poids démographique ou
économique croissant et ont les moyens de
le faire savoir, via un veto chinois au conseil
de sécurité de l’Onu ou au sein d’instances
comme le G20.
Pourtant, ce triangle Chindiafrique va
bien au-delà de simples convergences
géopolitiques du moment et ne se résume
pas non plus à une croissance élevée de
pays émergents, comme quand on parle des
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du
Sud). Il rebat les cartes plus profondément
dans les relations internationales parce qu’il
est déjà structuré et structurant dans cinq
domaines essentiels, complémentaires et
liés : démographie, économie, innovation,
ressources naturelles et politique.
Capital humain et poids
économique
Chindiafrique est d’abord une réalité dans un
aspect central du pouvoir démographique :
le capital humain. À l’horizon 2030, plus
de la moitié de l’humanité sera chinoise,
indienne ou africaine. La Chine, l’Inde
et l’Afrique pèseront chacun près d’un
milliard et demi d’habitants. Cet effet masse
intervient surtout dans des populations
structurées en puissantes diasporas, jeunes,
même en Chine, qui commence à peine à
connaître un phénomène de vieillissement
et de mieux en mieux éduquées. Le capital
humain de ce triangle, son stock éducatif,
est en effet en constante augmentation. Si
on multiplie le nombre moyen d’années
d’études par la population totale, selon la
méthode de Robert Barro, la Chine, l’Inde
mais surtout l’Afrique vont peser de plus
en plus à l’échelle mondiale en volume
et dépasser à terme l’Europe, le Japon et
même les États-Unis.
Au niveau qualitatif aussi, Chindiafrique
progresse. Les universités chinoises et
indiennes sont de plus en plus présentes
dans les classements internationaux comme
celui de Shanghai. Sans compter la grande
mobilité de ces étudiants chinois, indiens
et même africains investissant en masse
les grandes universités américaines, quand
ces dernières ne viennent pas directement
les chercher, en ouvrant des antennes
dans des pays africains, pour capter les
meilleurs éléments, dans la course mondiale
au savoir. En attendant que la politique
panafricaine d’universités comme celle
du Cap (UCT), en Afrique du Sud, porte
ses fruits.
Cet élément démographique est fondateur
car un des moteurs essentiels du deuxième
pilier du triangle Chindiafrique : son
poids économique grandissant, avec
des interactions de plus en plus fortes.
La Chine, d’abord, a profité pleinement
d’une formidable fenêtre d’opportunité
démographique, avec l’arrivée massive de
jeunes actifs qui ont alimenté son décollage
économique depuis les années 1980, avec
les fameuses décennies de croissance 1990
et 2000, à deux chiffres. Les réformes
Syrie, G20, innovations, Soft Power…
Chindiafrique redessine
les grands équilibres mondiaux
Les Occidentaux ont
découvert ces dernières
années la concurrence
chinoise et indienne sur
le continent africain.
Au même moment,
l’Afrique prend nettement
un essor économique
et politique qui en fait
un prétendant sur la carte
des géants du monde.
1 - Éditions Odile Jacob janvier 2013.

Géopolitique, Défense et Stratégie
dossier
42 / octobre 2013 / n°435
économiques de Deng Xiaoping visaient
d’abord à trouver des débouchés à l’ex-
portation pour ces nouveaux entrants
sur le marché, à qui il fallait donner du
travail, sous peine de créer les conditions
de nouvelles révolutions. L’Inde a suivi dans
ce chemin de l’ouverture, avec une fenêtre
d’opportunité démographique plus étalée et
moins grande, ce qui peut aussi expliquer
en partie des réformes économiques plus
graduelles depuis les années 1990 et une
croissance plus sage mais bien réelle.
La place de l’Afrique
L’Afrique, elle aussi, sans connaître un
décollage au sens strict, reste en phase
d’ébullition économique. Malgré ses
nombreux problèmes politiques et conflits,
dont la fréquence baisse cependant net-
tement depuis la décennie noire 1990,
le continent aux 53 pays, aux centaines
d’ethnies et aux frontières souvent dessinées
de manière arbitraire par la colonisation,
enregistre depuis 10 ans en moyenne 5 %
de croissance. Il devient une destination
de choix pour les grands fonds mondiaux
d’investissement. L’Afrique commence
pourtant globalement à peine à réunir les
conditions d’une fenêtre démographique
favorable mais timide : les jeunes actifs
augmentent en proportion de l’ensemble de
la population mais le poids des très jeunes
à charge reste élevé. Seulement voilà, le
parent pauvre de Chindiafrique bénéficie
aussi d’une dynamique unique au sein du
triangle : il agit comme un véritable aimant
avec ses deux grands partenaires chinois et
indien, à la fois terrain d’expérimentation
et d’influence, marché et fournisseur de
ressources naturelles.
L’Afrique est tout d’abord un formidable
marché et laboratoire pour les innovations
chinoises et indiennes qui, combinées
harmonieusement, permettent au continent
des sauts technologiques ful gurants.
L’innovation constitue ainsi le troisième
élément structurant du triangle Chindiafrique
pour déplacer les équilibres mondiaux. Qui
aurait imaginé que les téléphones chinois
(le hardware) bon marché combinés aux
logiciels (le software) indiens innovants,
aideraient l’Afrique en à peine une décennie
à devenir un eldorado des téléphones
portables, nettement plus nombreux
désormais qu’en Europe, avec toutes les
conséquences sur la mise en réseaux de
l’économie ? Il faut souligner qu’on ne
parle pas uniquement d’équipements mais
aussi des business models innovants qui
les accompagnent. Le mobile africain a
notamment décollé grâce aux business
models permettant de produire des mobiles
bon marché en masse (le taylorisme à la
chinoise des usines géantes de Shenzhen)
ou de vendre des minutes de communication
bon marché (la méthode d’un opérateur
indien comme Bharti consiste à partager le
gisement de sa clientèle au plus vite avec
des partenaires-fournisseurs étrangers,
plutôt que de perdre du temps à les
concurrencer dans leur domaine, selon la
méthode de « l’externalisation inversée »).
Nécessité fait loi pour intégrer les plus
pauvres dans les circuits de consommation,
en leur permettant par exemple d’utiliser
leur mobile comme un mini-compte en
banque et de réaliser des opérations simples
(virement, retrait…) auprès du commerçant
d’un village reculé africain. L’Inde et la
Chine apportent leur expérience dans ces
innovations frugales mais pas forcément de
mauvaise qualité, comme la télémédecine
indienne qui s’adresse au fameux « bas de
la pyramide » des consommateurs pauvres
mais nombreux et solvables.
L’Afrique est ensuite, bien sûr, un grand
fournisseur de ressources naturelles au
sein de Chindiafrique. La redistribution des
cartes mondiales opère une
nouvelle fois à plein dans
ce quatrième terrain de
jeu, les matières premières.
En témoignent les critiques
de la « Chinafrique », qui
serait un nouvel exemple
de néocolonialisme, après
la « Françafrique ». Mais
là encore, ne nous mépre-
nons pas. Ces critiques sont
fondées, notamment quand
Pékin achète à bas prix des
concessions à long terme de
mines en Afrique, contre la
fourniture, en grande partie
par des équipes chinoises,
d’infrastructures gigantesques, à la qualité
pas toujours à la hauteur. Mais la Chine ou
l’Inde gagnent justement du terrain dans ce
domaine car ils apportent des éléments de
coopération nouveaux et nécessaires aux
pays africains, à travers notamment des
fournitures clés en mains, du financement à
l’exploitation, d’une usine ou d’un bâtiment
que personne n’avait financé auparavant.
Les satellites météorologiques de l’agence
spatiale indienne Isro sont, dans un autre
registre, bien utiles pour améliorer les
récoltes de certains pays africains.
Les atouts européens
L’ouverture du jeu géostratégique doit en
réalité inciter les Européens et notamment
les Français à prendre pleinement en
compte ce triangle Chindiafrique, plutôt
qu’en critiquer la dynamique de manière
stérile. Sur tous les plans, les Européens
ont de bonnes cartes en main, à condition
d’accepter la nouvelle donne mondiale
dont Chindiafrique est l’exemple le plus
structurant.
L’Union européenne vieillissante a par
exemple tout intérêt à utiliser au mieux les
ressources démographiques d’un bassin
euro-africain dynamique, en permettant à
davantage d’Africains de venir étudier et
travailler en Europe, pour revenir ensuite, au
gré des besoins au pays, dans une logique
de « Brain gain » (retour des cerveaux)
plutôt que de « Brain drain » (fuite des
cerveaux). Sur le plan de l’économie
et de l’innovation, l’Europe doit aussi
s’inspirer des business models de nos trois
géants pour mieux conquérir les marchés
émergents et, pourquoi pas, les réimporter
en Europe quand cela fait
sens. En combinant par
exemple panneaux solaires
et éoliennes pour alimenter
des antennes relais de télé-
phonie mobile dans certaines
régions reculées, à l’instar
d’un partenariat sino-indien
en Afrique. Cette approche
dynamique et adaptée
aux spécificités locales est
parfaitement possible quand
on songe à la politique à
succès d’im plantation et de
R&D du français Orange sur
le continent africain.
Les Européens peuvent
enfin faire valoir leur modèle de concertation
politique, fondé sur la recherche de
consensus démocratique. Malgré ses
lenteurs et ses lacunes dans la construction
d’une entité politique intégrée, il reste
attractif pour un État démocratique
également imparfait comme l’Inde ou

dossier
43
/ octobre 2013 / n°435
pour une Union africaine qui se cherche
encore. Chindiafrique doit ainsi inciter
l’Europe à affirmer calmement mais plus
fermement son influence,
à travers des outils
indispensables de « Hard
power » comme des forces
militaires d’intervention
plus intégrées, en cas de
besoin pour un mandat
de l’Onu par exemple,
et des outils satellites
militaires communs.
Dans le domaine du « Soft
Power », c’est à l’échelle
européenne également
que doit s’envisager l’influence, notamment
via un réseau d’instituts culturels européens
mutualisant les ressources nationales, via
des structures ombrelles, pour faire face
par exemple à la déferlante des instituts
chinois Confucius en Afrique. La guerre des
bourses d’études et des cours de langues
n’est pas anodine à l’heure
où l’Afrique va fournir
les gros bataillons de la
francophonie.
L’Europe a d’autant moins
de complexes à avoir que,
sur le plan politique,
comme l’a montré l’affaire
syrienne, Chindiafrique ne
parle d’une seule voix que
dans son rejet d’un ordre
mondial qui serait dominé
par certains Occidentaux.
Il en est de même au G20 ou au FMI, où
elle réclame une meilleure représentation.
Pour le reste, les rivalités au sein de
Chindia, Delhi craignant en particulier
une politique d’encerclement géostratégique
menée par Pékin, restent vives. Et les
pays africains essayent de jouer la carte
chinoise et indienne en même temps, selon
leurs intérêts. Pour peu qu’ils acceptent
d’accueillir pleinement les autres joueurs à
la table, les Européens peuvent donc encore
faire valoir leurs atouts, en acceptant de
changer d’équipiers et de stratégie au gré
de parties sans cesse mouvantes. ■
Les Européens
peuvent donc encore
faire valoir leurs
atouts, en acceptant
de changer d’équipiers
et de stratégie au gré
de parties sans cesse
mouvantes
1
/
3
100%