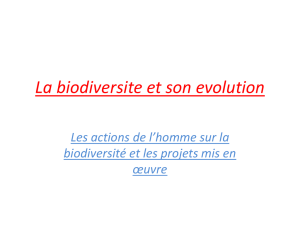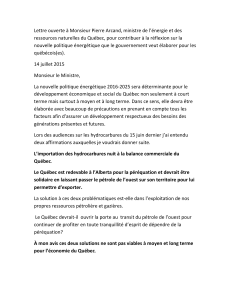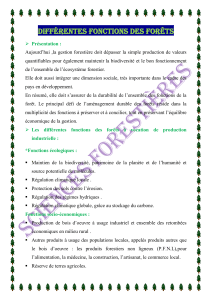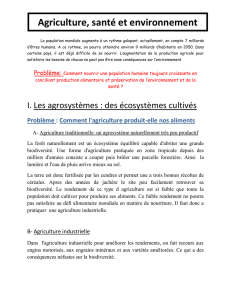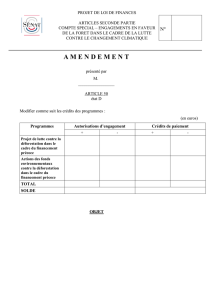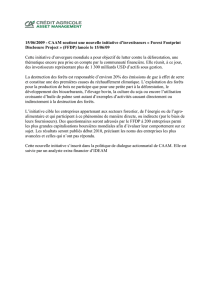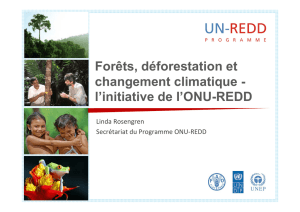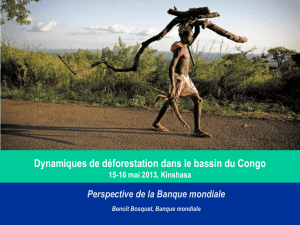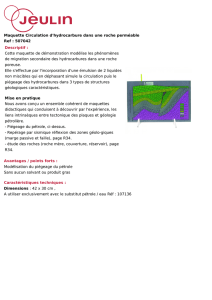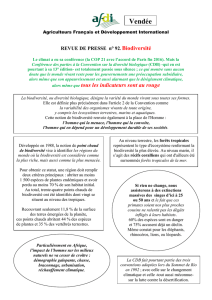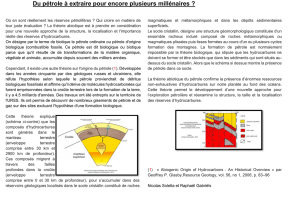Le retour de la rareté

Le retour de la rareté
Evolution de la surface de forêts
Exploitation des stocks de poissons (en % du stock total) et
évolution depuis 1992 (en %)
La crise économique déclenchée en 2007 peut
aussi s'analyser comme une crise de la rareté des
ressources naturelles. La croissance économique
soutenue des années précédentes avait en effet
conduit à une hausse du prix des denrées agricoles
et du pétrole, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des
ménages américains accédant à la propriété, et
devenant de ce fait incapables de rembourser leur
crédit. C'était le début de la crise des subprime.
Depuis, chaque tentative de relance de la
croissance se heurte au renchérissement des
matières premières. Un New Deal sur le modèle
rooseveltien, pour être durable, est donc condamné
à intégrer des éléments de conversion écologique
de l'appareil productif.
La croissance des Trente Glorieuses s'est faite à
crédit, basée sur des ressources non renouvelables
comme le charbon et le pétrole. Quand des milliards
d'êtres humains supplémentaires se lancent à leur tour dans la course au développement, la Terre
s'emballe, le prix des matières premières s'envole, les terres agricoles se font rares et les
dégradations de l'environnement s'amplifient, parfois irrémédiablement.
Evolution de la surface agricole mondiale entre 1961 et 2009
Une déforestation galopante
L'île de Pâques, si l'on en croit le géographe Jared
Diamond (voir encadré), s'est dépeuplée à partir du
XVIIe siècle en raison d'une déforestation totale.
Nous n'en sommes pas là à l'échelle planétaire,
mais la pente suivie est alarmante. La déforestation
continue, menaçant la survie de 1,6 milliard de
personnes qui en dépendent, la régulation des
précipitations, la biodiversité et des puits de carbone
précieux pour la lutte contre le réchauffement
climatique. 300 millions d'hectares de forêts
primaires sont partis en fumée depuis 1990, soit
l'équivalent de la surface de l'Argentine, d'après
l'Organisation mondiale pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO).
1

Estimation du nombre d'années de production des hydrocarbures
exploités au rythme actuel
La déforestation des forêts primaires est la plus criante
en Amazonie, dans le bassin du Congo et en
Indonésie. Le rythme de déforestation décroît en
Amazonie mais reste inquiétant, tant l'élevage et
l'exploitation minière continuent de grignoter le poumon
de la planète. En Indonésie, sous l'effet de la pression
démographique, du développement de la culture des
palmiers à huile et de l'exploitation illégale du bois pour
la pâte à papier, les forêts primaires ne sont souvent
plus qu'un souvenir. D'après le Programme des Nations
unies pour l'environnement (Pnue), près de la moitié de
la forêt de Sumatra a disparu entre 1985 et 2007. Le
reboisement à grande échelle de la Chine permet
toutefois d'afficher pour l'Asie un bilan du couvert forestier en progression.
Le bassin du Congo a mieux résisté, mais les réglementations plus strictes qu'autrefois sont
contournées par une corruption endémique et une maîtrise étatique très incertaine, si bien que la
tendance aux coupes sauvages est très inquiétante. Le tableau est sombre, mais les pays du Nord,
après avoir mis leurs forêts en coupe réglée pendant longtemps, ont réussi, au cours du XXe siècle,
à inverser la tendance. Ils montrent que le destin de l'île de Pâques n'est pas une fatalité.
Emissions de CO2 générées par la combustion de l'énergie et la
production de ciment
La biodiversité et l'eau en danger
L'érosion de la biodiversité est un péril écologique peu
spectaculaire. Pourtant, la dégradation rapide de la
diversité des espèces menace nos conditions de vie.
La biodiversité - autrement dit l'existence de milliers
d'espèces vivantes, animales ou végétales, et les
interactions entre elles dans différents écosystèmes -
rend pourtant d'inestimables services : dépollution de l'eau, fertilisation des sols, pollinisation des
cultures, régulation du climat, résistance des systèmes agricoles aux caprices du temps,
pharmacopée, ressources génétiques pour les biotechnologies, sans oublier la valeur culturelle et
récréative de la diversité des paysages.
Alors que, selon les scientifiques, une espèce sur 50 000 s'éteint "naturellement" chaque siècle, ce
rythme s'est emballé sous les effets de l'action humaine : il pourrait être 100 à 1 000 fois supérieur en
2050. L'indice planète vivante du WWF (Fonds mondial pour la nature), indicateur synthétique de
l'évolution de la biodiversité animale à partir du suivi de milliers d'espèces, a baissé de 30 % depuis
1970 au niveau planétaire, avec un déclin encore plus marqué dans les zones tropicales ou les eaux
douces.
La destruction des espèces résulte de leur prédation directe par l'homme ou de la dégradation de
leur habitat naturel. La richesse des milieux aquatiques est ainsi menacée à court terme, notamment
par la surpêche. Les prélèvements de poissons sont en effet passés de 13 millions de tonnes en
1950 à 70 millions aujourd'hui. Facteur aggravant : la raréfaction des stocks pousse les pêcheurs à
accroître la taille de leurs navires, à racler les fonds marins et à pêcher toutes les espèces sans
distinction. Si bien que plus de 80 % des stocks de poissons dans le monde seraient aujourd'hui à la
limite de la surexploitation, surexploités ou épuisés.
2

Quant aux nappes phréatiques et aux cours d'eau, ils sont affectés par les rejets d'eaux usées,
domestiques ou industrielles, et par les pollutions d'origine agricole, sous la forme des nitrates issus
des déjections animales ou du phosphore des engrais. Le manque d'eau potable dans les pays en
développement est un drame sanitaire pour des centaines de millions de personnes, qui souffrent de
maladies gastro-intestinales faute de sanitaires ou de stations d'épuration, en particulier dans les
bidonvilles en pleine expansion. De plus, les conflits pour l'eau se durcissent entre des populations
en croissance et une agriculture très consommatrice. Le secteur agricole ponctionne 84 % de l'eau
douce en Afrique, 88 % en Asie du Sud et 81 % en Asie du Sud-Est et en Océanie. Rien n'indique
qu'il saura limiter cette part : si l'on ne tourne pas le dos au productivisme agricole et à l'irrigation à
outrance, nourrir la planète en 2050 nécessitera deux fois plus d'eau qu'aujourd'hui. Ce qui est
rigoureusement impossible.
Raréfaction des matières premières, épuisement des ressources
naturelles, dégradation de l'environnement…, tout confirme la
disparition d'une société de l'abondance infinie.
Malthus passe à table
On a longtemps cru que les sombres prévisions de
Thomas Malthus (1766-1834) ne se vérifieraient pas et
que les progrès de la productivité agricole devanceraient
toujours ceux de la démographie.
Il est temps de déchanter.
Un peu partout dans le monde, les agriculteurs les plus
modernes butent désormais sur un palier de productivité
impossible à dépasser. Après une période d'amélioration
des rendements, les intrants (*) naturels ou chimiques
deviennent contre-productifs.
La standardisation des cultures et des écosystèmes,
l'usage des pesticides, herbicides et engrais chimiques et
la répétition des récoltes sur une même terre sans
assolement (*) appauvrissent les sols et produisent des
phénomènes d'érosion et de baisse de fertilité. Ils
menacent également la survie d'insectes pollinisateurs, comme les abeilles ou les bourdons. Pour la
santé humaine enfin, l'utilisation de produits chimiques de synthèse aboutit à disperser dans
l'environnement et les aliments des molécules cancérogènes ou des perturbateurs pour les systèmes
nerveux, immunitaires ou endocriniens.
Produire des aliments sains pour davantage de monde à partir de terres agricoles moins fertiles,
cette équation déjà difficile deviendra impossible si davantage d'humains adoptent le régime
alimentaire carné des pays occidentaux. De 34 kg de viande par an et par personne en 1992, la
consommation moyenne mondiale de viande est passée à 43 kg aujourd'hui, d'après le Pnue. Or,
produire une protéine animale nécessite beaucoup plus de terres, d'eau, d'engrais et de travail que la
production d'une protéine végétale. D'après la FAO, il faut entre 3 kg et 10 kg de protéines végétales
pour nourrir le bétail et produire en bout de chaîne un seul kilo de protéines animales.
Mais pour nourrir l'humanité, il faut avant tout des terres. Or, elles sont l'objet d'une compétition de
plus en plus féroce pour des usages en concurrence, que l'on résume souvent en anglais par 4F :
food, pour nourrir les humains, feed, pour nourrir le bétail, forest, pour conserver les forêts et les
puits de carbone, et fuel, pour produire de l'énergie à base d'agrocarburants. Développer au rythme
actuel les fonctions de feed et de fuel se fera nécessairement au détriment des deux autres
3

4
Trois scénarios catastrophe
L'effondrement
Biologiste de formation, Jared Diamond est aussi historien comparatiste et militant écologiste ; il
a dirigé le WWF (le Fonds mondial pour la nature) aux Etats-Unis. Dans un livre qui a fait
sensation lors de sa parution en 2003, Effondrement, il décrit les différents scénarios qui ont
conduit certaines sociétés jadis prospères, comme les Mayas, les habitants de l'île de Pâques ou
les Vikings du Groenland à s'effondrer plus ou moins brutalement.
A chaque fois, le facteur écologique intervient parmi les différents facteurs en interaction.
Diamond énumère huit processus "par lesquels les sociétés anciennes ont causé leur propre
perte en endommageant leur environnement" : la déforestation, l'érosion des sols, la gestion de
l'eau, la pêche et la chasse excessives, l'introduction d'espèces allogènes, la croissance
démographique et l'augmentation de l'impact humain par habitant.
Jared Diamond ne prédit pas la disparition de notre civilisation, tant le contexte a profondément
changé. Il n'existe quasiment plus aucune société déconnectée du reste de l'humanité, ce qui
réduit les risques de déclin brusque et solitaire d'une communauté. De plus, la connaissance de
nos écosystèmes et des leçons de l'histoire a progressé depuis le temps des Mayas. Ces
progrès ont cependant leur revers : l'interconnexion des sociétés est un facteur de propagation
des menaces (guerres, maladies, climat…) et les avancées techniques sont aussi synonymes de
capacités de destruction accrues.
La rupture radicale
Plutôt qu'un effondrement spectaculaire, des scientifiques de Vancouver, coauteurs d'une étude
publiée en juin 2012 dans la revue Nature, prédisent une autre forme de déclin : le
franchissement silencieux et irrémédiable de seuils dans l'érosion de la biodiversité au cours de
ce siècle. Au-delà de ces seuils, dont on ne sait pas précisément à quel niveau ils se situent, il
serait impossible de revenir sur la dégradation de l'environnement, de régénérer les stocks de
poissons et de refabriquer des espèces disparues ou des interactions naturelles infiniment
complexes entre un environnement et les espèces qui l'habitent. Ce basculement vers un nouvel
état inconnu serait comparable à l'extinction des dinosaures ou à la fin de l'ère glaciaire.
L'anéantissement
Si ce type d'affaiblissement est probable, un effondrement brutal de l'espèce humaine n'est pas
non plus à exclure. Les principaux dirigeants des puissances nucléaires ont en effet la possibilité
de raser plusieurs fois toute civilisation de la surface terrestre. La fragmentation de la scène
internationale, la miniaturisation et la dissémination de ce type d'armes multiplient les risques de
dérapage fatal, sans parler des accidents nucléaires. Les générations futures verront-elles dans
le sarcophage de Tchernobyl ou les ruines de Fukushima les lointains successeurs des vestiges
de l'île de Pâques ?
Pour surmonter ce défi et satisfaire une demande croissante, l'industrie extractive mondiale est
amenée à dépenser toujours davantage pour découvrir de nouveaux gisements plus difficiles
d'accès, contenant des minerais de moins en moins concentrés en métaux, demandant donc
davantage d'énergie. A court ou moyen terme, la rareté des métaux et des hydrocarbures se
rappellera à nous, sous la forme de hausse des prix ou de pénurie.

fonctions, pourtant vitales pour nourrir demain 10 milliards d'êtres humains et préserver le climat et la
biodiversité. D'ores et déjà, la surface totale des terres agricoles disponibles sur Terre stagne depuis
1991 et est même repassée sous les 1,4 milliard d'hectares.
Du "peak oil" au "peak all"
L'humanité brûle trop d'hydrocarbures. Pour se chauffer, se déplacer, produire, on consomme
toujours plus de pétrole, de charbon et de gaz, qui sont pourtant des énergies non renouvelables.
Des réserves constituées au cours de millions d'années sont ainsi gaspillées en quelques
générations. D'après l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Ifpen), le pic de
production de pétrole (le peak oil) sera atteint entre 2015 et 2025, entre 2025 et 2045 pour le gaz, et
en 2100 pour le charbon. Au-delà, la production de ces matières premières aurait tendance à chuter
irrémédiablement jusqu'à l'extinction des réserves accessibles.
D'autres ressources se raréfient inexorablement. Le cuivre, l'or, l'argent, le zinc, les terres rares (*) ,
l'uranium, les phosphates… ne pourront pas être extraits en quantités toujours croissantes. A tel
point que l'on ne parle plus seulement du peakoil (le pic de pétrole), mais aussi du peak all (le pic de
tout).
Par exemple, la disponibilité de l'uranium constitue une limite physique au développement de
l'énergie nucléaire, civile ou militaire. Présent dans une poignée de pays, comme l'Australie, le
Kazakhstan, la Russie ou le Niger, l'uranium s'épuiserait au bout de quelques décennies à peine si le
nucléaire se répandait au rythme annoncé il y a seulement quelques années. L'accident de
Fukushima, en rappelant les risques de cette énergie et en freinant nombre de projets, a sans doute
retardé de quelques années l'extinction du minerai. De même, l'économie dite immatérielle est
inenvisageable sans coltan pour produire des téléphones portables, ou sans terres rares pour nos
écrans plats. Même les énergies renouvelables ont besoin de ce groupe de minerais aux
particularités exceptionnelles, par exemple pour fabriquer les aimants des moteurs et des turbines
des éoliennes.
Le climat n'attend pas
La perspective d'un déclin du niveau de production des hydrocarbures arrive à grands pas, mais elle
se rapproche encore trop lentement pour sauver le climat. Depuis le premier rapport, en 1990, du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), le constat est connu : les
émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique (production d'énergie, déforestation…)
réchauffent l'atmosphère. Les températures auraient déjà augmenté de 0,74 °C depuis un siècle,
mais le pire est à venir. Si l'humanité ne parvient pas à diminuer ses émissions à partir de 2020, pour
les réduire de 50 % en 2050 par rapport à 1990, l'atmosphère se réchauffera de plus de 2 °C à
l'horizon 2100. D'après les dernières projections, on se dirigerait même plutôt vers une hausse de 4
°C, sinon plus. Les plus gros émetteurs historiques, comme les Etats-Unis, et les nouveaux, au
premier titre la Chine - devenue le premier émetteur au milieu des années 2000 - se renvoient la
responsabilité de l'échec chronique des négociations climatiques.
Le renchérissement du prix du baril de pétrole, au lieu d'inciter à économiser cette ressource,
entraîne la prospection d'hydrocarbures encore plus polluants, qu'il s'agisse du charbon, en plein
boom en Chine, d'hydrocarbures "non conventionnels" comme les sables bitumineux et le gaz et
l'huile de schiste sur le continent américain, ou de pétroles plus difficilement accessibles comme le
pétrole offshore au large du Brésil ou près du cercle polaire arctique.
Certes, chaque pays modère l'intensité énergétique de son produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire la
quantité d'énergie nécessaire pour produire une quantité de richesse donnée. Mais, d'une part, la
forte croissance économique des pays émergents annule ces gains énergétiques et, d'autre part, la
production mondiale se déplace de plus en plus vers les émergents, dont la production est moins
5
 6
6
1
/
6
100%