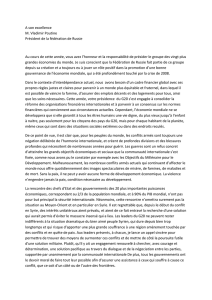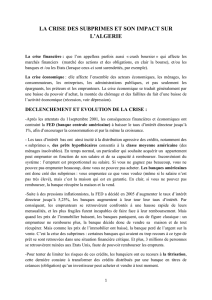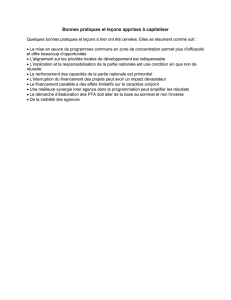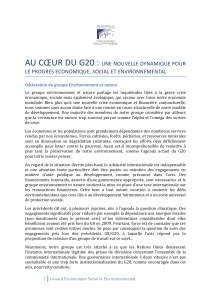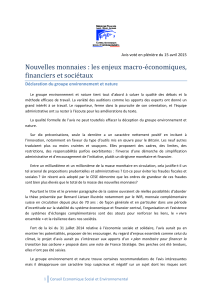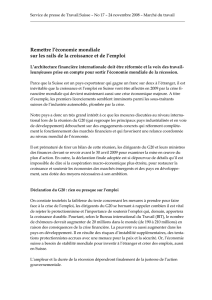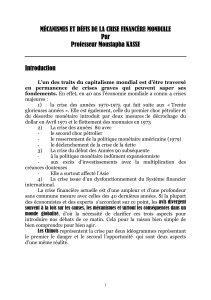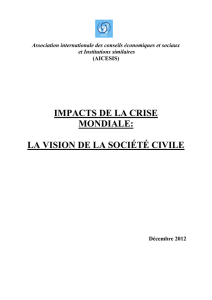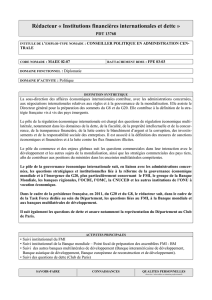Les premières leçons de la crise

Lionel Jospin au Cérium
Les premières leçons de la crise
À l’occasion du 5e anniversaire du Cérium, M. Lionel Jospin, ancien premier ministre
français, a prononcé une allocution sur les premières leçons de la crise financière et
économique.
LES PREMIÈRES LEÇONS DE LA CRISE
Je remercie l’Université de Montréal de m’avoir invité à participer au 5ème anniversaire
de son Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et de m’avoir convié à
m’exprimer devant vous par une conférence.
Le thème choisi pour mon intervention, qui sera suivie d’un débat, est celui-ci : « Les
premières leçons de la crise ».
La crise financière et économique qui nous frappe depuis 2008 n’est pas la première crise
globale du système économique. Mais elle est la première qui soit véritablement
mondiale. En effet, depuis les années Trente, voire depuis les chocs pétroliers des années
soixante-dix, le nombre des grands acteurs économiques s’est accru et l’unification du
globe par la communication et les marchés fait qu’aucune zone de la planète n’est
épargnée par la tempête.
Pour tirer des leçons de la crise et apprécier les réactions des gouvernements face à elle
(en particulier après le sommet économique dit G20 du 2 avril à Londres), il importe de
bien comprendre la nature de l’ébranlement qui nous touche. C’est pourquoi je
commencerai par la mesure du choc.

I – Nous sommes face à une crise d’ensemble du système économique
1 - Cette crise est d’abord financière.
Depuis l’effondrement de l’économie planifiée et la dislocation de l’URSS, malgré la
particularité du régime chinois et en dépit des aménagements profonds apportés par les
social-démocraties, on peut dire que l’essentiel du système économique mondial relève
du capitalisme. Or, assez logiquement, les crises du capitalisme commencent presque
toujours par une crise du capital.
Celle-ci est, fondamentalement, une crise d’endettement. Dans ce qu’on appelle
« l’économie réelle », celle de la production et de l’échange des biens et services, le
mécanisme des prix ajuste, normalement, l’offre et la demande. Quand les prix
augmentent, la demande baisse. Dans la sphère financière, le mécanisme joue à l’inverse.
Quand les prix des actifs financiers s’élèvent, ils sont réclamés davantage, dans
l’espérance de gains accrus. Ainsi, le système ne se régule pas lui-même. Il est entraîné
par un mouvement de spéculation à la hausse qui, un jour, butte sur une crise de
confiance, et se retourne.
L’explication la plus fréquemment avancée pour la crise financière actuelle est celle des
dérèglements, des dysfonctionnements du système. Ils existent, indiscutablement. Il y a
les errements des fonds spéculatifs (hedge funds) non réglementés ; les dérives offertes
par des paradis fiscaux opaques et non contrôlés ; la négation, la dissimulation et la
dissémination du risque, alors que celui-ci est inhérent à la fonction de prêteur ou
d’emprunteur ; la construction de montages financiers si complexes (l’outil mathématique
aidant) que leurs conséquences échappent à leurs auteurs mêmes. À cela se sont ajoutés
les rémunérations excessives, l’appât du gain et l’imprudence des acteurs financiers ; le
manque de vigilance des banques, des agences de notation et des autorités de contrôle ;

et, pour couronner le tout, la passivité des Banques centrales et des Etats. Chacun a sa
part de responsabilité dans les dysfonctionnements.
Mais en vérité, si on va au fond des choses, c’est le système économique et financier
lui-même qui est déséquilibré. Depuis trente ans, on a laissé se creuser un écart
extravagant entre la sphère financière et l’économie réelle (celle des biens et services). La
première est en effet aujourd’hui cinquante fois supérieure à la seconde.
En 2005, les marchés boursiers proprement dits atteignaient un montant plus élevé que le
PIB mondial : 51 Tera dollars (51 mille milliards de dollars) contre 44 Tera dollars.
Les transactions sur les marchés des changes, liées aux fluctuations des parités
monétaires et ayant pour objet non seulement les couvertures à terme mais aussi la
spéculation sur les monnaies, étaient plus de dix fois supérieures (avec 566 Tera dollars)
au PIB mondial.
Les transactions sur les produits dérivés, liées aux variations des taux d’intérêt, aux cours
de bourse, aux crédits immobiliers (dont aux Etats-Unis les fameux subprimes) mais
aussi désormais à des spéculations sur les prix des matières premières ou sur les cours du
pétrole et du gaz, excédaient de trente fois, avec 1.406 Tera dollars, le PIB mondial.
Pourquoi cet écart insensé et périlleux ? D’abord, parce que depuis 1971 et la suppression
par les Etats-Unis (sous le Président Nixon) de la convertibilité du dollar en or, le monde
a renoncé aux parités fixes, les taux de change sont déréglementés et fluctuent, et la
valeur des monnaies varie (sauf entre les monnaies européennes rattachées à l’Euro,
même si celui-ci bouge par rapport aux autres monnaies). Ensuite, parce que, depuis les
années 1980, les taux d’intérêt ont été déréglementés et sont eux aussi instables.
Pour faire face à cette double instabilité, s’est développée une industrie financière
globalisée qui, en se réclamant de « l’innovation financière », a proposé des produits de
couverture permettant notamment aux entreprises de s’assurer contre les variations de
prix (des taux de change et des taux d’intérêt). En somme, on a libéralisé les prix pour se
protéger ensuite contre leurs variations ! En est résultée une explosion folle de la sphère
financière, car de la couverture à terme on est passé bien sûr à la spéculation, le risque
étant transféré, selon des chaînes longues et complexes, à des spéculateurs qui en jouent.
C’est au cœur de cette logique folle qu’a surgi la crise des subprimes : des créances
immobilières américaines accordées imprudemment à des ménages fragilisés. Ces
subprimes ont pris leur source dans les produits dérivés de crédits, liés au surendettement
massif des ménages américains.
Les alertes à propos des déséquilibres du système n’avaient pourtant pas manqué. Les
crises, mexicaine en 1994, japonaise en 1995, asiatique en 1997 et 98, russe en 1998,
brésilienne en 1999 et argentine en 2001 avaient montré que le système financier était
fragile. En 1998, mon gouvernement avait alerté sur les risques encourus et fait des
propositions de réformes. Peu d’entre elles ont été retenues. Et, dans le climat de

déréglementation et de dérégulation qui imprégnait les milieux économiques et politiques
de l’époque, le monde financier a continué à tourner comme il l’entendait, en dédaignant
le risque et en se dérobant au contrôle. Quant à ces crises localisées, elles n’étaient pas
tenues pour alarmantes, en dépit de leur ampleur, parce qu’elles survenaient à la
périphérie du système et dans des pays jugés vulnérables.
Le monde s’est réveillé en 2008 avec une crise violente, qui surgissait cette fois au cœur
même de l’empire financier, à Wall Street, dans la première économie de la planète.
Rapidement, il a été clair que la tempête qui emportait ou menaçait les plus grands
établissements de la Place pouvaient conduire l’ensemble du système à la banqueroute.
D’où l’intervention massive des Banques centrales et des Etats. Et si celle-ci a stoppé la
panique, il est trop tôt pour affirmer que la crise financière est finie. Il faudrait pour cela
être certain que le système est assaini. Ce qui n’est pas le cas.
2 – Depuis, la crise est devenue économique, et donc sociale. En explosant, la bulle
financière a projeté ses éclats sur la sphère productive et sur le monde des échanges. Le
Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique et nos instituts statistiques nationaux s’accordent tous,
malgré quelques écarts, sur le même diagnostic : avec une chute du PIB global de près de
3 points d’une année sur l’autre et une croissance mondiale en 2009 à peine supérieure à
zéro, nous connaissons la plus grave crise économique depuis les années Trente.
La récession touche particulièrement les Etats-Unis, au centre du séisme, et les pays
développés qui ont laissé prospérer sans frein le capitalisme financier.
Mais le ralentissement n’épargne pas les pays émergents et notamment la Chine, si
dépendante de ses exportations et qui place aux Etats-Unis une bonne part de ses
ressources en devises. Or, en Chine, une croissance économique ramenée à 6 % peut
avoir des répercussions sociales plus brutales que si la récession atteint -3 % en France,
où la situation sociale est pourtant déjà tendue.

Quant aux pays en développement, ils seront durement frappés par la baisse des prix des
matières premières, par les retraits de capitaux privés et par une éventuelle réduction de
l’aide publique au développement.
Ce passage de la crise financière à la sphère économique était en tout cas inévitable. Il y a
eu d’abord l’impact mécanique de la tourmente. Celle-ci a entraîné de très lourdes pertes
de valeurs que le FMI, dans sa dernière estimation —à mon avis modeste— a évalué à
1.500 milliards de dollars. De plus, les banques et autres établissements de crédit, frappés
directement ou ébranlés dans leur confiance, ont rapidement restreint les transactions
interbancaires et les prêts aux entreprises et aux particuliers, opérant ce qu’on a appelé un
« credit crunch ». Du coup, l’activité économique s’est rétractée, provoquant une
multiplication des faillites et des vagues de licenciements. Les secteurs de la construction
et du logement ont subi de plein fouet le marasme de l’immobilier lié à la crise des
subprimes. La consommation a fléchi à cause des situations d’insolvabilité et en raison de
l’épargne de précaution inspirée par la peur du chômage et le climat d’instabilité. Car la
progression de la crise a naturellement engendré une perte de confiance chez tous les
acteurs de la vie économique, laquelle est alors entrée dans une spirale descendante.
Or l’économie était déjà déséquilibrée par sa financiarisation. Au cours des trente
dernières années, la sphère financière a progressivement imposé sa loi à la sphère
productive.
Pour assurer des revenus considérables aux actionnaires et aux acteurs financiers —avec
ces gratifications dont des exemples spectaculaires et scandaleux nous sont offerts
régulièrement par la presse de nos pays— il a été réclamé aux entreprises des taux de
rentabilité et des marges de profit déraisonnables par rapport aux normes anciennes :
souvent de l’ordre de 20 % ou plus. En conséquence, beaucoup d’entreprises ont orienté
leur gestion vers le très court terme (et la recherche du profit maximum), ont opéré des
délocalisations (vers les pays à faible coût de main d’œuvre), ont liquidé des
établissements jugés peu rentables (selon les nouvelles normes) et recherché à comprimer
leur masse salariale.
Cette évolution que les gouvernements ont —selon les cas— encouragée, tolérée ou
négligée, a créé un déséquilibre excessif dans la répartition des revenus entre le capital et
le travail —au détriment du second bien sûr— qui, outre son caractère injuste et ses
implications sociales, a entraîné une insuffisance de la consommation et de la demande.
Et c’est justement pour modérer l’impact sur l’activité économique de l’austérité salariale
—impact inévitable dans des pays comme les nôtres où les salariés représentent plus de
80 % de la population active— qu’on a recouru à l’expédient de l’endettement. Aux
Etats-Unis, les autorités monétaires (la FED), financières (les banques, les compagnies
d’assurances, les sociétés hypothécaires), politiques (l’Administration Bush) ont
systématiquement poussé les couches moyennes et populaires à s’endetter, même
inconsidérément, par exemple pour acheter leur logement. Il est donc logique que tout ait
commencé aux Etats-Unis par la crise des subprimes. Il est cohérent aussi que les pays les
plus touchés soient ceux qui ont joué le plus de la déréglementation financière (Grande-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%