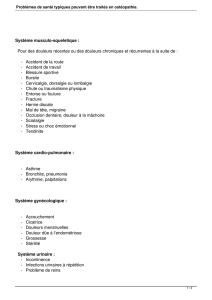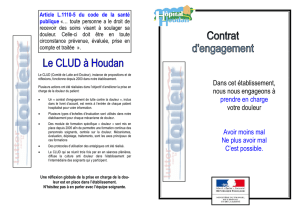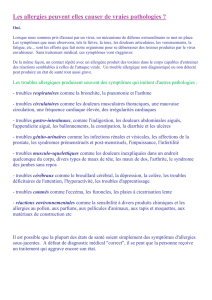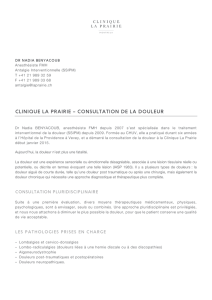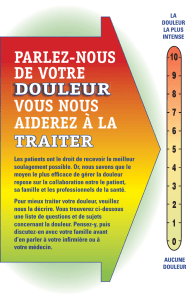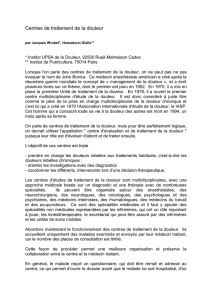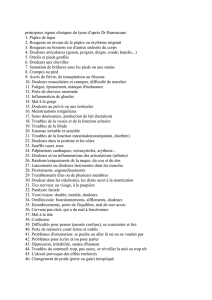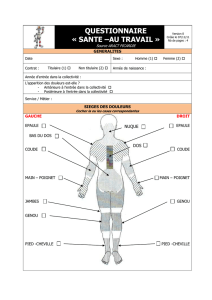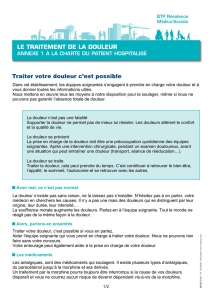Prise en charge après chirurgie cardiaque des douleurs aiguës

Mini-revue
Prise en charge après chirurgie cardiaque
des douleurs aiguës, persistantes et chroniques
Stéphane Donnadieu
Unité d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015 Paris
La majorité des interventions de chirurgie cardiaque se prati-
quent par sternotomie ou thoracotomie. Ces incisions, la mise
en tension des structures ostéoarticulaires en regard, la pré-
sence de drains sont à l’origine de la douleur aiguë postopéra-
toire contrôlée par des antalgiques morphiniques en autoadmi-
nistration, parfois associés à des anesthésies locorégionales
thoraciques. La persistance des douleurs au-delà du 5
e
jour
amène à envisager une complication locale ou générale, mais
les plus fréquentes sont les douleurs de la ceinture scapulaire en
association avec des douleurs myofasciales. La rééducation
associée à des infiltrations locales en est le traitement principal.
Les douleurs chroniques, évoluant depuis plus de 3 mois, tou-
chent environ 15 % des opérés. Elles sont essentiellement d’ori-
gine neuropathique par lésion d’un nerf intercostal lors d’une
thoracotomie ou de la confection d’un greffon avec l’artère
mammaire interne. Elles entraînent un retentissement émotion-
nel et comportemental important, nécessitant pour leur soulage-
ment des traitements par anticonvulsivants et antidépresseurs,
une psychothérapie et un projet de réinsertion sociale. Une
antalgie postopératoire efficace, des voies d’abord chirurgical
plus limitées, le dépistage des personnalités à risque sont
actuellement les moyens de prévention reconnus des douleurs
chroniques.
Mots clés :chirurgie cardiaque, douleur aiguë, douleur chronique,
antalgie
Les douleurs postopératoires se rangent en trois catégories selon leur
durée :
–les douleurs aiguës postopératoires précoces de décroissance rapide, dépas-
sant rarement les 5 premiers jours. Leur mécanisme est essentiellement noci-
ceptif, lié à l’abord chirurgical,
–les douleurs persistantes au-delà de la période postopératoire immédiate,
pouvant atteindre plusieurs semaines, mais ne perdurant pas au-delà du troi-
sième mois. Les séquelles ostéoarticulaires en représentent une part importante,
Correspondance et tirés à part :
S. Donnadieu
Sang Thrombose Vaisseaux 2005 ;
17, n° 2 : 93-9
STV, vol. 17, n° 2, février 2005 93
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

–les douleurs chroniques présentes depuis au moins trois
mois, dont la description peut être très différente de la
douleur postopératoire initiale. Leur retentissement émo-
tionnel est souvent important, avec risque d’autonomisa-
tion de cette douleur comme maladie à part entière. Une
participation neuropathique est fréquemment retrouvée, de
même qu’un terrain favorisant.
La chirurgie cardiovasculaire est pourvoyeuse de ces trois
types de douleurs [1]. Étant donné les grandes différences
dans les voies d’abord et les techniques chirurgicales, seu-
les les douleurs liées à la chirurgie cardiaque sont abordées
dans cet article.
Douleurs précoces
Mécanismes
La principale incision pratiquée en chirurgie cardiaque
reste la sternotomie, qui induit des douleurs d’origines
osseuse, articulaire et musculaire. Les douleurs osseuses
sont provoquées par des fractures de côtes favorisées par
l’ostéoporose. Très douloureuses, entravant la ventilation et
la kinésithérapie précoce, elles sont diagnostiquées par la
palpation d’un point douloureux exquis, parfois la percep-
tion d’un craquement à la pression. Les signes sont parfois
difficiles à mettre en évidence sur une radiographie prati-
quée « au lit ». Les contraintes appliquées aux cartilages
chondrocostaux par les écarteurs se traduisent au niveau de
la paroi thoracique antérieure au maximum par des luxa-
tions chondrocostales, facilement palpables en parasternal,
mais le plus souvent uniquement par des douleurs bien
localisées. Cette souffrance positionnelle se rencontre aussi
sur les articulations costovertébrales, entraînant des dorsal-
gies avec parfois des irradiations basses empruntant le trajet
des nerfs articulaires postérieurs, d’autant plus qu’il existe
une hypertrophie dégénérative de ces massifs articulaires
(figure 1).
Les douleurs myofasciales sont fréquentes, touchant aussi
bien la paroi antérieure que postérieure ainsi que la région
scapulaire. Les muscles impliqués sont le pectoral, les
dentelés, le trapèze, l’élévateur de la scapula, le rhomboïde.
Ces muscles sont douloureux et contractés à la palpation.
Le mécanisme des douleurs myofasciales est complexe :
arc réflexe segmentaire déclenché par les influx nocicep-
tifs, hyperalgésie secondaire, acidose locale des muscles
impliqués dans le geste opératoire.
Les drains médiastinaux et pleuraux participent aux dou-
leurs postopératoires précoces, entraînant des douleurs pos-
térieures augmentées par les mouvements ventilatoires am-
ples et par la toux. Une traction sur les fils d’attache de ces
drains est une source de douleur facilement évitable par une
meilleure fixation.
Les douleurs thoraciques postopératoires précoces peuvent
être le premier signe d’une complication : épanchement
péricardique, pleural, pneumopathie, embolie pulmonaire,
infection pariétale, œsophagite dont le traitement est à la
fois étiologique et symptomatique.
Syndrome du pectoral
Traumatisme chondral
Fracture de côte
Entorse chondrale
Myalgie intercostale
Syndrome de Tietze
Luxation costale
Figure 1.Étiologies des douleurs pariétales après thoracotomie.
STV, vol. 17, n° 2, février 2005
94
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Évaluation
Après chirurgie cardiaque, les opérés sont dirigés directe-
ment en réanimation ou en salle de surveillance post-
interventionnelle (SSPI). Si le patient est extubé et cons-
cient, l’évaluation de la douleur se fait par une méthode
d’auto-évaluation, utilisant soit une réglette (Échelle Vi-
suelle Analogique, EVA), soit plus souvent une échelle
numérique simple (0 = absence de douleur, 10 = douleur
maximale imaginable). Les valeurs doivent être notées sur
la pancarte de surveillance comme tout autre paramètre
vital, à intervalles réguliers et après chaque administration
d’antalgique. Le contrôle de la douleur est une des condi-
tions de sortie de SSPI.
Lorsque le patient est encore sous l’effet de l’anesthésie,
l’évaluation est essentiellement comportementale : aspect
du visage, manifestation d’agitation, profil hémodynami-
que. Il n’existe pas encore d’outil parfaitement validé de
mesure de la douleur chez ces patients. La sédation est
poursuivie jusqu’au réchauffement du patient et à l’obten-
tion d’une hémodynamique stable. L’apparition de la dou-
leur est prévenue par l’administration de morphine sous-
cutanée ou intraveineuse (IV).
Moyens antalgiques
Le soulagement de la douleur postopératoire ne se limite
pas à la prescription de médicaments antalgiques. Il com-
prend également les moyens non médicamenteux que sont
le confort de l’opéré par une bonne installation, un position-
nement sans tension des sondes et drains, et la mobilisation
indolore précoce.
Trois méthodes sont pratiquées pour l’antalgie médicamen-
teuse postopératoire :
–l’administration d’antalgiques par voie intraveineuse et
particulièrement l’autoadministration de morphine par
voie IV,
–l’administration régionale d’anesthésiques locaux,
–l’antalgie par voie périmédullaire.
L’antalgie par voie IV est la plus commune. Elle associe
des antalgiques non morphiniques (paracétamol injectable,
Néfopam, Acupan
®
) à des morphiniques. Lorsque le pa-
tient est maintenu sédaté pour ventilation mécanique, les
morphiniques les plus utilisés sont le sufentanil et la mor-
phine. Toutefois l’emploi, tout comme au bloc opératoire,
d’un morphinique rapidement métabolisé comme le rémi-
fentanyl (Ultiva
®
), est proposé par certaines équipes en
veillant à un relais précoce par la morphine pour éviter un
état hyperalgique. Lorsque le patient est conscient, en ven-
tilation spontanée, la méthode de choix est l’autoadminis-
tration de morphine (PCA) dont les réglages habituels sont
des bolus de 1 mg toutes les 5 minutes. La PCA est débutée
après une « titration » en morphine permettant d’atteindre
un taux de morphine suffisant pour obtenir une antalgie qui
sera ensuite auto-entretenue.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) injectables
utilisés dans ce cadre sont le kétoprofène (Profénid
®
) pour
les AINS non sélectifs et le parécoxib (Dynastat
®
) pour les
AINS inhibiteurs sélectifs de la cox-2. Leur emploi après
chirurgie cardiaque doit être très prudent du fait d’effets
délétères possibles sur la fonction rénale d’un patient à
l’hémodynamique instable.
L’administration régionale d’anesthésiques locaux est très
utile car n’ayant que peu de retentissement sympathicolyti-
que et permettant de réduire les morphiniques par voie
systémique. Les deux techniques les plus employées sont
les blocs intercostaux réalisés en fin d’intervention et le
bloc paravertébral avec mise en place d’un cathéter qui peut
être placé chirurgicalement en fin d’intervention. Ce der-
nier bloc est particulièrement indiqué en cas de thoracoto-
mie latérale. Le bloc intrapleural n’est plus recommandé du
fait de la présence des drains thoraciques modifiant la
résorption des anesthésiques locaux. L’anesthésique local
maintenant le plus répandu est la ropivacaïne (Naropeine
®
à 0,2 %) de longue durée d’action (8 heures) et peu cardio-
toxique aux posologies habituelles.
L’antalgie par voie périmédullaire correspond à l’adminis-
tration de morphine intrathécale directement dans le liquide
céphalorachidien à la dose de 0,5-1 mg, procurant une
antalgie d’environ 20 heures. Les effets secondaires sont
une dépression respiratoire tardive (après la 12
e
heure) et
une rétention d’urines, qui sont de peu de conséquences
pour les patients séjournant en réanimation. Des nausées et
un prurit peuvent également survenir.
L’autre technique d’antalgie périmédullaire est la péridu-
rale thoracique réalisée par ponction d’un espace entre T4
et T6 et introduction d’un cathéter dans l’espace péridural
pour une antalgie prolongée par l’administration d’anesthé-
siques locaux. Cette technique est la plus efficace pour la
réduction des douleurs postopératoires après thoracotomie.
Elle pose néanmoins le risque d’hématome périmédullaire
chez un patient ayant des troubles de la coagulation (anti-
coagulation, thrombopénie).
Quelques patients restent hyperalgiques en postopératoire
malgré une antalgie a priori bien conduite. Outre la pré-
sence d’une complication à rechercher systématiquement,
il existe des facteurs favorisants : douleur préopératoire
intense et prolongée, prise antérieure d’opiacés, addiction à
des stupéfiants ou au cannabis, pathologie psychiatrique.
Le médicament de choix est alors la kétamine (Kétalar
®
),
anesthésique général dissociatif utilisé pour son effet blo-
queur de la transmission de la douleur à des doses beaucoup
plus réduites que pour l’anesthésie générale (0,3 mg/kg par
STV, vol. 17, n° 2, février 2005 95
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

voie intraveineuse et administration continue de 2 mg/kg/j).
La kétamine à cette posologie n’a pas de retentissement
hémodynamique particulier. La surveillance porte essen-
tiellement sur l’apparition d’hallucinations.
En dehors de toute hypotension, l’administration de cloni-
dine (Catapressan
®
) est utile pour réduire un état d’agita-
tion ou atténuer des frissons intenses (300 lg/24 heures en
continu).
La cryoanalgésie des nerfs intercostaux a été une méthode
recommandée dès 1976 pour diminuer la douleur post-
thoracotomie, principalement en chirurgie pulmonaire.
L’application d’une température de -75 °C à l’extrémité
d’une aiguille positionnée par le chirurgien en fin d’inter-
vention au contact des nerfs intercostaux laissait supposer
un blocage durable de la conduction nerveuse sans lésion
neurologique irréversible, source de désafférentation. Les
résultats ont été contradictoires [2] et cette méthode est
maintenant abandonnée.
La douleur lors de pansements et de l’ablation des drains
thoraciques peut être importante et représente une cause
d’anxiété chez nombre d’opérés. L’obtention du statut de
médicament par le mélange équimoléculaire d’oxygène et
de protoxyde d’azote (MEOPA, Kalinox
®
, Médimix
®
)etla
possibilité de son administration en inhalation dans le cadre
d’un protocole infirmier, sans présence médicale à proxi-
mité immédiate, permet la réalisation quasi sans douleur de
ces gestes. Son usage est donc à développer dans les servi-
ces de chirurgie après une courte formation des personnels
amenés à manipuler ce mélange gazeux médicinal. Pour
certains patients, une prémédication à base d’anxiolytique
et de morphine à action rapide par voie orale (Actiskénan
®
,
Sevredol
®
) est donnée trois quarts d’heure avant le geste.
Douleurs persistantes
Les causes infectieuses sont exceptionnellement responsa-
bles de douleurs prolongées. L’observation de la cicatrice
et des téguments adjacents, la recherche de signes cliniques
d’infection, les bilans biologiques (numération formule
sanguine, protéine réactive C) ainsi que les examens d’ima-
gerie permettent d’en faire rapidement le diagnostic, guidé
éventuellement par des prélèvements bactériologiques diri-
gés.
Les douleurs ostéoarticulaires sont beaucoup plus fréquen-
tes. La constatation d’une consolidation insuffisante de la
sternotomie peut en expliquer certaines. Au niveau des
deuxième et troisième cartilages, une douleur parasternale
spontanée et provoquée par la palpation réalise le syndrome
de Tietze. Une injection loco dolenti d’anesthésiques lo-
caux et de corticoïdes en est le traitement. La figure 1
résume l’ensemble des causes de douleurs pariétales après
thoracotomie.
Une douleur de l’épaule peut évoluer vers un syndrome
d’épaule douloureuse bloquée, d’étiologie imprécise, évo-
luant sur plusieurs mois, dont la meilleure prise en charge
semble être la prescription d’antalgiques puissants pour
permettre une kinésithérapie précoce.
Une algodystrophie du membre supérieur est possible avec
d’abord une phase inflammatoire, suivie d’une phase d’en-
raidissement, principalement au niveau de l’articulation
scapulo-humérale. La scintigraphie osseuse à des temps
précoces et tardifs et l’IRM aident à poser le diagnostic. Le
traitement est semblable à celui de l’épaule douloureuse
bloquée mais comprend en plus la prescription de calcito-
nine.
Les douleurs myofasciales siègent principalement au ni-
veau des muscles dorsaux paravertébraux et des trapèzes.
Une contracture douloureuse est constatée à leur palpation.
Des injections peu profondes de faibles volumes d’anesthé-
siques locaux dans les zones musculaires douloureuses
peuvent améliorer les douleurs en y ajoutant des benzodia-
zépines myorelaxantes. La physiothérapie, bien que d’effi-
cacité non démontrée, est souvent utilisée. L’acupuncture
peut également être préconisée (figure 2).
Douleurs chroniques
Épidémiologie
La douleur chronique après chirurgie cardiaque se définit
comme une douleur intéressant le site chirurgical, diffé-
rente de la douleur préopératoire, survenant dans des délais
variables et persistant plus de trois mois.
Figure 2.Traitement de douleurs myofasciales par acupuncture.
STV, vol. 17, n° 2, février 2005
96
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Sur un groupe de 349 opérés en chirurgie cardiaque [3],
28 % des opérés se plaignaient un an après l’opération
d’une douleur thoracique. Cette douleur était qualifiée de
modérée pour 30 % d’entre eux (score sur l’échelle visuelle
analogique (EVA ≥30) et de forte (EVA ≥55) pour 4 %.
Sur le suivi d’une cohorte de 1080 opérés en chirurgie
cardiaque, Brice [4] rapportait une prévalence de douleurs
pour 39,3 % des opérés au 28
e
mois. La douleur pouvait
intéresser le thorax mais également être associée à une
douleur du membre inférieur, siège du prélèvement d’un
greffon saphène.
La possibilité de survenue d’une douleur chronique, du fait
de sa fréquence, fait partie de l’information du futur opéré.
Étiologies
Les douleurs neuropathiques représentent la majorité des
douleurs chroniques après thoracotomie [5]. Leur méca-
nisme principal est une lésion nerveuse intercostale par
section, contusion, coagulation, induisant, par un phéno-
mène de désafférentation, une hyperexcitabilité neuronale
faite d’activités exagérées tant spontanées qu’induites.
Avec le temps, ces phénomènes s’étendent au niveau mé-
dullaire et probablement central. Le diagnostic repose sur
des signes cliniques très évocateurs. À l’interrogatoire, le
patient se plaint de douleurs sur le trajet de la cicatrice, et
dans son prolongement antérieur de douleurs continues à
type de « brûlures, de picotements », avec des douleurs plus
intenses qualifiées « de décharges électriques, parfois en
éclair » spontanées ou déclenchées par un simple frôle-
ment. Une sensation de « gonflement » dans la région sous-
mammaire est souvent rapportée.
L’examen de la sensibilité superficielle dans le territoire
douloureux, par comparaison avec le côté non opéré, mon-
tre une allodynie (douleur induite par un stimulus non
douloureux), une hyperpathie (douleur intense provoquée
par un faible stimulus nociceptif) dans une zone où la
sensibilité discriminative est fortement diminuée. Ces dou-
leurs seraient plus fréquentes en cas de pontage utilisant
l’artère mammaire interne par rapport à l’utilisation d’un
greffon saphène [6].
Toute autre est la douleur du névrome, diagnostiqué sur la
palpation d’un point très douloureux, limité, sur le trajet de
la cicatrice. La responsabilité des fils métalliques de la
contention sternale est souvent évoquée par les patients qui
voient sur la radiographie thoracique les « pointes » de ces
fils auxquels il est tentant de rattacher l’origine des dou-
leurs. Toute décision d’ablation des fils doit être précédée
d’un test d’infiltration aux anesthésiques locaux et d’une
discussion avec l’opérateur sur l’opportunité de cette réin-
tervention. Bien que non publiés, les résultats en paraissent
décevants et l’ablation doit s’insérer dans un traitement
plus large de la douleur chronique.
Évaluation
L’évaluation de la douleur chronique nécessite beaucoup
plus qu’une simple réglette de mesure de l’intensité de la
douleur. En effet, la douleur chronique comporte toujours
des composantes cognitives et émotionnelles dont l’appré-
ciation peut se faire par l’emploi d’autoquestionnaires
comme le « questionnaire de la douleur de l’hôpital Saint-
Antoine », des questionnaires d’anxiété et de dépression et
des indicateurs de qualité de vie [7]. Cette évaluation res-
semble à une expertise multidisciplinaire où le concours
d’un psychiatre ou d’un psychologue est souvent indispen-
sable.
Traitements
Une douleur chronique peut rarement être soulagée par une
seule prescription thérapeutique du fait des retentissements
psychologiques induits, principalement à type d’anxiété et
de dépression. Cette douleur peut avoir également des
conséquences professionnelles, sociales et personnelles,
qui aggravent encore le handicap induit par la douleur et qui
sont à considérer chacune attentivement. De plus les diffé-
rents mécanismes peuvent s’intriquer, impliquant des trai-
tements spécifiques différents [8].
Techniques antalgiques
Parmi les diverses techniques antalgiques se trouvent :
–les infiltrations d’anesthésiques locaux. Leur principale
indication est le névrome. L’infiltration après application
prolongée sous un pansement occlusif de crème anesthési-
que EMLA
®
, utilise des anesthésiques locaux (lidocaïne :
Xylocaïne
®
, ropivacaïne : Naropeine
®
) associés à 50 mg
d’Hydrocortancyl
®
. Une nouvelle infiltration est parfois
répétée quelques semaines plus tard ;
–la stimulation électrique transcutanée. Elle consiste en
l’application d’un courant formé d’ondes biphasiques sur
un territoire douloureux à visée antalgique. Les électrodes
sont placées sur le métamère ou le tronc nerveux intéressé.
Les zones d’allodynie et d’anesthésie sont à éviter. Le
placement doit être effectué au plus près du nerf intercostal
à stimuler. La prescription de la location de l’appareil, pour
être prise en charge, doit être rédigée par une structure
d’évaluation et de traitement de la douleur. Les séances
durent environ deux fois deux heures par jour. La stimula-
tion électrique transcutanée représente un traitement non
médicamenteux des douleurs neuropathiques dont le rap-
port bénéfice-risque est très favorable ;
–les médicaments antalgiques. La composante neuropathi-
que des douleurs chroniques est peu sensible aux différents
STV, vol. 17, n° 2, février 2005 97
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%