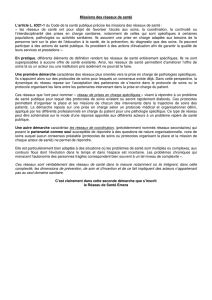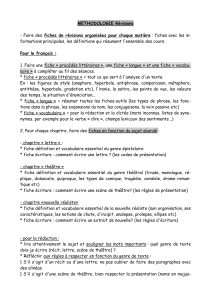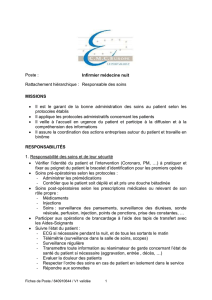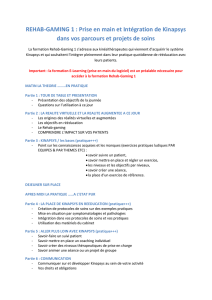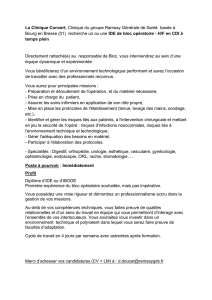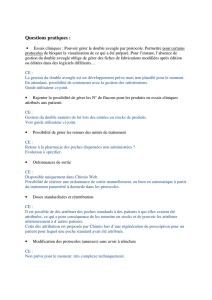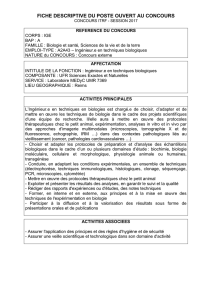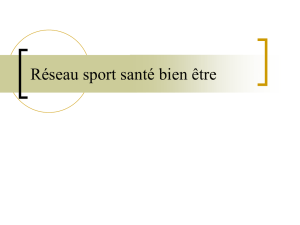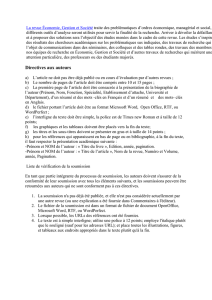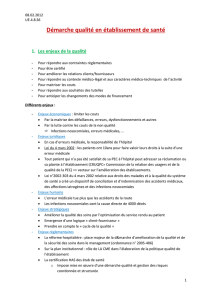Côté Patients L`actualité des Comités de patients en

re C h e r C h e s u r l e C a n C e r d u s e i n
Deux nouvelles études innovantes
La recherche sur le cancer du sein s’enrichit de deux études particulièrement
importantes en cours de mise en place. Promues par le groupe UNICANCER,
ces études visent, pour l’une, à déterminer le profil moléculaire des cellules
cancéreuses de chaque patiente afin d’orienter leur prise en charge vers des
traitements personnalisés, pour l’autre, à évaluer les effets indésirables à
moyen et long terme des traitements afin de parvenir à prédire ces toxicités et
ainsi améliorer la qualité de vie des femmes.
Le programme SAFIR 01 s’ins-
crit dans le développement de
la médecine personnalisée et
vise à évaluer dans la pratique
la mise en place de celle-ci.
Ce programme, qui s’adresse
à des femmes et des hommes
atteints d’un cancer du sein,
part du constat suivant : il
n’existe pas une seule, mais
de multiples formes de can-
cer du sein qui peuvent être
distinguées en fonction des
caractéristiques moléculaires
des cellules tumorales.
Un exemple permet de
le comprendre aisément.
Environ 15 % à 20 % des
femmes atteintes d’un cancer
du sein présentent ce que l’on
appelle une surexpression
du récepteur HER2. Il s’agit
d’une protéine présente à la
surface de toutes les cellules.
Chez les femmes porteuses de
tumeurs dites HER2 positives,
• Re c h e R c h e
Deux importantes études
sur le cancer du sein vont
prochainement débuter,
l’une sur les prols
moléculaires des tumeurs,
l’autre sur les toxicités à
long terme des traitements.
• co n g R è s eu R o c a n c e R
Une synthèse d’informations
à retenir.
• co m i t é d e p a t i e n t s
Un bilan du travail réalisé
depuis plus de dix ans et ses
enseignements.
sommaire
Côté Patients
L’ actuaLité des comités d e patients pouR L a RecheRche cLinique e n cancéRoLogie
(suite en page 2)
sept. 2011

• Repères
ce récepteur est retrouvé en très grand
nombre sur les cellules tumorales.
Comme ce récepteur est sensible aux
signaux de prolifération cellulaire,
en cas de surexpression, les cellules
tumorales se développent plus vite. Un
médicament ciblé existe, le trastuzumab
(Herceptin®) qui bloque spécifiquement
le récepteur HER2. Ce médicament
est efficace. Cependant, chez environ
50 % des patientes, des résistances
se développent progressivement. Il a
été montré que ces résistances sont
liées à des anomalies dans l’ADN
(1) des cellules tumorales. Plusieurs
de ces anomalies ont été clairement
identifiées et des médicaments sont
en cours de développement pour les
cibler. L’objectif est, avec ces nouvelles
molécules, de lever les résistances
et de retrouver une efficacité des
traitements.
De nombreuses autres mutations ou
caractéristiques moléculaires sont
aujourd’hui identifiées qui ont un
impact sur le pronostic de la maladie
et sur la réponse aux traitements.
Chacune d’entre elle constitue un sous-
type moléculaire du cancer du sein.
Un prol moléculaire individuel
L’idée du programme SAFIR 01 est
de proposer une analyse de l’ADN
des cellules tumorales afin de
cartographier toutes les anomalies
ou caractéristiques moléculaires
présentes pour lesquelles il existe
potentiellement un médicament en
développement. Cela est aujourd’hui
possible grâce à des outils dits de
criblage à haut débit qui sont en mesure
d’analyser en quelques heures l’ADN
extrait d’une biopsie d’une tumeur et
d’en répertorier toutes les anomalies
moléculaires.
Mis en place dans dix-neuf centres de
lutte contre le cancer, ce programme
s’adresse à 400 femmes et hommes
pour lesquels il sera procédé à criblage
moléculaire. En fonction de leur
profil, il sera proposé aux participants
d’entrer dans des essais évaluant des
médicaments ciblant spécifiquement
les anomalies portées par leurs
cellules tumorales. Ils pourront ainsi
(suite de la page 1)
bénéficier d’un traitement adapté à
leur profil moléculaire dont on peut
espérer qu’il soit plus efficace qu’un
traitement standard.
SAFIR 01 vise à montrer que ce type
de criblage est réalisable dans la
pratique. Si tel est bien le cas, ce
programme ouvre la voie à la médecine
personnalisée de demain.
Une cohorte de 20 000 patientes
De son côté, l’étude CANTO s’intéresse
à une question toute aussi importante :
la toxicité des traitements. Il a en effet
été constaté que la qualité de vie des
femmes traitées pour un cancer du sein,
qui sont en rémission sans rechute,
est inférieure à celle de la population
générale. Il est fort probable que cet
état de fait soit lié à la toxicité des
traitements reçus par ces femmes, dont
les effets peuvent persister pendant
plusieurs années. Malheureusement,
les effets indésirables à moyen et long
terme des traitements sont peu étudiés.
Cela a conduit le groupe UNICANCER
(issu de la Fédération nationale des
Centres de Lutte contre le Cancer),
en partenariat avec l’Institut Gustave
Roussy de Villejuif, le Centre Georges
François Leclerc de Dijon et le Centre
Léon Bérard de Lyon, à vouloir mettre
en œuvre une étude spécifiquement
dédiée à cette question, en se donnant
les moyens nécessaires pour l’explorer
dans ses différentes dimensions.
CANTO est ainsi une vaste étude
de cohorte conçue pour suivre
20 000 femmes pendant cinq ans. Les
participantes seront des femmes
atteintes d’un cancer du sein qui
n’auront pas commencé leur traitement
au moment de leur entrée dans l’étude.
Elles seront vues en consultation
avant le début de leur traitement,
trois mois après la fin de celui-ci, puis
tous les ans. En plus d’un examen
clinique complet, chaque consultation
donnera lieu à des examens sanguins
et les participantes devront répondre
à différents questionnaires.
L’étude CANTO poursuit en effet trois
grands objectifs :
- Recueillir de façon systématique les
effets indésirables persistants auprès
de l’ensemble des participantes. Cela
permettra de pouvoir disposer d’un
tableau précis de l’ensemble des
toxicités chroniques associées aux
traitements du cancer du sein.
- Déterminer quels impacts ont ces
toxicités sur la qualité de vie des
femmes, sur leur état psychologique
et sur leur situation sociale et
économique.
- Rechercher à partir des prélèvements
sanguins recueillis des marqueurs
biologiques associés à la survenue
des toxicités chroniques. L’idée est,
une fois de tels marqueurs identifiés,
de pouvoir mettre au point des tests
qui puissent permettre d’identifier
les patientes qui seront à risque de
développer des effets indésirables à
long terme.
Améliorer la qualité de vie
« Cette étude va permettre à terme
d’améliorer la qualité de vie des
patientes pendant et après les
traitements. Maintenant que nous
guérissons de plus en plus de femmes,
il faut s’attacher à ce qu’elles puissent
vivre avec la meilleure qualité de vie
possible en prévenant les éventuelles
toxicités et séquelles liées aux
traitements », explique le Dr Fabrice
André, cancérologue à l’Institut Gustave
Roussy et coordinateur de CANTO.
Il est prévu que les premières
inclusions dans CANTO commencent
au début de l’année 2012. L’étude
sera proposée aux patientes dans dix
Centres de lutte contre le cancer dans
un premier temps.
L’importance de cette étude est
soulignée par le fait qu’elle a obtenu
un financement de l’Etat dans le
cadre du programme « Investissement
d’avenir » (appelé également Grand
Emprunt) dont l’objectif est de soutenir
des projets de recherche innovants.
(1) ADN : acide désoxyribonucléique. Molécule
présente dans toutes les cellules vivantes, qui
renferme l’ensemble des informations nécessaires au
développement et au fonctionnement d’un organisme.
C’est aussi le support de l’hérédité.

Membres du Comité
de Patients en Recherche
Clinique en Cancérologie
40 membres actifs à ce jour.
• LNCC – Paris
Coordonnateur médical : Dr F. May-Levin, Dr C. Naud
Coordonnatrice nationale : M. Lanta
Etat des lieux : 30 patients
• R&D UNICANCER – Paris
Coordonnateur médical : Dr J. Genève
Coordonnatrice nationale : Mme C. Gamet
• ARCAD – Paris
Coordonnatrice : Mme M. de Bausset
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• EORTC – Bureau de liaison Paris
Coordonnateur : M. Ait Rahmoune
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Léon Bérard – Lyon
Coordonnatrices : Mme Z. Abdelbost, Mme C. Baconnier
Etat des lieux : 2 patients, soumission des protocoles pour relecture
• Institut Bergonie – Bordeaux
Coordonnatrices : Mme S. Louchet, Mme M. Birac
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Institut Paoli Calmettes – Marseille
Coordonnatrice : Dr D. Genre
Etat des lieux : 2 patients, soumission des protocoles pour relecture
• Institut Curie – Paris
Coordonnatrices : Dr S. Maral, Mme M. Le Begue
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre René Gauducheau – Nantes
Coordonnatrice : Mme G. Perrocheau
Etat des lieux : 2 patients
• Institut Jean Godinot – Reims
Coordonnatrice : Mme M.-L. Manche-Thevenot
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre René Huguenin – Saint-Cloud
Coordonnatrice : Dr E. Fourme
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Antoine Lacassagne – Nice
Coordonnatrice : Mme C. Lovera
Etat des lieux : 1 patient
• Centre Val d’Aurelle-Paul Lamarque – Montpellier
Coordonnateurs : Dr J-P. Bleuze, Mme B. Pont
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Oscar Lambret – Lille
Coordonnatrices : Mme S. Clisant, Mme Y. Vendel
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Georges-François Leclerc – Dijon
Coordonnatrice : Mme S. Tiago
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Jean Perrin – Clermont-Ferrand
Coordonnatrice : Mme G. Niezgodzki
Etat des lieux : 1 patient
• Centre Alexis Vautrin – Nancy
Coordonnatrice : Dr E. Luporsi
Etat des lieux : 2 patients, soumission des protocoles pour relecture
• Actualité
eu r o C a n C e r
Des résultats intéressants
Un membre du Comité de patients a participé à la dernière
édition du congrès Eurocancer, qui s’est tenu à Paris du
21 au 23 juin 2011. Voici une synthèse des informations
médicales qui ont retenu son attention.
Dépistage précoce : vers de nouveaux marqueurs. Plusieurs types de
substances font l’objet de recherches dans le but d’identifier des marqueurs
susceptibles de permettre un dépistage précoce des cancers. C’est le cas du
récepteur FSH (pour follicle-stimulating hormone) qui est normalement
exprimé par les organes de reproduction, mais dont il a été également
montré par une équipe française qu’il est produit en quantité importante
par les vaisseaux sanguins situés à proximité des tumeurs cancéreuses. La
détection de ce récepteur par imagerie pourrait ainsi permettre de mettre
en évidence des tumeurs à un stade précoce, où qu’elles soient situées dans
l’organisme.
D’autres marqueurs potentiels sont également à l’étude, notamment dans le
cancer colorectal. C’est le cas de l’ADN libre circulant dans le sang dont il a
été montré que sa concentration est augmentée chez les personnes atteintes
de cancer et qu’il présente des caractéristiques associées à la tumeur.
Différentes protéines qui sont retrouvées dans les selles sont également
étudiées.
Il n’est toutefois pas possible, sur la base des données actuellement
disponibles, de savoir si ces différents marqueurs pourront un jour être
utilisés en pratique courante et d’ici combien de temps.
Les cellules circulantes, marqueurs de l’efficacité des traitements. De
nombreuses recherches sont menées sur les cellules tumorales circulantes,
c’est-à-dire des cellules qui sont détachées de la tumeur et que l’on retrouve
dans le sang. Selon les communications présentées au cours du congrès,
concernant notamment le cancer du sein, la baisse du nombre de ces cellules
serait un meilleur marqueur de l’efficacité des traitements que la diminution
du volume de la tumeur. Les techniques permettant de détecter les cellules
tumorales circulantes sont en cours de développement.
Réduire l’hypoxie pour améliorer l’efficacité de la radiothérapie. Il
est connu qu’une partie des cellules tumorales est en hypoxie, c’est-à-dire
qu’elle manque d’oxygène, faute de vaisseaux sanguins à proximité pour les
irriguer. Il est également établi que les cellules tumorales en hypoxie sont
généralement plus agressives et résistent davantage aux traitements, en
particulier à la radiothérapie. Des approches sont en cours d’évaluation pour
favoriser la vascularisation d’une tumeur juste avant une radiothérapie, afin
de rendre les cellules tumorales plus sensibles au traitement. A suivre.
Le travail de nuit favorise le cancer du sein. Une équipe française a
confirmé ce que d’autres travaux avaient déjà montré : le travail de nuit est
associé à une augmentation du risque de cancer du sein. Cette augmentation
du risque concerne notamment les femmes ayant travaillé plus de 4,5 ans
la nuit, celles qui travaillent la nuit de façon intermittente et celle qui ont
commencé un travail de nuit avant leur première grossesse. Les raisons de
l’augmentation du risque ne sont pas formellement établies. Elle pourrait être
liée aux perturbations des rythmes biologiques entraînant une production
hormonale accrue. Il a été également constaté que les femmes travaillant
la nuit fument davantage et présentent une fréquence plus importante de
surpoids, qui constituent eux-mêmes de facteurs de risque pour le cancer
du sein.

Réalisation : RCP Communication
• Analyse
Co m i t é d e p a t i e n t s p o u r l a r e C h e r C h e C l i n i q u e
Les enseignements du passé pour nourrir le futur
A l’occasion des dix ans du
comité de patients, il a été
demandé à un sociologue,
Christian Legrand, de réaliser
un travail d’analyse de l’activité
du comité. Son bilan illustre
l’importance de ce qui a été
réalisé. Il permet également
d’interroger la place actuelle
du comité dans le monde de la
recherche et ce qu’elle pourrait
devenir.
C’est lors de la dernière assemblée
plénière du Comité de patients, qui
s’est tenu à Paris le 24 juin 2011, que
Christian Legrand a présenté les
résultats de son travail. Celui-ci s’est
appuyé sur des entretiens individuels
avec des membres du Comité, ainsi
que sur enquête documentaire.
Comme l’a rappelé Christian Legrand,
la création du Comité de patients, en
1998, s’est inscrite dans un contexte où
émergeait, sous l’influence notamment
des associations de lutte contre le sida,
le concept de « patient-partenaire ». Ce
concept résulte d’une évolution de la
place du patient dans le monde de la
santé où il n’est plus uniquement malade,
mais aussi acteur face à sa maladie,
en partenariat avec les professionnels
de santé. La recherche clinique étant
le moteur du progrès médical, il était
normal que les patients souhaitent y être
impliqués, non pas uniquement comme
participants aux essais, mais également
comme intervenants sur les processus
d’élaboration et de réalisation de la
recherche.
Le projet de Comité de patients a
été porté conjointement par la Ligue
nationale contre le cancer, notamment
par le Dr Françoise May-Levin, et la
Fédération française des centres de
lutte contre le cancer (devenue depuis
le groupe Unicancer). La mise en
œuvre du projet a été très rapide, avec
un programme ambitieux puisque
l’objectif affiché était notamment
« la participation des patients à la
construction des essais ».
En pratique, le Comité s’est
essentiellement attaché à définir une
charte et une grille de relecture des
protocoles, en particulier des notes
d’information destinées aux patients.
Expertise et légitimité
Depuis, plus de deux cents protocoles
ont été revus par le Comité, de
manière « sérieuse, méthodique et
appliquée » selon Christian Legrand.
Ce dernier considère que « le travail
réalisé par les membres du comité
constitue une véritable valeur ajoutée
aux protocoles », à la fois sur la qualité
des notes d’information mais aussi par
les commentaires sur les modalités de
réalisation des essais. « L’ensemble
des remarques énoncées par les
patients au fil des années permet
aujourd’hui de définir un corpus de
tous les aspects qui devraient être
pris en compte pour intégrer dans
les protocoles d’essais la vie des réels
des patients », a-t-il expliqué, ce qui
justifie la notion d’expertise apportée
par les membres du Comité.
De fait, la légitimité du Comité de
patients est aujourd’hui reconnue
par les acteurs de la recherche en
cancérologie. En témoigne le fait que
le second Plan Cancer a inscrit parmi
ses mesures la nécessité de prendre
l’avis des patients sur les protocoles
de recherche, et que l’Institut national
du cancer (INCa) a décidé assez
récemment de mettre en place une
consultation systématique du Comité
sur l’ensemble des essais cliniques en
cancérologie d’ici trois ans.
Cependant, Christian Legrand a pointé
que, jusqu’à présent, le Comité de
patients s’est essentiellement attaché
à relire les protocoles. Son rôle est
par conséquent limité à une phase
bien précise, et finalement assez
tardive, dans l’élaboration des essais
de recherche clinique. Si l’utilité de
cette activité n’est plus à remettre
en question, elle reste relativement
réduite par rapport à l’ambition
initiale du projet, à savoir l’implication
dans l’élaboration même des essais.
Par ailleurs, on peut se demander si
le Comité ne pourrait pas également
jouer un rôle dans l’information des
participants des essais, notamment
quant aux résultats obtenus par ceux-
ci. Autant de points qui ne manqueront
certainement pas d’alimenter la
réflexion des membres du Comité de
patients quant à l’avenir de celui-ci.
Cette lettre d’information est éditée par le département R&D du Groupe UNICANCER et
la Ligue Nationale Contre le Cancer pour rendre compte des activités de la Fédération des
Comités de Patients pour la Recherche Clinique en Cancérologie.
1
/
4
100%