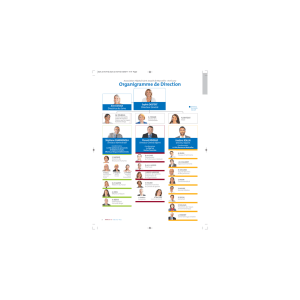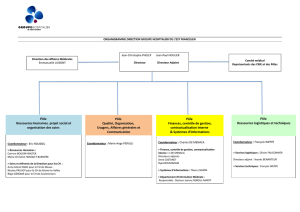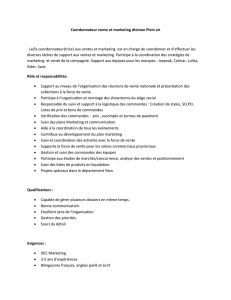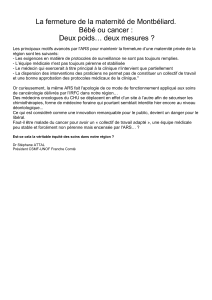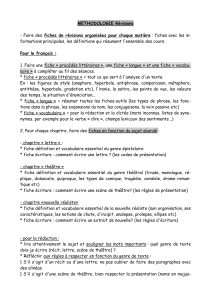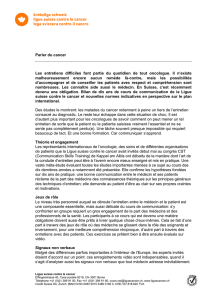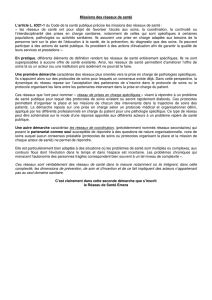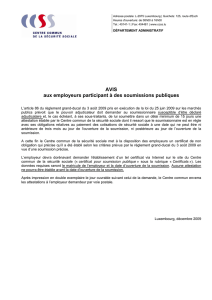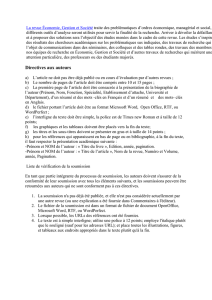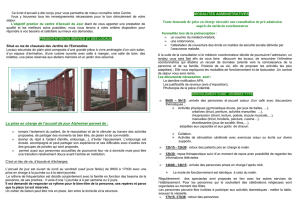Numéro 11 (PDF, 1,10 Mo)

Ar r ê t d e s t r A i t e m e n t s e n f i n d e v i e
« Il faut oser en parler aux malades »
Oncologue au Centre Léon Bérard à Lyon, le Dr Gisèle Chvetzoff a mené
une enquête sur une question à la fois douloureuse et délicate : l’arrêt des
traitements lorsque ceux-ci sont devenus impuissants et que la maladie
reste la plus forte. Pour cela, elle s’est entretenue avec des patients se
trouvant dans cette situation, ainsi qu’avec des oncologues et des membres
des Comités de patients. Nous l’avons interrogé sur ce travail à l’issue de la
présentation qu’elle a faite de ces observations lors de l’assemblée plénière
de la Fédération des Comités de Patients en juin dernier.
Pourquoi avoir mené cette
série d’entretiens ?
Dr Chvetzoff : j’ai réalisé cette
enquête dans le cadre d’une
thèse d’éthique. Je souhaitais
explorer les représentations
et les attentes à la fois des
patients et des médecins
sur cette question difficile.
Personnellement, je pense
que l’on tend à surtraiter les
patients qui sont en situation
où la maladie l’emporte, et
que cela ne leur rend pas
nécessairement service.
D’une part, en raison de la
toxicité des médicaments
qui leur sont donnés. D’autre
part, cela ne les place
pas dans les meilleures
• Ar r ê t d e s t r A i t e m e n t s
Une enquête sur les
représentations et les
attentes des patients et
des oncologues lorsque
les traitements deviennent
impuissants.
• FCPrCC
Le bilan de dix ans de
progrès de la recherche.
• Co n g r è s d e l’A s C o
Le point sur les dernières
avancées thérapeutiques.
sommaire
Côté Patients
l’ ACtuAlité des Comités d e PAtients Pour l A reCherChe Clinique e n CAnCérologie
(suite en page 2)
sePtembre 2010

• Repères
Ar r ê t d e s t r A i t e m e n t s e n f i n d e v i e
conditions psychologiques pour
faire face. Par ailleurs, je ne pense
pas que les oncologues préfèrent
s’acharner à donner des traitements.
Mes collègues ne sont ni insensibles,
ni incompétents. Il me semble qu’ils
sont vraisemblablement en difficulté
par rapport à cette situation. Il existe
certainement des possibilités de les
aider et d’améliorer les pratiques. Mon
enquête, modeste au demeurant, vise
aussi à comprendre les préoccupations
des oncologues afin d’identifier les
bons leviers susceptibles de favoriser
une meilleure approche de la situation
de l’arrêt des traitements.
Il ressort des entretiens que vous
avez conduits que la demande de
poursuite des traitements est
plus le fait des patients que des
oncologues.
Dr Chvetzoff : Qui ne demanderait
pas à continuer un traitement si cela
permet de rester en vie ? Mais c’est
une chose que le malade en fasse
la demande. C’en est une autre que
les médecins y répondent toujours
dans le même sens, en acceptant.
Je crois que c’est une façon d’éviter
une discussion difficile, pour le
patient comme pour l’oncologue. Je
ne suis pas certain qu’il faille éviter
les discussions difficiles. Certes, le
médecin ne doit pas aller au-delà de
ce que le patient peut entendre. Mais il
me semble qu’il ne faut pas considérer
a priori que le malade n’est pas en
mesure d’entendre.
D’après vous, les patients
disposent en eux des ressources
pour faire face ?
Dr Chvetzoff : Je pense que c’est le cas.
Comme l’ont montré plusieurs études,
le fait de délivrer une information
honnête et sincère constitue un
facteur d’espoir pour les malades.
Même lorsque les nouvelles ne sont pas
bonnes. Car le fait d’être honnête de la
part du médecin inscrit l’échange avec
le patient dans une relation humaine
vraie, ce qui est essentiel. Par ailleurs,
il faut certainement distinguer les
attentes et l’espoir. Ce sont deux
choses différentes. D’un côté, il y a
ce que l’on peut faire. De l’autre, il y
(suite de la page 1)
a l’espoir, qui se situe dans
une dimension plus abstraite,
plus inaccessible. Il est tout à
fait normal d’avoir de l’espoir
même quand on ne peut plus
attendre un résultat objectif.
En d’autres termes, vous
invitez les oncologues à
parler avec leurs patients
de l’arrêt des traitements.
Dr Chvetzoff : Il ne faut bien
sûr pas s’attendre à ce que
l’annonce d’une mauvaise
nouvelle soit facile pour celui
qui la donne et agréable pour
celui qui la reçoit. Pour autant,
il ne faut pas renoncer à dire
au prétexte que ce serait trop
difficile pour le patient. Il y a trente
ans, on considérait que l’on ne pouvait
pas dire le diagnostic de cancer
parce que ce n’était pas supportable.
Aujourd’hui, le diagnostic est énoncé
et les gens le supportent. Par rapport
à l’arrêt des traitements, c’est un peu
pareil. Bien entendu, dans un premier
« Au final, ce qui
compte, c’est de ne pas
abandonner le patient.
C’est ce que souhaitent
tous les malades. »
après l’arrêt des traitements. C’est
un vrai problème. Il faudrait que les
consultations soient poursuivies. Ce
n’est pas parce qu’une consultation
ne se conclut pas par une prescription
qu’elle a été inutile pour le patient,
bien au contraire dans ce type de
situation.
Qu’est-ce qui vous a le plus étonné
au cours de vos entretiens ?
Dr Chvetzoff : Même si je m’y
attendais un peu, j’ai été surprise
par l’implication émotionnelle des
oncologues. Ils ne sont pas des
rocs penchés sur leurs données
statistiques. Le souhait de bien faire,
l’attachement pour les patients, la
peur de les blesser, tout cela est très
présent chez eux.
Pour autant, est-ce un sujet dont
vos confrères parlent entre eux ?
Dr Chvetzoff : Non, ce n’est jamais
évoqué. Chacun se débrouille comme
il peut dans son coin. Cependant,
depuis environ deux ans, je constate
que cette question émerge dans les
congrès médicaux. Plusieurs équipes
travaillent également à des projets
de recherche sur ce thème. On peut
donc espérer voir apparaître des
outils et des approches qui aideront
les oncologues et les patients. Même
si, au final, la question de l’arrêt des
traitements restera avant tout une
affaire de cas particuliers, chaque
patient étant unique.
temps, beaucoup de patients ont une
réaction de colère ou de révolte. C’est
naturel. La question essentielle pour
les oncologues, c’est d’être en mesure
de recevoir ce type de réactions et
d’émotions, et de poursuivre malgré
tout la relation. Car au final, ce qui
compte, c’est de ne pas abandonner le
patient. C’est ce que tous les malades
disent : avant tout, ils ne veulent pas
être abandonnés.
Mais en pratique, après un arrêt de
traitement, est-ce que la relation
entre l’oncologue et le patient est
réellement poursuivie ?
Dr Chvetzoff : C’est variable selon les
structures. Il est évident que dans
certains centres, les patients ne
voient presque plus leur oncologue

FCPRCC
• LNCC – Paris
Coordonnateur médical : Dr F. May-Levin / Logistique : M. Lanta
Etat des lieux : 30 patients
• BECT – Paris
Coordonnateur médical : Dr J. Genève / Logistique : Mme C. Gamet
• ARCAD – Paris
Coordonnateur : Mme M. de Bausset
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Léon Bérard – Lyon
Coordonnateurs : Mme Z. Abdelbost, Mme C. Baconnier
Etat des lieux : 2 patients, soumission des protocoles pour relecture
• Institut Bergonie – Bordeaux
Coordonnateur : Mme S. Louchet, Mme M. Birac
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Institut Paoli Calmettes – Marseille
Coordonnateur : Dr D. Genre
Etat des lieux : 2 patients, soumission des protocoles pour relecture
• Centre Oscar Lambret – Lille
Coordonnateurs : Mme S. Clisant, Mme Y. Vendel
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Antoine Lacassagne – Nice
Coordonnateur : Mme C. Lovera
Etat des lieux : 1 patient
• Institut Jean Godinot – Rei ms
Coordonnateur : Mme M.-L. Manche-Thevenot
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Val d’Aurelle-Paul Lamarque – Montpellier
Coordonnateurs : Dr J-P. Bleuze, Mme B. Pont
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre René Huguenin – Saint-Cloud
Coordonnateur : Dr E. Fourme
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Alexis Vautrin – Nancy
Coordonnateur : Dr E. Luporsi
Etat des lieux : 2 patients, soumission des protocoles pour relecture
• Centre René Gauducheau – Nantes
Coordonnateur : Mme G. Perrocheau
Etat des lieux : 2 patients
• Centre Jean Perrin – Clermont-Ferrand
Coordonnateur : Mme G. Niezgodzki
Etat des lieux : 1 patient
• Institut Curie – Paris
Coordonnateurs : Dr S. Maral, Mme M. Le Begue
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
• Centre Georges-François Leclerc – Dijon
Coordonnateur : Mme S. Tiago
Etat des lieux : soumission des protocoles pour relecture
Lors de la dernière assemblée plénière de la Fédération des Comités de
Patients, qui s’est tenue à Paris le 22 juin dernier, le Pr Jacqueline Godet,
vice-présidente de la Ligue Nationale contre le Cancer, chargée de la
recherche, a brossé le panorama des progrès thérapeutiques réalisés au
cours des dix dernières années. Ce fut l’occasion de constater à quel
point ces progrès ont été importants pour le traitement des cancers et de
revenir sur toutes les pistes de recherche en cours d’exploration.
Dans un premier temps, le Pr Godet a rappelé ce constat publié dans un
rapport de l’Institut National du Cancer en avril 2010 : aujourd’hui, on
estime que 38 % des personnes atteintes d’un cancer pourront guérir de
leur maladie. Cette estimation statistique est à prendre avec précaution,
car la probabilité de guérison dépend notamment du type de cancer,
certain étant de nettement meilleur pronostic que d’autres. Néanmoins,
cela témoigne des progrès accomplis.
Ces progrès sont en partie liés à l’amélioration du dépistage des cancers.
Grâce aux campagnes d’information et au perfectionnement des outils
de diagnostic, la maladie est désormais identifiée plus souvent plus tôt.
Sachant que plus un cancer est pris en charge à un stade précoce et
meilleures sont les chances de succès thérapeutiques.
Les progrès sont dus aussi à ce que le Pr Jacqueline Godet a qualifié de
« grands pas », à savoir les avancées de la génomique et la mise au point
de thérapies ciblées. Avec la génomique, c’est-à-dire le décryptage des
mécanismes des cancers par l’étude des gènes, il est aujourd’hui possible
de définir ce que l’on appelle des « signatures » ; celles-ci permettent,
dans un certain nombre de cas, de prévoir le risque d’évolution de la
maladie et d’adapter les traitements en conséquence. Avec la génomique,
on s’oriente de plus en plus vers une individualisation de la prise en
charge thérapeutique.
le P A s e n A v A n t d e s t h é r A P i e s C i b l é e s
De leur côté, les thérapies ciblées sont utilisées pour détruire les
cellules cancéreuses grâce à des molécules dirigées spécifiquement
contre certaines anomalies de ces cellules, sans atteindre les cellules
normales. Plusieurs types de « cibles » sont possibles. Il existe ainsi
des médicaments qui bloquent la prolifération des cellules tumorales en
inhibant une enzyme favorisant leur multiplication. D’autres médicaments
sont des anticorps qui ciblent un récepteur spécifique à la surface des
cellules cancéreuses et empêchent celles-ci de recevoir des signaux
favorisant leur développement. D’autres encore empêchent la production
de nouveaux sanguins destinés à « alimenter » les cellules tumorales.
Contre différents types de cancers, les thérapies ciblées ont permis
d’obtenir des améliorations substantielles du pronostic pour les malades.
Ils ne sont toutefois pas dénués d’effets indésirables plus ou moins
sérieux et peuvent perdre de leur efficacité au fil du temps en raison de la
survenue de mutations de résistance au sein des cellules tumorales.
La recherche sur les thérapies ciblées est particulièrement active et
nul doute que de nombreux nouveaux médicaments de ce type seront
mis à la disposition des oncologues et des malades dans les prochaines
années. Il est également probable que seront associés plusieurs de ces
thérapies afin d’accroître leur efficacité. Dans le même temps, les travaux
de génomique et sur les marqueurs biologiques devraient contribuer à
poursuivre l’individualisation des traitements, afin que, dans un avenir
que l’on souhaite le plus proche possible, chaque malade puisse recevoir
les médicaments qui lui sont le plus adaptés pour une efficacité la plus
optimale possible.
• Fédération des Comités de Patients
re C h e r C h e t h é r A p e u t i q u e
Une décennie de progrès

Réalisation : RCP Communication
• Actualité
Co n g r è s d e l’AsCo 2010
Le point sur les dernières
avancées thérapeutiques
Le congrès annuel de l’ASCO (American Society of Clinical
Oncology) est sans conteste le plus important congrès médical
au monde consacré à la recherche sur les cancers. La dernière
édition de cette conférence s’est tenue en juin dernier à Chicago.
Lors de l’assemblée plénière de la Fédération des Comités de
Patients, fin juin, le Dr Jean Genève (FNCLCC) a fait le point
sur plusieurs informations thérapeutiques importantes.
Une avancée importante pour le
traitement du mélanome
Les résultats d’un essai international
évaluant un nouveau médicament appelé
ipilimumab constituent le premier progrès
important obtenu depuis longtemps pour
le traitement des mélanomes à un stade
avancé. L’ipilimumab est un anticorps
monoclonal dont l’action favorise
l’activité des défenses immunitaires
contre les cellules tumorales. L’essai
dont les résultats ont été présentés
au congrès de l’ASCO a concerné 676
patients atteints d’un mélanome à un
stade avancé et pour lesquels un premier
traitement avait été inefficace. Dans cette
situation, les options thérapeutiques
étaient jusqu’à présent très limitées.
Les patients ont reçu soit l’ipilimumab
seul, soit ce dernier associé à un vaccin
(appelé gp100), soit le vaccin seul.
Il a été observé une augmentation de la
durée médiane de survie (c’est-à-dire
le temps écoulé jusqu’au décès de 50 %
des patients) chez les participants qui
ont reçu l’ipilimumab : 10,1 mois par
rapport à 6,4 mois chez ceux qui ont
reçu uniquement le vaccin. Après un an
de suivi, 45 % des patients ayant reçu
l’anticorps monoclonal étaient toujours
vivants, ce qui était le cas de 25 % de
ceux traités uniquement avec le vaccin.
Le traitement par ipilimumab est ainsi
associé dans cet essai à une réduction
de 34 % du risque de décès.
Ce nouveau médicament n’est pas dénué
d’effets indésirables. Ceux-ci peuvent
même être graves mais ils sont le plus
souvent réversibles avec une prise en
charge appropriée.
Avec cet essai, c’est la première fois
depuis plus de 30 ans qu’une amélioration
de la durée de vie des personnes atteintes
d’un mélanome à un stade avancé est
observée.
Un nouveau traitement de référence
contre le cancer du pancréas
Un schéma thérapeutique appelé
folfirinox, associant quatre molécules,
a permis d’obtenir une augmentation du
taux de réponse et de la durée de vie par
rapport au traitement standard chez des
patients atteints d’un cancer du pancréas
avec des métastases. Réalisé en France
par la Fédération Nationale des Centres
de Lutte contre le Cancer (FNCLCC) et
la Fédération Française de Chirurgie,
l’essai ACCORD 11/0402 a inclus 342
patients qui ont reçu soit le folfirinox soit
le traitement standard (la gemcitabine).
L’essai a été interrompu après qu’une
analyse intermédiaire ait montré une
nette supériorité du premier par rapport
au second.
Ainsi, le taux de réponse partiel est de
31 % dans le groupe folfirinox par rapport
à 9,4 % dans le groupe gemcitabine.
De même, la durée médiane de survie
est respectivement de 11,1 mois par
rapport à 6,8 mois. Après un an de suivi,
48,4 % des patients ayant reçu le schéma
folfirinox étaient toujours vivants en
comparaison de 20,6 % de ceux traités
par gemcitabine.
Toutefois, le traitement par folfirinox
s’avère entraîner davantage d’effets
indésirables, parfois sévères, notamment
sur le plan hématologique et gastro-
intestinal. Il n’empêche que ce schéma
thérapeutique constitue une avancée
certaine et qu’il fait d’ores et déjà figure
de nouveau traitement de référence pour
la prise en charge des patients présentant
un cancer du pancréas à un stade avancé.
La FNCLCC a d’ores et déjà prévu
d’évaluer le folfirinox pour le traitement
du cancer du pancréas à un stade plus
précoce (traitement adjuvant).
En bref
• Un gain du délai sans progression
dans le traitement du cancer de
l’ovaire à un stade avancé. Un essai
a montré qu’un traitement d’entretien
par l’anti-angiogénique bévacizumab a
permis d’augmenter la durée du temps
sans progression de 3,8 mois.
• Un nouveau traitement de référence
dans le traitement du cancer de
la prostate localement avancé. La
déprivation androgénique (appelée
aussi « castration chimique ») associée
à la radiothérapie permet d’améliorer
la survie globale par rapport au
traitement androgénique seul, sans
surcroît de toxicité.
• Cancer du sein : intérêt d’une
radiothérapie ciblée. Une étude
internationale indique qu’une
radiothérapie ciblée réalisée pendant
l’intervention chirurgicale visant à
enlever la tumeur (radiothérapie
peropératoire) est toute aussi
efficace que la radiothérapie externe
classique, tout en exposant à moins
d’effets indésirables et en étant moins
contraignante pour les patientes.
Cette lettre d’information est éditée par le BECT de la FNCLCC et la Ligue Nationale Contre
le Cancer pour rendre compte des activités de la Fédération des Comités de Patients pour la
Recherche Clinique en Cancérologie.
Site web : www.asco.org
1
/
4
100%