Fécondité du dialogue entre philosophie et psychiatrie – Philosophy

46 | La Lettre du Psychiatre • Vol. V - n° 3 - mai-juin 2009
DOSSIER THÉMATIQUE
Actualité de la philosophie
en psychatrie
Fécondité du dialogue entre
philosophie et psychiatrie
Philosophy and psychiatry: a fruitful dialogue
F. Dastur*
C
e qui donne à la psychiatrie sa position à
part au sein de la médecine est le lien indis-
soluble qu’elle entretient avec la pratique,
de sorte qu’elle ne peut pas se transmettre par un
enseignement qui serait uniquement théorique. Ce
à quoi est en effet confronté le psychiatre, c’est à
ce qu’il y a d’incompréhensible en l’homme, lequel
est, en tant qu’existant, un mystère non seulement
pour les autres mais aussi pour lui-même. Or c’est
précisément en ce point que la médecine rencontre
nécessairement la philosophie, puisque celle-ci
consiste aussi à vouloir comprendre l’incompré-
hensible et à se donner pour tâche de reprendre
à son compte les grandes questions existentielles
qui sont déjà celles que l’humanité s’est posées
depuis toujours à travers les mythes, les religions,
l’art et l’ensemble de la culture.
La médecine en tant qu’art
Il est nécessaire de s’interroger d’abord sur le statut
à donner à ce que les Latins nomment medicina,
“art de porter remède”, et les Grecs, d’une manière
peut-être plus appropriée, therapeia, mot dont le
sens premier est “culte rendu aux dieux” et “soin
religieux”, et qui signifie par extension “le soin
médical, le traitement”. Le caractère probléma-
tique de cette discipline, à laquelle on ne sait s’il
faut donner le nom de science ou d’art, doit donc
être d’entrée de jeu souligné. Sa spécificité réside
en effet, comme c’est le cas pour toute pratique,
dans un faire, mais il s’agit d’un faire qui ne produit
pourtant aucune œuvre. Le médecin n’est pas à
cet égard comparable à un artisan ou à un tech-
nicien, car on ne peut dire de lui qu’il “fabrique”
la santé mais seulement qu’il vise au rétablisse-
ment de celle-ci, rétablissement qu’il peut certes
favoriser mais non provoquer. C’est ce qu’Aristote,
lui-même fils de médecin et premier philosophe
à avoir vu dans la médecine non pas un simple
savoir-faire empirique mais une véritable science
pratique, a bien mis en évidence. Il explique en
effet dans un passage du livre II de sa Physique
(1) que le médecin qui, malade, entreprend de se
guérir lui-même n’est pas en tant que médecin le
principe de sa guérison, ce qu’il est pourtant en
tant qu’homme, c’est-à-dire en tant qu’être vivant
faisant partie de la nature (1). Martin Heidegger,
qui cite et commente ce passage dans l’un de ses
séminaires, souligne que le savoir médical peut au
mieux hâter la guérison, mais non la produire, car
c’est la nature et elle seule qui constitue le prin-
cipe de la santé (2). Comme l’explique à son tour
Hans-Georg Gadamer, philosophe qui a consacré
toute une série de conférences et d’articles à la
médecine, on ne peut jamais savoir “dans quelle
mesure le succès d’une guérison revient au trai-
tement habile du médecin et dans quelle mesure
la nature ne s’est pas aidée elle-même” (3). Le
médecin n’agit donc qu’en simple auxiliaire de la
nature, au service de laquelle il s’est mis par le
savoir qu’il a amassé au cours de sa formation.
C’est cette assistance apportée à la nature qui
constitue le principe du succès de toute action
médicale – celle-ci doit viser à son autosuppression
en se rendant superflue. Il ne peut donc jamais être
question en médecine d’une parfaite maîtrise d’un
savoir-faire qui pourrait trouver son attestation
dans la production d’une œuvre réussie. Comme
H.G. Gadamer le souligne, il s’agit bien plutôt pour
le médecin de faire preuve de prudence, de cette
vertu que les Grecs nommaient phronèsis, afin de
parvenir à s’immiscer à l’intérieur de l’équilibre
naturel sans lui faire violence. C’est là ce qui fait
la spécificité tout à fait unique de la médecine,
* Professeur honoraire de philosophie
rattachée aux Archives Husserl de
Paris (ENS Ulm), F. Dastur a enseigné à
l’université Paris-I (Sorbonne) de 1969
à 1999, à l’université Paris-XII (Créteil)
de 1995 à 1999 et à l’université de
Nice de 1999 à 2003. Son travail
porte plus particulièrement sur la
phénoménologie et sur l’idéalisme
allemand, et elle a fondé en 1993
l’École française de Daseinsanalyse
(analyse existentielle). Elle a publié de
très nombreux articles en français, en
anglais et en allemand, collaboré à des
traductions d’œuvres de Nietzsche,
Fink, Husserl et Boss et est l’auteur
d’une quinzaine de livres.
Dernières publications :
Comment affronter la mort ? Paris :
Bayard, 2005.
Heidegger. La question du logos. Paris :
Vrin, 2007.
La mort. Essai sur la finitude. Paris :
PUF, 2007.

La Lettre du Psychiatre • Vol. V - n° 3 - mai-juin 2009 | 47
Résumé
dont H.G. Gadamer souligne qu’ “elle représente,
au sein des sciences modernes, une unité théo-
rique qui associe une connaissance théorique et
un savoir pratique, mais qui ne peut en aucun cas
être comprise comme l’application pratique d’une
science”, de sorte qu’elle “est une forme particulière
de science pratique, concept qui a disparu de la
pensée moderne” (4).
Certes, tout dans la médecine moderne ne relève
pas de cette science pratique. Car la nature que la
science moderne prend comme objet n’est pas la
nature telle qu’elle a été définie jusqu’ici, à partir
du concept grec de physis, comme cet ordre global
et ce principe d’équilibre capable de se maintenir de
lui-même à travers le changement. Il s’agit d’une
nature objectivée au sein de laquelle les rapports
de cause à effet sont isolés, de sorte que l’événe-
ment naturel est considéré comme relevant de lois
mathématiquement quantifiables, permettant ainsi
à l’homme non seulement d’agir sur elles mais aussi
de contrôler avec précision ses propres interven-
tions. Cependant, ces interventions mêmes, qui
relèvent d’un tout nouveau concept de la technique
comprise comme application d’un savoir, ne consti-
tuent pas à proprement parler une thérapie, un
service rendu à la nature, mais plutôt un artisanat
hautement perfectionné, comme l’est l’acte chirur-
gical, qui ne prend sens qu’à partir du moment où
l’on a dissocié la maladie de la personne et où on
la traite comme une entité à part dont il s’agit de
se rendre maître. La médecine prend aujourd’hui
de plus en plus la forme d’une telle technique,
c’est-à-dire d’une science appliquée. Or, plus le
domaine de l’application s’élargit, plus la place
du jugement personnel et de la science pratique
du médecin se réduit, et plus l’acte médical prend
une forme impersonnelle. La médecine moderne a
certes accompli d’immenses progrès au cours des
deux derniers siècles. Il faut toutefois reconnaître
que le domaine de ce qui ne peut pas être soumis
aux techniques médicales d’aujourd’hui demeure
important et qu’à cet égard, comme H.G. Gadamer
le souligne, la médecine clinique qui sert de fonde-
ment à la recherche dans la médecine moderne “ne
représente […] qu’un infime secteur comparée à
l’étendue du problème humain auquel l’ensemble
de l’art médical est censé répondre” (5).
La maladie
en tant que phénomène
existentiel global
C’est ici la notion de “tout”, ce que les Grecs
nommaient holon, qu’il s’agit de prendre en
considération, car c’est à partir d’elle que philoso-
phie et médecine peuvent être mises en relation.
Platon, dans un passage de l’un de ses Dialogues,
le Phèdre, établit un parallèle entre l’art oratoire et
l’art médical en ce que le premier concerne l’âme
et le second le corps, et explique, par la bouche de
Socrate, qu’il est impossible de connaître la nature
de l’âme sans connaître la nature du tout. Ce à
quoi son jeune interlocuteur réplique qu’à en croire
Hippocrate, le fondateur de la médecine grecque, on
ne peut comprendre quelque chose au corps que de
la même manière. H.G. Gadamer, qui cite ce passage
(6), veut ainsi opposer le caractère holistique de
la médecine grecque à la spécialisation du savoir
propre aux sciences modernes. Car ce que prend en
compte cette médecine antique, c’est l’ensemble du
contexte naturel et de l’environnement social dans
lequel vit le malade. Ce qui est donc en question
pour elle est ce qui constitue le fondement même
de la santé, à savoir un rapport harmonieux avec le
milieu à la fois naturel et culturel, que le malade,
qui l’a perdu, doit précisément se réapproprier.
H.G. Gadamer explique en effet que la santé n’est
autre que ce constant processus de stabilisation de
l’équilibre qui est à l’œuvre dans ces phénomènes
rythmiques que sont le souffle, le métabolisme
et le sommeil, lesquels, comme on le sait bien,
ne sont pas perturbés par des causes purement
physiques, le “tout” dont parle Platon englobant
l’ensemble de la situation existentielle du malade.
On en arrive ainsi à une définition beaucoup plus
complète de la maladie que celle que nous donne
la science biologique, puisque la perte de l’équi-
libre qu’elle constitue ne renvoie pas seulement à
un état de fait biologico-médical, mais aussi à un
événement biographique et social (7). Dès lors,
on mesure le danger que comporte en elle-même
toute intervention, puisque toute tentative de
compenser un trouble de cet équilibre par l’action
d’un contrepoids menace d’entraîner une perte
d’équilibre nouvelle.
La médecine n’est ni une science théorique ni une technique, mais davantage un art ou une
science pratique. Le rôle du médecin ne consiste pas à provoquer, mais simplement à favo-
riser le rétablissement de la santé chez celui qui a perdu son équilibre à la fois biologique et
existentiel. C’est à partir d’une telle conception holistique de la maladie que s’impose l’idée
que le traitement médical passe nécessairement par une relation de langage entre médecin et
malade. Or c’est dans le cadre de la psychiatrie que la relation thérapeutique prend sa forme
la plus problématique, ce qui rend nécessaire le dialogue entre médecins et philosophes.
Mots-clés
Art médical
Thérapie
Dialogue
Analyse existentielle
Sollicitude
Highlights
Medicine is neither a theoretical
science nor a technology, but
an art or a practical science. The
physician’s role does not consist
in inducing, but merely in facili-
tating the recovery of the health
of the patient who has lost at
the same time his biological
and existential balance. Such
a holistic conception of what
is a disease imposes the idea
that the medical treatment
involves necessarily a rela-
tion of language between the
physician and the patient. It is
in the domain of psychiatry that
the therapeutic relation finds
its most problematic form,
which leads to the necessary
dialogue between physicians
and philosophers.
Keywords
Medical art
Therapy
Dialogue
Existential analysis
Concern

48 | La Lettre du Psychiatre • Vol. V - n° 3 - mai-juin 2009
Fécondité du dialogue
entre philosophie et psychiatrie
DOSSIER THÉMATIQUE
Actualité de la philosophie
en psychatrie
Il n’est évidemment pas question de nier par là l’ap-
partenance de l’être humain à l’ordre de la nature
ni de lui reconnaître, en alléguant des fondements
religieux ou métaphysiques, un statut “privilégié”
par rapport à l’ensemble des vivants. Ce qui importe,
c’est de prendre en considération la spécificité que
représente le fait humain, en s’appuyant sur les
travaux les plus récents des biologistes, des ethno-
logues et des historiens, qui mettent en évidence,
comme le souligne H.G. Gadamer, que “c’est dans ce
que l’homme a de pleinement naturel qu’il apparaît
justement comme un être extraordinaire”, par le
fait “qu’il est le seul parmi les autres êtres vivants à
transformer son propre environnement en environ-
nement culturel” (8). Il s’agit donc tout simplement
de mettre l’accent sur ce que l’être humain a de
spécifique, et qui est précisément sa capacité en tant
qu’existant à reprendre à son compte la situation
de fait qui est la sienne et à la transformer. C’est ce
qu’un autre philosophe, Maurice Merleau-Ponty, a
particulièrement bien mis en lumière dans Phénomé-
nologie de la perception, lorsqu’il s’efforce de rendre
compte de l’expérience qu’a un individu de son corps
propre. C’est en effet à propos de la manière dont
l’existant se rapporte à sa propre corporéité physique
qu’il déclare : “L’existence n’a pas d’attributs fortuits,
pas de contenu qui ne contribue à lui donner sa
forme, elle n’admet pas en elle-même de pur fait
parce qu’elle est le mouvement par lequel les faits
sont assumés” (9). Aucun des attributs de l’homme
ne peut être considéré comme “extérieur” à lui du
seul fait qu’il les existe, qu’il existe donc la mort et la
naissance tout comme la maladie, en d’autres termes
qu’il se comporte vis-à-vis de ces déterminations de
son être et qu’il les intègre à la conception qu’il a de
lui-même. Il est donc nécessaire de réaffirmer avec
force aujourd’hui que toute maladie est totale et ne
concerne pas seulement une partie de l’organisme,
mais l’être au monde tout entier du malade, et cela
est vrai du mal le plus bénin, qui, aussi localisé qu’il
soit, affecte l’ensemble du comportement. Et c’est
plus particulièrement évident encore dans les affec-
tions dites “psychosomatiques”.
Traitement médical et dialogue
Qu’est-ce qui constitue en effet ce que l’on peut
nommer, avec Helmut Plessner, un des fondateurs
de l’anthropologie philosophique (10), “l’excentri-
cité” de l’homme, à savoir ce qui le distingue de
manière spécifique au sein de la nature ? N’est-ce
pas précisément la faculté de parole que possède en
propre l’être humain qui fait la véritable différence
entre la société humaine et les sociétés animales ?
Merleau-Ponty, qui a développé toute une philoso-
phie de l’expression, considère lui aussi que l’acte
de parole a pour vertu d’ouvrir “dans l’épaisseur
de l’être” ces “zones de vide” par lesquelles l’être
humain échappe à l’enfermement dans une nature
(11). C’est à partir de là que l’on peut comprendre sa
formule : “La parole est l’excès de notre existence sur
l’être naturel” (11). Cet excès, qui fait de l’homme un
être qui, en quelque sorte, a “surmonté” la nature,
est au fondement de l’histoire et de la culture qui
font que l’être humain appartient dès sa naissance
à un monde intersubjectif. Comment communi-
quons-nous avec les autres, si ce n’est par toute
une gestuelle dont le langage fait partie ? Comme
le souligne Merleau-Ponty : “La communication ou
la compréhension des gestes s’obtient par la réci-
procité de mes intentions et des gestes d’autrui,
de mes gestes et des intentions lisibles dans la
conduite d’autrui. Tout se passe comme si l’inten-
tion d’autrui habitait mon corps ou comme si mes
intentions habitaient le sien” (12). C’est parce que je
peux reprendre à mon compte le geste d’autrui que je
peux le comprendre, ce qui implique que le spectacle
qui m’est ainsi donné n’a pour moi de sens que s’il
rencontre des possibilités qui sont miennes et qu’il
a précisément pour vertu d’éveiller. Si, précise alors
Merleau-Ponty, on voulait répondre à la question
de l’origine du langage, il faudrait en chercher “les
premières ébauches dans la gesticulation émotion-
nelle par laquelle l’homme superpose au monde
donné le monde selon l’homme” (13). La langue
n’est donc pas simplement un “code” de communi-
cation, mais cet espace de dialogue au sein duquel
se constitue tout monde humain.
C’est donc nécessairement en tant qu’êtres de
dialogue que se rencontrent d’abord le médecin et
le malade, comme le rappelle d’ailleurs le terme
français “consultation”, qui sert à désigner la nature
de la rencontre médicale. Il faut certes reconnaître
que, dans le monde moderne, le dialogue entre le
médecin et le malade est devenu difficile, et qu’il
tend même à être escamoté dans les turbulences
d’un monde hospitalier où le patient est parfois
réduit à l’anonymat d’un cas à traiter. Une maladie
n’est pourtant pas d’emblée cet état identifiable
auquel la science médicale est capable de donner
un nom, c’est avant tout une expérience que vit le
patient et dont il a d’abord tenté, par lui-même,
de devenir maître. Car s’efforcer d’oublier ou d’oc-
culter le trouble ressenti relève, en tant que tel, de
cette technique d’équilibration inhérente à la vie et

La Lettre du Psychiatre • Vol. V - n° 3 - mai-juin 2009 | 49
DOSSIER THÉMATIQUE
que la maladie met en échec. La conscience de la
maladie n’est donc nullement un acte théorique qui
proviendrait d’une capacité d’auto-objectivation,
mais elle représente en elle-même un problème
existentiel qui touche la personne tout entière, et
c’est précisément cette situation qui est à l’origine
de la consultation médicale. C’est ce qui explique
qu’avant de procéder, par le recours aux tech-
niques de mesure, à l’établissement d’un diagnostic,
il est nécessaire que le médecin commence par
demander à son patient s’il se sent malade. En
effet, l’aide que le médecin est censé lui apporter
ne consiste pas seulement à éliminer des déficiences
somatiques mais à ramener à un état d’équilibre un
être qui a perdu ses repères vitaux et existentiels.
C’est la raison pour laquelle l’aide ainsi apportée
passe essentiellement par le dialogue, un dialogue
qui ne doit pas se distinguer de manière radicale de
ceux dont nous faisons l’expérience dans le cadre de
notre vie sociale. Car le médecin est ici en quelque
sorte dans la position qui est celle de Socrate dans
les dialogues platoniciens. Il occupe moins la posi-
tion du maître ou de l’informateur que de celui qui
amène l’autre à voir les choses par lui-même, de
sorte que le dialogue entre lui et son patient ne doit
viser qu’à rendre possible une collaboration entre
eux. C’est, affirme Gadamer, “à travers le dialogue
seulement que l’on tente d’atteindre le véritable but
visé qui est de réenclencher chez le patient le flux
communicatif propre à la vie ainsi que les contacts
avec autrui desquels le psychotique est exclu de
manière si funeste” (14).
Analyse existentielle
et psychiatrie
Tout ce que Gadamer a dit de l’art médical s’ap-
plique non seulement à la médecine dite “soma-
tique”, dont on a vu pourtant qu’elle est elle aussi
en réalité d’ordre psycho-somatique, mais aussi, et
de manière privilégiée, à la psychiatrie. La difficulté
majeure que rencontre le psychiatre, à cet égard,
réside en ce que, contrairement au médecin de la
médecine somatique, il ne peut pas s’en tenir à la
conscience qu’a son patient de sa maladie, car celle-ci
est elle-même affectée par la maladie. Le problème
de l’interprétation des troubles que présentent ses
patients se pose donc de manière particulièrement
aiguë pour le psychiatre, du fait qu’ils semblent
se dérober à toute compréhension, rendant ainsi
la collaboration nécessaire à la guérison des plus
problématique. Il semble en effet, souligne Gadamer,
qu’aucune herméneutique ne puisse parvenir à fran-
chir l’abîme qui sépare le psychiatre du malade dit
“mental”, bien que le dialogue, qui est ce qui nous
caractérise au plus profond en tant qu’humains,
doive revendiquer là aussi son droit (15). Ce qui est
requis pour cela, c’est moins la connaissance scienti-
fique et technique et l’expérience professionnelle du
psychiatre d’aujourd’hui, dont on sait qu’il dispose
d’instruments de mesure extrêmement précis et d’un
ensemble de données dûment catégorisées, que sa
capacité à établir une véritable collaboration avec
son patient. C’est en ce point précis que le dialogue
que seraient susceptibles de nouer psychiatres et
philosophes pourrait s’avérer fécond.
C’est précisément un tel dialogue qui a eu lieu entre
le psychiatre Médard Boss et le penseur Martin
Heidegger, comme en témoignent les Zollikoner
Seminare, ce volume réunissant les retranscrip-
tions des séminaires de Heidegger qui se tinrent
dans la maison de Médard Boss à Zollikon, et qui
réunirent plusieurs fois par an pendant dix ans, de
1959 à 1969, une assistance de quelque soixante
à soixante-dix étudiants en médecine, jeunes psy-
chiatres et psychiatres confirmés (16). Médard
Boss a découvert chez ce penseur le modèle même
de la relation thérapeutique qu’il a décrite dans
Être et Temps sous la forme de ce qu’il nomme la
“sollicitude devançante”, laquelle s’oppose à une
autre sorte, sans doute plus fréquente mais moins
authentique, de sollicitude, celle qui, visant à se
substituer à l’autre, n’est pas toujours exempte de
violence.
Comme le montrent bien les séminaires de Zollikon,
la méthode de l’analyse existentielle, qui seule
donne accès aux phénomènes humains en tant que
tels, s’oppose diamétralement à la méthode des
sciences de la nature, qui réduit ces phénomènes
à des données calculables, ce qui ne veut pourtant
nullement dire qu’elle est “non scientifique”.
Il faut donc d’emblée souligner que l’apprentissage
d’une telle méthode ne peut nullement consister à
faire de médecins des philosophes, c’est-à-dire des
théoriciens, mais simplement à les rendre attentifs
à ce qu’ils sont déjà en tant qu’êtres humains, à ce
qui les concerne donc de manière incontournable
en tant qu’êtres pensants. Ce qu’un tel apprentis-
sage requiert des participants, ce n’est donc pas la
compréhension seulement intellectuelle de ce qu’est
l’exister humain “en général”, mais bien un “engage-
ment” dans la manière d’être qui est déjà la leur et
qu’il s’agit précisément maintenant d’accomplir en
propre. Cela implique de leur part la mise hors circuit
des représentations inadéquates que l’on se fait de

50 | La Lettre du Psychiatre • Vol. V - n° 3 - mai-juin 2009
Fécondité du dialogue
entre philosophie et psychiatrie
DOSSIER THÉMATIQUE
Actualité de la philosophie
en psychatrie
l’homme du point de vue des sciences humaines,
dont la méthodologie est encore massivement sous
la domination de la méthode mathématique des
sciences de la nature. C’est la raison pour laquelle
l’enseignement dispensé par Heidegger à Zollikon
s’apparente davantage, comme le souligne Médard
Boss, à une thérapie de groupe et à une sorte de cure
heideggerienne assez semblable à la cure freudienne,
du moins dans les résistances qu’elle fait apparaître
chez les participants (17). Elle est en réalité plus
semblable encore à cette pratique de “délivrance”
qu’est la maïeutique socratique, dont Heidegger
se réclame explicitement. Car le médecin ou l’ana-
lyste, comme Socrate, est le motif et non la cause
de la guérison du malade, ce qui implique que la
relation thérapeutique est une situation humaine
caractérisée par l’“être-ensemble” du médecin et
du malade et qui ne peut nullement être réduite
à un processus objectif analogue à ce que sont les
processus naturels pour les sciences de la nature. Il
s’agit en effet de voir dans la relation thérapeutique
un “être-l’un-avec-l’autre” originaire qui n’est rien
de biologique ou de sensible, puisque, comme le
souligne Heidegger, “il n’est pas d’organe des sens
pour ce qui s’appelle l’autre” (18, 19).
À partir de là peut être mis en évidence le fait que
dans la relation thérapeutique, le médecin, en tant
qu’il est l’occasion et non la cause de la guérison
du malade, se tient très exactement dans la posi-
tion de cette sollicitude que Heidegger qualifie de
devançante parce qu’elle s’élance au-devant de
l’autre, “non point pour lui ôter son souci, mais
au contraire pour le lui restituer”, est-il dit dans
le paragraphe 26 de Être et Temps (20), alors que
la sollicitude substitutive consiste au contraire
à prendre la place de l’autre et à remplir à sa
place la tâche qui lui incombe, au risque de le
placer dans une situation de dépendance. C’est
dans cette sollicitude qui consiste à laisser être
l’autre, c’est-à-dire à le laisser déployer par lui-
même son propre “pouvoir-être”, que Heidegger
voit la forme la plus haute de la relation à autrui.
Car si la maladie en général – et la maladie dite
mentale en particulier – consiste essentiellement
en une perturbation de l’équilibre existentiel et
de la liberté, il ne peut s’agir, dans la relation
thérapeutique au sens propre, que de mettre en
œuvre une modalité de la relation qui anticipe sur
la liberté qui doit être recouvrée par le malade.
C’est donc en témoignant de sa propre liberté,
et en se conduisant non pas seulement comme
un professionnel mais aussi et en même temps
comme un être humain que le médecin peut rendre
l’autre, le malade, à la sienne. ◼
Références bibliographiques
1. Aristote. Physique, livre II, 1, 192 b 23-27.
2. Heidegger M. “Ce qu’est et comment se détermine la
physis” (1958) in Questions II. Paris: Gallimard, 1968:
205-6.
3. Gadamer HG. “Apologie de l’art médical” in Philosophie
de la santé. Paris: Grasset-Mollat, 1998:44.
4. Ibid.:50.
5. Gadamer HG. “Philosophie et médecine pratique” in
Philosophie de la santé, op. cit.:104.
6. Gadamer HG. “Traitement et dialogue” in Philosophie
de la santé, op. cit.:141.
7. Gadamer HG. “Apologie de l’art médical” in Philosophie
de la santé, op. cit.:52.
8. Gadamer HG. “Théorie, technique, pratique” in Philo-
sophie de la santé, op. cit.:23.
9. Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception.
Paris : Gallimard, 1945:198.
10. Plessner H. Mit anderen Augen, Aspekte einer philoso-
phischen Anthropologie. Stuttgart: Reclam, 1982.
11. Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception,
op. cit.:229.
12. Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception,
op. cit.:215.
13. Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception,
op. cit.:219.
14. Gadamer HG. “Traitement et dialogue” in Philosophie
de la santé, op. cit.:147.
15. Gadamer HG. “Herméneutique et psychiatrie” in Philo-
sophie de la santé, op. cit.:178.
16. Heidegger M. Zollikoner Seminare, édité par Boss M,
Klostermann, Francfort-sur-le-Main, 1987.
17. Ibid.:174.
18. Ibid.:199.
19. Dastur F. “Phénoménologie et thérapie : la question de
l’autre dans les Zollikoner Seminare” in La Phénoménologie
en question. Paris: Vrin, 2004:117-30.
20. Heidegger M. Être et Temps. Paris : Gallimard,
1986:122.
1
/
5
100%
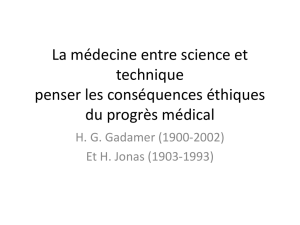
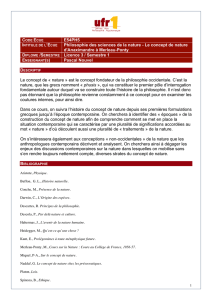
![Un pape philosophe [La Presse, 3 avril 2005] Jean Grondin](http://s1.studylibfr.com/store/data/004602676_1-91381956bcf4047a8f22ff5ea2c9d984-300x300.png)
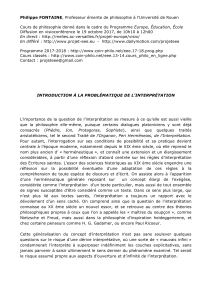
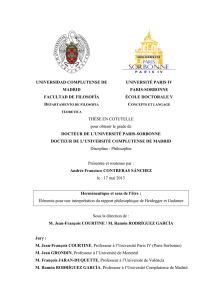

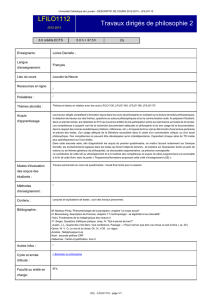
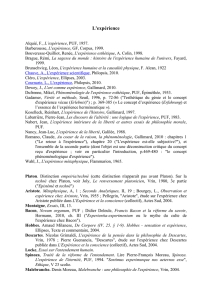
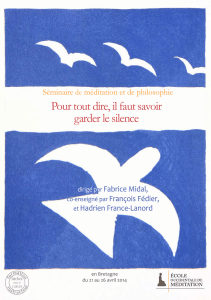

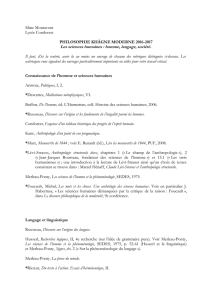
![PROPOSITIONS [Martin Heidegger] « La philosophie est une des](http://s1.studylibfr.com/store/data/003957154_1-7d167e4564521f5c2b9c483ce6d4f43c-300x300.png)