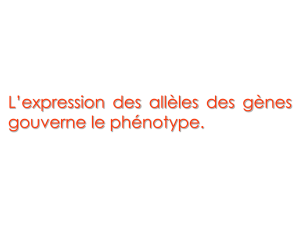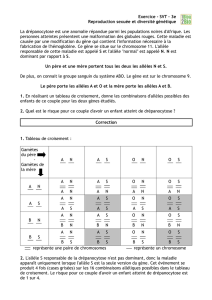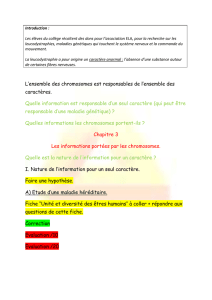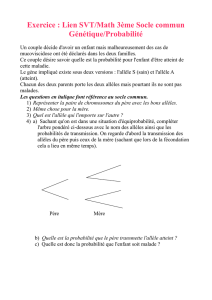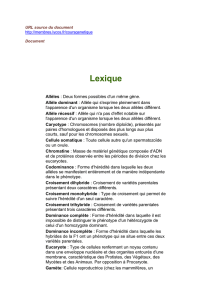2 LA GÉNÉTIQUE

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - Diffusion interdite
17
2
LA GÉNÉTIQUE
La transmission des caractères d’un couple
d’individus à ses descendants est une notion
familière qui s’impose au sens commun par
de simples observations : « il a les yeux de
sa mère, elle a les traits de son père … »
À la fin de ce chapitre, tu
seras capable de …
SAVOIR
• Définir et utiliser les mots-clés apparaissant en
rouge.
• Énoncer et expliquer les lois de Mendel.
• Expliquer la naissance de la théorie chromosomique
de l’hérédité.
• Donner les apports de Morgan à la théorie
chromosomique de l’hérédité.
• Expliquer le principe de l’établissement des cartes
factorielles et cytologiques.
• Donner les conventions pour établir un arbre
généalogique.
• Expliquer l’hérédité liée au sexe.
• Développer les étapes nécessaires à la synthèse des
protéines.
• Citer les différents types d’acides nucléiques, donner
leur composition, leurs caractéristiques et leurs rôles
dans la cellule.
• Schématiser la structure d’un nucléotide, de l’ADN,
de l’ARN et d’une protéine.
• Connaître la complémentarité des bases des acides
nucléiques.
• Donner les caractéristiques du code génétique.
• Citer et expliquer les différents niveaux de structure
des protéines.
• Décrire la réplication de l’ADN.
• Interpréter un graphique montrant la variation de la
quantité d’ADN par cellule au cours du temps.
• Donner les propriétés d’une enzyme.
• Expliquer la régulation du gène chez les
procaryotes.
• Expliquer la différenciation cellulaire au niveau
génétique.
• Citer et expliquer les différents niveaux de
régulation des gènes chez les eucaryotes.
• Distinguer les mutations génomiques,
chromosomiques et géniques.
• Expliquer les causes et les conséquences des
mutations.
• Distinguer les mutations somatiques et germinales.
SAVOIR FAIRE
• Analyser, interpréter et prédire des résultats
expérimentaux.
• Résoudre des exercices sur la transmission des
caractères héréditaires.
• Établir des cartes factorielles.
• Établir des arbres généalogiques.
• Déterminer le mode de transmission d’un caractère
sur base d’un arbre généalogique.
• Élaborer un modèle cellulaire mettant en jeu tous les
acteurs de la synthèse d’un polypeptide.
• Utiliser le code génétique.
• Comparer les différents acides nucléiques.
• Connaissant la séquence des nucléotides d’un
fragment d’ADN, modéliser la synthèse du
polypeptide correspondant.
• Connaissant la séquence des acides aminés d’un
polypeptide, retrouver une séquence possible de
nucléotides au niveau de l’ADN.
• Établir le lien entre gène et protéine.
• Comparer l’expression du gène chez les procaryotes
et chez les eucaryotes.
• Schématiser le mécanisme de la réplication semi-
conservative sur base d’une séquence connue.
• Modéliser la régulation du gène chez les
procaryotes.
• Á partir de documents, établir l’origine génétique
d’une maladie et donner ses conséquences au niveau
moléculaire, cellulaire et de l’organisme.
• Évaluer un risque génétique.

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29
18
PREMIÈRE PARTIE : La transmission des caractères héréditaires
1. L’aube de la génétique
La génétique est la branche de la biologie
qui étudie l’hérédité, à savoir la
transmission des caractères d’un être
vivant à ses descendants.
Depuis que l’Homme est devenu
cultivateur et éleveur il y a quelque 10 000
ans, il s’est intéressé à l’hérédité en
conservant pour ses semis les graines d’un
plant remarquable ou en choisissant les
meilleurs animaux pour produire la
génération suivante.
Dès le XVIIIe siècle, des esprits curieux
ont tenté d’établir des lois qui régissent la
transmission des caractères de génération
en génération, en croisant des individus
présentant diverses versions d’un
caractère. Johann Mendel (1822 - 1884),
mieux connu sous son prénom de religieux
Gregor, est le seul de ces « hybrideurs »
dont la postérité a retenu le nom.
003mendel.jpg
Contrairement à ses prédécesseurs qui
avaient étudié la ressemblance globale
d’une génération à la suivante, Mendel
s’est attaché à la transmission de
différences, en concentrant son attention
sur un nombre limité de caractères.
Expérimentateur méticuleux, Mendel
démontra que la transmission des
caractères suit des règles bien précises,
mathématiquement prévisibles. En 1865,
Mendel présenta ses travaux à la Société
de sciences naturelles de Brünn, laquelle
publia en 1866 un article « Recherches sur
les Hybrides végétaux » dans lequel
Mendel tire de nombreuses conclusions sur
la transmission des caractères héréditaires.
Ses travaux n’ont pas eu la notoriété qu’ils
méritaient.
Les travaux de Mendel furent redécouverts
en 1900 indépendamment, par trois
botanistes qui n’en eurent connaissance
qu’après leurs propres travaux : un
néerlandais, Hugo de Vries (1848 - 1935),
un allemand, Carl Correns (1864 - 1933) et
un autrichien, Erich von Tschermak (1871
- 1962).
Docs+
L’avant Mendel
Dans la Grèce antique, le philosophe Platon pense
que les semences mâle et femelle nécessaire à la
reproduction proviennent de la moelle et de
l’encéphale. D’autres, comme Hippocrate,
proposent que les semences proviennent de toutes
les parties du corps, idée qui sera reprise par
Darwin dans la théorie de la pangenèse. Pour
Aristote, les semences viennent de la partie chaude
du sang et la semence mâle, porteuse des caractères
de l’espèce et de l’individu, domine la semence
femelle : avoir un fils qui ressemble à son père est
la norme, engendrer autre chose est une
perturbation.
Jusqu’au XVIIIe siècle, le présupposé d’une
contribution différente des sexes se poursuit dans
les théories de la préformation, selon lesquelles
l’individu en miniature est déjà présent dans les
semences mâle ou femelle. Van Leeuwenhoek
(1632 - 1723), un « animalculiste » observe le
sperme au microscope et croit découvrir dans les
spermatozoïdes un minuscule enfant préformé.
Suite à la découverte des follicules ovariens par
Reinier de Graaf en 1673, Charles Bonnet, un
oviste, avance que c’est l’ovule qui contient l’être
préformé. Bonnet formule même l’idée que l’Eve
initiale devait contenir tous les germes de l’espèce
humaine emboîtés les uns dans les autres à la
manière des poupées russes.
C’est le perfectionnement des outils d’observation
et l’abandon de la référence permanente aux
anciens au profit de l’expérimentation minutieuse
qui ont permis le rejet des idées
préformationnismes et la compréhension du mode
de transmission des caractères.
2. Les lois de Mendel
Nous développerons la méthode utilisée
par Mendel chez le pois cultivé (Pisum
sativum) en analysant successivement la
transmission d’un seul caractère, des
expériences de monohybridisme, puis la
transmission de deux caractères, des
expériences de dihybridisme.

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29
19

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29
20
2.1. Expériences de Mendel sur
les pois cultivés
Mendel dispose de graines de pois de
lignées pures ou races pures, c’est-à-dire
dont les caractères étudiés (couleur de la
graine, forme de la graine, longueur de la
tige …) sont bien fixés et ne se modifient
pas au cours des générations successives
d’autofécondation.
Le croisement d’individus (P) de deux
lignées pures de pois, l’une à graines
lisses, l’autre à graines ridées, donne en
première génération (F1) 253 graines
lisses.
Mendel sème ces graines et laisse les fleurs
de ces 253 plantes ainsi obtenues
s’autoféconder. Il obtient en seconde
génération (F2), 7 324 graines dont 5 474
sont lisses et 1850 ridées, soit 75% de
lisses et 25% de ridées.
Mendel explique la réapparition des
caractères des parents en seconde
génération, par le fait que chaque caractère
(ici la forme de la graine) est conditionné
par deux facteurs héréditaires aujourd’hui
appelés allèles. Ceux-ci n’ont pas la même
force d’expression. Mendel qualifie de
récessifs les allèles qui ne se manifestent
plus en F1 pour réapparaître en F2 et de
dominants ceux qui se manifestent à
chaque génération. Les gamètes ne
contiennent qu’un seul de ces allèles.
On peut modéliser les interprétations de
Mendel en représentant l’allèle dominant
par une lettre majuscule et l’allèle récessif
par une lettre minuscule.

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29
21
L’établissement de l’échiquier de Punnett,
qui porte le nom de son inventeur Reginald
C. Punnett, un généticien anglais, permet
de déterminer les proportions des
différents génotypes et phénotypes obtenus
en seconde génération. Sur la ligne du
haut, on place les types de gamètes
produits par les mâles de première
génération, et dans la première colonne les
types de gamètes produits par les femelles
de première génération. À l'intersection
de chaque ligne et de chaque colonne, on
écrit le génotype produit de l'union du
gamète mâle avec le gamète femelle.
On observe que les allèles L et r se retrouvent en au
moins une copie dans 75 % des cas. Comme l’allèle
L est dominant, le caractère « lisse » se retrouve
dans 75 % des graines de seconde génération.
Mendel obtient des résultats semblables
pour les différents caractères étudiés.
2.2. Expériences de Correns sur
la belle-de-nuit
Le croisement de deux individus de lignées
pures de belle-de-nuit (Mirabilis jalapa),
l’une à fleurs rouges et l’autre à fleurs
blanches, donne 100% de descendants à
fleurs roses.
Ces belles-de-nuit à fleurs roses, croisées
entre elles, donnent 50% de descendants
roses, 25% de blancs et 25% de rouges.
Correns explique ces résultats en précisant
que, pour certains caractères, les deux
allèles peuvent s’exprimer chez l’hybride
de première génération en donnant un type
intermédiaire. Les deux allèles sont
codominants.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%