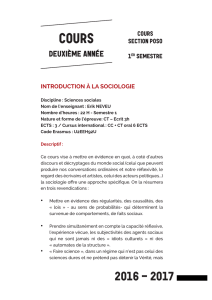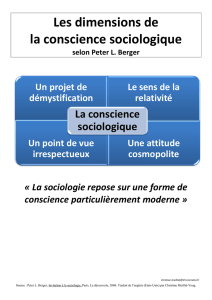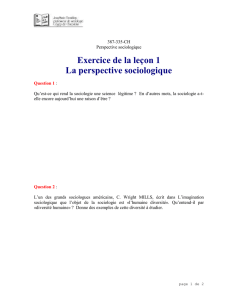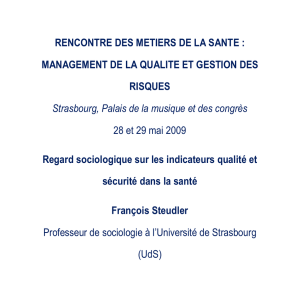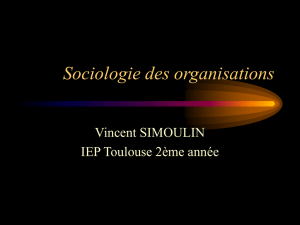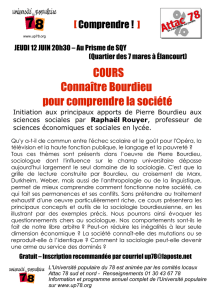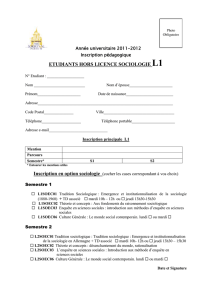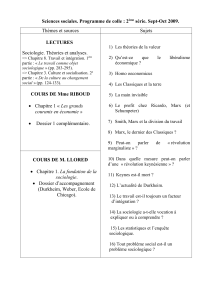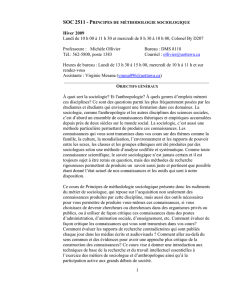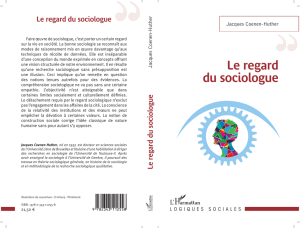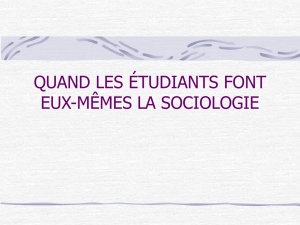Comment les sciences sociales construisent

153
C
omment
les sciences sociales
FLORENCE RUDOLF
Université de Marne La Vallée,
Laboratoire de Sociologie de la
Culture Européenne,
UPRESA 7043, Strasbourg
construisent-elles
le savoir ?
FLORENCE RUDOLF
a société contemporaine, dans la
présentation que nous en fait la
sociologie, en dépit de ses variantes
nationales et d’écoles, se caractérise par
une modification profonde de notre
immersion dans le monde et de la com-
préhension que nous en avons. Ces tran-
formations affectent le statut des savoirs,
les formes de l’action ainsi que les repré-
sentations de l’identité à notre époque. Ce
thème dit de la modernité avancée ou
réflexive présente, par ailleurs, des ana-
logies profondes avec la substitution crois-
sante du concept d’environnement à celui
de nature.1A une conception figée de
l’idée de nature fait place une vision indé-
terminée de ses contenus. Cette ouvertu-
re contribue à une remise en question des
catégories les plus familières. Ainsi, la
connaissance comme vecteur de certi-
tudes, l’action et la décision en terrain
connu, de même que l’identité comme
référent stable des contextes d’action et de
décision, se trouvent fragilisées par de tels
remaniements de la pensée.
C’est au savoir, et en particulier dans la
forme qu’il prend en association avec le
non savoir, que nous souhaitons consacrer
la présente réflexion. Nous nous appuie-
rons pour ce faire sur un certain nombre
d’ouvrages qui s’interrogent sur la condi-
tion des sciences sociales à notre époque.
Je pense en particulier aux livres d’Hen-
ri-Pierre Jeudy, Sciences sociales et démo-
cratie,de Pierre Bourdieu, Méditations pas-
caliennes,et de Patrick Watier, La sociologie
et les représentations de l’activité sociale.2
Bien que différents dans leurs propos et
approches, ces travaux portent un éclaira-
ge sur les problèmes inhérents à la
connaissance en général, et au savoir socio-
logique en particulier. Outre le fait qu’il
s’agit d’un motif récurrent de la discipline,
qui s’interroge au tournant du XIX ème
siècle sur ses fondements et sa spécificité,
il s’agit ici d’un renouvellement de ce
questionnement autour notamment de la
contribution du savoir à la réalité sociale.
Cette réflexion entre en écho avec les tra-
vaux d’Isabelle Stengers consacrés aux
sciences, dont L’invention des sciences
modernes,3et aux conséquences pour
notre monde de leur quête permanente
contre la faille susceptible de porter un
coup au pouvoir des fictions. Les sciences
modernes, comme cela a souvent été rele-
vé, mènent une lutte sans merci contre les
préjugés, et participent au désenchante-
ment du monde. Si elles ont, par le passé,
contribué à la déstabilisation des autorités
traditionnelles, elles semblent, de contre-
pouvoirs qu’elles étaient, s’être érigées en
nouveaux pouvoirs, voire en dogmes, et
constituer de nouvelles entraves au savoir
lui-même. Ce renversement de situation
nous invite à penser les limites inhérentes
à ces pratiques pour envisager leur renou-
vellement. L’enjeu de la question semble,
par ailleurs, tenir au fait qu’elle outre-
passe une réflexion strictement épisté-
mologique en ce que les énoncés scienti-
fiques conditionnent le devenir de
l’humanité et de la vie dans son ensemble.
Cette remarque souligne l’importance
qu’ont prise les sciences dans l’établisse-
ment de l’humanité, mais plutôt que de
s’arrêter à ce constat désormais trivial, il
nous faut revenir sur la relation du savoir
au pouvoir, soit de celle entre le savoir et
la réalité, d’où l’éclairage choisi autour des
quelques auteurs sus-cités.
L
152
Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, 1999, n° 26, L’honneur du nom, le stigmate du nom ■
© extrait de Cnacarchives, Paris 1972, Agam, 8+1 en mouvement, 1953
Notes
■
1.Ce travail a été réalisé dans le cadre
d’une recherche financée par le pro-
gramme “communication” du CNRS
sur le thème : “La construction
médiatique de l’Europe par les
médias régionaux. Analyse socio-
politique comparée de formes dis-
cursives (figures et arguments) pro-
duites par la presse régionale
française”, notamment en collabo-
ration avec l’équipe du professeur
Jacky Simonin, Université de la
Réunion, URA 1041 du CNRS.
2.Voir à ce sujet Philippe Breton, “La
presse régionale entre le fait uni-
versel et le commentaire local”,
Etudes de communication,Jacky
Simonin, Ed, Bulletin du CERTEIC,
1995 publié en 1996.
3.voir à ce sujet Philippe Breton, L’ar-
gumentation dans la communication,
La découverte, octobre 1996, notam-
ment chapitre 3 et 4.
4.Sur cette question des lieux, voir
Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L.,
Traité de l’argumentation, la nouvel-
le rhétorique,Editions de l’Universi-
té de Bruxelles, 1970.
5.Voir à ce sujet : Gauthier Gilles, “La
mise en cause de l’objectivité jour-
nalistique”, in Communications,vol
12, n°2, 1991
6.Voir sur ce sujet : Lucien Sfez, Cri-
tique de la communication,Seuil,
Paris, 1988 et Philippe Breton,
“L’utopie de la communication
entre l’idéal de la fusion et la
recherche de la transparence”, Qua-
derni n°28, 1996, ou encore Philippe
Breton, La parole manipulée,La
Découverte, 1997 (prix 1998 de
l’Académie des sciences morales et
politiques).
Conclusion
■
Cette hypothèse du “bruit de fond”,
mise en évidence ici de façon quasiment
expérimentale, devrait être vérifiée dans
le cas du traitement d’autres événe-
ments. La mise en évidence plus systé-
matique d’un tel “bruit de fond” per-
mettrait de renouveler la réflexion sur
les formes contemporaines de la
(néo-)propagande spécifique des régimes
démocratiques qui s’en croient juste-
ment indemnes.
A cette conclusion on peut ajouter
deux remarques, qui sortent du cadre de
la présente recherche, mais qui consti-
tuent aussi des pistes à suivre. La pre-
mière tient à la relative identité qui s’est
dégagée entre les grandes valeurs euro-
péennes proposées au choix des élec-
teurs et celles de ce que nous avons
appelé ici, à la suite de Lucien Sfez,
“l’idéologie de la communication”. C’est
cette identité qui a permis d’isoler ici le
bruit de fond médiatique. L’Europe n’au-
rait-elle rien d’autre à offrir qu’un systè-
me de valeurs associées à la médiation ?
La deuxième remarque tient aux consé-
quences du déni du caractère positif des
votes en faveur du “non”. L’impossibilité
d’expression dans les médias sur ce
thème n’a-t-elle pas au bout du compte
marginalisé une partie de l’électorat
régional? Rappelons ce curieux para-
doxe : l’Alsace est à la fois “championne”
du vote en faveur de l’Europe et “cham-
pionne” du vote pour le Front National.
Pour quelle Europe s’était donc pronon-
cé l’électorat alsacien ?

155
■
Florence Rudolf Comment les sciences sociales construisent-elles le savoir ?
élaboration et de leurs propriétés. On peut
éventuellement, à partir de l’idée du “Par-
lement des choses” ou de celle d’une “éco-
logie des pratiques”, tirer quelques élé-
ments de réflexion susceptibles d’orienter
la recherche, qui nous incitent à aller voir
du côté de la connaissance sociologique.
Nous retiendrons de cette excursion
dans les travaux d’Isabelle Stengers,
qu’une pratique résulte d’un engagement,
au sens de l’établissement d’une relation
au monde, dont on ne peut négliger la por-
tée heuristique, que cette dernière soit
reconnue ou non. La reconnaissance socia-
le, quant à elle, relève de la capacité de
tels collectifs à se faire entendre, que ce
soit dans le cadre d’un “Parlement des
choses” ou ailleurs. Bien qu’indissociable
d’une réflexion sur le statut des savoirs, la
question de l’ancrage dans l’opinion et l’es-
pace publics des savoirs susceptibles d’in-
fluer sur les orientations de l’humanité,
s’en écarte sensiblement dans la mesure
où elle ne dépend pas strictement de la
pertinence ou de la fiabilité de tels énon-
cés, mais de leur pouvoir de rassemble-
ment à un moment donné. Isabelle Sten-
gers n’approfondit pas cet aspect qui
relève autant, davantage ou de façon
variable, de la formation de nouvelles
alliances sociales que de l’évaluation
rationnelle des énoncés en fonction de cri-
tères de validité. Entrer dans ce débat,
nous amènerait à confronter la communi-
cation comme forme de socialisation, au
sens où André Akoun la distingue de l’in-
formation proprement dite, à la thèse de
Jürgen Habermas selon laquelle l’agir
communicationnel est présenté comme la
forme idéale de la rationalisation sociale,
par exemple. C’est parce qu’elle ne pour-
suit pas l’analyse sur le mode précédent,
que l’hypothèse du “Parlement des
choses” s’inscrit dans un discours dont la
tonalité diffère de celui qui le précède. Il
se montre plus passionnel que résultant
d’un cheminement réfléchi de la pensée.
Constater cela n’est pas une critique en
soi, mais plutôt l’occasion de réfléchir sur
deux moments également importants de la
pensée qui sont la rigueur, l’impartialité,
voire une certaine indifférence, et l’en-
gouement. La “chute” que nous propose
Isabelle Stengers apporte un contre-poids
par rapport à la pensée qui l’amène, de
sorte qu’elle nous livre deux expressions
de la pensée, dont la reconnaissance et
l’articulation vont sous-tendre la discus-
sion que nous entendons mener ici. Le pas-
sage du premier énoncé à un propos enga-
gé se fait relativement bien, dans la mesu-
re où le discours en amont, prépare
l’hypothèse du “Parlement des choses”
comme aboutissement de la succession
d’épreuves auxquelles les témoins fiables
doivent se soumettre pour mériter une
telle opération. Dans cette perspective, les
revendications issues d’expériences et de
pratiques sociales diverses participent de
la formation des savoirs. Elles les fragili-
sent en les exposant, et les renforcent à
chaque fois davantage. Le “Parlement des
choses” apparaît, par conséquent, comme
une étape indispensable dans l’établisse-
ment des connaissances, et parfait les
sélections opérées dans le secret du labo-
ratoire. Cet éclairage nous conduit à nous
interroger sur la formation des savoirs
dits sociaux ou issus de pratiques
humaines multiples et variées auxquels les
témoins fiables vont devoir se confronter
pour pouvoir attester de leur robustesse.
La construction du
savoir sociologique
■
C’est vers la connaissance sociologique
que nous allons nous tourner pour tenter
l’exploration du caractère potentiellement
heuristique de l’activité et des pratiques
humaines. Cette dernière, en effet, porte
un éclairage sur la vie en société, et pré-
tend, même si c’est à des degrés divers,
apporter un surcroît de connaissance à
celle qu’en ont le commun des mortels. Il
ne me semble pas en disant cela trahir les
différentes approches et réduire la diver-
sité des points de vue qui contribuent à la
connaissance sociologique. En effet, selon
qu’elle est vécue comme un acte de dévoi-
lement des situations sociales ou comme
une réflexion sur les pratiques sociales qui
s’effectue en marge de leur déroulement,
la connaissance sociologique tente d’ins-
crire dans des actes de langage une réali-
té multiforme qui nous échappe par bien
des aspects. Pierre Bourdieu, Henri-Pierre
Jeudy et Patrick Watier, les trois auteurs
auxquels je me réfère pour construire
mon propos, abordent chacun à leur
manière cette question. En dépit de la dis-
tance qui les sépare, c’est la critique qu’ils
formulent à l’encontre des sciences
sociales qui m’intéresse, dans la mesure où
elle met l’accent sur une faille importan-
te de la connaissance sociologique en
vertu de laquelle ce “laboratoire” que
constitue la société dans son ensemble
semble avoir été mal exploré, et ce pour
différentes raisons.
Pierre Bourdieu,
une théorie “inachevée”
des pratiques sociales
■
Dans les Méditations pascaliennes,Pier-
re Bourdieu s’en prend aux effets de l’ha-
bitus scolastique sur la pensée et la
connaissance. Le retrait du monde et l’as-
cèse qu’elle prône, qui va de pair avec une
certaine aisance économique et une recon-
naissance sociale, entretiennent l’illusion
d’un sujet transcendant, dont la souverai-
neté repose sur l’absolutisation de la Rai-
son et de la Liberté, qui s’exprime respec-
tivement dans la philosophie cartésienne
et kantienne. Bien qu’opposées sur bien
des points, ces deux traditions se rejoi-
gnent sur une attitude surplombante qui
s’affirme à travers la dualité du sujet et de
l’objet. Il s’ensuit que le monde réel, empi-
rique et profane échappe de deux
manières distinctes à la connaissance,
c’est-à-dire comme histoire et dynamique
propre, et comme “objectivité” et positi-
vité. On trouve ici un élément de réponse
à la question qui nous intéresse, à savoir
qu’en se coupant de la réalité sociale, la
sociologie est peut-être passée à côté de la
connaissance de la vie sociale. C’est sur
fond de ce constat d’échec de la tradition
scolastique que l’auteur s’interroge sur les
conditions nécessaires à une appréhension
plus juste de la réalité sociale, et réitère
les missions selon lui de la connaissance
sociologique. Cette dernière se doit d’être
attentive aux pratiques sociales et rompre
pour cela avec une vision métaphysique et
essentialiste incapable de rendre compte
de l’historicité et du pouvoir contraignant
des situations sociales.
Si le propos de Pierre Bourdieu tient
globalement jusque là, il tourne court à
partir du moment où l’habitus est érigé en
modèle pour une sociologie des pratiques,
et semble indiquer la sortie de l’impasse
dans laquelle la connaissance s’est four-
voyée avec la skole.Ce plaidoyer en faveur
de l’habitus convaint d’autant moins, qu’on
ne voit toujours pas dans cet ouvrage, en
quoi la sociologie de Pierre Bourdieu
rompt avec la relation duale du sujet à l’ob-
jet, et l’attitude surplombante du sujet
154
Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, 1999, n° 26, L’honneur du nom, le stigmate du nom ■
Le savoir scientifique ou
la naissance des
témoins fiables
■
Qu’est-ce que le savoir, et qu’est-ce
que la science en particulier? Sans pré-
tendre faire le tour de cette question, on
ne peut en faire l’impasse dans le contex-
te présent, ni dans celui dans lequel nous
vivons. Comme nous l’indiquions précé-
demment, Isabelle Stengers peut apporter
une précieuse contribution à une défini-
tion des sciences modernes. Ces dernières
émergent autour du dispositif expérimen-
tal, c’est-à-dire qu’elles s’imposent autour
d’énoncés fiables, qui s’affranchissent des
contextes de leur production, ou pour le
dire plus justement, dont les contextes de
production ne semblent pas porter ombra-
ge à leur fiabilité. Ce sont des énoncés à
prétention universelle au sens où ils ne
sont pas tributaires d’un lieu ou d’une
équipe de recherche. C’est à ce titre que
Galilée refuse l’arrangement qui lui est
proposé, et qui pourrait lui sauver la vie,
à savoir que sa découverte est sans consé-
quences pour l’humanité chrétienne et
n’engage que la communauté à laquelle il
appartient. Il ne peut accepter un tel
pacte sans renier la science qu’il défend,
à savoir qu’il s’agit d’une pratique qui
rompt avec la fiction et les discours qui ne
valent qu’en certains lieux et contextes.
Les sciences expérimentales, comme nous
le rappelle Isabelle Stengers, sont nées de
leur pouvoir de “mise en scène” de
témoins fiables qui coupent court à la
controverse. Cette alchimie a lieu dans le
laboratoire, sorte de non lieu, où s’inven-
te des dispositifs susceptibles de révéler la
vraie nature des phénomènes. Il ne s’agit
pas d’une création, au sens où les phéno-
mènes exprimés n’existeraient pas, mais
d’une mise en situation. Bien qu’indis-
pensable à cette opération, le dispositif ne
peut être soupçonné de se substituer à la
vérité du phénomène, dans la mesure où
il ne l’influence pas, mais rend unique-
ment cette visibilité possible, d’où l’ex-
pression de témoin fiable. Depuis l’inven-
tion du laboratoire et du fait expérimental,
les sciences dans leur ensemble s’oriente-
ront d’après cet idéal.
On peut poursuivre la réflexion, en
s’interrogeant sur la fiabilité effective de
ces témoins, sur les limites d’application
de cet idéal, et enfin sur le statut des
savoirs qui ne reposent pas sur de telles
inventions. S’il est une chose qu’on puisse
dire avec quelque certitude, c’est que la
cumulativité des savoirs dépend de la
constitution de témoins fiables. Une de
leurs particularités est de ne plus consti-
tuer un enjeu de la connaissance en tant
que tel. Le statut de faits quasi-irréfu-
tables auquel ils ont accédé, au terme de
luttes souvent longues et ardues, leur
confère une invisibilité qu’il ne faudrait
pas confondre avec une inusité ou une
inutilité.Ainsi, ce sont des savoirs, qui bien
souvent sont objectivés sous la forme d’ap-
pareils de mesure, par exemple, et de
façon générale, ils constituent les fonde-
ments d’édifices complexes, ainsi qu’en
témoignent les tollés que déclenche toute
tentative d’“ouverture” de ces “boîtes
noires”.4A la suite de Bruno Latour, Isa-
belle Stengers reprend le terme de “fai-
tiches”, afin de souligner qu’il n’est pas
question d’artefacts bien qu’ils soient
dépendants des dispositifs qui les révè-
lent. Il s’agit, en d’autres mots, de signaler
qu’ils préexistaient à l’intervention humai-
ne, mais que cette dernière leur a conféré
une consistance plus forte qu’ils n’en déte-
naient avant qu’elle n’ait lieu. On notera
qu’il ne semble pas que cette dernière soit
uniquement le fait de l’accession à notre
conscience, mais de leur imbrication, de ce
fait, dans des systèmes d’interdépendance
dans lesquels ils n’intervenaient pas aupa-
ravant.
Quant aux limites de cet idéal, nous
considérerons deux aspects, celui qui a
trait au pouvoir des “faitiches”, et celui qui
concerne ses domaines d’application.
Comme nous venons de le voir précédem-
ment, les témoins fiables sont des soubas-
sements tangibles pour de nouvelles
controverses. Ils permettent d’investir un
champ de l’existence et constituent, à cet
égard, les fondements pour de nouvelles
disciplines. En revanche, leur irruption
n’est pas le garant de leur succès, ni même
de leur impact sur le devenir de l’huma-
nité. Leur portée historique dépend de
l’intéressement des hommes à ces inven-
tions. C’est d’ailleurs un des principaux
enjeux des luttes auxquelles s’adonnent
leurs protagonistes. Aussi, peut-on dire
que l’impact d’un “faitiche” dépend de la
capacité de ses inventeurs à convaincre
une communauté d’initiés, et à porter le
débat dans un cercle plus large afin d’en
faire un enjeu de société. Cet éclairage
sert d’ailleurs de point d’appui à la
réflexion que mène Isabelle Stengers sur
ce qu’elle appelle avec Bruno Latour, le
“Parlement des choses”, à savoir que les
témoins fiables ne peuvent se substituer
au débat social, et permettre de faire l’im-
passe de la démocratie. En effet, s’ils per-
mettent d’accéder aux “questions qui se
posent à la nature et auquel elle répond à
sa façon”, ils n’apportent pas de réponse
à celles que se donne l’humanité dans
toute sa diversité et sa conflictualité. En
d’autres mots, ils ne peuvent se substituer
aux discussions dont de telles questions
peuvent émerger, ni aux controverses
nécessaires aux éléments de réponse. En
revanche, ils peuvent les éclairer.
Les savoirs
sans témoins fiables ?
■
Qu’en est-il des savoirs, enfin, qui ne
s’édifient pas sur des témoins fiables ?
Pour cette question, il faut bien le dire, la
contribution d’Isabelle Stengers touche à
ses limites. Certes, on trouve des éléments
de réponse dans la typologie qu’elle pro-
pose des sciences modernes.Aux sciences
théorico-expérimentales, elle adjoint les
sciences de terrain et les sciences prédic-
tives. Ces dernières se distinguent des
sciences théorico-expérimentales, en ce
qu’elles ne sont pas fondées sur des
témoins fiables, sans pour autant aban-
donner l’intention de connaissance. Leur
spécificité tient au caractère inachevé et
nécessairement particulier des savoirs
qu’elles produisent. Ainsi ce sont des
sciences vectrices d’incertitude, qui ne
visent pas des généralisations, mais la
production d’une connaissance locale, sin-
gulière et limitée à un contexte particulier.
Leurs énoncés s’apparentent à des récits
qui mettent en scène des dynamiques à
partir de l’étude de configurations pré-
cises. Ils permettent tout au plus de dire
que dans tel contexte, certains facteurs
semblent avoir contribués de façon non
négligeable au devenir, et que sous ces
conditions, les situations peuvent prendre
une telle tournure. Cette différenciation
des sciences modernes rend compte du sta-
tut des sciences humaines en leur sein,
sans régler pour autant la question de la
formation des connaissances, qui sans être
le résultat de pratiques de laboratoire,
n’en demeurent pas moins des savoirs. Le
problème qui se pose alors est celui de leur

157
■
Florence Rudolf Comment les sciences sociales construisent-elles le savoir ?
naissance des sciences modernes. La sub-
stitution de l’espace public au secret d’ini-
tiés dans le processus d’élaboration des
connaissances n’apporte aucune garantie
à une réelle remise en question de notre
rapport au savoir. Henri-Pierre Jeudy
exprime ainsi un doute radical à l’en-
contre de cette conception du savoir, et de
l’illusion de pouvoir évacuer l’arbitraire
sous couvert d’une procédure communi-
cationnelle.
Cette critique présente l’avantage de
susciter une réflexion plus approfondie de
la notion de savoir, en particulier dans sa
relation aux normes et à la constitution de
liens sociaux, fondés entre autres sur le
partage de valeurs. Sa faiblesse tient en
partie au fait qu’elle n’échappe pas à ce
qu’elle dénonce, à savoir que tout en
revendiquant une position esthétique, elle
produit un énoncé comparable à ceux
qu’elle fustige. Cette remarque n’est pas
sans conséquence pour les savoirs en géné-
ral, et, en particulier, les énoncés qui se
vantent d’échapper à tout contenu nor-
matif, dans la mesure où elle met l’accent
sur l’imbrication entre les rapports au
monde et les effets de connaissance. On
notera, enfin, qu’étonnement Isabelle
Stengers apporte un crédit à l’analyse
d’Henri-Pierre Jeudy, et que ce dernier
partage avec Pierre Bourdieu une certaine
souveraîneté, en vertu de laquelle ils
seraient hors de portée des critiques qu’ils
formulent. Mais alors que la première atti-
tude exprime une révolte, et revendique la
liberté de laisser l’espace des possibles dis-
ponible, la deuxième tient de la supério-
rité de l’autorité qui sait, et qui au nom de
ce savoir aspire à un pouvoir. Aussi, le rap-
prochement s’arrète-t-il là.
Patrick Watier,
du jeu du savoir et
du non-savoir dans la
constitution de la réalité
sociale et de la connais-
sance sociologique
■
L’analyse que Patrick Watier propose
de la vie en société apporte des éléments
de réponse à la contribution de la socio-
logie à la connaissance ordinaire. Je dirai
au passage, que cette association de mots
signale une situation dans laquelle des
compétences rencontrent des valeurs, et
qu’à ce titre les savoirs communs sont des
accords sensibles, fondées sur des valeurs
et des esthétiques partagées, dont le sens
de la vérité n’est pas exclu.A cet égard, la
réflexion à laquelle Patrick Watier nous
invite permet de sortir de l’opposition
entre savoir et norme dans laquelle les
contributions d’Isabelle Stengers et
d’Henri-Pierre Jeudy pouvaient nous
enfermer.
L’auteur débute également son propos
par une réflexion sur le savoir du socio-
logue qu’il se propose de comparer à ceux
auxquels la vie en société nous initie, et
que nous nous forgeons à travers ces expé-
riences. Cet éclairage présente le mérite
d’ouvrir à une analyse minutieuse des
compréhensions réciproques et des che-
minements internes nécessaires à la plus
triviale des routines sociales. Même si
l’auteur n’échappe pas à l’imposition d’un
contexte structuré par le langage et les
concepts qu’il emploie, sa présentation de
la réalité sociale se veut soucieuse de l’ex-
périence qu’en a tout un chacun, enrichie
de l’épaisseur que peut produire la
réflexion de l’expérience. Le pari ici relè-
ve de l’art du témoignage à travers une
microscopie de la vie sociale, et illustre ce
faisant, même s’il ne le revendique pas, ce
que pourrait être une théorie des pra-
tiques. Patrick Watier dégage à partir de
son propos et sa démarche ce que le savoir
commun et le savoir sociologique ont de
commun et de distinct, en même temps
qu’il parvient à montrer comment ils peu-
vent s’informer utilement. On remarquera
au passage qu’ils sont plus proches que la
tradition dominante de la discipline ne le
veut, et que cette proximité est le pré-
requis de la connaissance sociologique.
Car comment envisager en effet que la
sociologie puisse émerger sans cette conni-
vence entre les hommes et la société? On
assiste, par conséquent chez Patrick
Watier, à une démonstration subtile de
l’imbrication entre l’expérience, la vie ou
une totalité incondensable, et l’objectiva-
tion ou la production de sens sans laquel-
le les deux sont impensables. Le propos, il
faut le reconnaître, est assez convaincant
dans la mesure où une impression de
lumière sur le monde social s’en dégage
sans que les zones d’ombre ne soient éva-
cuées pour autant. On assiste de ce fait à
un savoir qui intègre le non-savoir, le res-
pecte, raisonne à partir de lui, en fait un
partenaire.
Un des secrets de cette réussite tient en
partie, il me semble, à l’usage que Patrick
Watier fait du concept de socialisation. Ce
dernier, comme on le sait, fait l’objet d’in-
vestissements multiples, voire opposés, en
sociologie, selon que le processus d’inté-
riorisation prend le pas sur celui d’exté-
riorisation et vice versa. L’intervalle ouvert
par ces deux pôles renvoie à la question
classique de la dialectique sociale, de la
place de la tradition et de l’innovation, ou
encore du poids des morts sur les vivants,
pour reprendre une expression de Peter
Berger, dans la formation des situations
sociales.8Le concept de socialisation réac-
tualise la question de Georg Simmel “Com-
ment la société est-elle possible?”, et peut
s’avérer un garde-fou précieux contre les
dérapages toujours possibles de la réifi-
cation qui consiste à oublier que la gran-
de majorité des faits auxquels s’intéres-
sent les sciences sociales, sont construits
socialement. L’intérêt du terme réside
pour l’essentiel dans l’attention qu’il per-
met de porter à la structuration plutôt
qu’aux structures, et à la sensibilité qu’il
peut développer et accompagner pour le
caractère mouvant et non cloisonné de la
vie. Ainsi, la considération de motifs psy-
cho-sociaux, voire psychologiques ne peut
être taboue sous prétexte qu’il s’agit de la
constitution d’une réalité sociale. La socia-
lisation suppose un intérêt pour le présent,
pour ce qui est en train de se passer, et si
156
Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, 1999, n° 26, L’honneur du nom, le stigmate du nom ■
connaissant qui l’accompagne. La théorie
de la formation de l’habitus, par soumis-
sion aux forces qui structurent le champ
social, passe sous silence la constitution de
l’espace social, et pour cause, puisqu’elle
néglige les dynamiques qui, au jour le jour,
produisent ces structures. L’occultation
des événements qui conduisent à la stabi-
lisation de certaines lignes de force au
détriment d’autres éventualités, n’est pos-
sible que parce que Pierre Bourdieu fait fi
des réponses que les individus apportent
en situation. Ce désintérêt trahit une
conception mécanique de la vie sociale
selon laquelle les hommes en tant que tels
ne sont pas compétents, mais les déposi-
taires passifs des pouvoirs que leur confè-
re leur positionnement dans l’espace
social. Dans cette perspective, l’immersion
dans la vie n’est d’aucun secours pour le
développement d’un sens de l’existence en
fonction duquel nous savons en partie ce
que nous faisons, et pourquoi nous le fai-
sons. Ce déni de la dimension heuristique
de la vie quotidienne est renforcé par le
fait que tout se passe comme si Pierre
Bourdieu savait d’emblée quels sont les
événements qui comptent dans la struc-
turation de l’espace social, et pouvait de ce
fait faire l’économie d’une compréhen-
sion plus fine des situations, qui l’amène-
rait à observer, par exemple, comment
des options différentes s’affrontent, négo-
cient ou non, pour s’imposer finalement,
avec quelle conscience ou en l’absence de
toute conscience, dans certains espaces
plus facilement que d’autres, par exemple.
Bien qu’elle recourt au concept de pra-
tique, la théorie des champs vide cette
notion de sa substance, à savoir celle de
rester au plus proche de la vie et de ses res-
sorts. Le terme de pratique perd ainsi de
sa virtualité critique.
On peut s’interroger, pour finir, au nom
de quelle compétence Pierre Bourdieu
accède-t-il à une intelligence du social
qu’il dénie aux autres? Le lecteur reste sur
sa faim, car à aucun moment l’auteur ne
l’éclaire sur la pratique, c’est-à-dire sur le
type de médiation qu’il établit avec le
monde, et qui lui permet d’en dévoiler les
ressorts. A moins qu’il ne fasse implicite-
ment que confirmer que sa démarche ne se
distingue pas tant que cela de la tradition
surplombante qu’il condamne dans la pre-
mière partie de son ouvrage. Rien ne per-
met de conclure, par conséquent, à une
remise en question véritable de l’épisté-
mologie de la rupture chez Pierre Bourdieu,
de sorte que la critique qu’il fait de la skole
perd de sa consistance au terme de son ana-
lyse. Il semble reproduire l’idéal des
sciences théorico-expérimentales selon
lesquelles la connaissance s’élabore dans le
secret du laboratoire, et méconnaître les
étapes ultérieures qui pourraient leur
conférer le statut de savoirs robustes, c’est-
à-dire celles de la confrontation avec des
connaissances “indigènes”. La référence à
la notion de pratique ici n’est d’aucun
effet sur la démarche du sociologue qui
s’en sert pour asseoir son autorité, et non
pour se remettre en question.
Pierre-Henri Jeudy :
pour en finir avec l’idéal
de la connaissance
comme objectivation
■
Le regard qu’Henri-Pierre Jeudy porte
sur les tendances actuelles des sciences
sociales, procède apparemment d’un
constat d’échec de la connaissance socio-
logique comparable à celui dont part Pierr-
re Bourdieu. Cette convergence relative
cède cependant vite le pas à des analyses
et des conclusions très différentes, voire
opposées. La réflexion d’Henri-Pierre
Jeudy s’organise autour de la relation
entre le langage et la réalité. Si cette arti-
culation a toujours été au centre de l’in-
terrogation des sciences humaines, qui
contrairement aux sciences théorico-expé-
rimentales, s’extériorisent à travers des
actes de langage et portent en partie,
voire exclusivement, sur une réalité lan-
gagière, elle s’est radicalisée depuis que le
langage a accédé au statut de réalité socia-
le. Le phénomène de substitution du lan-
gage à la réalité comme caractéristique de
notre temps revient régulièrement dans
les analyses consacrées à la société
contemporaine. Ainsi, lorsque Serge Mos-
covici s’interroge sur les effets de l’imbri-
cation entre la société conçue et la socié-
té vécue,5ou quand Anthony Giddens
réfléchit aux conséquences de la délocali-
sation des systèmes experts et de leur relo-
calisation,6il s’agit bien de variations
autour d’un même thème qui n’est autre
que celui de la double herméneutique.
Bien que l’expression ne soit pas employée
par Henri-Pierre Jeudy, son ouvrage explo-
re et met en évidence le caractère maudit
de toute pratique langagière, et par consé-
quent le dilemne insoluble de la connais-
sance en sciences humaines. En effet, quel
que soit le point de vue adopté, elles
n’échappent jamais à une imposition de
sens, et à une normalisation de la vie
sociale. Lorsqu’ un sociologue utilise une
métaphore conceptuelle, comme celle de
“système d’intégration”, par exemple, il
outrepasse le cadre de l’intercompréhen-
sion pour imposer une détermination de
sens et il est déjà dans l’ordre de la gestion
du social.7L’imposition normative est déjà
en germe dans le désir d’attribuer du sens
à la réalité, de l’organiser, et de lui confé-
rer une cohérence. Les sciences sociales se
retrouvent, par conséquent, coincées entre
deux alternatives, celle de se transformer
en réservoirs de significations disponibles
pour toute sorte d’usages et de pouvoirs
quitte à contribuer à l’instrumentalisation
de la vie sociale, ou de s’enfermer dans
une réflexivité nécessaire à l’élaboration
de la théorie au risque de céder à un pro-
jet de normalisation de la pensée à travers
la contribution à une orthodoxie logique.
La pensée n’échappe pas, par conséquent,
à la mortification, soit par imposition d’un
sens qui sert toujours des valeurs et des
intérêts, soit par soumission à des impé-
ratifs procéduraux, au nom d’une positivi-
té qui témoigne d’une fascination, elle
aussi suspecte. Tant que la réflexivité
théorique n’est pas au service d’un monde
imaginaire, poursuivant ses propres lois,
mais se plie à un cadre préétabli, on ne
peut à proprement pas parler d’une pen-
sée en acte, mais d’une activité au service
de l’édification d’une théorie universelle
du normatif. Les principaux écueils de la
pensée semblent par conséquent liés à
l’objectivation, que celle-ci s’exprime à tra-
vers la recherche d’un énoncé vrai, au sens
où il se substitue à la réalité, ou inatta-
quable parce que conforme aux critères de
la logique. Ce n’est pas le fait de s’extrai-
re de la réalité, qui est perçu ici comme
principal obstacle épistémologique, mais
plutôt la soumission à un tel impératif.
C’est bien évidemment l’idéal des sciences
théorico-analytiques qui est visé, mais pas
uniquement, puisqu’il s’agit aussi d’ex-
primer un doute quant au programme pro-
posé par Isabelle Stengers, par exemple.
En effet, cette critique affecte également
le “Parlement des choses”, comme dispo-
sitif susceptible de palier à l’autorité des
sciences dans la construction des savoirs,
dans la mesure où ce projet ne rompt pas
avec l’objectivation du réel à laquelle la
connaissance s’est identifiée depuis la
Lettre internationale n° 31, hiver 91/92

159
L
es échanges entre
Émile Durkheim
et Georg Simmel
JOËLLE BOURGIN
Faculté des Sciences Sociales
au tournant du siècle, un épisode méconnu
de l’histoire de la sociologie
JOËLLE BOURGIN
Introduction
■
Émile Durkheim (1858-1917) et
de son oeuvre, la plupart des
présentations traditionnelles ne
retiennent que quelques aspects : l’invi-
tation à appliquer le positivisme scienti-
fique aux sociétés humaines, projet fon-
dateur de la sociologie en France (“ il faut
considérer les faits sociaux comme des
choses”); la primauté de la société sur
l’individu, soumis à la contrainte sociale ;
enfin, la préoccupation pour le maintien
de la cohésion sociale dans les sociétés
modernes. Le sociologue et philosophe
allemand Georg Simmel (1858-1918) n’a,
quant à lui, été redécouvert en France
que récemment - l’Université des
Sciences Humaines de Strasbourg, qui
enseigne cet auteur en bonne place dès le
DEUG de sociologie, constituait une heu-
reuse exception -. C’est avant tout le pré-
curseur de l’interactionnisme (courant
sociologique nord-américain qui, s’oppo-
sant à tout déterminisme, considère la
société comme un réseau d’interactions
individuelles) que l’on salue en lui. On
apprécie également l’essayiste éclec-
tique, qui s’intéresse, sans souci apparent
de rigueur méthodologique mais toujours
avec un bonheur littéraire certain, aux
thèmes les plus divers (la mode, le secret,
le conflit, l’art…).
Fait social contre action sociale, posi-
tivisme contre orientation plus littéraire :
les deux sociologues ont nourri des cou-
rants antagonistes. Difficile, dans ces
conditions, d’imaginer qu’il y a un siècle,
sur la couverture du volume inaugural de
L’Année sociologique (revue lancée par É.
Durkheim et fer de lance de son combat
pour imposer la sociologie), Simmel figu-
rait en tête de la liste des collaborateurs ;
le numéro publie en effet conjointement
deux essais programmatiques, signés res-
pectivement Durkheim (sur la prohibi-
tion de l’inceste) et Simmel (“ Comment
les formes sociales se maintiennent”).
Comment interpréter ce fait qui cadre
si mal avec les présentations canoniques
des deux sociologues? Quand il n’est pas
passé sous silence, cet épisode est le plus
souvent envisagé comme un accident
isolé : la publication conjointe aurait été
dictée par des intérêts stratégiques pas-
sagers ou fondée sur un malentendu
vite dissipé. La suite des événements
semble donner raison à une telle lectu-
re,puisque le dialogue paraît tourner
court dès la parution du premier numé-
ro de L’Année,en 1898. En 1900, Dur-
kheim exprime dans une revue italienne
son désaccord définitif avec la concep-
tion simmélienne de la sociologie. Désor-
mais, les écrits du philosophe allemand
ne font plus l’objet, sous la plume de
Durkheim, que de jugements lapidaires
et de critiques assassines. À la suite d’ac-
cusations de plagiat, le sociologue fran-
çais niera même avoir jamais eu connais-
sance de la plupart des travaux de
Simmel. Selon nous, cette lecture anec-
dotique sacrifie un peu vite l’épisode
évoqué sur l’autel des oppositions théo-
riques traditionnelles. Dans une
recherche en cours dont nous aimerions
présenter ici quelques résultats, nous
nous proposons d’éclairer à nouveaux
frais la collaboration éphémère entre
Émile Durkheim et Georg Simmel, en
envisageant la possibilité d’affinités et
d’échanges de fond. Du coup, leur rup-
D’
158
Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, 1999, n° 26, L’honneur du nom, le stigmate du nom ■
les situations de face à face sont généra-
lement préférées à celles dans lesquelles
les individus sans être en co-présence, sont
“interconnectés” d’une certaine façon, soit
par le biais d’un outil, de l’écrit, ou de l’in-
formatique, les observations faites à partir
des contextes de co-présence doivent pou-
voir être élargies à ces situations, voire
modifiées en conséquence.
Cette compétence, qu’il faudra étudier
et préciser, est certes faillible, mais non à
tous les coups. Elle s’avère généralement
assez adéquate, et ce en l’absence de pré-
cisions et de clarifications ostensibles des
acteurs en co-présence. La vie sociale
requiert, en d’autres mots, de ceux qui y
participent une intelligence de la situation
qui passe par la compréhension de ce qui se
joue. Ce sens des circonstances ne signifie
pas une transparence totale, mais une capa-
cité à se situer et interargir avec d’autres.
On devrait même ajouter que trop de trans-
parence nuit à la formation des associations
sociales, et qu’à ce titre les zones d’ombre
servent l’entente et les accords. Comment
pourrais-je, en effet, m’unir à un autre, si
j’en connais toutes les intentions, les forces
et les faiblesses? Ce n’est que parce que
j’en sais suffisamment sur un alter ego, et
non parce qu’aucun mystère ne demeure,
que je peux faire le pari que notre alliance
ne sera pas un fardeau.
La compréhension est ainsi présentée
comme un préliminaire de la vie en socié-
té. Il se peut qu’elle soit plus souvent intui-
tive que discursive, mais il serait malhon-
nête de se saisir de cet argument pour
dénier aux individus une compétence
réflexive. En effet, il suffit pour s’en
convaincre d’observer que nous sommes
tous à nos heures, et en fonction de notre
recul par rapport aux situations que nous
vivons, capables de discernement et d’ana-
lyse. Certes, cette aptitude à la formalisa-
tion se forge au contact des contextes
dans lesquels nous vivons et des exigences
qui se posent à nous, et en ce sens elle
s’exerce sans que l’on puisse toutefois
l’ériger en privilège d’une minorité. En
d’autres termes, soit on admet qu’il s’agit
d’une potentialité de l’humanité, somme
toute assez banale à notre époque, soit il
faut expliquer comment, dans un contex-
te dont les hommes en sont généralement
dépourvus, les sociologues en sont dotés.
Car, en effet, un des meilleurs arguments
de la thèse en faveur de l’acquisition d’un
savoir sur la vie en société chemin faisant
tient à l’observation qu’en l’absence de
cette possibilité, la sociologie n’aurait pas
pu se développer. Au départ de sa forma-
tion et d’une nouvelle recherche, le socio-
logue ne dispose pas de compétences fon-
damentalement différentes du commun
des mortels.Tout comme ce dernier, il peut
se faire des idées sur la vie sociale qui ne
sont pas nécessairement incongrues, et à
sa différence, il en fait son métier, c’est-à-
dire qu’il se forge une expérience et des
compétences à travers le temps. De plus,
les buts qu’il poursuit n’étant pas ceux des
protagonistes de la situation, il bénéficie
de conditions propices à la réflexion. Si ces
deux aspects ne tiennent pas lieu d’expli-
cation suffisante de la différence entre la
connaissance ordinaire et la connaissance
sociologique, ils rendent compte de l’“épis-
témologie de la continuité”. Les savoirs
communs sont des savoirs pré-sociolo-
giques en ce qu’ils assurent une compré-
hension des situations sans laquelle la
participation à la vie sociale ne serait pas
possible. En revanche, ils s’en distinguent
de par leur immersion dans la vie et dans
le monde de l’action : ils ont partie liée à
la temporalité des contextes d’action et
aux intérêts et motifs poursuivis par les
acteurs. La distance entre le savoir socio-
logique et le savoir commun tient par
conséquent au retrait des affaires, et non
à une déstructuration systématique de la
connaissance ordinaire, comme si la véri-
té du social passait irrémédiablement par
une reconstruction autour de nouvelles
catégories, donc par une réfutation obli-
gatoire du savoir que les acteurs mobili-
sent dans leur pratiques quotidiennes. La
pertinence des analyses que le sociologue
propose des situations sociales tient davan-
tage à un travail de formalisation et de for-
mulation, soit à une compétence discursi-
ve plus développée que la moyenne, qu’à
l’émergence d’un savoir radicalement dif-
férent du savoir nécessaire à la participa-
tion à la vie en société.
En conclusion, on retiendra qu’il est
impossible de produire du sens et des
effets de connaissance sans prendre posi-
tion. A cet égard le propos d’Henri-Pierre
Jeudy est confirmé par les autres même
s’ils ne se rallient pas à sa proposition. En
revanche, une des limites de cet éclairage
tient peut-être à la clôture qu’il risque de
produire en ramenant notamment les
connaissances à de seuls effets de style.
Qu’on souscrive ou non à cette définition,
on aimerait réfléchir avec lui sur ce que dif-
férentes esthétiques, la sienne et d’autres,
peuvent apporter à la pensée, et pourquoi
pas en quoi elles contribuent à certaines
formes d’engagement, et façonnent le
monde. Réfléchir au projet du “Parlement
des choses” après avoir lu ou entendu
Henri-Pierre Jeudy permet de mesurer
plus précisément ce que signifie la part
d’un rapport aux valeurs dans la construc-
tion d’un savoir. L’hypothèse de l’écologie
des pratiques, comme nous le disions pré-
cédemment, diffère d’un raisonnement qui
tout en étant acquis à l’idée du partage des
savoirs, gagne en précision à travers l’ap-
profondissement de ce que la communica-
tion confère de plus aux savoirs élaborés en
laboratoire, à l’abri de la controverse
publique.Ainsi, il est vraissemblable qu’un
des principaux atouts du “Parlement des
choses” tienne au croisement des points de
vue qu’il permet, à partir duquel une
approche polycontextuelle est susceptible
de voir le jour, non comme accomplisse-
ment de l’idéal des sciences modernes,
mais comme expérience réflexive qui porte
à la fois sur le monde sensible et ses effets
de connaissance.
Notes
■
1.Florence Rudolf, L’environnement,
une construction sociale. Pratiques et
discours en Allemagne et en France,
Presses Universitaires de Stras-
bourg, Strasbourg, 1998.
2.Henri-Pierre Jeudy, Sciences sociales
et démocratie, Circé, Paris, 1997; Pier-
re Bourdieu, Méditations pasca-
liennes, Seuil, Paris, 1997 et Patrick
Watier, La sociologie et les représenta-
tions de l’activité sociale, Méridiens
Klincksieck, Paris, 1996.
3.Isabelle Stengers, L’invention des
sciences modernes, La Découverte,
Paris, 1993; Cosmopolitiques, La
Découverte, Paris, 1997 et Sciences et
Pouvoirs. La démocratie face à la tech-
noscience, La Découverte, Paris, 1997.
4.Michel De Pracontal, Les mystères de
la mémoire de l’eau, La Découverte,
Paris, 1990.
5.Serge Moscovici, La machine à faire
des dieux, Fayard,Paris, 1988; «Le
démon de Simmel», Sociétés,
6.Anthony Giddens, Les conséquences
de la modernité, L’Harmattan, Paris,
1994.
7.H.-P. Jeudy, op. cité,p.39.
8.Peter L. Berger, Comprendre la socio-
logie, Editions du Centurion, Paris,
1973.
1
/
4
100%