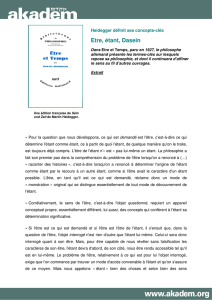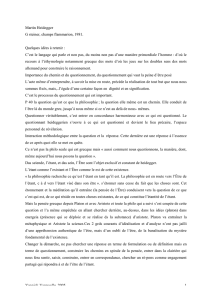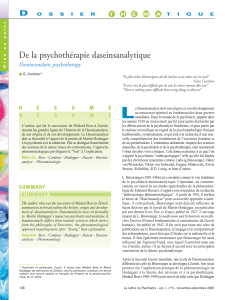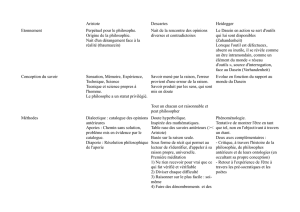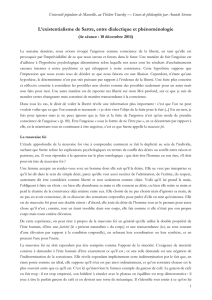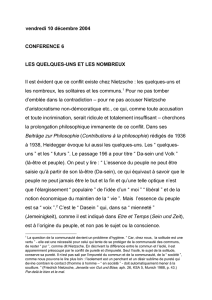La psychiatrie: Fondement d`une anthropologie philosophique?

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE
2011;162(1):10–20
www.sanp.ch |www.asnp.ch
Review article
10
Summary
Psychiatry: foundation of a philosophical anthropology? Ludwig Binswanger and
psychiatrist-being
How can the human status of an insane person be maintained from
the moment he has lost his reason which traditionally defines the human
being? That’s the question to which the psychiatric anthropology, by her
most eminent representative, Ludwig Binswanger, believed to have found
an answer in suggesting an alternative definition of the human being, based
on Heidegger’s concept of “Dasein”. When later on transcendental philoso
phy was rehabilitated and an intercorporeity (a primary bodily relatedness)
was identified which opens again the possibility of a primordial relatedness
to the other, this approach was given up. In fact, L. Binswanger, the founder
of “Daseinsanalyse” gives a redefinition of “being a psychiatrist” as distinct
of a “being an anthropologist” (a scientific conception) and of “being a doc
tor” (a conception of care), in incorporating into madness the phenomenon
of an impossibility to be the other. So the psychiatrist would be the insane
person’s other only if he becomes all others, which presupposes the use of a
philosophy supporting and validating all potential worlds.
Key words: human being; intercorporeity; psychiatry; Daseinsanalyse; other men
«L’être-psychiatre dans son être appelle (ruft…an) l’homme et le
revendique (beansprucht) dans sa totalité»: c’est par ces mots
aux résonances heideggeriennes que se clôt la mise au point
décisive donnée par Binswanger en 19581sur la contribu
tion de l’analytique existentiale à la représentation de soi de
la psychiatrie.
Venu du courant de l’humanisme médical qui, en ré
inventant la «folie»2, avait modifié en profondeur la relation
entre patient et soignant, Binswanger ne cesse de maintenir
un «cap» anthropologique qui semble lui servir de boussole
tout au long de son périple théorique dont les principales
étapes sont un ralliement à la phénoménologie husser
lienne – dès 1922 – puis une adhésion à l’analytique existen
tiale de Heidegger à partir de 1930… avec laquelle il finit
par prendre ses distances à partir de 1960 (dans Mélancolie
et Manie, puis Délire, son dernier livre, paru en 1965). Cette
orientation n’est pas un simple attachement de jeunesse
nourri par l’appartenance à la corporation des psychopatho
logues praticiens ou une fidélité à l’impulsion donnée par
La psychiatrie:
fondement d’une anthropologie philosophique?
Ludwig Binswanger et l’être-psychiatre
Philippe Veysset
Funding/potential conflict of interest: No funding. No conflict of interest.
Correspondance:
Dr phil. Philippe Veysset
Rue Charles Hanssens 13
BE-1000 Bruxelles
Belgium
le Cercle de Wengen3. Il témoigne plutôt d’une démarche
spécifique pour élaborer un nouvel art du «guérir». Après
avoir analysé le sens de l’inscription de Binswanger dans ce
courant et les raisons qui l’ont conduit malgré tout à se tour
ner vers la doctrine heideggerienne dont l’orientation anti
humaniste et même antianthropologique fut connue assez
tôt, on verra en quel sens la folie, loin d’être une transgres
sion de la norme, constitue plutôt le signe précurseur d’un
nouvel «êtrehumain».
Inscription de Binswanger dans l’anthropologie
philosophique
L’anthropologie fait l’objet d’un soin si attentif dans la
psychiatrie existentielle qu’elle finit par constituer le
conceptqui articule sa définition: «Par analyse existen-
tielle nous entendons une recherche anthropologique c’est-à-dire
une recherche scientifique dirigée sur l’essence de l’être-homme»
écrit le fondateur de l’analyse existentielle4. Et de poser
quelques lignes plus loin cette affirmation qui lui sera tant
reprochée: «L’analyse existentielle ne pose aucune thèse onto-
logique»5.
Inventer une psychiatrie qui, contre la théorie freu
dienne des pulsions notamment, réhabilite le patient, un
patient qui demeure Mensch non seulement en dépit de sa
folie mais par son truchement, par le message qui s’abrite
1«Importance et signification de l’analytique existentiale de
Martin Heidegger pour l’accès de la psychiatrie à la compré
hension d’ellemême», 1958, dans Introduction à l’analyse
existentielle, traduction Jacqueline Verdeaux, Paris, Minuit, 1971,
p. 263.
2Le terme même avait été banni au profit de celui de «mala
die mentale». Les représentants de l’anthropologie psychia
trique restituent à la folie l’épaisseur d’une expérience existen
tielle dont le positivisme médical l’avait privée lui assignant des
causes extérieures – organiques (biologiques ou génétiques) ou
psychiques qui aboutissaient à l’expulser ellemême du champ
de la normalité.
3Le Cercle de Wengen tire son nom du lieu de villégiature – si
tué dans les Alpes bernoises – où L. Binswanger, E. Minkovski,
E. Straus et V. Gebsattel se retrouvèrent dans l’entredeux
guerres pour donner le jour à une «nouvelle psychiatrie».
4«Sur la Direction de recherche analyticoexistentielle en psy
chiatrie» dans Analyse existentielle et psychanalyse freudienne,
traduction Roger Lewinter, Paris, Gallimard, 1970, p. 51.
5Ibidem. C’est M. Heidegger luimême qui dans les Zollikoner
Seminare, énonce l’hypothèse de sa transgression. Zollikoner
Seminare, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1987,
passim.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE
2011;162(1):10–20
www.sanp.ch |www.asnp.ch
Review article
11
dans ses plis secrets, fonder en somme une herméneutique
de la folie, quelle anthropologie philosophique le permet?
Ce que l’anthropologie classique6apporte à la psychia
trie dans sa tentative de compréhension de l’homme, c’est
d’abord l’existence d’une filiation entre le primitif et le fou
comme témoins d’une commune origine: il est banal chez
le primitif d’obéir à des forces mystérieuses (avec lesquelles
une communication de type hallucinatoire peut s’établir) à
l’instar de ce qui se passe dans nombre de schizophrénies
(tel le cas Aline ou encore celui de la paranoïa décrite par
A. Strindberg dans Inferno).
Mais, quel que soit son intérêt, cet enseignement laisse
intacte la principale question que l’anthropologie classique
pose à la psychiatrie: le problème de la «raison» comme
critère de l’humanité. Dès lors que, dans le fil de la défini
tion aristotélicienne, l’homme continue d’être défini comme
Z»on logon °xon,«vivant doté de la raison», comment un
fou peutil encore être dit un homme tandis qu’il a perdu
ladite raison? Et comment une relation équitable vatelle
pouvoir s’engager sur un fondement aussi instable non pas
en termes de rationalité dialogique, mais simplement parce
que l’interlocuteur ne répond plus à ce critère sur lequel
repose l’égalité censée régir tout commerce avec autrui?
Toujours guette l’animalisation du fou, fantasme nourri
d’hypothèses hâtivement façonnées.
C’est ici que l’anthropologie peut jouer un rôle déci
sif. Son principal enseignement est justement que lorsque
le primitif parle de luimême, il se désigne par le nom de
sa tribu ou de son clan, ce que Freud, dès 1913, a souligné
dans Totem et tabou. «L’homme – c’estàdire le hopi,lepeulh,
le nambikwara… – a fait ceci, cela…»veut dire: «j’ai fait ceci,
cela,…». Pour Ludwig Binswanger, cette alchimie primitive
est d’abord le fait du langage. Chez le primitif, «le nom colle à
l’individu comme une peau» et c’est pourquoi on peut prendre
celuici par son nom avec la même force qu’on prendrait
quelqu’un par le bras ou même la gorge7.
Ce mode d’expression participatif accuse un nouveau
type de conciliation entre pluriel et singulier, le primitif
étant aussi celui qui, souvent, recourt àdes formes duelles de
conjugaison, formes dont la trace se retrouve dans nombre
de langues modernes (le Beide allemand, le both anglais).
Binswanger souligne aussi l’importance de ce phénomène
d’une parole qui émane de l’intercorps.
De ce fait l’anthropologie, dans sa quête d’un «être»
humain, d’un Mensch-sein, est légitime à prétendre que son
objet de connaissance – le «primitif» – est aussi son principal
interlocuteur théorique, en ce que la pensée primitive nous
apprend qu’il n’y a pas d’«homme». Finalement il s’avère
que le savoir définit d’abord un mode de relation – positif ou
négatif – avec autrui avant même de caractériser son objet,
ce que la réflexion sur la «thématisation» scientifique ne fera
que confirmer.
Ceci laisse présager la redéfinition de la connaissance
psychiatrique en termes de relation à l’autre, idée qui va dès
lors constituer le fil directeur de la réflexion de Binswanger.
Lorsque je pense (à) quelqu’un, je m’adresse à quelqu’un:
La clinique prend à son service les explorations de tous
les champs d’objet psychiatriques et règle ce service. Cette
régulation s’effectue (…) dans le sens de l’intelligence de
l’articulation et de la hiérarchie de ces champs d’objet et
du but clinique suprême qui est d’accomplir, par tous les
moyens, la tâche médicale, le «faire au chevet du malade»8.
La pensée médicale est donc, du fait de sa visée iatrique,
une pensée qui se construit d’emblée en fonction de l’autre,
dont l’autre est l’horizon.
L’idée d’une anthropologie rénovée (Heidegger)
C’est ainsi que naît l’idée d’une anthropologie phénoméno
logique: il s’agit bien de sauver l’homme d’un émiettement
auquel le condamne l’oubli du corps par la philosophie – un
corps progressivement récupéré par la médecine sans que
celleci y ait spécialement vocation – mais sans recourir au
critère qualifiant de la raison:
L’analyse existentielle n’est ni ontologie ni philosophie
en général; c’est pourquoi la désignation d’anthropologie
philosophique ne peut être acceptée par elle; seule la dé
signation d’anthropologie phénoménologique recouvre le
véritable état des choses9.
La conférence que Husserl donne sur le rapport entre phé
noménologie et anthropologie10 établit en effet la possibilité
de ce rapport mais en des termes très restrictifs. Husserl pro
cède en deux temps: il montre d’abord que l’anthropologie
se donne comme science. Acetitre, elle ne bénéficie d’aucun
statut particulier. Comme n’importe quelle autre science,
elle reçoit son caractère propre d’une connaissance a priori,
philosophique, laquelle définit une ontologie régionale rela
tive à sa «sphère d’être» spécifique.
L’anthropologietire sa scientificité de son apodicti
cité et cette apodicticité provient et ne saurait provenir
que de l’aprioricité du cogito et du sujet transcendantal qui
l’exerce. La phénoménologie est «la philosophie transcen
dantale «accomplie» (ausgewirkt) et «parvenue à un tra
vail effectivement scientifique» (zu wirklich wissenschaftlicher
Arbeit gekommene) par lequel le monde conquiert son rang
6Nous entendons ici par «anthropologie classique» simplement
l’anthropologie antérieure à L. Binswanger. En fait, à l’époque
où le souci binswangerien prend forme, il existe déjà une
anthropologie qui se présente comme une alternative à l’an
thropologie traditionnelle – celle de Morgan, de Tylor et de
Bachofen. En Allemagne se développe autour de M. Scheler
et de H. Plessner, une «anthropologie philosophique». La cor
respondance de Binswanger avec Erich Rothacker, autre re
présentant de ce courant, atteste d’une familiarité avec celui
ci. D’autre part, à la même époque, une anthropologie médi
cale s’ébauche sur le fondement des travaux contemporains de
Buytendijk et de Uexküll.
7Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Herausg.
Von Max Herzog und HansJürg Braun, Ausgewählte Werke,
Heidelberg, Asanger Verlag, 1993, I, 2, «Das Nehmen bei».
8«Analytique existentielle et psychiatrie» dans: Analytique exis
tentielle et psychanalyse freudienne, op. cit. p. 111.
9Sur la direction… op. cit. p. 52.
10 «Phänomenologie und Anthropologie», Vortrag in den Kantge
sellschaften von Frankfurt, Berlin und Halle, in Frankfurt am
1. Juni, in Berlin, am 10. Juni und in Halle am 16. Juni 1931,
dans Husserliana, Ausätze und Vorträge 1922–1937.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE
2011;162(1):10–20
www.sanp.ch |www.asnp.ch
Review article
12
de phénomène11 et l’expérience, sa «valence» (Geltung).
Par l’Epochè, processus de réduction, «le monde est mainte-
nant entre parenthèses, simple phénomène, et certes en particu-
lier phénomène de valence de l’expérience qui s’écoule, celle de la
conscience principalement, mais d’une conscience transcendantale-
ment réduite»12.
D’autre part, cette «sphère d’être» est celle de l’être
homme – un étant parmi d’autres:
Toute doctrine de l’homme, note Husserl, qu’elle soit em
pirique ou a priori, suppose un monde étant ou pouvant
être étant. Par là une philosophie de l’êtrehumain retombe
dans cette naïveté que tout le sens de la modernité est de
surmonter.
L’homme, l’êtrehomme, est du côté du moi empirique
que Husserl nomme pour l’occasion «MenschIch», «moi
humain», et il existe entre l’ego transcendantal et ce moi
empirique, une distinction fondatrice (Grundunterscheidung).
Pourtant Husserl ne peut s’enfermer dans cette distinction.
Le concept qui va permettre de circuler au sein de cette dis
tinction est celui de solitude. Il écrit: «A partir de la solitude
humaine, au moyen de l’Epoché, est devenue une solitude radica-
lement autre, la solitude transcendantale, c’est-à-dire la solitude
de l’ego». L’expression allemande est: «Aus (der menschlichen
Einsamkeit) ist geworden … die transzendantale Einsamkeit».
C’est donc moins la solitude humaine qui se transforme,
qu’à partir d’elle la solitude transcendantale qui «devient».
Cette dernière utilise la solitude «mondaine» pour prendre
forme et tout aussitôt mettre en question «mon être comme
homme – parmi les hommes et les autres réalités du monde»13.Au
fond la solitude «transcendantale» qu’on appellerait mieux
isolement structurel ou principiel prend forme dans la soli
tude humaine. La phénoménalisation de l’êtrehomme re
quiert de rester seul avec son corps, mais cette idée d’un
corps qui reste seul n’a aucun sens et un moment, ce corps
disparaît à son tour. Naît alors l’ego transcendantal, un ego
transcendantal qui n’est toutefois pas pure négation du corps
mais condition d’apparition du «monde» (et donc du «psy
chisme», du «corps» et du «moi humain») comme objet
phénoménal d’étude. Le corps est le catalyseur de ce chan
gement qu’il inspire, modèle et engendre par son «occulta
tion». Il est, à la fois, condition de l’ego transcendantal et
principe de la phénoménalisation du monde.
On voit ici que la position husserlienne – celle d’un strict
transcendantalisme – annonce le rôle du corps, un corps
vécu non plus comme un poids dont il faudrait se défaire
mais comme transfiguré par sa propre vertu, dernier élément
qui sépare encore le moi physiquement isolé de l’ego trans
cendantal et en même temps refuse que l’humain puisse
dépasser le stade d’une empiricité phénoménale pour carac
tériser ce transcendantal luimême. L’humain reste sur le
seuil du transcendantal.
Mais surtout, ceux qui voient dans la transcendanta
lisation de l’ego une oblitération du monde ou un dua
lisme radical, passent «à côté» du «nouveau royaume» de la
science. Pour eux, «tout est manqué»14.
En dépit de sa rigueur, cette position reste fragile aux
yeux de Binswanger. Descartes ne cessetil pas de jeter –
en dépit du raisonnement des quatre dernières Méditations
qu’il a luimême conduit –, un pont entre l’âme et le corps
comme l’attestent sa Correspondance avec Elisabeth ou encore,
dans le Traité des passions, sa théorie des «esprits animaux»?
De même, la difficulté que rencontre Husserl pour justifier
de ma rencontre avec l’autre15 ne peut s’expliquer que si
on pose au départ un sujet coupé du monde. Mais surtout,
même si c’est son sacrifice qui ouvre l’accès à la science,
l’ego transcendantal demeure un ego désincarné. Y atil
un lien entre l’incommunicabilité avec l’autre et le sacrifice
du corps?
C’est cet essaim de questions qui va, dès 1930, orien
ter la réflexion de Binswanger vers l’analytique existentiale.
L’invitation heideggerienne àune nouvelle anthropologie
Heidegger en effet ne disqualifie pas originairement l’an
thropologie. Il écrit notamment:
L’analytique du Dasein demeure entièrement orientée sur
la tâche directrice de l’élaboration de la question de l’être.
C’est par là que se déterminent ses limites. Elle ne peut pré
tendre fournir une ontologie complète du Dasein – laquelle
bien sûr doit être construite si quelque chose comme une
anthropologie philosophique doit un jour s’élever sur une
base philosophique suffisante16.
Cette attitude de conciliation apparente est suffisante aux
yeux de Husserl pour rattacher l’auteur de Sein und Zeit à ce
courant17. Mais cette attitude s’expliquetelle uniquement
par des raisons d’opportunité?
Françoise Dastur, dans Heidegger et la question de l’an
thropologie18, fait signe vers d’autres raisons. Dans Kant et
le problème de la métaphysique19, paru en 1929, Heidegger
rappelle que «l’instauration kantienne du fondement fait
découvrir que fonder la métaphysique est une interroga
tion sur l’homme, est anthropologie». Il ne s’agit pas d’une
anthropologie «pragmatique» à l’instar de celle rédigée par
Kant luimême mais bel et bien d’une anthropologie «philo
sophique». La quatrièmequestion ajoutée par Kant aux trois
questions de la raison pure: «Que puisje faire? Que dois
je faire? Que m’estil permis d’espérer?», à savoir «Qu’est
11 Id. p. 168. On peut se reporter à Erste Philosophie, Hua, VIII, 5.
12 Id. p. 171.
13 «Jetzt aber (…) ist auch mein Sein als Mensch – unter Menschen
und sonstigen Realitäten der Welt – mit in Frage, mit der Epoche
unterworfen.» Ibidem.
14 «Ist der Sinn der Reduktion verfehlt, die das einzige Eingangstor
in das neue Reich ist, so ist alles verfehlt». Op. cit. p. 172.
15 Difficultés que le recours à la théorie de l’Einfühlung, reprise
de Theodor Lipps et formulée dans les textes tardifs, ne suffira
pas à résoudre.
16 Sein und Zeit, § 5, traduction Emmanuel Martineau, édition
hors commerce p. 35 [17], la pagination entre crochets est celle
de l’édition de 1960.
17 Heidegger est moins cité que visé dans la conférence de 1931.
Relégué sur le versant empirique du monde, le Dasein y est
toujours évoqué comme «menschliches Dasein».
18 Françoise Dastur, Heidegger et la question de l’anthropologie,
Leuven, Peeters, 2003.
19 Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Paris, Galli
mard, Coll. Tel, 1981, p. 269.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE
2011;162(1):10–20
www.sanp.ch |www.asnp.ch
Review article
13
ce que l’homme?» et synthèse des trois autres, aborde la
question de l’«êtrehomme» sous l’angle de la finitude (par
exemple «Que puisje faire?» interroge les limites de mes
possibilités d’être et d’agir). C’estainsi qu’Heidegger en vient
à affirmer: «Plus fondamentale que la question de l’homme
est celle de sa finitude».
Mais la question de la finitude doit être correctement
posée. S’il estincontestable que d’une part l’ontologie fonda
mentale est bien celle de cet étant singulier qu’est le Dasein
humain et entretient donc un lien particulier avec l’anthro
pologie qui, entendue comme anthropologie philosophique,
est différente d’une simple ontologie régionale, son objet
de connaissance étant constitué par un étant radicalement
différent des autres, il convient en premier lieu de penser
cette différence entre le Dasein et les autres étants et en par
ticulier, de voir que cette différence n’est pas une différence
ontique mais ontologique:
Parce qu’il est dans la perte de soimême (…), le Dasein a
«naturellement» tendance à comprendre sa différence par
rapport aux autres étants comme une différence ontique et
non pas comme une différence ontologique20.
D’autre part, la question de la finitude ne doit plus être
posée comme le fait Kant en termes de finitude exclusive de
la raison mais dans l’horizon de la question du sens de l’Être,
ce dernier étant également caractérisé par elle sous la forme
de la temporalité.
L’approche anthropologique est donc accréditée mais
elle fait l’objet d’un protocole. Au demeurant, dès Sein und
Zeit, Heidegger marquait les limites de cette accréditation:
Les origines dont dérive l’anthropologie traditionnelle, note
til21, montrent que la question de l’être de l’homme a été
oubliée lorsqu’on s’est efforcé de déterminer l’essence de
l’étant homme.
Le modus operandi théorique: «transcendance»
(ouverture) et raison
C’est en tant qu’ekstatique que le Dasein peut se trouver
au centre de la problématique ontologique. Il s’agit bien
de récuser le sujet cartésien dont toute la question est de
savoir comment il peut retrouver le monde et s’y retrouver
luimême, question qui est encore celle de l’intentionna
lité husserlienne. La transcendance comme constitution du
Dasein, rend possible de redéfinir l’homme en accordant à
la raison un statut plus contingent – ce qui fait qu’elle peut
être, accessoirement, «perdue»22.
Binswanger ne peut qu’entériner une telle évolution
qui dénoue la plupart des tensions nouées autour de ce der
nier concept: dans Sur la direction de recherche daseinsanaly-
tique en psychiatrie (1945), la psychose est définie comme une
«flexion du transcender» (Abwandlung des Transzendierens).
Le transcender est en même temps formation de monde,
«mondéisation» sur un certain mode temporel. Ce sera,
par exemple, le «saut» pour la fuite ordonnée des idées, le
«tourbillon» pour la fuite désordonnée des idées, le ratati
nement et la «permondéisation» dans certaines pathologies
schizophréniques telle l’anorexie d’Ellen West qui, alterna
tivement, s’enterre et s’envole jusqu’au ciel. Dans ce dernier
cas, la «liberté du laisseradvenir le monde» s’oppose à la
«nonliberté du devoirs’enfoncer dans le monde». Oiseau
devient ver de terre ou plutôt est dévoré par lui.
A travers cette flexion de la structure fondamentale de
l’être au monde, du «mondéiser», c’est en fait une flexion
du «corporéiser» qui s’opère. Cette thèse sera finalement
validée par Heidegger dans les Zollikoner Seminare, au tra
vers du concept de «Leiben» qui constitue la première mani
festation de l’apparaître, le premier étantphénomène. Que
cette démarche affecte la forme d’une déréalisation de tout
ou partie de son corps (syndrome de Cotard), d’une mécon
naissance de son reflet ou d’une destruction de la chair (mu
tilation, autolyse), le schizophrène ne corporéise pas.
Néanmoins jusqu’où va cet échec de la phénoménali
sation? Le schizophrène manifestetil cette ruine de l’ap
paraître? Telle est la question que pose la psychose tant au
philosophe qu’au psychiatre. Il faut d’abord noter qu’en sa
genèse, la psychose se manifeste comme un «dérangement»
de la manifestation (linguistique). Suzanne Urban conçoit
sa psychose lorsque le spécialiste qui examine son mari lui
fait injonction – en plaçant son index sur sa bouche – de se
taire et sur ce mode prohibitif, lui annonce que son mari
souffre d’un mal incurable. Un autre cas, rapporté par Henri
Maldiney23, fait état d’un jeune homme qui conçoit sa psy
chose au moment où il lit sur le visage de son père la grimace
du désespoir lorsque retentit la détonation du coup de fusil
que se donne son frère.
Il yadérèglement du langage mais langage quand même?
Dérèglement de l’homme mais homme quand même? Telle
est toujours la question. Jusqu’où va la liberté du Dasein,
une liberté qui est d’abord, fautil s’en souvenir, celle de
l’Être s’ouvrant en ses possibles. Le terme de «flexion» uti
lisé pour désigner la psychose, est significatif: c’est un terme
grammatical pour désigner les variations d’un suffixe adja
cent au radical d’un mot. Tout est langage. Et toute folie,
dérèglement d’un code symbolique24. La communication
avec le médecin se fait sur le mode de la trahison mais elle se
fait tout de même et tant soit peu. Il y a un «corps» et, même
s’il est «privé», un «langage» du schizophrène.
20 Françoise Dastur, Heidegger et la question… op. cit. p. 32.
21 Sein und Zeit, S. 49.
22 On ne peut écrire que la substitution de la «transcendance» à
la «raison» induit une substitution du «Dasein» à l’«homme».
Ce que récuse Heidegger, c’est le recours même du Dasein à
la notion d’homme, marque d’inauthenticité en ce que cette
notion qui relève du registre ontique, lui voile sa relation à
l’Être, partant l’Être luimême. Ce n’est pas parce qu’il y a
substitution de la notion de transcendance à celle de raison
que le terme d’«homme», trop lié à celui de «raison», serait
disqualifié. C’est plutôt la notion de Dasein, comme étant pour
qui il y va en son être de l’Être, qui fonde l’abandon du recours
au concept de «raison». On ne peut pas d’ailleurs pas parler
d’abandon de la notion de «raison», celleci étant conservée et
revisitée dans un sens présocratique – héraclitéen par exemple –
qui lui confère un caractère de transcendance.
23 Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon,
2007, p. 316.
24 On peut ici se reporter au beau chapitre consacré par Marc
Richir à Ludwig Binswanger dans Phénoménologie et institution
symbolique, Grenoble, Millon, 1988.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE
2011;162(1):10–20
www.sanp.ch |www.asnp.ch
Review article
14
Mais s’établitelle vraiment, cette communication, telle
est encore une fois vraiment la question, non qu’il s’agisse
de savoir si l’«homme» subsiste dans la folie mais plutôt si le
Mit-da-sein, son contraire, subsiste ou plus exactement, s’il y a
phénoménologie de la genèse de la différence ontologique.
C’est bien ici que va s’amorcer la bifurcation entre les deux
pensées, celle du philosophe et celle du psychiatre, car pour
le premier, il ne saurait être question d’une telle phénomé
nologie qui serait comme une reprise de l’Être par l’étant.
L’Être décide de son retrait comme de son apparaître, la
phénoménologie comme science de la raison, est du côté de
l’étant. C’est ici que le problème du suicide –celui même qui,
sous le nom de «retrait existentiel», avait conduit Binswan
ger à chercher du côté de la philosophie un levier possible
de guérison –, prend tout son sens puisque le suicide est le
point de nonretour du corps ne laissant derrière lui qu’une
trace de sa présence, une présence indirecte. Pour Heidegger,
par le suicide, le Dasein rejoint les étants du monde ambiant
et non pas l’Être. La perte théorique de l’«humain» rejoint
sa perte «pratique». Pour Binswanger, il fait signe vers un
retour à l’Être et ce signe suffit à assurer définitivement la
victoire de l’humain et partant, de l’anthropologique.
Le Dasein et l’homme chez Heidegger
Ce problème est au cœur de la polémique qui, avec une
intensité croissante, va opposer le philosophe et le psy
chiatre. Lorsqu’Heidegger subordonne la raison à la finitude
et semble préférer au terme d’«homme» celui de «Dasein»,
Binswanger ne peut que se rallier à ce qu’il juge être un
simple ajustement lexicologique. Mais pour Heidegger, la
sauvegarde du langage ou de l’apparaître ne signifie pas (ou
de moins en moins) celle de l’homme, voire celle du Dasein,
mais celle de l’Être.
Très vite en effet25, Heidegger se détache de la perspec
tive anthropologique: «Dans Sein und Zeit, le Dasein s’offre
encore sous l’aspect de l’anthropologique alors que c’est tout
le contraire qui est en vue»26. Il parle de «mésinterprétation
anthropologique»27. Le principal reproche est intéressant à
noter: il concerne le caractère contingent de l’apparition du
«phénomène humain» (pour reprendre le titre du célèbre
ouvrage de l’anthropologue Teilhard de Chardin)28:
L’êtrejeté (de l’homme) n’est expérimenté qu’à partir de la
vérité de l’Être. Dans la première interprétation, celle de Sein
und Zeit, une erreur reste possible: l’idée d’un avènement
accidentel de l’homme dans le reste de l’étant. C’est par ce
pouvoir que dès lors terre et corps s’animent. L’êtrehomme
et «la vie». Où est l’impulsion de départ pour faire du Dasein
un objet de pensée sinon dans l’Être luimême?
L’erreur de l’anthropologie est tout simplement de vouloir
faire du Dasein un «objet de pensée» (hinausdenken), ce qui
l’affecte d’un coefficient de contingence alors que par cette
pensée qu’il est, et seulement dans la mesure où il l’est, le
Dasein appartient à l’Être. Comme Husserl donc, Heideg
ger récuse l’idée d’une anthropologie philosophique mais
tandis que chez Husserl cette récusation se fonde sur l’oubli
de l’ego transcendantal, chez Heidegger c’est la présence de
l’ego transcendantal au sein de la conception «anthropolo
gique» de l’homme qui l’anime. Or cette identification entre
ego transcendantal et «nature» humaine est, on le verra, ce
que Binswanger ne saurait accepter, le cogito ayant foncière
ment valeur d’expérience, non de substance.
Il importe dès lors de bien analyser la nature de la rela
tion entretenue par le Dasein et l’êtrehumain.
En premier lieu, il convient de rappeler la situation de
l’Être (Seyn) par rapport au Dasein: «Le Dasein est la fonda-
tion de la vérité de l’Être (Seyn)»29.En quel sens le Dasein peut
il fonder cette vérité? Celleci semble être une démarche de
rupture d’avec sa propre unicité, son absolue singularité.
«L’Être, note Heidegger, a besoin (braucht) dans son unicité
(Einzigkeit) du Dasein. En cela il est fondé»30.
Mais quelle est cette fondation? Le Dasein est à la fois la
dissimulationdel’Être et la manifestation de cette dissimula
tion: «L’essence du Dasein est la dissimulation de la vérité de l’Être,
du dernier dieu, dans l’étant»31 et «Le Dasein est l’essence de l’illu-
mination du «se-cacher»32.
Cette position peut surprendre. Comment à la fois dis
simuler et montrer, exhiber, phénoménaliser? N’y atil
pas simplement deux différences: la différence entre Être et
Dasein d’une part et d’autre part la différence – dite «onto
logique – entre Être et étant?
Heidegger ne peut l’admettre. Le risque est grand de voir
apparaître par réfraction une troisième différence – celle
même que Binswanger qualifiera d’«anthropologique»33 –,
entre Dasein et étants «nonhumains» (animaux, plantes…),
ce que laisse voir d’ailleurs en partie Sein und Zeit, Heidegger
luimême le rappelle34.C’est ici que l’homme entre en jeu en
tant qu’être historique. Celuici est doté d’un double statut,
selon qu’il endosse ou non le Dasein, son «avenir».
Il y a donc une seule différence: la différence ontolo
gique. Être et Dasein s’entreappartiennent. La séparation
fondamentale «Êtreétant» est occultée par la séparation
(captieuse) «sujetobjet» laquelle a donné naissance non pas
à l’homme mais à unereprésentation singulière, inauthen
25 C’estàdire dès 1935–36, date d’attribution des manuscrits
publiés dans la Gesamtausgabe (volume 65) sous le titre
«Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)». Voir notamment le
chapitre V «Die Gründung».
26 «Das Dasein steht in «Sein und Zeit» noch im Anschein des
«Anthropologischen» oder «Subjektivistischen» und Individua
listischen» usf und doch ist von allem das Gegenteil im Blick»
G.A § 172.
27 «Anthropologische Missdeutung» Id. § 272.
28 «Die Geworfenheit wird erst erfahren aus der Wahrheit des
Seyns. In den ersten Vordeutung («Sein und Zeit») bleibt sir
noch missdeutbar im Sinne eines zufälligen Vorkommens des
Menschen unter dem anderen Seienden» Id. § 194.
29 «Das Dasein ist die Gründung der Wahrheit des Seyns» Idem,
§ 175.
30 «Das Sein in seiner Einzigkeit braucht das Dasein und darin
gegründet und es gründend den Menschen» Id. § 194.
31 «Das Wesen des Daseins (…) ist die Bergung der Wahrheit des
Seins, des letzten Gottes, in das Seiende» 188.
32 « Das Dasein ist die Wesung der Lichtung des Sichverbergens»
Id. § 173.
33 Et que récuse expressément Heidegger dans les Zollikoner
Seminare.
34 Il condamnera explicitement la notion de différence anthropo
logique dans les Zollikoner Seminare: «Die «anthropologische
Differenz» ist ein Holzweg» («La «différence anthropologique»
ne mène nulle part»). Op. cit. p. 231.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%