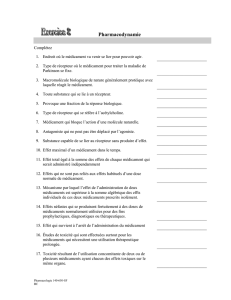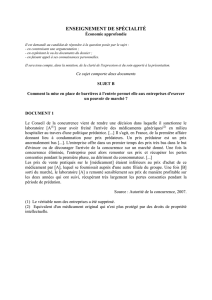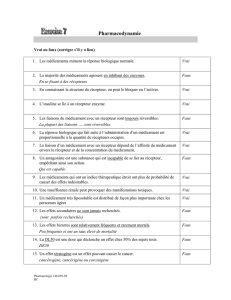Les médicaments en question.

Comité d’Orléans de la FRM
Feuille d’automne 2011
La Fondation pour la Recherche Médicale est une organisation
nationale reconnue d’utilité publique depuis 1965. Elle a pour mission de soutenir et de faire
progresser la recherche dans tous les domaines médicaux. Le Comité d’Orléans de la FRM travaille
pour faire connaître la FRM et pour favoriser le développement de la recherche médicale dans les
laboratoires de recherche orléanais.
Conférence-débats
Organisée par l’Amopa (Ordre des Palmes Académiques)
au Muséum d’Orléans,
6 rue Marcel Proust
*******************
Lundi 26 septembre à 18 h
Les médicaments en question.
Effet placébo, prescriptions homéopathiques, médicaments
présents et futurs
Michel Monsigny, professeur émérite des Universités
**************
En guise d’introduction, voici quelques citations :
** Le but de la médecine selon d'Hippocrate, 410 av. J.-C. :
« ἀσκέειν, περὶ τὰ νουσήµατα, δύο, ὠφελέειν, ἢ µὴ βλάπτειν » :
« Avoir, dans les maladies, deux choses en vue : être utile ou du moins ne pas nuire » in
Épidémies (I, 5)
** « Toute substance est un poison : il n’y en a aucune qui n’en soit pas un. La dose
appropriée différentie le poison du médicament. » Paracelse, 1493-1541
** Le serment du futur médecin : … « Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou
de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et
sociaux. » …
1 - Les médicaments classiques (allopathiques)
Quelle est la définition du terme médicament ? Le mot est emprunté au latin
medicamentum = remède, drogue .: « substance employée à des fins thérapeutiques» (Henri de
Mondeville, Chirurgie, 1314, éd. A. Bos, 1051) : Substance employée à des fins thérapeutiques
pour rétablir l'équilibre dans un organisme perturbé. (Atilf).
La mise au point d’un médicament exige un grand nombre de travaux qui précédent la
demande d’Autorisation de mise sur le marché (AMM). L’AMM, en France, est délivrée, après
expertise, par le Directeur Général de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire et des Produits de
Santé (AFSSAPS). Pour l’Europe : c’est l’Agence européenne du médicament ou EMA. Un
composé candidat pour une pathologie donnée doit répondre à différents critères concernant le
composé lui-même, ses interactions avec la cible choisie, son comportement vis-à-vis des cellules,
sa répartition dans l’organisme, les doses requises …
Les cibles : les médicaments sont destinés à modifier l’activité d’une cible appelée
récepteur. Par exemple, une statine se fixe sur une enzyme (protéine) impliquée dans une étape
précoce de la synthèse des isoprénoïdes, famille à laquelle appartient le cholestérol. L’aspirine se
fixe, entre autres cibles, sur une enzyme (oxygénase) clé de la synthèse des substances impliquées
dans la sensation douloureuse.
Le récepteur : molécule (protéine, par exemple) qui a de l’affinité pour une autre molécule,
c'est-à-dire qui est capable de s’associer à une autre molécule. Si le récepteur est une enzyme, le
partenaire sera soit un substrat qui sera modifié par l’enzyme, soit un inhibiteur qui diminue
l’activité de l’enzyme (par exemple l’inhibiteur de l’acétyl-cholinestérase). Si la molécule est un
modulateur de l’activité neuronale, le médicament sera soit un agoniste qui favorise l’activité du
récepteur soit un antagoniste qui inhibe son activité. L’efficacité d’un médicament dépend aussi
de son affinité spécifique pour le récepteur visé.
L’affinité est une dimension fondamentale dans la sélection des médicaments. En effet, pour
qu’un produit soit efficace, il est nécessaire que son affinité soit suffisamment élevée pour qu’une
proportion significativement élevée du récepteur soit associée au médicament. Par exemple, si
l’affinité est élevée (109 Litre/mole) le médicament sera actif lorsque sa concentration à proximité
du récepteur sera de l’ordre de 10-9 Mole / Litre. En d’autres termes, un médicament de ce type
sera actif pour une dose de l’ordre d’un dixième de mg pour une personne de 70 kg. Si l’affinité
est moyenne (106), la dose sera de l’ordre de 100 mg.
Répartition du médicament dans l’organisme : cette répartition dépend de divers facteurs
dont
la voie d’administration : voie orale, intraveineuse, sous-cutanée, intradermique, etc.
la fréquence des prises du médicament
la solubilité dans l’eau (ou les milieux aqueux) ou dans les milieux lipidiques (membranes)
la vitesse d’élimination
les voies métaboliques : c'est-à-dire mécanismes de transformation : activation, dégradation
(en particulier au niveau du foie),
etc.
La dose est la quantité précise de médicament généralement exprimée par la masse ou le
volume qui doit être administrée à un malade (Atilf) en une fois. Cependant pour que la
concentration du médicament se maintienne au niveau d’efficacité recherchée, il est souvent
nécessaire que la dose soit prise à intervalles réguliers : 1, 2 , 3 ou 4 fois par jour
La concentration est la quantité d’une substance dissoute dans un volume défini, par
exemple 3,42 g par litre, soit 3,42 mg par millilitre ou centimètre cube, concentration minimale en
sucre pour détecter le goût sucré.
Lorsque le laboratoire a arrêté son choix commencent les essais cliniques qui sont très
couteux (souvent plusieurs centaines de millions d’Euros), d’où le découpage en phases, ce qui
permet le cas échéant d’arrêter les frais plus tôt. Les expérimentations en double aveugle : afin

de ne pas biaiser les résultats, les médecins prescripteurs et les personnes qui reçoivent le
traitement ignorent si le lot prescrit contient ou ne contient pas le principe actif (voyez la
feuille d’automne 2010).
Les essais cliniques : les différentes phases comprennent une phase pré-clinique et 4
phases cliniques.
phase préclinique
*étude de la molécule, sa structure, son effet sur les cellules, son effet sur l'animal
au niveau comportemental et biologique, l'étude des organes cibles.
phase I : 20 à 80 participants
*évaluation de la tolérance et de l'absence d'effets secondaires chez des sujets le
plus souvent volontaires sains, rémunérés pour cela.
*étude de la cinétique et du métabolisme chez l'homme de la substance
phase II
détermination de la dose optimale du médicament et de ses éventuels effets
secondaires.
*phase IIa : détermination de l’efficacité de la molécule avec 100 à 200 malades,
*phase IIb : détermination de la la dose thérapeutique de la molécule avec 100 à
plus de 300 malades.
phase III
étude comparative d'efficacité proprement dit : traitement / placébo, ou
traitement / traitement de référence avec plusieurs milliers de malades.
phase IV (après la mise sur le marché)
dépistage des effets secondaires rares ou des complications tardives.
Retrait ou suspension de l’AMM : l’arrêt de la commercialisation peut être le fait du
laboratoire ou à la demande de l’Agence si le médicament a des effets secondaires
indésirables, s’il y a de nouveaux médicaments plus efficaces, des génériques, etc.
Cas du Médiator
Le Médiateur a obtenu l’AMM en tant que médicament contre le diabète de type 2 ou
diabète « gras » et a été commercialisé en France de 1976 à 2009. Cependant, l’un des effets
facilement identifiables étant la perte d’appétit : le médicament a été utilisé comme coupe
faim. Mais, comme toute substance active, le Médiator a des effets secondaires indésirables
chez certains patients : en particulier, il favorise le développement de valvulopathie et d’
hypertension artérielle pulmonaire. La controverse et le « scandale médiatique » récents (en
France) viennent de ce que le médicament n’a pas été retiré du marché suffisamment tôt alors
qu’il aurait dû l’être compte tenu : des alarmes venues d’autres pays, des analogies avec un
autre médicament qui avait été retiré et de diverses études épidémiologiques. En outre, depuis
les années 1970, d’autres médicaments antidiabétiques ont reçu l’AMM et se sont avérés plus
efficaces et moins toxiques que le Médiator. Il est à noter que le retrait d’AMM n’est pas
propre au médiator ; en effet, plusieurs dizaines de médicaments ont été retirés du marché au
cours des dernières décennies.
2 -
L’homéopathie
: « Similia similibus currentur : que les semblables
guérissent les semblables ».
L’homéopathie, développée à la fin du 18
e
siècle par Samuel Hahnemann repose sur le
principe qu’une substance toxique qui produit des symptômes semblables à ceux d’un état
pathologique doit pouvoir guérir la dite pathologie à condition que la substance toxique soit
suffisamment diluée. Par exemple, l’Influenzinium 9 CH, préconisé contre la grippe, est
préparé à partir d’une solution mère qui est diluée un milliard de milliards de fois (10
-18
).
Compte tenu des doses utilisées (infiniment faibles) l’Académie de Médecine a demandé
l’arrêt du remboursement des prescriptions homéopathiques en 2004. Les études en double
aveugle ont montré que les prescriptions homéopathiques n’étaient pas plus performantes que
l’effet placébo (voyez la feuille d’automne 2010). Par ce que les principes actifs sont utilisés
à des doses infinitésimales, les prescriptions homéopathiques ne risquent pas d’avoir d’effets
toxiques mais, par contre pour des pathologies lourdes, l’utilisation de prescriptions en lieu et
place de médicaments allopathiques peut entrainer une aggravation irréversible de la
pathologie.
3 - La médecine personnalisée.
La venue de la médecine personnalisée permettra dans l’avenir de nouveaux progrès
dans le domaine thérapeutique. En effet, les effets indésirables des médicaments classiques
sont dus à diverses causes : le médicament est sélectionné sur la base d’une bonne spécificité
vis-à-vis de la cible souhaitée (récepteur). Cependant dans l’organisme, il y a souvent
d’autres récepteurs qui sont suffisamment proches pour qu’aux doses utilisées
(concentrations) ils s’associent aussi au médicament. L’efficacité d’un médicament, les
phénomènes secondaires ainsi que les vitesses de dégradation et d’élimination sont variables
d’un patient à l’autre. En outre, une même pathologie a, en général, diverse origines.
Par exemple, la mucoviscidose est due, dans quelques % des cas, à un défaut de synthèse
de la protéine CFTR : la protéine est beaucoup plus petite que la protéine normale. Il est clair
que les thérapies efficaces pour ces cas rares ne le sera pas pour la majorité des patients qui
ont la forme pathologique la plus répandue (absence de l’amino-acide F508, l’un des 1480
maillons de la protéine). Aujourd’hui, parce qu’il est possible de déterminer l’anomalie
génique de la mucoviscidose, une nouvelle thérapie limitée au cas des patients porteurs de la
protéine tronquée est en phase clinique 3.
De même, un type particulier de leucémie myéloïde chronique (celle liée au
chromosome Philadelphie) est très efficacement traité par un médicament : Imatinib
(Gleevec) qui est un inhibiteur sélectif d’une enzyme produite par ce chromosome et qui est à
l’origine de la multiplication des globules blancs.
***********************
Si vous souhaitez être informé(e) des sujets et des dates des prochaines conférences et des
activités de la recherche médicale dans l’Orléanais, veuillez adresser vos nom et adresse à
FRM Comité d’Orléans
30, rue des Varennes 45650 Saint Jean le Blanc
carole.laurent01@orange.fr
Vous souhaitez aider la recherche médicale, faites parvenir un don par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de : F.R.M. Comité d’Orléans à l’adresse suivante :
F.R.M. Comité d’Orléans 54 rue de Varenne 75335 Paris cedex 07
Les dons à la FRM Comité d’Orléans donnent droit à déduction fiscale.
1
/
2
100%