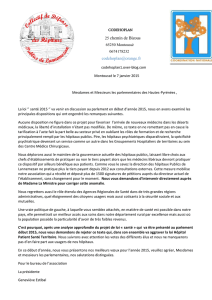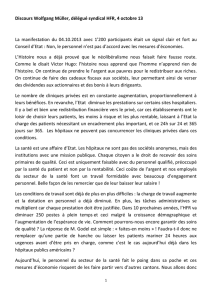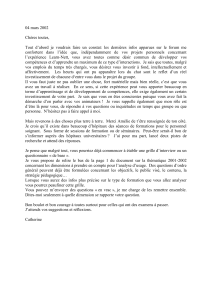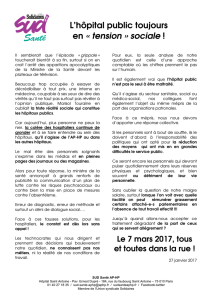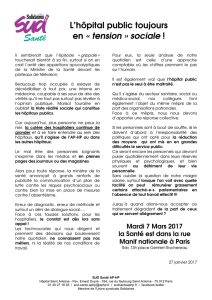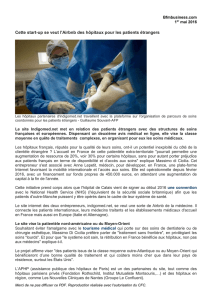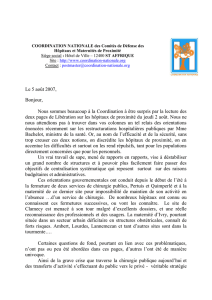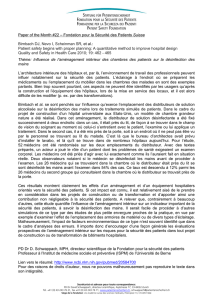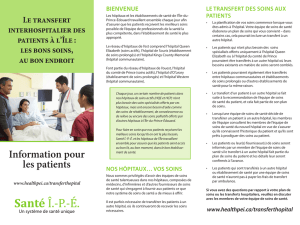La guerre contre les germes

8REVUE DRÄGER 1.1 | NOVEMBRE 2010
FOCUS HYGIÈNE
L
’été 2010 a été assombri par un cer-
tain nombre d’inquiétudes pour les
patients des hôpitaux allemands.
Dans un premier temps, on a appris qu’un
hôpital du Sud de l’Allemagne avait utili-
sé des outils chirurgicaux non stériles pen-
dant plusieurs mois. Puis, trois nouveaux-
nés décédaient dans un centre hospitalier
universitaire en raison de perfusions conta-
minées. Une fois encore, l’hygiène dans les
hôpitaux a fait les gros titres des journaux et
la peur du « piège mortel de l’hôpital » s’est
propagée. Rapidement, les politiques ont
annoncé un durcissement de la législation
et des réglementations supplémentaires.
Mais le débat public oublie réguliè-
rement que l’hygiène dans les hôpitaux
n’est pas un sujet récent. En effet, indé-
pendamment de ces incidents regretta-
bles et très médiatisés, des experts enga-
gés se battent depuis longtemps et sur tous
les fronts contre les agents responsables
des infections nosocomiales. Et les hôpi-
taux allemands sont d’ailleurs loin d’ob-
tenir de mauvais résultats si on les com-
pare au plan international, au contraire :
selon un rapport du European Center for
Disease Control Prevention and Control,
3,5 pour cent des patients d’hôpitaux alle-
mands sont victimes d’une infection noso-
comiale, contractée à l’hôpital, alors que
la moyenne européenne se situe aux alen-
tours de 7,1 pour cent.
Attention à bien se
désinfecter les mains
Cependant, le problème est et demeure
sérieux. L’Union Allemande pour d’Hygiène
des Hôpitaux (DGKH) estime que jusqu’à
500.000 infections se produisent chaque
année dans les hôpitaux allemands, entraî-
nant jusqu’à 20.000 décès. Chaque cas par-
ticulier est lié à une tragédie personnelle,
qui aurait éventuellement pu être évitée
grâce à des mesures relativement simples.
En priorité, les experts continuent à
insister sur l’amélioration de l’hygiène
des mains : « Les infections transmises par
l’environnement via les mains, peuvent à
90 pour cent être évitées en se désinfectant
correctement les mains » affirme le Pro-
fesseur Axel Kramer, qui dirige l’Institut
d’Hygiène et de Médecine Environnementale
à Greifswald. Grâce à des campagnes tel-
les que « l’action mains propres », l’utilisa-
tion de désinfectant pour les mains a quasi-
ment doublé dans de nombreux hôpitaux,
selon les observations du Professeur Kra-
mer. M. Kramer n’a aucun doute que cela
a déjà permis de réduire largement le pro-
blème : « Des études réalisées le plus sou-
vent aux USA, nous ont montré par le passé
que le respect accru de telles mesures a un
effet important sur le taux d’infection. »
Depuis, l’hygiène correcte des mains
est devenue un domaine de recherche à
part entière. On sait depuis longtemps que
le lavage à l’eau et au savon est ineffica-
ce voire contre-indiqué, car un lavage fré-
quent des mains finit par agresser la peau.
Des mains soignées avec une peau intacte
sont la condition de base à une désinfec-
tion efficace des mains : « En Allemagne,
on n’accorde pas à la protection et au soin
de la peau la place qui devrait leur reve-
nir et on les néglige souvent par ignoran-
ce », explique M. Kramer. « Lorsque les
mains sont irritées, on hésite également
à les désinfecter. »
La guerre contre les germes
Dans les cliniques allemandes, l’hygiène est au-dessus de la moyenne. Toutefois, environ
3,5 pour cent
des patients attrapent un germe à l’hôpital. La modification des comportements, mais aussi DE NOUVEAUX
CONCEPTS D’APPAREILS ET D’HYGIÈNE visent à poursuivre la réduction de ce pourcentage.
EN BREF L’Union Allemande pour d’Hygiène
des Hôpitaux enregistre jusqu’à 20.000 décès
par
an
dans les hôpitaux
allemands. Ce chiffre
peut être réduit, autant grâce à des
programmes
d’hygiène
systématiques que grâce à l’amélio -
ra tion
des équipements médicaux.
Les premiers
succès se manifestent déjà.
>
D-11080-2010

9
REVUE DRÄGER 1.1 | NOVEMBRE 2010
HYGIÈNE GROS PLAN
Les germes sont invisibles.
Une propreté visible est
un premier pas vers
une hygiène optimale.

10 REVUE DRÄGER 1.1 | NOVEMBRE 2010
Il est indispensable d’utiliser systémati-
quement le distributeur de désinfectant,
avant et après tout contact avec le patient.
Ce distributeur de désinfectant contient un
mélange d’alcools. « Certains fabricants
y ajoutent d’autres substances, mais leur
efficacité en termes de désinfection supplé-
mentaire n’est pas prouvée », selon M. Kra-
mer. Les produits éliminent généralement
les bactéries, les champignons et certains
virus. « Cependant, il n’existe que peu de
produits efficaces contre les virus nus, tels
que les norovirus », explique M. Kramer. Il
a développé lui-même un de ces produits,
un mélange synergétique de trois alcools. Si
une clinique est touchée par des infections
aggravées dues aux norovirus, M. Kramer
conseille de changer les distributeurs de
désinfectant : « Malheureusement, il n’est
pas possible d’utiliser ces produits en per-
manence, car ils irritent la peau. »
Pour une hygiène efficace,
tout le monde doit être motivé
Dès le milieu du 19e siècle, Ignaz Sem-
melweis prouvait que la propreté des
mains pouvait sauver des vies, lorsqu’il
fut le premier à obliger ses étudiants à se
désinfecter les mains avant de pratiquer
des accouchements. Cependant, une ques-
tion difficile demeure : comment amener
les médecins et le personnel soignant à
prendre le temps de se désinfecter régu-
lièrement les mains, malgré le stress quo-
tidien qui domine le travail à l’h
ô
pital ?
C’est la question qu’étudie Onno Helder
(MSc) à la Clinique Universitaire de Rot-
terdam. Une campagne de sensibilisation
lui a permis d’accroître la fiabilité de la
désinfection des mains de façon signifi-
Plus rapide, c’est possible : le manque de temps
nuit à une bonne hygiène des mains
>
Désinfecter d’abord, puis continuer à protéger contre les germes.
L’hygiène est un concept global, à appliquer de façon systématique.
D-11081-2010D-11083-2010
D-11082-2010D-11084-2010

11
REVUE DRÄGER 1.1 | NOVEMBRE 2010
HYGIÈNE FOCUS
cative. « Tout d’abord, il faut bien expli-
quer quels sont les dangers liés au manque
d’hygiène, puis il faut que les collabora-
teurs prennent conscience de leurs pro-
pres erreurs. En effet, la plupart d’entre
eux pensent qu’ils font déjà plutôt bien les
choses. Nous leur montrons que ce n’est
justement pas le cas », explique M. Helder.
« Il est également important d’impliquer
dans les campagnes des personnes d’auto-
rité, telles que les directeurs de clinique,
afin qu’elles se prononcent publiquement
en faveur d’une amélioration de l’hygiè-
ne. » M. Helder a déjà pu enregistrer un
premier succès : dans le service des soins
intensifs pour prématurés, le taux des
infections détectables dans le sang a bais-
sé de 44 à 22 pour cent au cours de la cam-
pagne d’hygiène.
Le Professeur Axel Kramer et ses collè-
gues à Greifswald se consacrent également
à la question de la motivation des collabora-
teurs. M. Kramer considère que l’une des
principales causes des problèmes d’hygiè-
ne des mains est le manque de temps. Il se
pose donc la question suivante : ne serait-il
pas plus raisonnable de réduire le délai de
30 secondes exigé par les fabricants pour
l’utilisation de leur désinfectant ? D’après
ses analyses, les mains sont tout aussi bien
désinfectées après 15 secondes d’utilisation
du produit. Dans le cadre d’un test, il a donc
demandé aux infirmières d’un service pour
prématurés de se frotter les mains à l’al-
cool pendant 15 secondes seulement pen-
dant toute la durée de leur service. Il put
alors observer une nette augmentation de
la fréquence avec laquelle les infirmières
se désinfectaient les mains. « Nous avons
prouvé qu’une utilisation d’une durée de 30
Comment fonctionne la stérilisation ?
L’objectif de la stérilisation est une élimination maximum des germes. Les instruments
chirurgicaux sont considérés comme « stériles », lorsque la validation du processus
assure que sur un million d’instruments, un seul germe est détecté. Généralement, les
objets sont stérilisés à la chaleur humide, dénaturant l’albumine. De 121 °C, on est
aujourd’hui passé à 134 °C, afin d’éliminer aussi les prions. Les microorganismes sont
détruits plus rapidement dans l’air humide que l’air sec, car la vapeur d’eau transmet
mieux la chaleur que l’air et gonfle en outre les spores des bactéries. Pour chauffer
suffisamment la vapeur d’eau, on utilise la surpression et l’on génère un vide comme
avec une cocotte-minute, afin que la vapeur pénètre tous les vides. Pour ce faire on
utilise des autoclaves de vaporisation à vide. Ce terme vient du grec « auto » et
« clavis » = clé. Les couvercles des récipients à surpression se ferment hermétiquement
à partir d’une pression de 2-3 bars. La durée du processus de stérilisation dépend
également des objets à stériliser. Avant la stérilisation, les objets doivent être soigneu-
sement nettoyés, car la saleté risquerait de faire écran et de protéger les microbes.
secondes est inutile », déclare M. Kramer.
De toute façon, ce délai est rarement res-
pecté dans la pratique. Par-contre, lorsque
l’on adapte l’exigence à la réalité, la disposi-
tion du personnel à se désinfecter les mains,
augmente visiblement. Si M. Kramer par-
vient à imposer sa recommandation, cette
modification de détail pourrait alors engen-
drer une amélioration importante.
Un tiers des infections est
apporté par le patient lui-même
Mais bien évidemment, la désinfection des
mains n’en représente qu’une seule, par-
mi les nombreuses mesures s’intégrant
dans un concept global. Environ un tiers
des infections se manifestant dans les hôpi-
taux est endogène, c’est-à-dire qu’elles sont
apportées par les patients. La grande majo-
rité des infections apparaissant dans les
hôpitaux n’est pas uniquement due à la
négligence du personnel soignant et des
médecins. La médecine moderne permet
d’effectuer des interventions de plus en plus
intensives, les agents pathogènes peuvent
pénétrer dans le corps via les cathéters et
les circuits patients, et la médecine intensi-
ve parvient de plus en plus souvent à main-
tenir en vie des patients affaiblis et vulnéra-
bles. L’utilisation accrue des antibiotiques
favorise l’apparition de bactéries de plus en
plus résistantes et difficiles à combattre.
Les pneumonies liées à l’assistance respi-
ratoire sont particulièrement dangereuses
pour les patients et représentent l’infection
la plus courante dans les services de soins
intensifs ainsi que l’infection nosocomiale
entraînant le taux de mortalité le plus élevé.
Une hygiène des mains minutieuse joue, là
encore, un rôle central, mais parallèlement
>

12 REVUE DRÄGER 1.1 | NOVEMBRE 2010
à cela, toute une série d’autres facteurs
entrent en jeu. « Un appareil d’anesthésie
n’est pas un simple outil, mais constitue
un poste de travail complet, devant dispo-
ser d’un concept d’hygiène adapté », expli-
que le Professeur Michael Wendt, direc-
teur de la Clinique d’Anesthésiologie et de
Médecine Intensive au CHU de Greifswald.
« Certais éléments, tels que l’écran tacti-
le, certains tuyaux et câbles d’électrocar-
diogramme doivent être désinfectés après
chaque utilisation. Au lieu de se fier à la
logique du personnel, il vaudrait mieux
signaler clairement ces éléments par des
couleurs. » Monsieur Wendt et son collè-
gue Axel Kramer souhaitent introduire un
tel système de signalisation à l’aide de cou-
leurs à Greifswald.
L’optimisation de l’hygiène et la mini-
misation de pneumonies sont également
un sujet important dans le cadre du déve-
loppement d’appareils d’anesthésie et d’as-
sistance respiratoire. « Nous soutenons le
développement de normes d’hygiène et dis-
cutons en permanence avec les médecins
ainsi qu’avec le personnel soignant et les
spécialistes de l’hygiène », explique Michael
Klein de Dräger. Une innovation importan-
te de ces dernières années est le filtre HME
« Heat and Moisture Exchanger » (échan-
geur de chaleur et d’humidité). À chaque
respiration naturelle, l’air respiré est humi-
difié et purifié par les muqueuses des voies
respiratoires supérieures. En cas de respira-
tion artificielle, c’est à l’équipement tech-
nique de remplir ce rôle. À la place d’une
humidification active, le filtre HME absorbe
l’eau de l’air lors de l’expiration et la réin-
troduit lors de l’inspiration. Ainsi, l’eau de
condensation dans le circuit patient, favori-
>
Les innovations de la technique médicale
optimisent l’hygiène
Un niveau d’hygiène maximum s’impose dans la salle d’opération,
où tous les instruments sont stérilisés.
Que faire contre les germes multirésistants ?
Les infections nosocomiales sont particulièrement dangereuses, lorsque les agents
résistent à de
nombreux antibiotiques. Les staphylocoques dorés multirésistants
(MRSA) représentent un grave problème dans de nombreux pays européens. Cepen-
dant, quatre pays se démarquent par un taux de MRSA particulièrement bas : les
Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Danemark
. Quel est leur secret ? Un point impor-
tant est
certainement l’utilisation traditionnellement plus réticente des antibiotiques.
Mais des procédures rigoureuses,
par exemple aux Pays-Bas, jouent également un rôle
décisif. Tous les patients à risques subissent un test de MRSA. En cas de résultat
positif, les patients touchés par les MRSA sont isolés en chambres individuelles et l’agent
est complètement éliminé. Cependant, les MRSA ne sont pas les seuls agents
multirésistants. Si l’on décidait de mettre chaque patient infecté en chambre individuelle,
les hôpitaux atteindraient vite leurs limites.
D-11085-2010
 6
6
1
/
6
100%