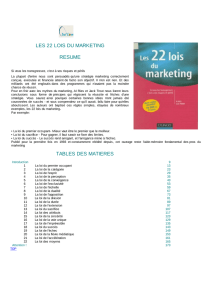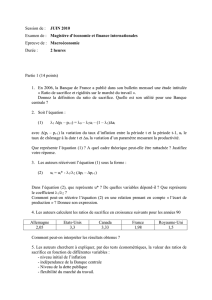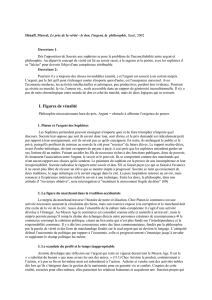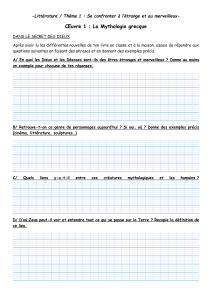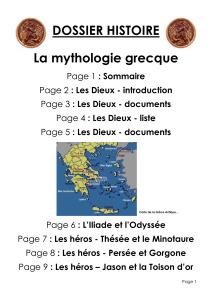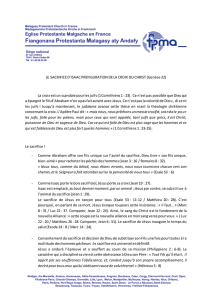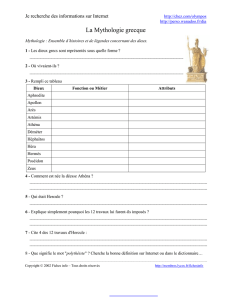INALCO Document pédagogiques 2011

INALCO Document pédagogiques 2011-2012
Cours ASU 016 février-mars 2012
Idéologies et pratiques de l’hindouisme
cours donné par Raphaël Voix (CEIAS)
Citations lues en cours
A/ Le sacrifice :
« Dans le védisme et le brahmanisme ancien, l’ordre du monde repose sur le sacrifice (yajña) et plus
généralement sur les rites dont le sacrifice est la forme suprême et le modèle. C’est en effet le sacrifice
offert par les hommes qui confirme les dieux dans leur statut divin et qui, donc, assure la mise en œuvre
harmonieuse des forces qui permettent la succession régulière des saisons et la formation des aliments
propres à chaque classe d’êtres ; c’est également le sacrifice qui confirme le statut des « dieux visibles »
qui est celui des brahmanes, et donc, l’organisation d’ensemble de la société ; et c’est le sacrifice qui
permet à l’homme (du moins à celui qui est habilité à le célébrer) de régler les dettes (r̥ ṇa) constitutives
dont il est chargé dès la naissance. En sorte que le sacrifice est ce qui donne sens à l’activité humaine : il
est même ce qui rend licite, pour l’homme, le simple fait de survivre, puisque la seule nourriture qu’il
puisse absorber sans péché est celle qui d’une façon ou d’une autre, est faite des reste des repas qu’il a
offerts – sacrificiellement – aux dieux, à d’autres hommes, ou bien aux Mânes. […] Or le sacrifice est
essentiellement, dans l’Inde brahmanique, affaire « villageoise ».
MALAMOUD, Charles, 1989, « Villages et forêt dans l’idéologie brahmanique », in Malamoud, Charles,
Cuire le monde. Rite et pensée dans l’Inde ancienne, La découverte, Paris, pp. 93-114.
Les fonctions sociales en rapport avec le sacrifice :
« Aux brahmanes, le (Créateur) assigna d’enseigner et d’étudier (les Veda et tout ce qui s’y rapporte), de
sacrifier pour eux-mêmes et pour les autres (comme officiants), de donner et de recevoir des dons ; aux
kṣatriya de protéger les créatures, de donner, de sacrifier pour eux-mêmes et d’étudier, ainsi que de ne
pas s’attacher aux objets des sens ; au vaiśya, il assigna de protéger le bétail, de donner, de sacrifier et
d’étudier, de faire du commerce, du prêt à intérêt et de cultiver la terre ; aux śūdra, le Tout-Puissant
enjoignit une seule activité : l’obéissance sans murmure aux trois premières classes »
Manu Smr̥ti
« L’immortalité des dieux leur vient du sacrifice ; elle est donc fondée sur le bon fonctionnement de ce
dernier. […]Le sacrifice est d’abord nourriture des dieux. Agni, le feux sacrificiel qui assure le transport
des fumées de l’oblation jusqu’au ciel, est lui-même une divinité védique importante qui requiert des
égards, un traitement bien réglé, sans défaut ni excès. […] C’est [aux hommes, du moins à certains
d’entre eux] qu’il revient de nourrir les dieux et d’assurer leur subsistance […] lorsqu’ils sont bien nourris
par les sacrifices, [les dieux] envoient la pluie en temps utile : dans un pays où le problème de l’eau est si
crucial, on comprend que ce soit là le symbole même de l’ordre cosmique. La pluie qui vient à l’heure fait
pousser les plantes, ce qui permet de nourrir les bêtes, les hommes et, par conséquent les dieux, puisque
le sacrifice est alors possible ».
BIARDEAU, Madeleine, 1996, « Le sacrifice dans l’hindouisme », in Biardeau M. et C. Malamoud, Le
sacrifice dans l’Inde ancienne, Paris, Peeters, p. 24.

INALCO Document pédagogiques 2011-2012
2
« Le kṣatriya constitue le yajamāna par excellence : il institue des sacrifices « royaux », solennels qui sont
destinés autant à la prospérité de son royaume qu’à celle de son règne. Par les taxes qu’il lève, par ses
droits sur le sol et le sous-sol, il est le principal détenteur de richesse, celui, par conséquent, qui peut
accompagner ses sacrifices des dons les plus généreux ».
BIARDEAU, Madeleine, 1996, « Le sacrifice dans l’hindouisme », in Biardeau M. et C. Malamoud, Le
sacrifice dans l’Inde ancienne, Paris, Peeters, p. 28.
Tableau : varṇa et sacrifice
« deux-fois nés »
(dvija)
Sacrifier pour soi
Etudier le Veda
Sacrifier pour les autres
Enseigner le Veda
« avec varṇa »
(sa-varṇa)
brāhmaṇa
✓
✓
✓
kṣatriya
✓
✓
✗
vaiśya
✓
✓
✗
śūdra
✗
✗
✗
« sans varṇa »
(a-varṇa)
intouchables
✗
✗
✗
mleccha
✗
✗
✗
Commentaire :
Dans la société brahmanique, telle qu’elle se donne à voir dans ses textes, tous les deux-fois-nés, c’est-à-
dire, tous les membres des trois varṇa supérieurs ont obligation quotidienne de sacrifier. S’ajoute à cette
obligation, celle, corollaire d’étudier le Veda, car, pour sacrifier il faut savoir réciter le Veda. En revanche,
seul les brahmanes sont habilités à sacrifier pour les autres, c’est-à-dire à être officiant dans un rituel
solennel. Corollairement à cette fonction, s’ajoute celle, complémentaire, d’enseigner le Veda.
Les cinq « grands sacrifices » (mahayajña) ou les « sacrifices quotidiens »
1. sacrifice aux dieux
2. sacrifice aux Pères
3. sacrifice au Veda
4. sacrifice aux hommes
5. sacrifice aux bhūta (êtres indistincts qui rodent autour de la maison)
Les don (dāna) dans le sacrifice solennel :
Il n’y a pas de sacrifice sans don :
1. « substance ou matière oblatoire » (dravya) aux dieux par l’intermédiaire d’Agni.
2. « honoraire sacrificiel » (dakṣiṇā) donné aux officiants : vache, - c’est la dakṣiṇā par excellence
elle est essentiel aux brahmanes pour sacrifier grâce à ces cinq produits (urine, bouse, lait, beurre
clarifié.. ) -, de l’or, vêtement, cheval, etc.
3. Dons de richesses aux brahmanes présents lors du sacrifice.
Les différents maillons de la chaîne sacrificielle (yajña).

INALCO Document pédagogiques 2011-2012
3
1. « Confiance » (śraddhā), littéralement la foi, mais désigne, la confiance que le sacrifiant a en l’efficacité
du rite et dans la compétence de l’officiant qu’il choisit pour officier dans ce rite.
2. « initiation » ou « consécration » (dīkṣā) = rite pour entrer dans le rite : manière de se dépouiller de son
corps profane afin de se donner au divin. Il redevient embryon, et se prépare à renaître comme
nourriture pour les dieux
3. « sacrifice » (yajña). Sacrifice au sens étroit du terme. Ensemble des gestes et des paroles qui font que
la matière oblatoire (dravya) est acheminée jusqu’à ses destinataires.
4. don de l’« honoraire sacrificiel » (dakṣiṇā). Attention n’est pas un salaire, mais bien un acte religieux,
cela n’est pas distinct de ce qui est donné aux dieux
5. « lustration finale » (avabhr̥ta). Moment par lequel le sacrifiant avec son épouse se dégage du sacrifice
pour rentrer dans la vie profane.
B/ La théologie de la dette
Śatapatha-Brahmaṇa (I 7, 2, 1-6.)
« Tout être en naissant naît comme une dette due aux dieux, aux saints, aux Pères, aux hommes. Si on
sacrifie, c’est que c’est là une dette due de naissance aux dieux ; c’est pour eux qu’on le fait, quand on leur
sacrifie, quand on leur offre des libations. Et si on récite les textes sacrés, c’est que c’est-là une dette due
de naissance aux saints ; c’est pour eux qu’on le fait, et qui récite les textes saints est appelé ‘le gardien du
trésor des saints’. Et si on désire de la progéniture, c’est que c’est là une dette due de naissance aux Pères ;
c’est pour eux qu’on le fait, que leur progéniture soit continue et ininterrompue. Et si on donne
l’hospitalité, c’est que c’est là une dette due de naissance aux hommes ; c’est pour eux qu’on le fait quand
on leur donne l’hospitalité, quand on leur donne à manger. Celui qui fait tout cela a fait tout ce qu’il a à
faire ; il a tout atteint, tout conquis. Et parce qu’il est de naissance une dette due aux dieux, il les satisfait
en ce qu’il sacrifie » (.
LEVI, Sylvain, 1966, La Doctrine du sacrifice dans les Brahmanas, 2e ed., avec préface de L. Renou, Paris,
PUF, « Bibliothèque de l’Ecole pratique des hautes études » (section des sciences religieuses LXXIII) ; 1ère
ed., Paris, 1898, p. 131.
Les trois «dettes » (
r̥ ṇa)
– en réalité quatre - des deux-fois-nés.
Dettes
Devoir
Règles les rapports
« voyants » (r̥ ṣi)
« étude védique » (brahmacarya)
Entre les hommes et les r̥ ṣi
« dieux » (deva)
« sacrifice » (yajña)
Entre les hommes et les dieux
« Pères » ()
avoir un «fils » (putra)
Entre les hommes et leur ancêtres
« hommes »
« hospitalité »
Entre les hommes et leurs contemporains.
« […] les Brāhmaṇa présentent une théorie de la dette comme constitutive de la nature humaine […] la
dette congénitale de l’homme, si elle explique tout, ne s’explique par rien, et n’a pas d’origine ».
« L’homme n’est pas simplement affecté par la dette, il est défini par elle »
Taittirīya Saṃhitā VI 3, 10, 5.
« En naissant, le brahmane naît chargé de trois dettes : (dette) d’étude védique à l’égard des r̥ ṣi, de
sacrifice à l’égard des dieux, de progéniture à l’égard des Pères. Celui-là est libre de dette qui a un fils, qui
sacrifie, qui a mené la vie d’étudiant brahmanique ».
Śathapatha-Brāhmaṇa I7, 2, 1-6.

INALCO Document pédagogiques 2011-2012
4
« Tout être en naissant naît comme une dette due aux dieux, aux saints, aux Pères, aux hommes. Si on
sacrifie, c’est que c’est là une dette due de naissance aux dieux ; c’est pour eux qu’on le fait, quand on leur
sacrifie, quand on leur offre des libations. Et i on récite les textes sacrés, c’est que c’est là une dette due de
naissance aux saints ; c’est pour eux qu’on le fait, et qui récite les textes saints est appelé « le gardien du
trésor des saints ». Et si on désire de la prgéniture, c’est que c’est là une dette due de naissance aux Pères,
c’est pour eux qu’on le fait, que leur progéniture soit continue et ininterrompue. Et si on donne
l’hospitalité, c’est que c’est là une dette due de naissance aux hommes ; c’est pour eux qu’on le fait quand
on leur donne l’hospitalité, quand on leur donne à manger. Celui qui a fait tout ce qu’il a à faire ; il a tout
atteint, tout conquis. Et parce qu’il est de naissance une due aux dieux, il les satisfait en ceci qu’il
sacrifie. »
MALAMOUD, Charles, 1989, « La théologie de la dette dans le brahmanisme», in MALAMOUD, Charles, Cuire
le monde. Rite et pensée dans l’Inde ancienne, La découverte, Paris, pp. 115-136.
C/ L’opposition village/forêt :
« Dans l’Inde védique, et plus généralement dans l’Inde brahmanique, cette dichotomie [village (grāma),
et forêt (araṇya)] est omniprésente. Le grāma et l’araṇya se partagent la totalité du monde habitable […]
Ils se distinguent moins par des traits matériels, que par la signification religieuse et sociale que l’on
attribue à chacune de [ces zones]. Le mot grāma, traduit d’ordinaire par « village », désigne une
concentration d’hommes, un réseau d’institutions, bien plutôt qu’un territoire fixe. […] La stabilité du
grāma tient à la cohésion du groupe qui le forme plutôt qu’à l’espace qu’il occupe. […] Et pourtant la
notion de limite, est étroitement associée à celle de village ; mais ce n’est pas la limite qui définit le
village, c’est le village qui engendre la (notion de) limite, comme l’enseigne cet adage : point de village,
alors point de limite. En face du village, l’araṇya, ce mot que l’on a pris l’habitude de traduire par
« forêt », désigne, en vérité, l’autre du village. » (Malamoud, 1989 : 94-95)
MALAMOUD, Charles, 1989, « Villages et forêt dans l’idéologie brahmanique », in Malamoud, Charles,
Cuire le monde. Rite et pensée dans l’Inde ancienne, La découverte, Paris, pp. 93-114.
D/ Les quatre étapes (āśrama) de la vie dans le brahmanisme :
« renonçant » (saṃnyāsa)
« ermite forestier » (vānaprastha)
« maître-de-maison » (gr̥hasta)
« étudiant védique » (brahmacarya)
E/ Couple d’opposés vus en cours
« Dans le monde » (pravr̥tti)
« Hors du monde » (nivr̥tti)
« village » (grāma)
« forêt » (araṇya)
« sacrifice » (yajña)
« renoncement » (saṃnyāsa)
« maître de maison » (gr̥hasta)
« renonçant » (saṃnyāsin)
« acte » (karma)
« gnose » (jñāna)
«section des actes» (karmakāṇḍa)
« section de la connaissance» (jñānakāṇḍa)

INALCO Document pédagogiques 2011-2012
5
E/ Les « rites perfectifs » (saṃskāra)
Les rites de passages qui jalonnent accompagnent la vie des hindous. Les listes sont diverses et
nombreuses, mais parmi les plus importants de ces rites, on compte : l’initiation (upanayana) du jeune
garçon qui marque son entrée dans la vie socio-religieuse ; le rite de mariage (vivāha), qui permet à la
femme de devenir épouse et ainsi d’accéder à sa vie socio-religieuse ; et le rite de crémation (antyeṣṭi) qui
constitue le dernier sacrifice.
E/ Glossaire
ātman : le « Soi », principe éternel animant l’être empirique de naissance en naissance. Il désigne aussi le
brahman intérieur.
agnicayana : « construction de l’autel du feu », un des rituels solennels védiques. Filmé par F. Staal et
visionné en cours.
agnihotra : offrande de lait versée matin et soir dans un des feux sacrificiels.
ārya : littéralement « noble ».
araṇya : la « forêt », en tant que « l’autre du village ».
āśrama : « stade » de la vie, étapes successives de la vie du « deux-fois-né » selon l’idéal hindou. En
théorie au nombre de quatre (étudiant, maître de maison, habitant de la forêt et renonçant)
avatāra : « descente », incarnation du dieu (en particulier Viṣṇu) sur terre pour rétablir l’ordre du
monde en péril.
bhakti : la dévotion, forme dominante de l’hindouisme où prévalent la relation personnelle qui unit le
dévot à sa divinité d’élection ainsi que la notion de grâce divine. Elle permet d’obtenir la délivrance tout
en restant dans la société.
bhūta : « êtres indistincts qui rôdent autour de la maison ».
brahma : nom neutre, qui désigne l’absolu.
Brahmā (nom. masc. sg.) : des trois formes (mūrti) sous lesquelles se manifeste la toute-puissance
divine dans ses relation avec le cosmos, Brahmā est celle qu’il revêt quand il émet les créatures. C’est
l’Absolu personnel.
brahmacarya : « fréquentation du Veda », désigner l’étude védique auquel le jeune deux-fois-nés
s’astreint à l’étude du Veda en maintenant un célibat strict.
brahmacarīn : « l’étudiant brahmanique ».
brahman (nom neutre) : [BR̥H - grandir, croitre, se fortifier] l’ Asolu, nom neutre. terme signifiant
originairement « formule sacrée » il est devenu l’une des désignations de l’Absolu Impersonnel, du Soi
universel. Le brahman habite dans l’homme sous la forme d’ātman.
brāhmaṇa : [BR̥H - grandir, croitre, se fortifier] : En tant que nom masculin, il désigne la classe (varṇa)
sacerdotale. En tant que nom neutre, il désigne un corpus spécifique du Veda.
dakṣiṇā : [DAKṢ- agir avec compétence] « honoraire sacrificiel » donné par le « sacrifiant » à
« l’officiant »
darśana : [DR̥Ś- voir] « point de vue », désigne les « « écoles de la philosophie » indienne mais
également la « vision sanctificatrice » de l’objet d’adoration.
dīkṣā : « initiation »
dharma : [DR̥H - soutenir] « ordre socio-cosmique qui maintient l’univers dans l’existence » : sur le plan
universel, l’ordre cosmique qui soutient le monde ; sur le plan individuel , la conduite appropriée en
fonction de la naissance (jatī) et du stade de la vie dans tel groupe social ou tel sexe.
īśvara : « Seigneur », titre couramment donné à Dieu dans la bhakti.
jāti : littéralement « naissance » ou « espèce », désigne ce que l’on appelle aujourd’hui les « castes ».
 6
6
 7
7
1
/
7
100%