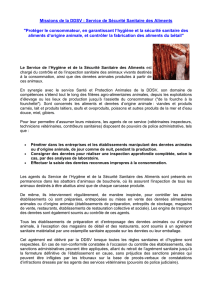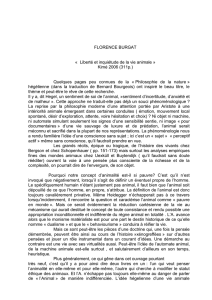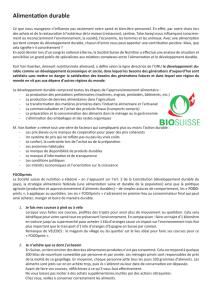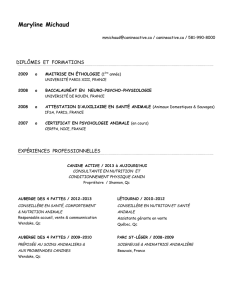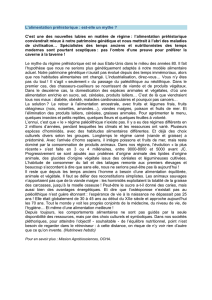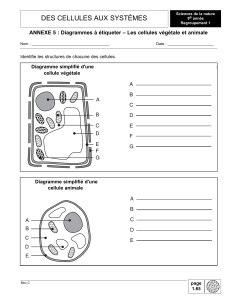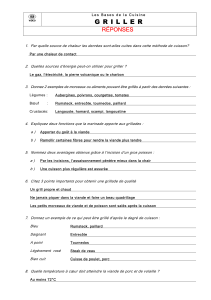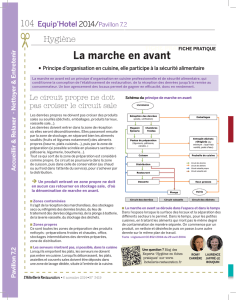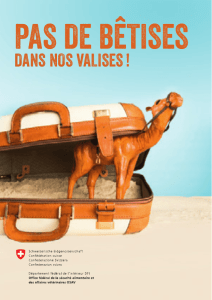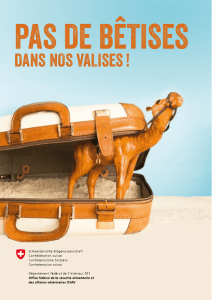Société des Vétérinaires Suisses 200 ans au service des animaux

Société des Vétérinaires Suisses
Service médias, Christof Scheidegger, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus
Téléphone 031 307 35 37, mobile 079 709 73 85, [email protected], www.gstsvs.ch
200 ans au service des animaux, mais pas seulement
Un bilan du point de vue des consommatrices et des consommateurs
Congrès du bicentenaire de la Société des Vétérinaires Suisses (SVS)
Berne, mercredi 5 juin 2013
de Sara Stalder
directrice de la fondation pour la protection des consommateurs SKS
Seule la version orale fait foi
Chère Madame la Présidente,
Chers jubilaires, chère assemblée,
Les pères fondateurs de votre société seraient certainement surpris de savoir que la protection des
consommateurs prend la parole à l’occasion de votre bicentenaire.
En effet, les consommatrices et les consommateurs n’avaient pas encore leur place dans leurs visions de
ce début d’octobre 1813. Ce qui comptait alors était:
-le maintien des effectifs de bétail, qui représentaient alors la richesse,
-la création de structures d’information dans le but principal de lutter contre les épizooties
-et la coordination de la formation.
Les fondateurs considéraient alors qu’ils devaient dédier leurs efforts à ces trois champs d’activités: il
n’ont donc pas dit un mot du bien-être des individus, mis à part l’objectif économique.
La plaquette anniversaire revient en détail sur l’histoire de votre société. En poussant les recherches un
peu plus loin, j’ai constaté que sa fondation a eu lieu dix jours avant la défaite cuisante de Napoléon lors
de la bataille de Leipzig. A cette époque en Suisse, Jeremias Gotthelf suivait les cours de l’école de
littérature à Berne. Une formation qui lui permettrait de rédiger sa première œuvre vingt ans plus tard.
Avec cette petite parenthèse historique et grâce à mes connaissances des textes du poète de l’Emmental,
j’ai pu imaginer à quel point les conditions devaient alors être différentes et, en conséquence, dans
quelle mesure le travail des vétérinaires – exclusivement des hommes – s’écartait de la profession
actuelle.
Lorsque les responsables de l’organisation de cette fête m’ont demandé d’y participer, je leur ai dit que
j’étais impressionnée par l’âge avancé de votre société. Vous devez savoir que notre fondation pour la
protection des consommateurs n’aura qu’un quart de l’âge de la SVS l’an prochain. C’est pour cette
raison également que les pères fondateurs de votre organisation n’auraient jamais eu à débattre de la
pertinence de faire une petite place aux consommateurs dans le cadre de cet anniversaire.
Votre société s’engage depuis deux siècles pour un cheptel en bonne santé, mais aussi pour une
amélioration de la coordination et de la qualité de l’échange d’informations et de la formation. On lui
doit également l’évolution des bases légales pendant plus de cent ans: la loi sur les épizooties a ainsi été
continuellement améliorée et la loi sur les denrées alimentaires a vu le jour en 1905 déjà. Depuis plus
d’un siècle, il est par ailleurs reconnu que la santé des animaux et les denrées alimentaires d’origine
animale ont une influence directe sur la santé des individus. Le bien-être des consommateurs est
devenu un élément important du champ d’action de cette loi.
A l’époque, leur engagement avait connu un développement économique important: depuis, les
vétérinaires n’œuvrent plus seulement pour le maintien de cheptels et d’animaux domestiques en bonne
santé mais contribuent à assurer aux consommateurs de ne pas mettre leur santé en danger lorsqu’ils
consomment des aliments d’origine animale. Il s’agit d’une condition essentielle pour qu’ils continuent à
accorder leur confiance à ces denrées. En effet, ce secteur important pour l’économie est très sensible à
ce niveau. Chaque scandale alimentaire influence les décisions d’achat des consommateurs de manière
imprévisible. Et lorsque les produits sont d’origine animale, les réactions sont disproportionnées. C’est
ce que confirment les nombreux appels téléphoniques, mails et lettres que reçoit notre secrétariat. Ils
nous rappellent qu’aucun autre secteur de l’alimentation n’est aussi sensible et perçu de manière aussi

exceptionnellement émotionnelle par les consommateurs. Ceci est d’une part dû à la nature périssable
des denrées d’origine animale, aux contaminations possibles ou au stockage et à la préparation
incorrects. D’autre part divers scandales portant sur la viande et les conditions de détention des
animaux ont joué un rôle marquant, ébranlant de manière fondamentale et durable la confiance des
consommateurs.
Depuis les années 1980, il est de plus en plus fréquent que des images dramatiques d’élevages cruels
paraissent dans la presse, ce qui n’est certainement pas sans lien avec la globalisation. Cela ne va pas
sans laisser de traces auprès des consommateurs: ces trente dernières années, la consommation de
viande a reculé de façon massive, aussi suite à des scandales comme l’utilisation d’hormones ou
d’antibiotiques pour stimuler la croissance du bétail, à la crise de l’ESB, à l’épidémie de fièvre aphteuse,
aux valeurs de dioxine trop élevées ou aux empoisonnements aux salmonelles.
Actuellement, l’Europe est en phase d’analyse du scandale des lasagnes à la viande de cheval, une
escroquerie de vaste ampleur qui aura eu pour effet de ternir l’image des composants d’origine animale
de quelques denrées fortement transformées. Ce cas montre clairement que les produits d’origine
animale sont pris très au sérieux et qu’ils suscitent un intérêt marqué, même si leur part est finalement
très faible dans les lasagnes en question.
Les scandales, ou leur absence, déterminent largement le comportement de consommation vis-à-vis des
denrées d’origine animale. Vient s’y ajouter le fait que la prise de conscience des consommateurs et les
connaissances sur les conditions de production des denrées alimentaires d’origine animale ont
fortement évolué ces dernières décennies. Alors qu’il y a 200 ans, on trouvait encore des animaux dans
les villes, essentiellement pour s’assurer des réserves alimentaires et garantir la mobilité, le savoir sur
l’élevage des animaux s’est perdu depuis. Lorsqu’il existe encore, ce sont surtout des visions idéalisées
qui dominent.
Et même si l’on constate un recul de la présence de la viande dans les assiettes, la seule consommation
de viande de porc reste, à mon avis, toujours impressionnante: chaque année, les Suisses en mangent en
moyenne 25 kilos. Il s’agit de la viande la plus consommée dans notre pays. Entre parenthèses, elle est
suivie de la viande de bœuf et de la volaille, dont on consomme environ 10 kilos de chaque
annuellement.
Mais les consommateurs n’achètent et n’utilisent consciemment que la moitié de ces quantités. Le reste
des produits carnés est préparé dans des cuisines hors des foyers privés, et consommé à l’extérieur. Un
point qui n’est pas sans importance sur le plan économique, les repas pris hors du domicile
représentant une somme de plus de treize milliards de francs chaque année en Suisse.
Contrairement à ce qui se passait il y a 200 ans, de nombreuses instances s’occupent désormais en
Suisse d’établir ou de préserver la confiance en édictant des lois et en mettant sur pied des organes
d’application et de contrôle. La vaste législation semble garantir le contrôle complet du flux de
marchandises.
Mais la surveillance et l’application de la législation sont plus importantes. Et là, divers acteurs sont
impliqués. D’après le rapport de la commission de gestion du Conseil national (CdG-N) du mois de juin
2013, il existe pour cette raison des problèmes de coordination à divers niveaux, ce qui conduit à des
applications pratiques différentes en matière de réclamations et de sévérité des sanctions dans les
cantons. Dans les procédures pénales communiquées par les cantons à l’Office vétérinaire fédéral (OVF)
en 2011, les différences cantonales sont flagrantes, et sont naturellement dues à des facteurs variés.
Pourtant, il est permis de s’interroger!
La législation est vaste et les diverses procédures de contrôle n’empêchent pas que, récemment encore,
la confiance des consommateurs ait été massivement ébranlée.
La branche doit faire davantage d’efforts pour compenser la perte de confiance qu’elle a subie.
Ce que je veux vous montrer est que la consommation de denrées alimentaires d’origine animale dépend
fortement de la confiance que l’on accorde à ces produits, et que vous jouez un rôle important dans ce
contexte. La condition essentielle à l’établissement d’un rapport de confiance est l’indépendance et la
crédibilité. Pourtant, les relations étroites et les dépendances entre recherche, industrie et autorités
empêchent en grande partie l’établissement d’un tel rapport de confiance avec les consommateurs.
J’ai lu dans le récit de l’histoire de votre société que la médecine vétérinaire a reconnu, depuis des
décennies, qu’il s’agissait d’un exercice difficile. Votre spécialité évolue dans un contexte tendu où
s’affrontent des intérêts contraires. Et les consommateurs sont l’un des éléments suscitant la tension. Ce
fait est reconnu depuis des dizaines d’années, comme le prouve le slogan «Des animaux sains – une
alimentation saine – une population saine» lancé par les vétérinaires après la crise de l’ESB pour montrer
à la population que la profession pend au sérieux son engagement «de l’étable à la table». Nous
partageons ce souci: pour les consommateurs, un rapport équilibré entre les trois domaines «traitement
des maladies animales», «rentabilité des produits d’origine animale» et «responsabilité pour l’absence
de dangerosité des aliments» est également essentiel du point de vue des consommateurs.
Après cette rétrospective, je me permets, pour conclure, de jeter un bref regard vers l’avant:
je souhaite, pour l’avenir, que les vétérinaires parlent d’une voix unie et forte, sachant pourquoi leur
société est diversifiée. Il existe toutefois aussi des domaines dans lesquels, à mon avis, une prise de
position unifiée est ou aurait été possible: dans l’étude des documents qui m’ont été envoyés, j’ai par
exemple constaté que les prix excessifs des médicaments pour animaux importés étaient très
contrariants. La Fondation pour la protection des consommateurs se bat d’arrache-pied depuis deux ans
pour faire cesser la pratique du «supplément suisse», nuisible à l’économie Pour la révision de la loi sur

les cartels, qui fait actuellement l’objet de débats parlementaires, nous avons besoin du soutien de
toutes les branches concernées!
Ou, vu l’actualité récente, il ne fait aucun doute que votre société partagerait le point de vue de notre
fondation sur certains points relatifs à la révision de la loi sur les denrées alimentaires (prise en compte
des aliments des animaux, exigences en matière de déclaration), qu’elle pourrait alors défendre vis-à-vis
des législateurs.
Ou, autre point de plus en plus actuel, l’utilisation des antibiotiques et les résistances en la matière.
Vous savez que divers groupes de travail et tables rondes sont déjà actifs en la matière. Votre voix ne
doit pas manquer!
Depuis plus d’un siècle, votre société et la protection des consommateurs partagent divers champs
d’intérêts identiques avec, en partie, des exigences d’orientation similaire: utiliser ces synergies serait, à
mon avis, une option méritant réflexion et un objectif judicieux pour les années à venir.
Pour conclure brièvement, je dirai que les deux siècles de travail de la société n’ont pas seulement
profité au bétail mais de plus en plus aussi aux chiens et aux chats, ainsi qu’à tous les autres petits
animaux, mais aussi à la population. Vos efforts n’ont donc en aucun cas été inutiles!
Je vous souhaite une voix forte et efficace au bon moment et vous adresse tout mon respect pour l’âge
avancé de votre organisation. Continuez sur cette voie!
- - -
Sara Stalder est née en 1966. Après avoir obtenu un diplôme d’enseignante pour les écoles primaires
bernoises, elle a enseigné pendant plusieurs années dans diverses écoles avant de diriger, depuis 2011,
une école primaire de taille moyenne. Elle est mariée et mère de trois enfants.
En 2008, Sara Stalder a pris la direction de la fondation alémanique pour la protection des
consommateurs SKS.
1
/
3
100%