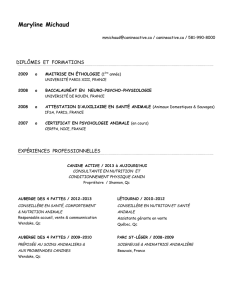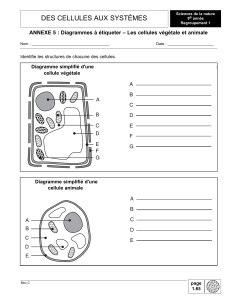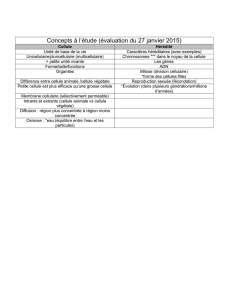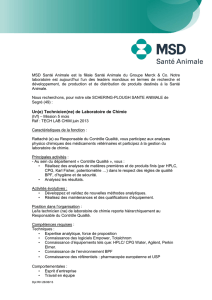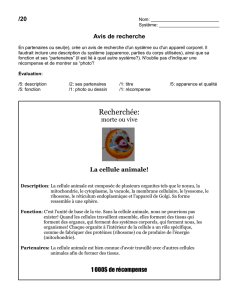Liberté et inquiétude de la vie animale

FLORENCE BURGAT
« Liberté et inquiétude de la vie animale »
Kimé 2006 (311p.)
Quelques pages peu connues de la « Philosophie de la nature »
hégélienne (dans la traduction de Bernard Bourgeois) ont inspiré le beau titre, le
thème et peut-être le rêve de cette recherche.
Il y a, dit Hegel, un sentiment de soi de l’animal, »sentiment d’incertitude, d’anxiété et
de malheur ». Cette approche ne traduit-elle pas déjà un souci phénoménologique ?
La reprise par la philosophie moderne d’une attention portée par Aristote à une
intériorité animale émergeant dans certaines conduites ( émotion, mouvement local
spontané, désir d’exploration, attente, voire hésitation et choix) ? Ni objet ni machine,
ni automate simulant seulement les signes d’une sensibilité sentie, ni image « pour
documentaires » d’une vie sauvage de luxure et de prédation, l’animal serait
méconnu et sacrifié dans la plupart de nos représentations. La phénoménologie nous
a rendu familière l’idée d’une conscience sans sujet ; ici c’est un « sujet » « perceptif
actif » même sans conscience, qu’il faudrait prendre en vue.
Les grands récits, épique ou tragique, de l’histoire des vivants chez
Bergson et chez Schopenhauer ( pp. 151-173) mais surtout les analyses empiriques
fines des mondes animaux chez Uexküll et Buytendijk ( qu’il faudrait sans doute
rééditer) ouvrent la voie à une pensée plus consciente de la richesse et de la
complexité, on pourrait dire de l’envergure, de son objet.
Pourquoi notre concept d’animalité est-il si pauvre? C’est qu’il n’est
invoqué que négativement, lorsqu’il s’agit de définir un éventuel propre de l’homme.
Le spécifiquement humain n’étant justement pas animal, il faut bien que l’animal soit
dépouillé de ce que l’homme, en propre, s’attribue. La définition de l’animal est donc
toujours cavalièrement privative. Même Heidegger n’échapperait pas à ce travers
lorsqu’incidemment, il rencontre la question et caractérise l’animal comme « pauvre
en monde ». Mais ce serait évidemment la réduction cartésienne de la vie au
mécanisme qui aurait destitué le concept de toute consistance et rendu possible une
appropriation inconditionnelle et indifférente du règne animal en totalité . L’A. avance
alors que le monisme matérialiste est pour une part le destin historique de ce qu’elle
nomme « dualisme » et que le « behaviourisme » conduira à réifier la vie.
Mais ce sont peut-être les pièces d’une doctrine qui, une fois la pensée
démembrée, peuvent être ainsi au cours de l’histoire »xénogreffées » sur d’autres
pensées et jouer un rôle instrumental dans un courant d’idées. Une démarche au
contraire est une vie avec ses virtualités aussi. Peut-être l’idée de l’automate animal,
de la machine animale est-elle surtout , et salutairement d’ailleurs en son temps,
heuristique. Plus généralement, ce qui gêne dans cet ouvrage pourtant
très neuf, c’est qu’il y a pour ainsi dire deux livres en un : l’un qui veut penser
l’animalité en elle-même et pour elle-même, l’autre qui cherche à modifier le statut
éthique des animaux. Et l’A. n’échappe pas toujours elle-même au danger de parler
de « l’Animal » de manière indifférenciée. L’idée hégelienne d’une vie animale

capable de « laisser être les choses » et ainsi d’aller vers le « théorétique », à quels
types d’animaux peut-on l’appliquer ? Ne faut-il pas supposer, même en l’homme,
pour qu’il pense, un arrachement à ce qui en lui est purement machinal ? Ne faut-il
pas comme Leibniz (cité p.103) supposer dans une vie animale au moins
une »mémoire des perceptions » pour qu’elle ne soit pas celle d’une » Bête » ?
Jean-Pierre Richard
1
/
2
100%