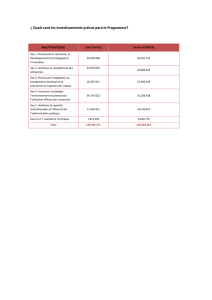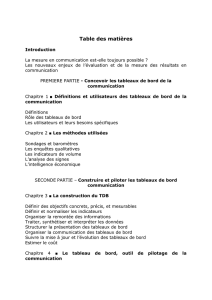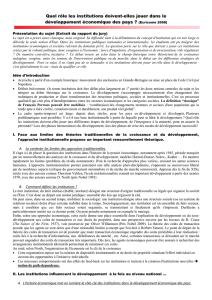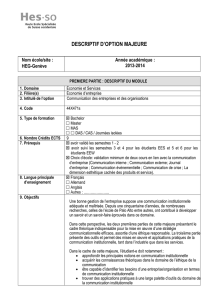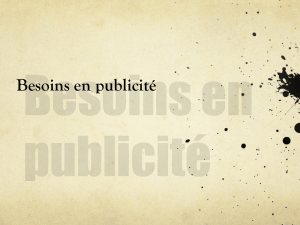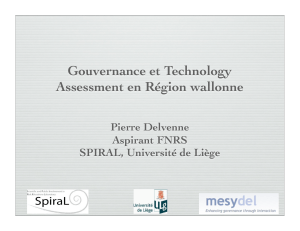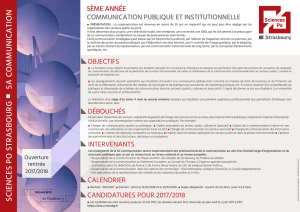La dimension institutionnelle du management

! ! 1
!
!
La dimension institutionnelle du
management stratégique
Interview de Bernard de Montmorillon,
Professeur des Universités à l’Université
Paris Dauphine, menée par Jean-
Philippe Denis (Precepta Stratégiques)
Coop alternatives, 436 Rte de la Croix de Chorre – 38950 Quaix en Chartreuse
06 48 03 74 14
contact@coop-alternatives.fr
SIRET : 519 675 144 00025
!

! ! 2
!
!
La dimension institutionnelle du management stratégique.
Avec Patrick Joffre, dans un ouvrage qui a fait date, coordonné par Alain Charles
Martinet et Raymond-Alain Thiétart, Stratégies, actualités et futurs de la recherche, un
texte consacré aux approches institutionnelles. Pourquoi s’intéresser aux approches
institutionnelles c’est important quand on veut faire de la stratégie ?
La question institutionnelle nous avait Patrick et moi intrigué il y a une dizaine d’années.
A l’époque, nous travaillions sur la coordination dans les organisations. De plus en plus, il
devenait évident que la coordination dans les organisations ne pouvait plus seulement
être appréhendée par des analyses traditionnelles fondées sur le marché ou fondées
sur l’autorité ; là, je reprends les grandes catégories de Williamson.
Parallèlement à ces modes de coordination, il fallait s’intéresser à des types de
coordination d’un autre niveau. Avec Patrick Joffre, nous nous sommes intéressés à la
coordination réticulaire, la coordination par le réseau, en nous appuyant sur Mark
Graovetter, la force des liens faibles et puis nous nous étions intéressés à la coordination
dans la société, en nous inspirant des travaux de Mauss. Je pense aujourd’hui que cette
dimension là est devenue de plus en plus essentielle pour les organisations et les
sciences de gestion. On ne peut plus envisager la gestion des organisations sans
envisager leur intégration dans leur environnement et notamment leur environnement
territorial. Poser la question comme cela, c’est poser la question des institutions. C’est
pour cela que je pense que ce thème aujourd’hui est devenu encore plus central qu’il
ne l’était il y a 10 ans.
A quoi ça sert l’entreprise ?
Quelle est la finalité du pilotage de l’entreprise ?
On a longtemps parlé du primat de la valeur actionnariale. Aujourd’hui, de plus en
plus, à côté de cette valeur actionnariale que personne ne songe à remettre en cause,
il y a d’autres dimensions de la valeur qu’il faut approfondir et l’approfondissement
passe de mon point de vue par une réflexion de type institutionnelle.
Dans la lignée du prix, il y a le contrat, qui passe par l’échange contractuel traditionnel.
Ce que vous avez approfondi à travers cette dimension réticulaire c’est tout ce qui
entoure les relations entre les individus dans l’organisation ? D’où l’importance de cette
dimension institutionnelle, sur des choses très concrètes, comme par exemple le
territoire.
Je crois qu’il y a au moins deux ancrages pour lesquels ces dimensions institutionnelles
deviennent incontournables :
Un premier ancrage est assez centré sur l’organisation : quelle est la logique profonde
de l’organisation ? A quoi sert-elle ? Comment mobiliser les collaborateurs ? Comment
donner une vision ? Comment donner un sens ? Dès lors qu’on travaille sur les valeurs du
management, on peut analyser ces questions là avec la logique des conventions.
Quelles sont les valeurs synthétiques qui portent l’action collective ? Quelles sont les
dimensions de cette action collective ? Les travaux sur les conventions me paraissent
donner une réponse à la fois économique et sociale. Je les trouve très intéressants et
pas assez mobilisés aujourd’hui.
Il y a une deuxième dimension, c’est quelle est la finalité de l’entreprise du point de vue
du territoire politique qui l’accueille ? Pour le coup, la réflexion sur ce sujet là est en
train de se développer très vigoureusement. On parle beaucoup du modèle allemand :
qu’est-ce que c’est que le modèle allemand ? Il est de mon point de vue très
largement marqué par le droit des sociétés allemandes mis en place en 1951, revu en
1976.

! ! 3
!
!
Toutes les entreprises allemandes de plus de 2 000 salariés sont régies avec une
structure de conseil de surveillance et directoire et les conseils de surveillance sont
paritaires, sont mixtes, moitié représentant des actionnaires, moitié représentant des
collaborateurs et des salariés. Quand on a un conseil de surveillance qui surveille le
management stratégique et qui est mixte, bien sûr les décisions stratégiques qui seront
prises tiendront compte des points de vue des deux partenaires. Je pense que c’est
tout à fait fondamental. Ce type de question là pose la question de l’encastrement du
management stratégique dans le développement collectif des territoires, dans le
développement politique. C’est une question centrale.
Bien sûr. Au fond, on ne peut pas raisonner autrement. Vous avez posé la question de
la valeur actionnariale. On ne peut pas raisonner autrement que sur des formes de
valeurs partenariales. Comment à l’intérieur de ces dynamiques institutionnelles les
concours sont divers, multiples et des compromis doivent être gérés ?
C’est l’excellent article de Charreaux et Desbrières à la fin du siècle dernier mais c’est
aussi tous les travaux de March, de Simons, de Sayer, sur lesquels on est en train de
revenir et qu’on redécouvre 30 ans après.
Dans cette logique partenariale, il y a évidemment l’intérêt collectif, il y a évidemment
l’intérêt du territoire. Il est urgent dans notre pays de re-légitimer la finalité territoriale,
collective, du développement de l’entreprise. C’est tout à fait indispensable !
Comment le faire ? Est-ce qu’il faut transposer en France le modèle allemand ? Il faut
peut être s’en inspirer. Nous, nous avons toujours eu un Etat protecteur. Comment faire
en sorte que cet Etat protecteur développe l’initiative créatrice du manager ? C’est
aujourd’hui me semble-t-il la question clé ou la question centrale.
Au fond, la culture, dont vous êtes un des spécialistes, porte des enjeux de
compétitivité ?
Absolument ! Je reprends les deux points évoqués précédemment :
La culture au niveau de l’entreprise. Vous ne mobilisez pas les collaborateurs si vous ne
les faites pas adhérer à un système de valeurs qui les amène à être créatifs : la
confiance, la prise de risques, la créativité. En même temps, vous avez du mal à les
mobiliser s’ils se disent que tous leurs efforts vont servir n’importe quel conseil
d’administration aux antipodes du système de valeurs.
Même si la dimension du village mondial est aujourd’hui de plus en plus intégrée,
notamment du fait de la révolution numérique, cependant, cette révolution là ne doit
pas écarter l’intérêt du territoire proche, du territoire dans lequel vivent les acteurs que
le projet professionnel mobilise. Cette inscription dans l’intérêt du territoire, c’est le rôle
du politique. Parmi les parties prenantes, il y a les représentants politiques des territoires
dans lesquels l’entreprise se développe.
Mots clés : Management, Marketing et
Stratégie, Organisation, Institutions, Bernard de Montmorillon, Management
stratégique
1
/
3
100%