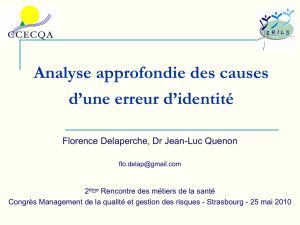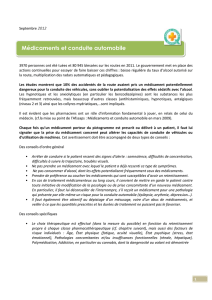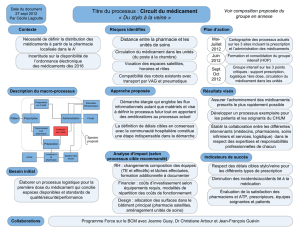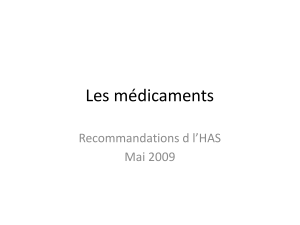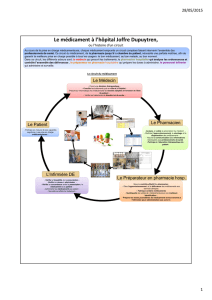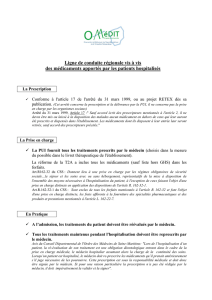De l`usage rationnel à l`usage optimal des médicaments

Neuropsychiatrie
de
l’enfance
et
de
l’adolescence
60
(2012)
69–76
Article
original
De
l’usage
rationnel
à
l’usage
optimal
des
médicaments
psychotropes
auprès
des
enfants
From
rational
use
to
optimal
use
of
psychotropic
drugs
among
children
D.
Lafortune∗,
M.-P.
Gagné
,
É.
Blais
École
de
criminologie,
université
de
Montréal,
CP
6128,
succursale
Centre
Ville,
Montréal,
H3C
3J7
Canada
Résumé
La
consommation
croissante
de
médicaments
psychotropes
soulève
diverses
questions
relatives
aux
taux
de
prévalence
et
aux
caractéristiques
des
jeunes
à
qui
l’on
en
prescrit.
Les
tendances
récentes
indiquent
que
des
prescriptions
et
polyprescriptions
sont
faites
pour
des
enfants
de
plus
en
plus
jeunes
et
qu’elles
sont
souvent
motivées
par
les
symptômes,
plus
que
par
le
diagnostic.
Le
prescripteur,
comme
tout
praticien,
est
appelé
à
prendre
des
décisions
dans
un
contexte
d’incertitude
et
de
rationalité
limitée.
Voilà
pourquoi
il
faudrait
s’intéresser
aux
pratiques
de
prescription
à
partir
d’un
modèle
heuristique
et
systémique.
Les
premiers
facteurs
associés
au
recours
à
la
médication
peuvent
être
posés
en
termes
de
connaissances
tirées
des
revues
savantes,
des
rapports
de
recherche
produits
par
l’industrie
pharmaceutique
et
des
recensions
systématiques.
Des
éléments
relevant
de
l’identité
professionnelle
peuvent
intervenir
également
dans
la
décision
de
prescrire
:
les
lignes
directrices
émanant
d’associations
médicales,
les
champs
et
les
actes
réservés,
ainsi
que
la
notion
de
«
responsabilité
».
Finalement,
une
intervention
peut
répondre
aux
contingences
plus
locales
du
milieu
de
pratique
ou
de
la
relation
thérapeutique.
Voilà
pourquoi,
depuis
quelques
années,
lorsque
vient
le
temps
de
s’intéresser
à
des
milieux
de
pratique
complexes,
le
paradigme
de
l’usage
optimal
semble
plus
pertinent
que
celui
de
l’usage
rationnel.
©
2011
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
Mots
clés
:
Médicaments
psychotropes
;
Enfants
;
Pratiques
de
prescription
;
Connaissances
scientifiques
lignes
directrices
;
Déterminants
sociaux
Abstract
The
increasing
use
of
psychotropic
drugs
raises
various
issues
related
to
prevalence
and
characteristics
of
youth
for
whom
medication
is
prescribed.
Recent
trends
indicate
that
psychotropic
medication
and
polypharmacy
users
are
younger
and
that
prescribing
practices
are
often
motivated
by
symptoms
rather
than
diagnosis.
The
prescriber,
as
any
practitioner,
is
called
upon
to
make
decisions
in
a
context
of
uncertainty
and
limited
rationality.
That
is
why
prescribing
practices
should
be
studied
from
a
heuristic
and
systemic
standpoint.
First
factors
associated
with
the
use
of
medication
can
be
discussed
in
terms
of
knowledge
gained
from
scholarly
journals,
research
reports
produced
by
the
pharmaceutical
industry
and
systematic
reviews.
The
guidelines
from
medical
associations,
fields
and
reserved
acts
that
define
the
medical
identity
and
the
notion
of
“responsibility”
are
elements
which
may
also
intervene
in
the
decision
to
prescribe.
Finally,
an
intervention
can
meet
the
contingencies
of
more
local
practice
environments
or
the
therapeutic
relationship.
That
is
why,
in
recent
years,
when
it
comes
time
to
pay
attention
to
prescribing
practices
in
complex
practice
environments,
the
paradigm
of
optimal
use
may
be
relevant.
©
2011
Elsevier
Masson
SAS.
All
rights
reserved.
Keywords:
Psychotropic
drugs;
Children;
Prescribing
practices;
Professional
guidelines;
Social
determinants
Depuis
40
ans,
l’essor
de
la
génétique,
l’émergence
des
neu-
rosciences
et
la
parution
des
DSM
III
et
IV
ont
profondément
modifié
les
pratiques
en
santé
mentale
[1].
Tel
que
le
men-
∗Auteur
correspondant.
Adresse
e-mail
:
(D.
Lafortune).
tionne
le
Blueprint
for
Change
du
National
Institute
of
Mental
Health
[2]
:
«
le
DSM
a
délimité
le
domaine
de
la
classifica-
tion
psychiatrique
et,
par
conséquent,
contrôlé
le
discours
sur
la
maladie
mentale,
structuré
les
axes
de
recherche
et
établi
les
paramètres
de
connaissance
»
(p.
19).
Moncrieff
et
Craw-
ford
[3],
qui
voient
dans
ces
transformations
un
changement
de
paradigme,
rappellent
que
:
«
en
Angleterre
et
en
Amérique
du
0222-9617/$
–
see
front
matter
©
2011
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
doi:10.1016/j.neurenf.2011.05.002

70
D.
Lafortune
et
al.
/
Neuropsychiatrie
de
l’enfance
et
de
l’adolescence
60
(2012)
69–76
Nord,
au
cours
des
dernières
décennies,
les
modèles
sociaux
et
psychanalytiques
de
la
maladie
mentale,
prédominants
au
milieu
du
siècle,
ont
été
remplacés
par
une
orientation
de
plus
en
plus
biologique
»
(p.
349).
En
cette
ère
neuroscientifique,
la
consommation
croissante
de
médicaments
psychotropes
et
l’élargissement
du
registre
de
leur
utilisation
soulèvent
nombre
de
questions
par
rapport
aux
taux
de
prévalence,
aux
caractéris-
tiques
des
jeunes
à
qui
l’on
prescrit,
aux
nouvelles
tendances
en
matière
de
pharmacoprescription
et
aux
facteurs
qui
sont
associés
à
cet
acte.
Pour
traiter
de
ces
questions,
nous
avons
entrepris
de
faire
une
recension
des
écrits
publiés
au
cours
des
dernières
30
années.
Les
bases
de
données
bibliographiques
informatisées
suivantes
ont
été
consultées
:
Medline,
PsychInfo,
EMBASE,
ERIC
et
Current
Content.
La
stratégie
de
recherche
était
fondée
sur
les
mots-clés
suivants
:
((Mental*
or
psychiatric)
and
(ill*
or
disorder*
or
health))
AND
(juvenile
or
children
or
adolescent)
AND
(medication
or
psychiatric
medication
or
medical
care
or
psychotropic)
AND
(Practices
guidelines
or
patterns
or
para-
meters).
Plus
de
350
références
pertinentes
ont
été
identifiées
et
font
actuellement
l’objet
d’une
analyse
approfondie
(Lafortune
et
al.
en
préparation
:
Examen
de
l’étendue
des
connaissances
sur
l’usage
optimal
des
médicaments
psychotropes
dans
les
milieux
de
réadaptation
pour
jeunes
en
difficultés).
Les
lignes
qui
suivent
présentent
un
aperc¸u
de
cette
recension.
1.
La
prévalence
des
pharmacoprescriptions
Selon
Bailly
[4],
chez
les
jeunes
issus
de
la
population
géné-
rale,
les
taux
de
prescriptions
pour
l’ensemble
des
médicaments
psychotropes
varient
de
0,5
à
4
%
selon
les
pays
étudiés.
De
manière
plus
spécifique,
les
psychostimulants
sont
prescrits
à
2,9
%
des
jeunes
américains,
tandis
qu’entre
0,4
et
1
%
des
jeunes
européens
en
rec¸oivent
(France,
Grande-Bretagne,
Alle-
magne,
Hollande).
Le
taux
de
prescription
d’antidépresseurs
s’élève
à
1,8
%
chez
les
enfants
américains
âgés
de
moins
de
13
ans,
tandis
qu’il
est
de
0,4
%
dans
les
pays
européens.
Le
taux
de
prescription
des
antipsychotiques
atypiques
est
de
3,8
%
aux
États-Unis,
comparativement
à
0,2
%
en
Europe.
Quelle
que
soit
la
classe
de
médicaments,
les
taux
de
prévalence
nord-
américains
dépassent
ceux
observés
en
Europe
[5].
Auprès
des
enfants
et
des
adolescents,
les
taux
d’utilisation
de
ces
molécules
aux
États-Unis
ont
pratiquement
rejoint
ceux
évalués
auprès
des
adultes
[6].
Par
ailleurs,
les
enquêtes
épidémiologiques
de
Julia
Zito
ont
révélé
d’importantes
variations
régionales
dans
les
pratiques
américaines,
ce
qui
constitue
une
donnée
intéressante
pour
qui
cherche
à
analyser
les
facteurs
sociaux
associés
à
la
pharma-
coprescription.
Ainsi,
aux
États-Unis,
les
taux
de
prescription
de
médicaments
psychotropes
fluctuent
beaucoup
d’un
État
à
l’autre,
pouvant
passer
du
simple
au
triple
[7].
Au
Québec,
il
en
est
de
même
pour
les
prescriptions
de
psychostimulants
qui,
en
1999,
touchaient
de
1,3
%
à
3,4
%
des
jeunes
selon
les
régions.
De
telles
variations
régionales
dans
les
taux
de
prescription
de
méthylphénidate
ont
également
été
observées
en
Ontario
et
au
Manitoba
[8].
2.
Portrait
des
jeunes
utilisateurs
De
manière
générale,
en
Amérique
du
Nord,
la
première
indication
de
psychopharmacothérapie
chez
les
enfants
et
les
adolescents
est
un
diagnostic
de
comportement
perturbateur
(c.-à-d.
trouble
du
déficit
de
l’attention
avec
hyperactivité
[TDAH],
trouble
oppositionnel
ou
trouble
des
conduites)
[9].
Les
jeunes
médicamentés
comptent
plus
de
garc¸ons
(70
%)
et
sont
en
moyenne
plus
vieux
que
les
enfants
non
médicamentés.
Dans
la
population
normale,
les
classes
de
médicaments
psy-
chotropes
les
plus
prescrites
sont
:
les
psychostimulants
et
les
antidépresseurs.
La
prévalence
des
prescriptions
de
médicaments
psycho-
tropes
est
en
progression
très
marquée
chez
les
jeunes
pris
en
charge
par
l’État
et
placés
dans
les
centres
éducatifs
ou
«
de
réadaptation
»1[5].
En
effet,
les
recherches
épidémiologiques
portant
sur
la
pharmacothérapie
en
centres
éducatifs
rapportent
des
taux
de
prescription
variant
de
13
à
77
%.
Les
médicaments
psychotropes
les
plus
fréquemment
prescrits
pour
ces
jeunes
sont
les
psychostimulants,
les
antipsychotiques
atypiques
et
les
antidépresseurs
[10].
Il
est
à
noter
que
l’accroissement
des
prescriptions
de
rispéridone
est
marqué
dans
les
milieux
ins-
titutionnels
[11].
Par
exemple,
au
Québec,
36,6
%
des
jeunes
de
six
à
18
ans
placés
dans
les
centres
de
réadaptation
de
la
banlieue
montréalaise
recevaient
une
médication
psychotrope
en
2001–2002
[12].
Les
psychostimulants
y
étaient
les
médi-
caments
les
plus
prescrits
(37,8
%
des
ordonnances),
suivis
par
la
rispéridone
(25,6
%)
généralement
donnée
pour
endi-
guer
l’agressivité
d’enfants
non
psychotiques.
Par
ailleurs,
dans
la
plupart
de
ces
échantillons,
parmi
les
enfants
faisant
usage
de
médicaments
psychotropes,
près
de
la
moitié
rec¸oivent
une
polyprescription.
Enfin,
Zima
et
al.
[13]
suggèrent
que
le
niveau
de
fonction-
nement
global
des
enfants
faisant
usage
de
médicaments
est
faible,
tel
qu’évalué
au
moment
du
diagnostic.
Cela
suggère
des
perturbations
majeures
ou
persistantes
dans
le
fonctionnement
familial,
social
et
scolaire
de
l’enfant.
3.
Nouvelles
tendances
Trois
nouvelles
tendances
peuvent
être
repérées
en
matière
de
pharmacoprescription
:
le
rajeunissement
des
enfants
à
qui
l’on
prescrit,
une
centration
sur
les
symptômes
plus
que
sur
les
diagnostics
et
l’utilisation
de
plus
en
plus
courante
de
plusieurs
molécules
en
même
temps.
3.1.
Des
enfants
plus
en
plus
jeunes
Au
fil
des
ans,
l’âge
moyen
des
jeunes
consommateurs
tend
à
diminuer.
Ainsi,
Zito
et
al.
[14]
ont
été
parmi
les
premiers
à
évoquer
une
augmentation
«
dramatique
»
(p.
1069)
des
ordon-
nances
faites
aux
enfants
d’âge
préscolaire
aux
États-Unis.
1Au
Québec,
un
«
centre
de
réadaptation
»
est
un
centre
éducatif
destiné
aux
jeunes
de
six
à
18
ans
qui
sont
placés
en
vertu
d’une
loi
pour
mineurs
(protection
de
la
jeunesse
ou
système
de
justice
pénale
pour
les
adolescents).

D.
Lafortune
et
al.
/
Neuropsychiatrie
de
l’enfance
et
de
l’adolescence
60
(2012)
69–76
71
3.2.
Des
prescriptions
plus
en
plus
motivées
par
les
symptômes
Il
y
a
plus
de
dix
ans,
les
pharmacoépidémiologistes
ont
observé
une
relative
autonomie
entre
la
formulation
d’un
diag-
nostic
principal
(sur
l’axe
I
ou
II)
et
la
consommation
de
médicaments
psychotropes.
Selon
Connor
[15]
deux
raisonne-
ments
se
sont
mis
en
place
quant
au
recours
à
la
médication
:
à
l’approche
traditionnelle
fondée
sur
le
diagnostic
principal
(primary
illness
approach),
s’est
ajoutée
une
approche
par
symp-
tômes
cibles
(target
symptom).
Cette
deuxième
stratégie
cible
des
symptômes
spécifiques,
peu
importe
le
diagnostic
principal,
de
telle
sorte
que
la
notion
de
prescription
hors
indication
prin-
cipale
(off
label)
devient
quasi
obsolète.
En
effet,
le
prescripteur
passe
alors
de
raisonnements
syndromiques
à
des
raisonnements
symptomatologiques
et
dimensionnels
(incluant
des
seuils
ou
cut
off
points).
D’après
Jensen
et
al.
[16],
ce
paradigme
rend
compte
de
80
%
des
prescriptions
faites
aux
enfants
et
adoles-
cents
et
inclut
par
exemple,
le
traitement
de
l’agression
et
des
problèmes
de
sommeil.
Ce
dernier
constat
n’est
pas
étranger
au
développement
de
la
neurobiologie
qui
ne
prend
pas
comme
modèle
le
DSM-IV.
Elle
propose
plutôt
différentes
hypothèses
dimensionnelles
pour
rendre
compte
du
fonctionnement
normal
et
anormal.
Il
n’y
a
qu’à
penser
au
modèle
tridimensionnel
du
tempérament
du
Clo-
ninger
[17],
au
modèle
dopaminergique
du
déficit
de
l’attention
ou
de
la
schizophrénie
[18],
au
modèle
sérotoninergique
de
la
violence
[19]
ou
de
la
dépression
majeure
[20],
de
même
qu’au
modèle
gabaergique
de
la
peur
et
de
l’anxiété
[21].
Dans
le
para-
digme
neurobiologique,
le
médicament
agit
en
faisant
varier
de
fac¸on
spécifique
les
neurotransmetteurs
disponibles
et
par
le
fait
même
l’expression
des
symptômes.
3.3.
De
la
prescription
à
la
polyprescription
Aux
dires
de
Wilens
et
al.
[22],
la
polyprescription
ou
combinaison
de
différents
médicaments
psychotropes
(ex.
:
anti-
dépresseurs
et
psychostimulants)
est
en
pleine
émergence.
Dans
les
revues
savantes
et
les
guides
de
pratique,
cette
stratégie
est
souvent
motivée
par
la
notion
de
comorbidité.
«
Le
besoin
d’utiliser
les
combinaisons
de
médicaments
provient
d’une
réponse
souvent
moins
que
satisfaisante
aux
agents
simples,
d’une
meilleure
prise
de
conscience
des
hauts
taux
de
comor-
dibité
psychiatrique
»
écrit
Wilens
(p.
110).
Le
patient
sous
polymédication
est
alors
vu
comme
polysyndromique.
Or
la
polyprescription
ne
fait
pas
l’unanimité
dans
les
milieux
médi-
caux,
si
l’on
se
fie
au
nombre
de
commentaires
et
de
lettres
aux
éditeurs
publiés
à
ce
sujet
[23].
En
somme,
diverses
tendances
sont
apparues
et
il
importe
d’examiner
les
facteurs
scientifiques,
professionnels
et
sociaux
qui
les
alimentent.
Pour
ce
faire,
l’heuristique
et
l’étude
des
milieux
de
pratique
complexes
sont
d’un
grand
apport.
4.
Heuristique
et
décision
de
prescrire
Tout
praticien
est
appelé
à
prendre
des
décisions
dans
un
contexte
d’incertitude
et
de
rationalité
relative
[24].
L’heuristique
s’est
constituée
en
tant
que
champ
d’étude
des
pro-
cessus
cognitifs
du
clinicien
:
ses
raisonnements,
son
jugement,
sa
mémoire
et
ses
préférences
quant
au
choix
des
traitements
[25].
Par
exemple,
des
études
réalisées
dans
la
collectivité
ont
montré
que
les
médecins
généralistes
de
première
ligne
ont
des
pratiques
de
prescription
différentes
de
leurs
collègues-
psychiatres.
Comparativement
à
eux,
devant
un
tableau
clinique
similaire,
ils
ont
tendance
à
prescrire
davantage
d’anxiolytiques
et
d’antidépresseurs
et
moins
d’antipsychotiques
[26].
On
peut
penser
qu’il
y
a
là
une
préférence
dictée
par
la
prudence.
Dans
le
champ
de
la
pharmacoprescription,
chaque
classe
de
molécules
a
ses
indications
principales
et
secondaires.
Ainsi,
les
signes
et
symptômes
d’agressivité,
de
dépression
ou
d’anxiété
posent
au
clinicien
la
question
du
«
potentiel
de
réponse
pharma-
cologique
»
[27].
Cela
dit,
l’acte
de
prescrire
est
souvent
posé
dans
un
milieu
de
pratique
complexe.
Ainsi,
dans
les
écoles,
les
centres
éducatifs
ou
les
prisons
pour
jeunes,
la
prescription
et
la
dispensation
des
médicaments
psychotropes
ne
sont
que
des
éléments
dans
un
système
de
prise
en
charge
multidiscipli-
naire
plus
large,
allant
du
dépistage
des
troubles
mentaux
par
le
personnel
non
médical,
à
la
discussion
de
cas
en
équipes
multi-
disciplinaires
et
au
suivi
de
l’observance
des
prescriptions.
Cela
engage
à
regarder
la
diffusion
des
connaissances
scientifiques
dans
la
communauté
biomédicale
l’identité
professionnelle
et
la
complexité
des
milieux
de
pratique
(Fig.
1).
5.
Dimensions
scientifiques
:
la
diffusion
des
connaissances
Les
premiers
facteurs
associés
au
recours
à
la
médication
psychotrope
peuvent
être
posés
en
termes
de
connaissances
des
nosographies,
des
indications,
de
l’efficacité
et
de
la
sécurité
du
médicament
psychotrope.
Sur
ce
plan,
chaque
clinicien
fonc-
tionne
selon
certains
modèles
d’évaluation
et
d’intervention
qu’il
a
édifiés
à
partir
d’une
orientation
théorique
préféren-
tielle,
prise
parfois
dès
sa
formation
universitaire
(ex.
:
lecture
de
manuels
de
base
tels
Essentials
of
clinical
psychopharmaco-
logy
[28]),
parfois
plus
tard
au
cours
de
sa
carrière
et
à
la
suite
d’activités
de
formation
continue.
Selon
Noah
[29],
il
n’est
pas
facile
d’identifier
quels
sont
les
principaux
vecteurs
de
trans-
fert
des
connaissances
dans
la
communauté
biomédicale.
Au
terme
d’une
analyse
de
plus
de
90
pages,
l’auteur
conclut
à
un
processus
horizontal
de
transfert
des
connaissances,
où
chaque
professionnel
de
la
santé
acquerrait
et
assimilerait
des
informa-
tions
passablement
incomplètes
et
conflictuelles,
lui
parvenant
quasi
quotidiennement
par
divers
canaux.
5.1.
Revues
savantes
Dans
les
revues
scientifiques,
sont
publiés
des
études
de
cas,
des
opinions,
des
essais,
des
études
cliniques
avec
ou
sans
pro-
cédure
de
double
insu,
des
protocoles
multisites
et
des
projets
d’algorithme,
tels
que
le
Texas
Children’s
Medication
Algorithm
Project
[30].
Il
existe
par
ailleurs
des
publications
électroniques
ayant
un
objectif
de
formation
continue,
sous
forme
de
feuillets
mensuels
recensant
les
plus
récentes
recherches
et
distribués
gra-
tuitement
aux
psychiatres.
Il
s’agit
par
exemple
de
Medscape

72
D.
Lafortune
et
al.
/
Neuropsychiatrie
de
l’enfance
et
de
l’adolescence
60
(2012)
69–76
Evid
enc
e based
Medicine
Document
s de
l'indust
rie
Revues sa
vantes
Relati
on
théra
peuti
que
Contextes de
pratique
Identi
té
professionn
elle
Éthiqu
e et
déontolog
ie
Lignes di
rectrices
Presc
ript
eur (sexe,
âge,
formati
on,
spéciali
té
)
Patient (s
exe, âge,
symptôm
es,
diagnost
ic,
fonctionneme
nt global)
Fig.
1.
Un
modèle
systémique
d’usage
optimal
des
médicaments
psychotropes.
(http://www.medscape.com)
ou
de
Journal
Watch
Psychiatry
(Massachusetts
Medical
Society).
5.2.
Rapports
de
recherche
produits
par
l’industrie
pharmaceutique
Les
médecins
peuvent
aussi
tirer
leurs
connaissances
de
documents
émanant
directement
de
l’industrie
pharmaceutique,
information
dont
l’objectivité
est
souvent
questionnée.
En
effet,
une
série
de
méta-analyses
récentes
montrent
que
parmi
les
recherches
mettant
à
l’épreuve
un
médicament,
celles
financées
par
l’industrie
pharmaceutique
sont
plus
susceptibles
d’aboutir
à
des
résultats
positifs
que
celles
réalisées
par
des
équipes
indé-
pendantes.
Ainsi,
Als-Nielsen
et
ses
collaborateurs
[31]
reprennent
les
résultats
de
25
méta-analyses
déjà
repérées
par
les
Cochrane
Collaboration
Reviews
afin
de
les
inclure
dans
une
régression
logistique
permettant
de
contrôler
l’effet
possible
de
variables
telles
que
la
qualité
méthodologique
des
études,
la
taille
de
l’échantillon
ou
l’année
de
publication.
Ces
25
méta-analyses
regroupent
370
essais
cliniques
(il
est
impossible
de
connaître
l’âge
des
sujets
inclus
dans
ces
essais).
Treize
avaient
pour
but
de
mesurer
l’efficacité
d’un
médicament
psychotrope,
les
autres
mettant
plutôt
à
l’épreuve
des
médicaments
prescrits
pour
traiter
des
troubles
somatiques.
Les
auteurs
constatent
que
le
médica-
ment
mis
à
l’épreuve
est
recommandé
dans
16
%
des
études
réalisées
de
manière
indépendante,
alors
qu’il
l’est
dans
51
%
des
études
financées
(p
<
0,001).
Le
risque
relatif
résultant
de
la
régression
logistique
indique
qu’une
étude
financée
a
5,3
fois
plus
de
chance
de
conclure
à
l’efficacité
du
médicament
qu’une
étude
indépendante.
Bekelman
et
al.
[32]
synthétisent
les
conclusions
de
huit
articles
ayant
comparé
les
résultats
d’études
cliniques
avec
un
promoteur
industriel
à
ceux
d’études
cliniques
sans
promoteur
industriel.
Pour
être
considérés,
ces
articles
doivent
avoir
pour
objectif
principal
ou
secondaire
d’évaluer
l’étendue,
l’impact
ou
la
gestion
des
liens
financiers
entre
l’industrie,
l’équipe
de
chercheurs
et
les
organismes
de
recherche
universitaires.
Ces
huit
articles
regroupent
eux-mêmes
les
résultats
de
plus
de
1140
essais
cliniques
originaux.
Une
régression
logistique
montre
que
les
résultats
des
essais
cliniques
sont
3,6
fois
plus
susceptibles
de
conclure
à
l’efficacité
du
médicament
lorsqu’il
y
a
contribution
financière
de
l’industrie
(IC
à
95
%
:
2,63–4,91).
Quant
à
Lexchin
et
al.
[33],
ils
soumettent
à
une
nou-
velle
analyse
les
résultats
de
30
études
publiées
dans
la
période
1980–2002,
qui
ont
été
repérées
à
l’aide
des
mots
clé
:
clinical
trials,
conflict
of
interest,
drug
industry,
financial
support,
publi-
cation
bias,
research
design
et
research
support.
Ils
concluent
cette
fois
à
un
risque
relatif
de
4,05
associant
le
financement
à
des
conclusions
favorables.
Bref,
cette
série
de
trois
méta-analyses
établit
que
les
recherches
financées
sont
de
trois
à
cinq
fois
plus
susceptibles
de
conclure
en
recommandant
la
molécule
qui
a
été
évaluée.
5.3.
Recensions
systématiques
et
evidence
based
medicine
Faisant
écho
à
la
question
qu’avaient
posée
Anderson
et
Gra-
ham
en
1980,
Is
there
an
information
overload
?
[34],
on
peut
rappeler
qu’il
y
a
dans
le
monde
plus
de
25
000
revues
biomédi-
cales
qui
publient
plus
de
deux
millions
d’articles
chaque
année.
Des
initiatives
de
construction,
de
structuration
et
de
diffusion
de
l’information
ont
vu
le
jour
depuis
cinq
ans,
dont
celle
de
la
Collaboration
Cochrane.
Elles
utilisent
une
approche
de
la
pra-
tique
fondée
sur
les
données
probantes
et
emploient
largement
les
méthodes
de
la
recension
systématique
et
de
la
méta-analyse
[35].
La
médecine
fondée
sur
des
données
probantes
tente
d’améliorer
la
prise
de
décisions
par
les
médecins.
Par
exemple,
Gibson
et
al.
[36]
rappellent
qu’en
milieu
hospitalier,
il
arrive
qu’il
faille
calmer
un
patient
psychotique
et
violent
à
l’aide
d’une
injection
d’antipsychotique.
Les
auteurs
ont
donc
mené
une
recension
systématique
afin
d’apprécier
l’efficacité
de
l’acétate
de
zuclopenthixol.
Ils
concluent
que
face
à
de
telles
situations
de
crise,
il
faudrait
que
le
médecin
considère
avec
prudence
les
recommandations
qui
font
du
Clopixol®un
médicament
de
choix,
comparativement
aux
traitements
pharmacologiques
« standard
».
En
effet,
la
plupart
des
essais
cliniques
comportent
d’importantes
lacunes
méthodologiques
et
les
résultats
sont,

D.
Lafortune
et
al.
/
Neuropsychiatrie
de
l’enfance
et
de
l’adolescence
60
(2012)
69–76
73
jusqu’ici,
assez
minces.
Les
auteurs
rappellent
qu’une
recension
Cochrane
parue
en
2004
n’a
pu
corroborer
que
le
Clopixol®est
plus
efficace
que
l’halopéridol
intramusculaire
dans
le
contrôle
des
symptômes
agressifs
de
la
psychose
aiguë,
ni
qu’il
a
une
action
plus
rapide.
6.
Facteurs
professionnels
:
guides
de
pratiques,
identité
et
responsabilités
professionnelles
Pour
Freidson
[37],
la
relation
thérapeutique
entre
un
méde-
cin
et
son
patient
est
modulée
par
un
contexte
professionnel.
C’est
dire
qu’outre
les
connaissances
scientifiques,
d’autres
éléments
interviennent
sur
le
raisonnement
et
la
prise
de
décision
:
les
lignes
directrices
émanant
d’associations
médi-
cales,
les
champs
et
les
actes
réservés
qui
définissent
l’identité
professionnelle,
ainsi
que
la
notion
éthique/déontologique
de
«
responsabilité
».
6.1.
Guides
de
pratique
Les
associations
médicales
font
des
efforts
pour
soutenir
la
prise
de
décision
et
établir
le
périmètre
à
l’intérieur
duquel
devrait
s’exercer
le
jugement
clinique.
Cette
démarche
s’est
accélérée
après
qu’Eddy
[38]
se
soit
inquiété,
dans
la
revue
JAMA,
de
la
grande
variation
des
pratiques
d’une
région
à
l’autre
d’un
pays.
Elle
se
concrétise
par
la
publication
de
lignes
direc-
trices
ou
paramètres
de
pratique.
En
Amérique
du
Nord,
ces
lignes
directrices
sont
habituellement
publiées
dans
le
Journal
of
the
American
Academy
of
Child
and
Adolescent
Psychiatry,
American
Journal
of
Psychiatry
ou
Journal
of
Clinical
Psychia-
try.
Il
s’agit
d’une
méthode
de
consensus
formel.
Un
comité
d’experts
reconnus
prépare
une
recension
critique
des
écrits
vou-
lant
faire
autorité.
Il
y
calibre
prudemment
la
qualité
des
données
colligées,
y
intègre
ses
propres
opinions,
puis
soumet
une
pre-
mière
version
du
texte
à
certains
individus
ou
organisations.
Il
s’ensuit
un
processus
de
révision
et
de
délibérations
de
quelques
mois,
où
chacun
peut
réagir
à
la
première
version
du
guide.
A
priori,
il
n’existe
dans
ce
processus
aucune
règle
absolue
pour
trancher
sur
les
débats
et
les
controverses
qui
apparaissent,
si
ce
n’est
par
une
décision
éditoriale.
Les
documents
qui
en
résultent
ont
bien
sûr
pour
objectif
d’orienter
ensuite
les
décisions
et
les
pratiques.
Selon
Noah
[29],
c’est
sur
cette
cookbook
medicine
que
reposent
les
activités
de
formation
continue
de
la
plupart
des
cliniciens.
Par
exemple,
deux
articles
récemment
publiés
dans
Journal
of
the
American
Academy
of
Child
and
Adolescent
Psychiatry
et
signés
par
d’imposantes
équipes
où
figurent
des
chercheurs
indépendants
(Treatment
Recommendations
for
the
Use
of
Anti-
psychotics
for
Agressive
Youth,
ou
TRAAY
[11,39])
reprennent
et
ré-analysent
les
conclusions
de
plusieurs
essais
cliniques
éva-
luant
l’efficacité
de
la
rispéridone
et
de
la
quétiapine.
Dans
ces
textes,
il
est
frappant
de
constater
que
les
effets
secondaires
sont
tout
à
coup
décrits
comme
étant
passablement
plus
lourds
que
ce
qui
est
rapporté
d’habitude
dans
les
rapports
de
recherche
pro-
duits
par
l’industrie.
Outre
le
gain
de
poids
jugé
préoccupant,
Schur
et
al.
soulignent
que
l’incidence
d’effets
extrapyramidaux
n’est
pas
à
négliger,
que
l’usage
de
la
rispéridone
peut
être
asso-
cié
à
une
augmentation
du
niveau
de
prolactine
et
qu’il
peut
mener
au
priapisme.
Par
conséquent,
les
recommandations
cli-
niques
du
TRAAY
sont
beaucoup
moins
enthousiastes,
reléguant
l’usage
des
neuroleptiques
au
second
rang
dans
le
traitement
de
l’agression
et
privilégiant
un
traitement
psychosocial.
Si
la
médi-
cation
est
nécessaire
pour
diminuer
les
comportements
agressifs,
elle
devrait
être
complémentaire
à
des
interventions
psychoso-
ciales,
telles
que
l’organisation
d’un
milieu
thérapeutique
[40],
des
programmes
d’économie
de
jetons
[41]
ou
un
entraînement
aux
habiletés
sociales
[42].
6.2.
Identité
et
activités
professionnelles
Si
le
clinicien
se
représente
les
psychopathologies
et
leurs
traitements
à
partir
de
connaissances
acquises,
il
le
fait
aussi
à
partir
d’une
plus
ou
moins
grande
adhésion
aux
valeurs
et
idéaux
de
sa
profession
[43].
Les
travaux
classiques
de
Freid-
son
[37]
sur
la
profession
médicale
ont
bien
décrit
les
processus
de
socialisation
des
résidents
et
médecins.
Dans
la
plupart
des
pays
du
monde,
le
système
professionnel
a
conféré
au
méde-
cin
une
expertise
unique
en
ce
qui
concerne
le
diagnostic
et
le
traitement.
Il
en
a
fait
le
seul
professionnel
habilité
à
diagnosti-
quer
les
troubles
mentaux,
à
déterminer
le
plan
de
traitement
et
à
prescrire
les
médicaments.
Sont
ici
introduites
les
notions
de
champ
de
compétences,
d’actes
réservés
et
de
responsabilités.
La
grande
circulation
de
molécules
psychotropes
n’en
a
pas
moins
d’importantes
implications
pour
le
travail
des
non-médecins,
tel
que
l’ont
bien
montré
Bentley
et
Walsh
[44].
De
la
même
fac¸on,
Biadi-Imhof
[45]
a
étudié
les
attentes
spécifiques
formulées
par
différentes
catégories
d’intervenants
(psychiatres,
psycho-
logues,
infirmières,
etc.)
en
matière
de
médication
psychotrope.
Elle
conclut
que
les
différentes
professions
ne
représentent
pas
le
médicament
de
la
même
fac¸on
et
que
ces
différences
sont
liées
aux
spécificités
du
rôle
de
chacun
dans
la
relation
thérapeutique.
6.3.
Responsabilités
et
dilemmes
éthiques
La
dimension
éthique
est
l’une
des
composantes
de
l’heuristique
de
tout
clinicien.
Elle
peut
être
considérée
comme
une
dimension
professionnelle
puisqu’elle
se
traduit
souvent
par
des
considérations
déontologiques
relatives
à
la
gestion
des
risques,
aux
responsabilités
et
aux
possibilités
de
préjudices.
Sous
cet
angle,
depuis
dix
ans,
plusieurs
auteurs
dénoncent
l’écart
important
entre
la
pratique
et
l’état
des
connaissances
nécessaires
à
une
prescription
avertie
[46,47].
Chez
l’enfant,
plusieurs
médicaments
utilisés
proviennent
de
la
pharmaco-
pée
adulte,
souvent
à
la
suite
d’une
extrapolation
hâtive
et
mal
justifiée.
Gadow
[48]
écrit
:
«
le
changement
qui
est
probable-
ment
le
plus
prévisible
dans
l’utilisation
des
médicaments
au
fil
des
ans
est
la
célébrité
instantanée
de
nouveaux
produits,
sou-
vent
adoptés
avec
enthousiasme
en
l’absence
complète
d’études
contrôlées
montrant
leur
sécurité
ou
leur
efficacité
auprès
des
enfants
»
(p.
230).
Voilà
pourquoi
le
médecin
peut
avoir
le
sentiment
d’engager
sa
responsabilité
lorsqu’il
prescrit.
Les
dif-
ficultés
entourant
le
consentement
éclairé
des
enfants,
ainsi
que
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%