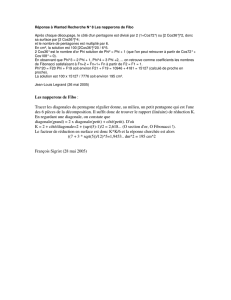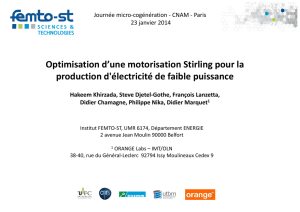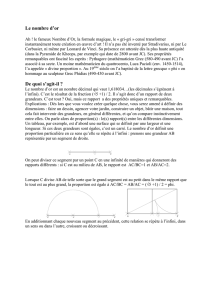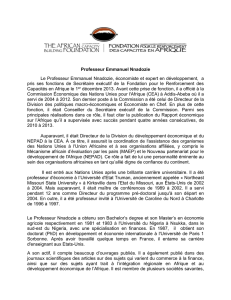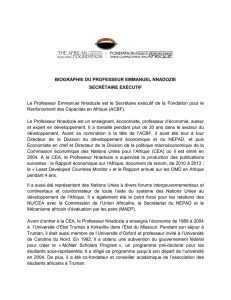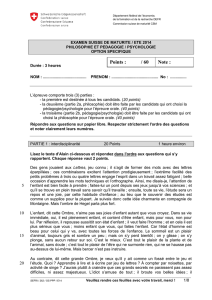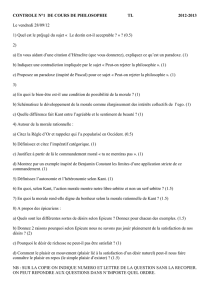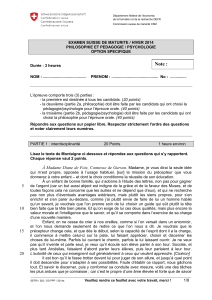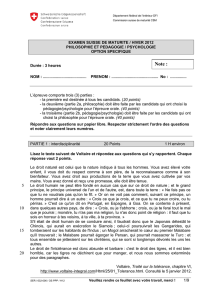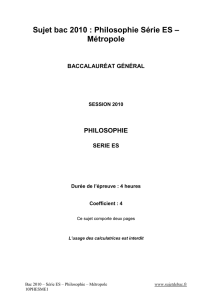Philosophie et pédagogie / psychologie, option spécifique

SEFRI/D262/OS PPP/H15 Veuillez rendre ces feuilles avec votre travail, merci !
1/8
Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Commission suisse de maturité CSM
EXAMEN SUISSE DE MATURITE / HIVER 2015
PHILOSOPHIE ET PEDAGOGIE / PSYCHOLOGIE
OPTION SPECIFIQUE
Durée : 3 heures
NOM : ........................................ PRENOM : ........................................... No : ...............
L’épreuve comporte trois (3) parties :
- la première est destinée à tous les candidats. (20 points)
- la deuxième (partie 2a, philosophie) doit être faite par les candidats qui ont choisi la
pédagogie/psychologie pour l’épreuve orale. (40 points)
- la troisième (partie 2b, pédagogie/psychologie) doit être faite par les candidats qui ont
choisi la philosophie pour l’épreuve orale. (40 points)
Répondre aux questions sur papier libre. Respecter strictement l'ordre des questions
et noter clairement leurs numéros.
PARTIE 1 : interdisciplinarité 20 Points 1 heure environ
Lisez le texte de Fichte ci-dessous et répondez dans l'ordre aux questions qui s’y
rapportent. Chaque réponse vaut 2 points.
L'éducation nouvelle a pour but immédiat de rendre l'élève capable de se livrer à une activité
spirituelle régulière et progressive. Quant à la connaissance, on ne saurait dire qu'elle
constitue l'objectif direct, immédiat de l'éducation : elle n'en est qu'une fin pour ainsi dire
complémentaire. L'ancienne éducation, au contraire, y voyait justement son objectif immédiat
et cherchait à doter l'élève d'une certaine quantité de connaissances. Il y a, en outre, une
5
grande différence entre la nature de la connaissance qui constitue le résultat de la nouvelle
éducation, et la nature de celle que dispensait l'ancienne. La première connaissance est
celle des lois qui déterminent la possibilité de toute activité spirituelle. Lorsque, par exemple,
donnant libre cours à l'imagination, on cherche à délimiter un espace à l'aide de lignes
droites, on se livre à une activité spirituelle sous sa forme la plus élémentaire. Mais lorsque,
10
tout en poursuivant ce travail, on constate qu'il est impossible de délimiter un espace avec
moins de trois lignes, une nouvelle connaissance s'acquiert, qui a pour résultat de
restreindre les possibilités de la connaissance acquise précédemment et d'imposer des
limites à un pouvoir qu'on avait cru illimité. Cette éducation apparaît ainsi, dès ses débuts,
comme une connaissance dépassant vraiment toute expérience, générale, obéissant à une
15
rigoureuse nécessité, comme une connaissance qui englobe déjà toutes les futures
expériences possibles. L'éducation ancienne, au contraire, acceptait comme données les
propriétés des choses et des objets telles qu'on les voyait, sans en rechercher les causes et
les raisons, et qu'il n'y avait qu'à accepter et à enregistrer de confiance ; elle se proposait
ainsi d'obtenir une acceptation purement passive, en comptant uniquement sur la mémoire
20
qui est toujours au service des choses, et cela sans avoir le moindre soupçon que c'est
l'esprit qui constitue le principe autonome et primaire des choses. Il n'entre pas dans mes
intentions de rappeler, pour justifier la nouvelle pédagogie, notre aversion de l'exercice
purement mécanique de la mémoire, pour l'acquisition de connaissances fondée uniquement
Note :
Points : / 60

2/8
sur l'apprentissage par cœur. L'exercice de la mémoire pour elle-même, sans aucun but
25
spirituel, au lieu d'être une activité spirituelle, constitue plutôt une souffrance, et il est facile
de comprendre pourquoi l'élève se montre si peu empressé à se soumettre à cette
souffrance ; et la connaissance qu'il acquiert de choses qui lui sont tout à fait étrangères et
ne présentent pas pour lui le moindre intérêt constitue une bien maigre compensation à cette
souffrance; c'est ce qui explique aussi son aversion pour tous les arguments dont on voudrait
30
le consoler, en lui parlant de la future utilité de ces connaissances et en lui faisant croire que
c'est seulement grâce à elles qu'il pourra s'assurer son pain quotidien et sa dignité, et que
c'est d'elles que dépendent également ses récompenses et ses châtiments dans le présent.
Bref, on avait conçu dès le début l'éducation comme devant être au service du bien-être
matériel, et cette éducation, dont nous avons dit plus haut qu'étant donné son contenu, elle
35
était impuissante à développer chez les élèves le sens moral, avait ainsi besoin, rien que
pour atteindre l'élève, d'enraciner et de développer en lui tout le contraire du sens moral et
de mettre tous ses intérêts sous la dépendance de mobiles et de stimulants essentiellement
amoraux.
[…] L'élève de la nouvelle éducation sera animé d'un amour dont l'objet ne sera pas
40
une jouissance sensible (cet amour-là n'existant pas pour lui), mais l'activité spirituelle pour
elle-même, en tant qu'activité, et la loi pour elle-même, en tant que loi. Bien que la moralité
ne repose pas sur cette activité spirituelle en général, mais sur une orientation particulière de
celle-ci, il n'en reste pas moins que cet amour détermine la nature générale et la forme de la
volonté morale, d'où il résulte que cette éducation spirituelle constitue la phase préliminaire
45
de la culture morale.
Johann G. FICHTE, Discours à la Nation allemande, Paris, Aubier, 1981 (texte remanié)
1. 1 - Afin de donner un résumé du texte en quelques lignes, dites ce qui distingue pour
Fichte (philosophe allemand, 1762-1814) "l'éducation nouvelle" de "l'ancienne éducation".
1. 2 - Pourquoi Fichte affirme-t-il à propos de la connaissance : "on ne saurait dire qu'elle
constitue l'objectif direct, immédiat de [la nouvelle] éducation" (lignes 2-3)?
1. 3 - En vous appuyant sur l'exemple des trois lignes droites en géométrie (l. 9 à 14),
montrez ce qui différencie la "nouvelle connaissance" (l. 12) de celle que Fichte qualifie
d'"élémentaire" (l. 10).
1. 4 - "Restreindre" (l. 13), "imposer des limites" (l. 13-14) : dites pourquoi ces mots,
apparemment négatifs, désignent dans ce texte, paradoxalement, un cheminement de
pensée positif, une conquête de la connaissance.
1. 5 - "C'est l'esprit qui constitue le principe autonome et primaire des choses" (l. 21-22).Quel
est le sens et la portée de cette affirmation?
1. 6 - Pourquoi Fichte critique-t-il "l'apprentissage par cœur" (l. 25)?
1. 7 - Fichte s'oppose à une éducation qui fournirait à l'élève une connaissance grâce à
laquelle il pourrait "s'assurer son pain quotidien et sa dignité" (l. 32). Pour quelle raison?
1. 8 - A votre avis, la connaissance doit-elle porter en priorité sur les faits ou sur les lois
(l. 42)? Justifiez votre réponse.
1. 9 - Selon vous, est-ce le rôle de l'école de "développer chez les élèves le sens moral"
(l. 36)? Justifiez votre réponse.
1. 10 - En quoi ce texte relève-t-il de la pédagogie? En quoi relève-t-il de la philosophie?

3/8
PARTIE 2a : philosophie 40 points 2 heures environ
Partie réservée aux candidats présentant la psychologie/pédagogie à l’oral
Lisez attentivement le texte suivant :
Je commencerai par prendre un exemple imaginaire : ce sera ici comme un experimentum
crucis (une expérience cruciale). […] – Concevons deux jeunes hommes, Caïus et Titus,
tous deux passionnément épris de deux jeunes filles différentes : chacun d'eux se voit barrer
la route par un rival préféré, préféré pour des avantages extérieurs. Ils résolvent, chacun de
son côté, de faire disparaître de ce monde leurs rivaux ; d'ailleurs ils sont parfaitement à
5
l'abri de toute recherche, et même de tout soupçon. Pourtant, au moment où ils procèdent
aux préparatifs du meurtre, tous deux, après une lutte intérieure, s'arrêtent. C'est sur cet
abandon de leur projet qu'ils ont à s'expliquer devant nous, sincèrement et clairement.
- Quant à Caïus, je laisse au lecteur le choix des explications qu'il lui mettra dans la bouche.
Il pourra avoir été retenu par des motifs religieux, par la pensée de la volonté divine, du
10
châtiment qui l'attend, du jugement futur, etc. Ou bien encore il dira: « J'ai réfléchi que la
maxime de ma conduite dans cette circonstance n'eût pas été propre à fournir une règle
capable de s'appliquer à tous les êtres raisonnables en général, car j'allais traiter mon rival
comme un simple moyen, sans voir en lui en même temps une fin en soi. » Ou bien avec
Fichte, il s'exprimera ainsi: « La vie d'un homme quelconque est un moyen propre à amener
15
la réalisation de la loi morale : je ne peux donc pas, à moins d'être indifférent à la réalisation
de la loi morale, anéantir un être dont la destinée est d'y contribuer. » (Ce scrupule, soit dit
en passant, il pourrait s'en défaire, car il espère bien, une fois en possession de celle qu'il
aime, ne pas tarder à créer un instrument nouveau de la loi morale.) […] Bref, il dira ce qu'il
vous plaira.
20
- Mais pour Titus, que je me suis réservé de faire s'expliquer à ma manière, il dira: « Quand
j'en suis venu aux préparatifs, quand, par suite, j'ai dû considérer pour un moment, non plus
ma passion, mais mon rival, alors j'ai commencé à voir clairement de quoi il s'agissait et pour
moi et pour lui. Mais alors aussi la pitié, la compassion m'ont saisi, je n'ai pas eu le cœur d'y
résister: je n'ai pas pu faire ce que je voulais. » Maintenant, je le demande à tout lecteur
25
sincère et libre de préjugés : de ces deux hommes, quel est le meilleur ? quel est celui aux
mains de qui on remettrait le plus volontiers sa destinée ? quel est celui qui a été retenu par
le plus pur motif ? - Où gît dès lors le fondement de la morale ?
Il n'est rien qui soulève jusque dans ses profondeurs notre sentiment moral autant que la
cruauté. Toute autre faute, nous pouvons la pardonner ; la cruauté, jamais. La raison en est
30
que la cruauté est précisément le contraire de la pitié. [Devant un acte de grande cruauté],
aussitôt nous voilà saisis d'horreur ; nous nous écrions : "Comment peut-on faire de pareilles
choses?". Et quel est le sens de cette question? Celui-ci peut-être : comment peut-on
redouter aussi peu les châtiments de la vie future ? - L'interprétation est difficile à admettre. -
Ou bien celui-ci : comment peut-on agir d'après une maxime aussi peu propre à devenir la loi
35
générale de tous les êtres raisonnables ? - Pour cela, non. Ou bien encore : comment peut-
on négliger à ce point sa propre perfection et celle d'autrui ? - Pas davantage. Le sens vrai,
le voici à n'en pas douter : comment peut-on être à ce point sans pitié ? C'est donc quand
une action s'écarte extrêmement de la pitié qu'elle porte comme un stigmate le caractère
d'une chose moralement condamnable, méprisable. La pitié est par excellence le ressort de
40
la moralité.
Le principe de la morale, le ressort de la moralité, tel que je l'ai révélé, est le seul absolument
auquel on puisse rendre cette justice, qu'il agit avec efficacité et même sur un domaine
étendu. Personne ne voudrait en dire autant de tous les autres principes de morale proposés
par les philosophes : ces principes consistent en des propositions abstraites, souvent même
45
subtiles, sans autre fondement qu'une combinaison artificielle des notions : c’est au point
qu'ils ne sauraient s'appliquer à la vie pratique sans offrir quelque côté risible. Une bonne
action qui aurait été inspirée par le seul principe moral de Kant, serait au fond l'acte d'un

4/8
pédant de philosophie ; ou elle aboutirait à un mensonge que l'agent se ferait à lui-même :
étant donné un acte qu'il aurait accompli pour de certains motifs, il lui en attribuerait d'autres,
50
et y verrait un produit de l'impératif catégorique et d'une notion en l'air, celle du devoir. Mais
ce n'est pas seulement aux principes de morale qu'ont inventés pour le seul besoin de leurs
théories les philosophes, c'est aussi à ceux que les religions ont établis en vue d'une utilité
toute pratique, qu'il est difficile de reconnaître une efficacité marquée. En voici un premier
signe : si diverses que soient les religions répandues sur la terre, on ne voit point que la
55
moralité des hommes, ou pour mieux dire leur immoralité, varie dans une mesure correspon-
dante ; au contraire, pour l'essentiel, elle en est à peu près partout au même point.
Arthur SCHOPENHAUER, Le Fondement de la morale, Paris, Le Livre de Poche, 2003.
Répondez dans l’ordre aux questions ci-dessous.
A. Connaissances préalables et carte d’identité du texte (6 points)
Phi 1 - Dites en quelques phrases et en utilisant vos propres mots quelle est la thèse
défendue par Schopenhauer dans ce texte.
Phi 2 - Présentez en quelques lignes les traits distinctifs de la morale de Kant (son éthique
déontologique).
B. Explication de détail/compréhension (12 points)
Phi 3 - Pourquoi Schopenhauer passe-t-il par un "exemple imaginaire" (ligne 1) pour
promouvoir et défendre sa thèse sur la morale?
Phi 4 - Schopenhauer "laisse au lecteur le choix des explications" (l. 9) qu'il mettra dans la
bouche de Caïus. "Il dira ce qu'il vous plaira" (l. 19-20). Comment expliquer cette
indifférence, voire cette désinvolture?
Phi 5 - Pour Schopenhauer, la pitié est-elle de l'ordre de la volonté ou est-elle l'effet du
sentiment? Justifiez votre réponse.
Phi 6 - Reformulez avec vos propres termes la question capitale de la ligne 28 : "Où gît dès
lors le fondement de la morale?".
Phi 7 - En quoi consiste pour Schopenhauer le "mensonge" dont il est question à la ligne
49?
Phi 8 - Quel est l'apport de la dernière phrase à la démonstration de Schopenhauer?
C. Maîtrise des notions philosophiques (10 points)
Dites à quel terme du vocabulaire philosophique, présent dans le texte sous la forme
d’un nom ou d'un adjectif, correspond chacune des 10 définitions suivantes. Voici un
exemple :
Définition : "fait d’être unique, seul de son espèce"
Réponse : "singularité"

5/8
Phi 9 - Ensemble des croyances et des rites collectifs ayant pour fonction de mettre en
communication l'être humain avec un autre monde.
Phi 10 - Opinion forgée à l'avance, souvent adoptée sans connaissance ni examen.
Phi 11 - Activité générale de la pensée soucieuse, selon Kant, de répondre aux trois
questions suivantes : "Que puis-je savoir?", "Que dois-je faire?", "Que suis-je en
droit d'espérer?".
Phi 12 - (chez Kant notamment) Pensée adoptée comme règle de conduite. Principe
subjectif du vouloir, donc considéré par celui qui l'adopte comme valable pour sa
volonté propre.
Phi 13 - Sentiment ou disposition de celui qui est touché par les souffrances d'autrui et porté
à les soulager.
Phi 14 - Proposition fondamentale qui sert de base à un travail de pensée. Proposition
première dont le raisonnement tire par déduction les conséquences.
Phi 15 - Partie de la philosophie qui a pour objet les lois et les règles de l'action bonne et qui
a une prétention à l'universalité.
Phi 16 - (adjectif) Qui dispose de la capacité de distinguer le vrai du faux, le réel de
l'imaginaire, le bien du mal. Dans le langage courant, caractérise un être sage et
mesuré.
Phi 17 - (chez Kant notamment) L'obligation morale considérée en elle-même et en général,
donc indépendamment de telle règle d'action particulière.
Phi 18 - Ce qui sert pour parvenir à un but, à une fin.
D. Questions générales (12 points)
Phi 19 - Schopenhauer a peu d'estime et même pas mal de dédain pour les "propositions
abstraites"(l. 45) des philosophes qui font de la morale l'objet d'une élaboration
théorique. Essayez en quelques lignes de partir à la défense de ces philosophes,
de montrer que leur préoccupation et leur ambition ne sont pas forcément vaines.
Phi 20 - Lorsque l'homme fait le bien, agit-il avant tout par choix, par aptitude naturelle, par
intérêt ou par disposition psychologique? Développez brièvement votre position
personnelle sur cette question.
Phi 21 - Si la pitié est, comme le pense Schopenhauer, un sentiment universel chez
l'homme et "le ressort de la moralité" (l. 40-41), comment expliquer l'effrayante
indifférence des bourreaux à l'égard de leurs victimes lors de guerres, dans les
camps de la mort, etc.?
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%