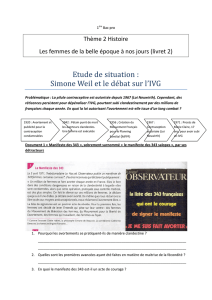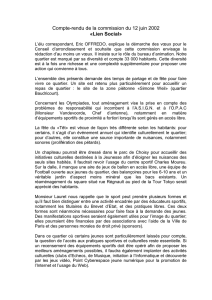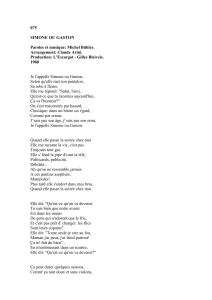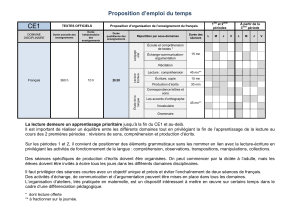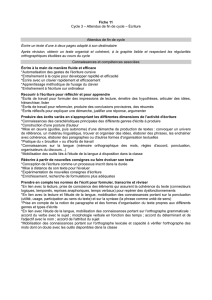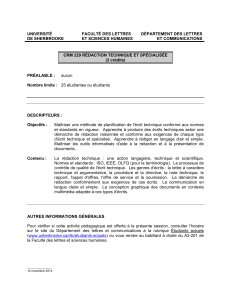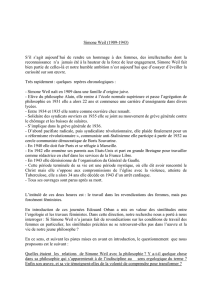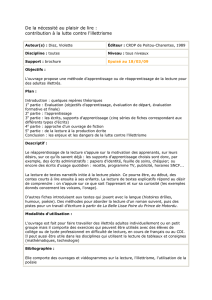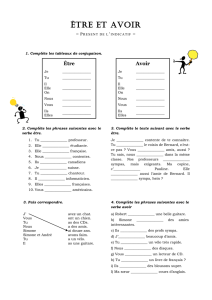Écrits historiques et politiques 2. Deuxième partie

Simone Weil (1909-1943)
Écrits historiques
et politiques
2. Deuxième partie :
politique
Un document produit en version numérique par Mme Marcelle Bergeron, bénévole
Professeure à la retraite de l’École Dominique-Racine de Chicoutimi, Québec
et collaboratrice bénévole
Courriel: mailto:[email protected]
Site web: http://www.geocities.com/areqchicoutimi_valin
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
dirigée et fondée par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm

Simone Weil, Écrits historiques et politiques. 2. Deuxième partie : Politique 2
Un document produit en version numérique par Mme Marcelle Bergeron, bénévole,
professeure à la retraie de l’École Dominique-Racine de Chicoutimi, Québec
courriel: mailto:[email protected]
site web: http://www.geocities.com/areqchicoutimi_valin
à partir de :
Simone Weil (1909-1943)
Écrits historiques et politiques.
2. Deuxième partie : politique
Une édition électronique réalisée du livre Écrits historiques et
politiques. Deuxième partie : Politique Paris :Éditions Gallimard, 1960,
413 pages. Collection Espoir, nrf. (pp. 225 à 413)
(Recueil d’articles)
Polices de caractères utilisée :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
Édition électronique réalisée avec le traitement de textes
Microsoft Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)
Édition complétée le 9 août 2003 à Chicoutimi, Québec.

Simone Weil, Écrits historiques et politiques. 2. Deuxième partie : Politique 3
Table des matières
Écrits historiques et politiques
Note de l’éditeur
Deuxième note de l’éditeur
Première partie : Histoire
1- Quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme (1939-1940)
I. Permanence et changements des caractères nationaux
« la France éternelle »
L'éternelle Allemagne
L'hitlérisme et les germains
II. - Hitler et la politique extérieure de la Rome antique
III. - Hitler et le régime intérieur de l'empire romain
Conclusion
2- Rome et l'Albanie (1939)
3- Réflexions sur la barbarie (fragments) (1939 ?)
4- L'agonie d'une civilisation vue à travers un poème épique (1941?
1942?)
5- En quoi consiste l'inspiration occitanienne ? (1941 ? 1942 ?)
6- Un soulèvement prolétarien à Florence au XIVe siècle (1934)
7- Ébauches de lettres (1938 ? 1939 ?)
I
II Variante de la lettre précédente
III
IV
8- Conditions d'une révolution allemande (1932)
9- Premières impressions d'Allemagne (1932)
10- L'Allemagne en attente (1932)
11- La grève des transports à Berlin (1932)
12- La situation en Allemagne (1932-1933)
I
II Le mouvement hitlérien
III Le réformisme allemand
IV
VLe mouvement communiste
VI
VII

Simone Weil, Écrits historiques et politiques. 2. Deuxième partie : Politique 4
VIII
IX
X
13- Sur la situation en Allemagne (9 avril 1933)
14- Quelques remarques sur la réponse de la M.O.R. (7 mai 1933)
15- Le rôle de l'U.R.S.S. dans la politique mondiale (23 juillet 1933)
16 Journal d'Espagne (août 1936)
17- Fragment (1936 ?)
18- Réflexions pour déplaire (1936 ?)
19- Lettre à Georges Bernanos (1938 ?)
Deuxième partie : Politique
I. - Guerre et paix.
1- Réflexions sur la guerre (novembre 1933).
2- Fragment sur la guerre révolutionnaire (fin 1933).
3- Encore quelques mots sur le boycottage (fragment) (fin 1933 ?
début 1934 ?).
4- Réponse à une question d'Alain (1936 ?).
5- Faut-il graisser les godillots ? (27 octobre 1936).
6- La politique de neutralité et l'Assistance mutuelle (1936).
7- Non-intervention généralisée (1936 ? 1937 ?).
8- Ne recommençons pas la guerre de Troie (1er au 15 avril 1937).
9- L'Europe en guerre pour la Tchécoslovaquie (25 mai 1938)
10- Réflexions sur la conférence de Bouché (1938).
11- Lettre à G. Bergery (1938).
12- Désarroi de notre temps (1939?)
13- Fragment (1939 ?).
14- Réflexions en vue d'un bilan (1939 ?).
15- Fragment (1939 ?).
16- Fragment (après juin 1940).
II. - Front populaire
1- Quelques méditations concernant l'économie (1937 ?).
2- Méditations sur un cadavre (1937).
III. - Colonies
1- Le Maroc, au la prescription en matière de vol (10 février
1937).
2- Le sang coule en Tunisie (mars 1937).
3- Qui est coupable des menées anti-françaises ? (1938 ?).
4- « Ces membres palpitants de la patrie... » (10 mars 1938).
5- Les nouvelles données du problème colonial dans l'empire
français (décembre 1938)
6- Fragment (1938-1939 ?).
7- Fragment (1938-1939 ?)

Simone Weil, Écrits historiques et politiques. 2. Deuxième partie : Politique 5
8- Lettre à Jean Giraudoux (fin 1939 ? 1940 ?).
9- À propos de la question coloniale, dans ses rapports avec le
destin du peuple français (1943).
Appendice (Ébauches et variantes).
1- Un petit point d'histoire (Lettre au Temps) (1939).
2- Note sur les récents événements d'Allemagne (25 novembre
1932).
3- La situation en Allemagne (note) (25 février 1933)
4- Quelques remarques sur la réponse de la M.O.R. (1933).
5- Réflexions pour déplaire (1936 ?).
6- Quelques réflexions concernant l'honneur et la dignité
nationale (1936 ?).
7- Réponse au questionnaire d'Alain (1936 ?).
8- Progrès et production (fragment) (1937 ?).
9- Esquisse d'une apologie de la banqueroute (1937 ?).
10 Méditation sur un cadavre (1937).
11- Les nouvelles données du problème colonial dans l'empire
français (1938)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
1
/
162
100%