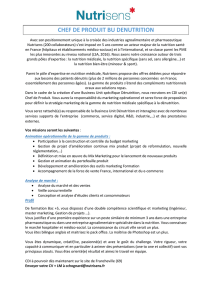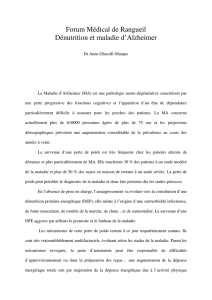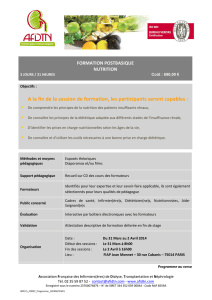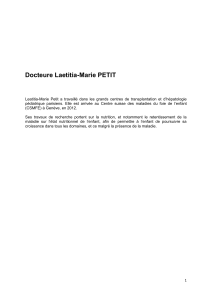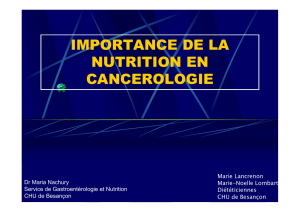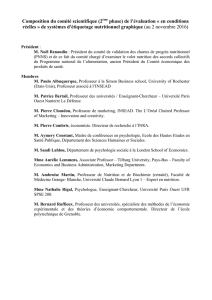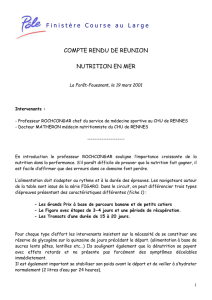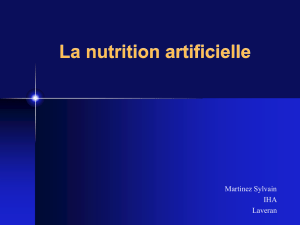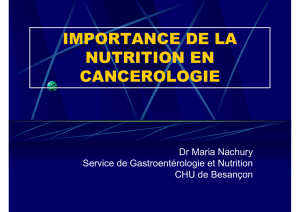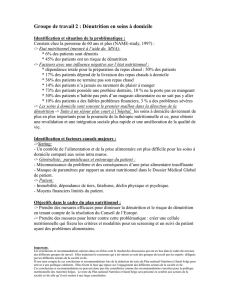Nutritionet infection - Revue Médicale Suisse

introduction
La malnutrition est la principale cause de déficit immunitaire
dans le monde.1 Bien que ce terme englobe également des
états de surnutrition et de troubles métaboliques, c’est surtout
les situations de dénutrition qui seront abordées ici.
Maintenir et améliorer l’état nutritionnel peut jouer un rôle
important dans la prévention et la guérison des infections.
D’un autre côté, la plupart des infections influencent l’état
nutritionnel. Enfin, certains traitements à visée nutritionnelle,
en particulier la nutrition parentérale, présentent des risques
infectieux qu’il faut connaître.
influence de l’état nutritionnel
sur l’immunité
Au siècle passé, si l’amélioration des conditions d’hygiène a
permis une diminution de certaines infections, ce n’est qu’en
améliorant la quantité et la qualité de l’alimentation que la
prévalence d’autres pathologies infectieuses a diminué. Des
infections à germes opportunistes (par exemple :
Pneumocystis jirovecii
) ont été
identifiées à plusieurs reprises chez des personnes dénutries sans autre déficit
immunitaire connu. Ces observations ont incité à rechercher un phénomène
d’altération de l’immunité spécifiquement lié à la dénutrition.2-4
Plusieurs travaux ont démontré que la dénutrition altère l’immunité cellulaire
mais également nombre d’autres processus, notamment la phagocytose et l’immu-
nité humorale.2,5
L’observation de populations en situation de famine ainsi que le suivi de per-
sonnes suivant une grève de la faim ont permis de décrire l’évolution naturelle
d’une dénutrition non traitée.2,6 Celle-ci se caractérise par une dégradation fonc-
tionnelle progressive et par l’apparition de pathologies infectieuses entraînant
finalement le décès (figure 1).
La dénutrition est une pathologie fréquente dans nos hôpitaux, elle touche 20
à 40% des patients à l’admission.7 Les patients souffrant de dénutrition sévère
présentent un taux d’infections nosocomiales cinq fois plus élevé
8 et ce phéno-
mène est à l’origine de surcoûts importants.
La dénutrition entraîne un déficit immunitaire global. Quelle
est l’influence d’un état de dénutrition sur la survenue et le
cours d’une maladie infectieuse ? De quelle façon une infec-
tion agit-elle sur l’état nutritionnel ? Peut-on améliorer l’état
nutritionnel en traitant les infections et à l’inverse peut-on pré-
venir la survenue d’une infection en améliorant l’état nutri-
tionnel ? Cet article résume les réponses à ces questions et
aborde le sujet des complications infectieuses liées aux trai-
tements nutritionnels, en particulier la nutrition parentérale.
Quelques exemples de pharmaconutrition sont également
mentionnés.
Nutrition et infection
mise au point
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009 1975
R. Rakotoarimanana
Nutrition and infection
Undernutrition leads to a global immune defi-
ciency. What is the influence of undernutrition
on the occurence and development of an infec-
tious disease ? How does an infection act on
nutritional state of a patient ? Is it possible to
improve nutritional state by treating an infec-
tion and inversely, is it possible to prevent the
arrival of an infectious disease by improving
nutritional state ? This article summarizes ans-
wers to these questions and takes up the sub-
ject of infectious complications related to nu-
tritional treatment and parenteral nutrition in
particular. Some exemples of pharmaconutri-
tion are also mentioned.
Rev Med Suisse 2009 ; 5 : 1975-8
Dr Riana Rakotoarimanana
Département de médecine
interne
Hôpital neuchâtelois-La Chaux-
de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009 0
cas d’infection. Son évolution est fortement dépendante
du traitement de l’infection de base.
peut-on prévenir les infections en
améliorant l’état nutritionnel ?
Plusieurs études observationnelles réalisées au XXe siè-
cle montrent que la prévalence de la tuberculose4 :
• était plus basse (1,2%) dans un camp de prisonniers an-
glais recevant des suppléments alimentaires correspon-
dant à 30 g de protéines et de 1000 kcal/j (contre 19% dans
un autre camp) ;
• stagnait malgré l’amélioration des conditions d’hygiène
chez des recrues norvégiennes mais diminuait après enri-
chissement de leur alimentation ;
• avait augmenté dans la population danoise durant une
période de restrictions alimentaires puis diminué lorsque
que le blocus a été levé (alors qu’elle restait élevée dans
les autres pays toujours soumis aux restrictions).
Une étude11 réalisée au Guatemala, dans une popula-
tion d’enfants préscolaires, a comparé une intervention nu-
tritionnelle seule à une intervention médicale seule.
L’intervention nutritionnelle s’est montrée significative-
ment plus efficace pour diminuer la morbidité infectieuse
de cette population.
Ces données suggèrent que l’amélioration de l’état
nutritionnel peut diminuer l’incidence de maladies infec-
tieuses, en particulier de la tuberculose. Les populations
étudiées avaient cependant des conditions de vie glo-
balement plus précaires que les nôtres actuellement.
Dans le monde contemporain occidental, les études mon-
trent que si l’administration systématique de supplé-
ments nutritifs au tout-venant des patients n’a pas d’effet
démontrable sur la morbidité infectieuse, une prise en
charge nutritionnelle ciblée sur des populations à risque
(personnes âgées dénutries et/ou souffrant d’une fracture
du col du fémur) permet une diminution des compli-
cations infectieuses.12 Au vu de ces données, un dépista-
ge systématique du risque de dénutrition devrait être réa-
1976 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009
Figure 1. Conséquences de la dénutrition
Adaptée de réf.6
% du
poids
usuel
Temps
100
90
80
70
60
50
Anémie
Hypoalbuminémie
Diminution de l’immunité cellulaire
Bronchopneumopathie
Faiblesse pour marcher
Infection urinaire
Faiblesse pour s’asseoir
Escarres
Mort
influence des infections sur l’état
nutritionnel
Toute infection, par l’agression qu’elle représente, en-
traîne des répercussions métaboliques et systémiques (ef-
fet anorexigène des cytokines, catabolisme des protéines
accru, fièvre, frissons augmentant les pertes énergétiques)
qui peuvent entraîner une dénutrition. Par ailleurs, une in-
fection ciblant le système digestif peut avoir des consé-
quences nutritionnelles, par baisse des apports liée aux
symptômes (douleurs, nausées, diarrhées, etc.) ou en lien
avec une inflammation de la paroi du tube digestif interfé-
rant avec les fonctions de digestion et d’absorption.
Chez des personnes en bonne santé, ces phénomènes
sont souvent transitoires et n’entraînent en général pas
de répercussions cliniques importantes. Lorsqu’ils se pro-
longent ou qu’ils atteignent des personnes fragilisées ou
déjà dénutries, les conséquences peuvent être plus sé-
rieuses car un cercle vicieux s’installe, la dénutrition favo-
risant les infections et les infections aggravant la dénutri-
tion (figure 2).
peut-on améliorer l’état nutritionnel
en traitant les infections ?
En cas de pathologie infectieuse aiguë, un catabolisme
protéique accru est observé. Tant que cet état n’est pas
contrôlé, il n’est pas possible d’améliorer l’état nutrition-
nel. Le traitement d’une infection peut donc avoir un effet
bénéfique simplement parce qu’il permet de retrouver un
état d’anabolisme indispensable à la renutrition.
Une étude allemande
9 a comparé l’indice de masse cor-
porelle et la composition corporelle de patients VIH posi-
tifs avant et après l’introduction des trithérapies haute-
ment actives. Les auteurs ont constaté une diminution de
la prévalence de la dénutrition de l’ordre de 30 à 50%. Tout
récemment une étude réalisée chez environ 5000 patients
au Cambodge et au Kenya a démontré que la prise de
poids après trois mois de traitement par une trithérapie
hautement active était associée à une meilleure survie.10
La dénutrition est donc une comorbidité fréquente en
Figure 2. Cercle vicieux de la dénutrition
Adaptée de Pichard C, et al, in Tobin J.M., 1997.
Pathologies chroniques
Pathologies aiguës
Complications infectieuses
Mauvaise cicatrisation
Stress métabolique
Etat inflammatoire
Catabolisme
Jeûne
Anorexie
Dénutrion

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009 1977
lisé à l’hôpital afin d’identifier le plus rapidement possible
les personnes qui bénéficieront cliniquement d’une prise
en charge nutritionnelle.7,12
quelles sont les complications
infectieuses des traitements
de la dénutrition ?
Le choix du type d’assistance nutritionnelle est impor-
tant car les risques et les bénéfices sur le plan infectieux
ne sont pas les mêmes.
Il existe trois types d’assistance nutritionnelle :
• les suppléments nutritifs oraux, sous forme de boissons
hypercaloriques et parfois hyperprotéinées.
• La nutrition entérale, administrée par une sonde d’alimen-
tation, nasale ou percutanée.
• La nutrition parentérale totale, administrée par voie in-
traveineuse sur un cathéter veineux central.
La prise de
suppléments nutritifs oraux
n’augmente pas en
soi les complications infectieuses mais leur présentation
sous forme liquide peut majorer le risque de fausse route.
En cas de
nutrition entérale
, il existe un risque de pneu-
monies d’aspiration lié partiellement à la présence d’une
sonde empêchant une fermeture efficace du sphincter du
cardia : ce n’est pas le seul mécanisme car la nutrition par
gastrostomie percutanée n’a pas d’effet protecteur. La bron-
cho-aspiration massive de liquide nutritif est redoutée mais
plutôt rare. Il s’agit le plus souvent de broncho-aspirations
à bas bruit qui n’ont pas toujours de retentissement cli-
nique. Hormis un mauvais positionnement ou un déplace-
ment secondaire de la sonde d’alimentation, les facteurs
de risque sont la position du patient (risque plus élevé si
allongé à plat) et le pH gastrique élevé (attention aux inhi-
biteurs de la pompe à protons).3
La
nutrition parentérale
consiste à injecter un liquide nutri-
tif dans un milieu stérile (sang veineux), à travers une brè-
che dans la peau. Elle expose à un risque élevé d’infec-
tions de cathéter, par contamination cutanée (au niveau du
point d’insertion) ou endoluminale (sur les manipulations
du cathéter). De plus, ces patients sont fréquemment à jeun
et l’atrophie de la muqueuse digestive qui en découle aug-
mente le risque de translocations digestives.
Un patient sous nutrition parentérale est donc à consi-
dérer comme présentant un risque infectieux plus élevé
que s’il était porteur d’un abord veineux central pour
d’autres traitements. Un état fébrile sans piste doit alors
être considéré comme une infection de cathéter jusqu’à
preuve du contraire et pris en charge sans délai car l’évo-
lution peut être rapidement catastrophique.
Une nutrition «par la veine» est malheureusement sou-
vent mieux acceptée par le patient (et parfois par les soi-
gnants…) que la mise en place d’une sonde d’alimentation
(perçue comme invasive). Les contre-indications réelles à
la nutrition entérale sont pourtant rares et les complications
d’une nutrition parentérale, potentiellement sérieuses, ne
sont acceptables que si l’indication a été bien réfléchie. En
cas de pancréatite aiguë, la pratique consistait à mettre
systématiquement le patient à jeun avec une nutrition pa-
rentérale, jusqu’à ce que des études mettent en évidence
un taux plus faible de complications infectieuses chez les
patients sous nutrition entérale par rapport aux patients
sous nutrition parentérale.13
prévention des complications
infectieuses chez un patient
sous assistance nutritionnelle
Dans l’évaluation de tout problème nutritionnel, il est
important de dépister des troubles de la déglutition et de
les investiguer. Lors de la prescription d’un
supplément nutri-
tif oral
, des conseils simples (boire lentement, à petites gor-
gées, en étant bien assis) diminuent le risque d’aspiration.
En cas de
nutrition entérale
, à part la vérification systéma-
tique de l’emplacement de la sonde d’alimentation, seul
un positionnement du patient tête à 30-45° a été démon-
tré efficace pour prévenir les pneumonies d’aspiration.3 La
mesure du résidu gastrique est controversée car elle n’a
pas prouvé avoir une réelle incidence sur la prévalence
des pneumonies d’aspiration.
Pour la
nutrition parentérale
, la meilleure prévention con-
siste à éviter les prescriptions inappropriées car dès que
l’intestin fonctionne la règle est de l’utiliser ! Si une nutri-
tion parentérale est initiée, il faut régulièrement réévaluer
son indication et la possibilité de passer à la voie entérale.
L’application de protocoles pour la pose et les soins des
abords veineux centraux ainsi que l’existence d’une équi-
pe spécialisée en nutrition14 sont des facteurs qui dimi-
nuent significativement le risque d’infection.
pharmaconutrition
Voici quelques exemples de micronutriments dont l’ef-
fet thérapeutique a été étudié, dans l’espoir que leur utili-
sation en situation aiguë améliore le cours de la maladie.
La rougeole est une maladie infantile fréquemment ba-
nalisée dans notre société mais dont la mortalité peut at-
teindre les 10% chez les enfants dénutris. Ce taux est dimi-
nué de moitié par l’adjonction de
vitamine A
mais le méca-
nisme précis n’a pas encore été élucidé.15
Acide aminé le plus abondant du corps, la
glutamine
est
le principal substrat énergétique des entérocytes. Elle favo-
rise entre autres la trophicité intestinale et joue un rôle
dans des systèmes de protéines qui protègent l’intégrité de
la cellule en cas d’agression. En cas de pathologie aiguë,
la capacité de synthèse de l’organisme est dépassée et il
devient dépendant d’un apport externe.
Chez les grands brûlés et les polytraumatisés sa prescrip-
tion diminue significativement les épisodes infectieux.16
L’
immunonutrition
est l’appellation donnée à des supplé-
ments nutritionnels enrichis notamment en arginine et en
oméga 3. Un effet significatif sur les complications infec-
tieuses a été démontré – indépendamment de l’état nutri-
tionnel – en cas d’intervention élective ORL majeure (laryn-
gectomie, pharyngectomie) ou abdominale majeure (œso-
phagectomie, gastrectomie, Whipple), ainsi que chez les
polytraumatisés sévères.13
De nombreuses autres substances sont en cours d’étu-
de (oméga 3 notamment) mais les données de la littéra-
ture ne sont pas encore assez solides pour les recom-
mander.
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009 0
conclusion
A part améliorer les apports alimentaires quantitatifs
et qualitatifs des populations en situation précaire dans
le monde, il est possible de prévenir les infections par la
nutrition :
• en recherchant et traitant la dénutrition dans des grou-
pes à risque identifiés par dépistage systématique.
• En privilégiant la nutrition orale ou entérale à chaque
fois que l’intestin est fonctionnel.
• En faisant appel à des techniques et des compétences
spécialisées pour la gestion des nutritions parentérales.
• En sachant reconnaître les situations dans lesquelles une
pharnaconutrition est indiquée.
Lorsqu’une dénutrition précède ou accompagne une
pathologie infectieuse, le traitement de la pathologie de
base est indispensable pour assurer une bonne évolution
clinique sur le plan nutritionnel.
1978 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
7 octobre 2009
Implications pratiques
Un patient dénutri est à considérer comme potentiellement
immunodéprimé
En cas de maladie infectieuse chez un patient dénutri, il est
indispensable de traiter les deux pathologies pour que l’évo-
lution de chacune d’entre elles soit favorable
Un état fébrile chez un patient sous nutrition parentérale
doit être considéré comme une infection de cathéter jusqu’à
preuve du contraire
L’identification et la prise en charge précoces de certaines
populations cibles, la présence sur le terrain de personnel
spécialisé en nutrition clinique et le strict respect des indica-
tions (limitées) à la nutrition parentérale font partie des me-
sures qui diminuent les complications infectieuses chez les
patients hospitalisés
>
>
>
>
1 Katona P, Katona-Apte T. The interaction between
nutrition and infection. CID 2008;46:1582-8.
2 Scrimshaw NS, Taylor CE, Gordon JE. Interactions
of nutrition and infection. Monogr Ser World Health
Organ 1968;57:3-329.
3 Vasson MP, Reimund JM. Nutrition, immunité et
inflammation. Chapitre 34 du Traité de nutrition artifi-
cielle de l’adulte, 3e édition, 2007.
4 Cegielski JP, McMurray DN. The relationship bet-
ween malnutrition and tuberculosis : Evidence from stu-
dies in humans and experimental animals. Int J Tuberc
Lung Dis 2004;8:286-98.
5 * Schaible UE, Kaufmann HE. Malnutrition and infec-
tion : Complex mechanisms and global impacts. PloS Me-
dicine 2007;4:e115:806-12.
6 Heymsfield SB, Berthel RA, Amsley RA, et al. Ente-
ral hyperalimentation : An alternative to central venous
hyperalimentation. Ann of Int Med 1979;90:63-71.
7 ** Berthod G, Roduit J, Roulet M, et al. Dénutri-
tion : quelles stratégies pour une pathologie que l’on
ne peut plus négliger à l’hôpital ? Rev Med Suisse 2007;
3:2466-71.
8 Schneider S, Veyres P, Pivot X, et al. Malnutrition
is an independent factor associated with nosocomial
infections. Br J Nut 2007;92:105-11.
9 Schwenk A, Beisenherz A, Kremer G, et al. Bio-
electrical impedance analysis in HIV-infected patients
treated with triple antiretroviral treatment. Am J Clin
Nutr 1999;70:867-73.
10 Madec Y, Szumilin E, Genevier C, et al. Weight gain
at 3 months of antiretroviral therapy is strongly associa-
ted with survival : Evidence from two developing coun-
tries. AIDS 2009;23:853-61.
11 Scrimshaw N, Historical concepts of interactions,
synergism and antagonism between nutrition and infec-
tion. J Nutr 2003;133:316S-21.
12 Groupe de travail de la haute autorité de santé.
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition pro-
téino-énergétique chez la personne âgée. Service des
recommandations professionnelles, Avril 2007, www.
has-sante.fr (accédé le 4 novembre 2008).
13 Marik PE, Zaloga GP. Immunonutrition in critically
ill patients : A systematic review and analysis of the lite-
rature. Intensive Care Med 2008;34:1980-90.
14 Sutton C.D, Garcea G, Pollard C, et al. The intro-
duction of a nutrition clinical nurse specialist results in
a reduction in the rate of catheter sepsis. Clin Nutr
2005;24:220-3.
15 Solomons NW. Malnutrition and infection : An up-
date. Br J Nut 2007;98(Suppl.1);S5-10.
16 Marik PE, Zaloga GP. Meta-analysis of parenteral
nutrition versus enteral nutrition in patients with acu-
te pancreatitis. BMJ 2004;328:1407-12.
* à lire
** à lire absolument
Bibliographie
1
/
4
100%