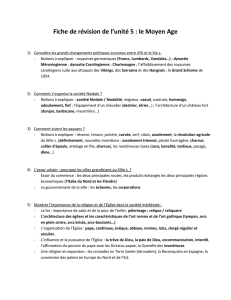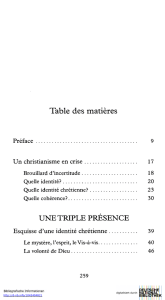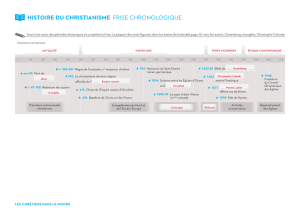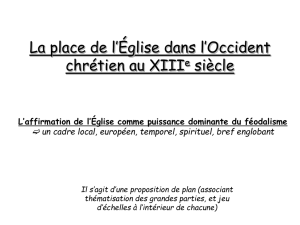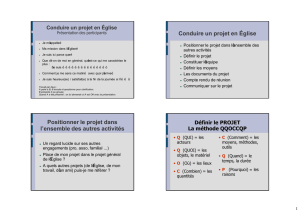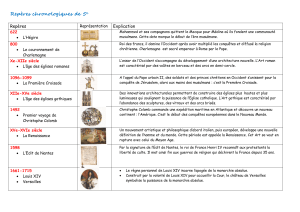sample - Create Training


Table des Matières
Page de Titre
Table des Matières
Page de Copyright
Introduction
Le christianisme des XIIIe-XVe siècles en Occident
Contexte
Sources et historiographie
Chapitre 1 - L'Occident latin à l'orée du XIIIe siècle
L'espace contrasté de l’Occident latin
Un cadre institutionnel solidement établi
La réaffirmation de la doctrine
Chapitre 2 - Renouveau du monde des réguliers et avènement des ordres mendiants
Ordres anciens et expériences nouvelles
Les ordres mendiants
L'insertion disputée des ordres mendiants
Chapitre 3 - Gouverner l’Église au XIIIe siècle
L'accroissement de la centralisation romaine
Papes, empereurs et rois : l’affrontement
L'affirmation face aux éléments extérieurs
Chapitre 4 - La papauté d’Avignon (1316-1377)
Le temps des papes français
Une machine administrative puissante et décriée
Avignon / Rome : quelle capitale ?
Chapitre 5 - L'encadrement pastoral
La paroisse et son « curé »
Les multiples voies de la transmission du message
La place des laïcs
Chapitre 6 - Le dynamisme des cultes et des dévotions
La quête du salut : une aventure collective
Les enjeux spirituels et identitaires des cultes
Pèlerinages, indulgences et jubilés
Chapitre 7 - Les voies de la perfection : spiritualité et sainteté

Les séductions persistantes de la voie pénitentielle
La conquête de l’intériorité
La nouvelle sainteté
Chapitre 8 - Église et vie sociale
Poursuite de l’œuvre d’assistance
La formation des esprits
Le « bon usage du monde »
Chapitre 9 - Le Grand Schisme, l’épisode conciliariste et la réaffirmation de la papauté
Le Grand Schisme (1378-1417)
L'épisode conciliariste
La nouvelle donne de la puissance pontificale
Chapitre 10 - L'Église face à ses adversaires et au monde extérieur
Anciennes et nouvelles hérésies
Extension de l’exclusion
L'Occident latin sur la défensive
Chapitre 11 - La réorganisation de la vie régulière et les mouvements de l’observance
Les ordres monastiques au défi du renouveau
La division interne des ordres mendiants
Aux marges de la réforme
Chapitre 12 - Les Églises d’Occident au tournant des XVe et XVIe siècles
Les Églises des royaumes de « vieille chrétienté »
Les Églises de l’Empire
Les Églises des royaumes de « chrétienté nouvelle »
Conclusion générale
Tableau récapitulatif des ordres religieux cités dans le volume1
Les papes et les conciles du XIIIe au XVe siècle
Bibliographie

Copyright © Armand Colin, 2009
978-2-200-24668-6

XIIIe-XVe siècle
Collection U
Histoire
Ouvrage publié sous la direction de Geneviève Bührer-Thierry
Au seuil de cet ouvrage, j’ai plaisir à exprimer ma vive reconnaissance aux promotions
successives d’étudiants qui m’ont permis de le mûrir et aux trois lecteurs qui m’ont aidée à lui
donner forme, Andrée Nordon-Gérard, Bénédicte Sère et Patrice Wahlen.
Je remercie également son éditrice, Marie Lécrivain, pour sa confiance,
son écoute attentive et ses suggestions.
Armand Colin
21, rue du Montparnasse
75006 Paris
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous
pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des
pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue
une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les courtes citations
justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées
(art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%