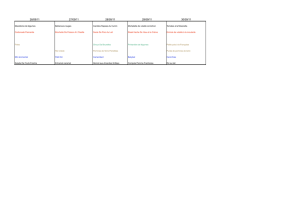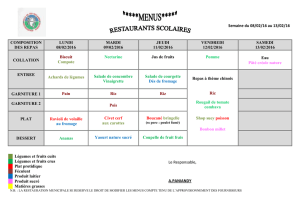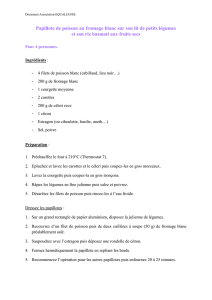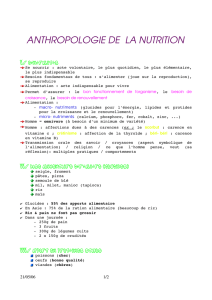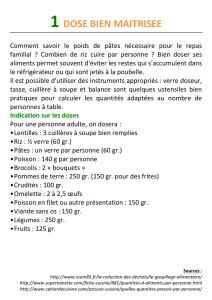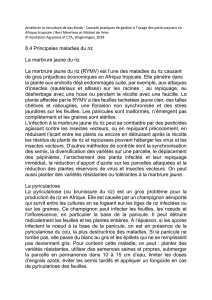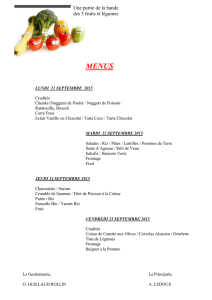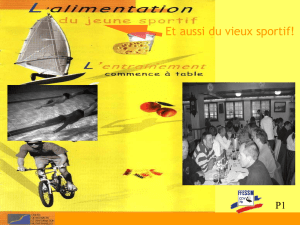Analyse économique de la filière riz au Mali

« Analyse économique de la filière Riz au Mali » Baris Perrin Zaslavsky Synthèse Version provisoire (02/11/04)
Les analyses formulées dans cette note ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l’AFD.
AFD
ANALYSE ECONOMIQUE DE LA FILIERE RIZ
AU MALI
NOTE DE SYNTHESE
(PREMIERES RECOMMANDATIONS)

« Analyse économique de la filière Riz au Mali » Version provisoire (02/11/04) 2
1. La filière rizicole au Mali fait face à un nouveau contexte qui nécessite de repenser
rapidement la politique du secteur. Parmi les faits symptomatiques récents, on notera :
• La montée en puissance des importations de riz, avec une nette accélération depuis
2002 ;
• La préférence des consommateurs pour le riz malien, notamment pour les variétés
produites sur la zone de l’Office du Niger (ON) ;
• La hausse des consommations de riz par tête, dans les villes, mais semble-t-il aussi
dans les campagnes ;
• Le maintien d’une forte irrégularité de la production de riz hors des périmètres
irrigués avec contrôle total de l’eau ;
• Le plafonnement des rendements à l’ON et une réduction de plus en plus nette de la
surface moyenne des exploitations.
Reprenons chacun de ces points, dont la conjonction change radicalement le paysage
classiquement présenté de la riziculture malienne.
2. La modération des importations (en moyenne de 50 000 tonnes dans les années 90,
soit 10% de la consommation) faisait du Mali une exception en Afrique de l’Ouest, où la
plupart des pays assurent plus de la moitié de leur consommation en riz par des
importations. Mais, depuis 2002, les importations tendent à tourner autour de 200 000
tonnes et les premières estimations pour 2004 sont loin d’inverser la tendance1. Plusieurs
facteurs expliquent ce dérapage : en premier, les mauvaises campagnes de mil/sorgho en
2002/03 et de riz pluvial en 2001/02 et 2002/03, ce qui a d’ailleurs incité le gouvernement à
réduire la TVA en septembre 2002 sur 40 000 tonnes de riz importé. Il faut aussi tenir
compte d‘importants flux de réexportation de riz vers le nord de la Côte d’Ivoire, qui serait de
l’ordre de 35 000 tonnes ces 2 dernières années2. Mais ces phénomènes conjoncturels
cachent en fait un décrochage de l’offre nationale de riz face à la forte augmentation
de la demande.
3. La montée des consommations de riz est spectaculaire. Sur le long terme, la
consommation a augmenté régulièrement de 8 % par an sous le double coup de la
croissance urbaine et des consommations par tête. Les résultats de la dernière enquête
budget/consommation (année) montrent que la consommation par tête à Bamako dépasse
les 60 kg/an, soit 10 kg de plus que lors de la précédente enquête. Le riz devient partout au
Mali un aliment de base et les importations progressent en milieu rural, notamment dans les
zones structurellement déficitaires en vivrier. Des projections réalisées selon des hypothèses
basses montrent que la demande de riz aura doublé en 2025. Dans 10 ans (2015), il faudra
produire 300 000 tonnes de riz supplémentaires pour satisfaire la demande - soit nettement
plus que la production actuelle de l’Office.
Le problème majeur n’est donc pas de trouver des débouchés ou d’hypothétiques
marchés à l’export, mais de développer l’offre nationale qui risque, si rien n’est fait
rapidement, d’être impuissante à satisfaire la demande nationale et de laisser la place
à des importations massives.
1 Selon les informations des gros importateurs, il y aurait de 150.000 à 180.000 tonnes importées en septembre 2004 et les
importations de l’année sont loin d’être achevées, compte tenu notamment des dégâts faits par les criquets et des anticipations
liées des importateurs (les dégâts récents des criquets au Mali semblent jusqu’ici concerner surtout des zones de pâturages, un
peu les céréales en sec, mais pas le paddy).
2 Notons que le riz exporté vers le Nord de la Côte d’Ivoire entre au Mali après paiement des droits de douanes et de la TVA. Il
est ensuite entreposé dans divers magasins, notamment à Sikasso, d’où des grossistes maliens l’acheminent jusqu’à la
frontière, où il est alors vendu à des commerçants ivoiriens de la zone Nord tenue par les « rebelles », qui prennent le relais.

« Analyse économique de la filière Riz au Mali » Version provisoire (02/11/04) 3
4. La préférence pour le riz malien est un phénomène nouveau. Jusqu’en 2000, le riz de
l’ON dit « DP » (pour décortiqueuse privée) se vendait moins cher sur le marché de Bamako
que le riz importé. En période de soudure son prix montait, mais il allait buter sur le prix du
riz importé, qui fixait un plafond en limitant la hausse des prix. Dans les années 90, le Mali a
su habilement utiliser les taxes sur les importations pour réguler le prix du riz local. Ces trois
dernières années la situation a changé radicalement. En 2001, le prix du riz local a traversé
le plafond du riz importé et, en 2002/2003, le riz local s’est vendu toute l’année plus cher que
le riz importé3. Le phénomène tient à la progression sur le marché de nouvelles variétés
produites à l’ON, comme la gambiaka ou l’adni, qui sont très appréciées par les
consommateurs4 (alors que riz importé assure aujourd’hui la moitié du marché de Bamako).
Cette préférence pour certains riz locaux est un atout pour la filière ON.
5. Si la production de l’ON croît de façon régulière depuis le début des années 90, par
contre les autres rizicultures sans maîtrise de l’eau (submersion plus ou moins contrôlée,
bas-fonds, décrue ou riz pluvial au sens strict…) restent sujettes à de fortes variations de
production, qui vont du simple au double d’une année sur l’autre. Malgré les incertitudes
statistiques sur ces rizicultures souvent mal connues, il semblerait que jusqu’à aujourd’hui
les gains de production ne se font que par une extension des surfaces. D’abord cultivées
pour l’autoconsommation, ces rizicultures n’alimentent que marginalement certaines villes de
l’intérieur. Hors d’un changement profond des conditions de production (notamment la
vulgarisation de nouvelles variétés moins sensibles aux aléas climatiques), leur contribution
à satisfaire la demande croissante des villes ne sera que limitée et surtout très irrégulière5.
6. Le plafonnement des rendements et la réduction de la surface des exploitations
montrent que les systèmes de production de l’Office ont aujourd’hui atteint leurs limites.
D’après les propres statistiques de l’Office6, les rendements moyens ont stagné depuis 2000
sans passer la barre des 6 T/ha (ce qui reste très honorable) et les rendements dans les
casiers aménagés tendent à baisser depuis 3 ans. De même, la surface cultivée en riz par
an et par famille est passée de 7 ha en 1980 à 4 ha en 1990 et serait maintenant à moins de
3 ha. Il est clair désormais qu’on ne peut espérer une augmentation de la production et
surtout des volumes commercialisés de l’ON que par une extension rapide des
surfaces aménagées qui permettra de relâcher la pression sur les terres.
7. En conclusion, face à une demande qui se développe rapidement, l’offre nationale ne
suit pas, faute d’une politique d’extension des surfaces irriguées sur la zone de l’Office du
Niger, qui dispose d’un potentiel irrigable par gravitation unique dans le contexte africain
(voire mondial) et permet de produire à des prix tout à fait compétitifs. En un mot, l’exception
malienne d’un pays autosuffisant tend à disparaître et, si la tendance actuelle se confirme, le
Mali risque très rapidement de se retrouver dans la situation de dépendance généralisée aux
importations alimentaires qui caractérise aujourd’hui la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest.
Ainsi, l’exportation du riz malien (thème récurrent depuis la période coloniale) n’est plus une
priorité ni une justification nécessaire pour l’extension des surfaces de l’ON. Ceci ne veut
pas dire qu’il ne faille pas exporter. Car le Mali peut conquérir certains marchés voisins avec
des riz de qualité. Mais, face au déficit croissant de l’offre sur le marché national, un
objectif d’exportation massive n’est plus d’actualité.
3 La situation était identique en octobre 2004, soit juste avant le démarrage de la récolte, ce qui tend à confirmer cette nouvelle
tendance.
4 La variété dite gambiaka, issue de la recherche, s’est généralisée sur la zone ON, où elle supplante désormais la BG, plus
productive, mais plus sensible à la virose et moins appréciée par le consommateur (écart moyen de 15 à 25 FCFA/kg).
5 La recherche vient de mettre au point de nouvelles variétés plus résistantes aux variations climatiques, ce qui permettrait de
relancer le riz « pluvial » et notamment le riz de bas-fonds où le potentiel est important (en particulier dans le sud du pays). Cela
suppose que ces innovations réduisent suffisamment les risques pour permettre le passage à l’intensif, alors que les variétés ne
sont que l’un des éléments du processus de production. Tout ceci mérite d’être suivi et analysé.
6 Actuellement remises en question pour leur « optimisme » (cf. notamment les enquêtes de Bélières et Bomans (2001).

« Analyse économique de la filière Riz au Mali » Version provisoire (02/11/04) 4
8. Dans ce nouveau contexte, on proposera une stratégie visant dans le temps 3
objectifs (classés par ordre de priorité, suivant leur opportunité et le coût pour les atteindre) :
Les 3 objectifs de la filière Riz
1) D’abord satisfaire l’accroissement de la demande nationale. Il y a déjà beaucoup de
chemin à faire : une demande de 275 000 T de riz supplémentaire en 2015, 430 000 T en
2020 et 640 000 T en 2025.
2) Ensuite, reconquérir les parts du marché malien tenues par le riz importé. En
espérant qu’une partie des 200 000 tonnes importées ces dernières années soit liée à la
conjoncture (mauvaises campagnes agricoles, réexportations vers la Côte d’Ivoire et la
Mauritanie), il resterait un marché de 100 000 à 150 000 T à reconquérir sur les
importations7. Encore faut-il que le riz malien soit compétitif sur son propre marché, en
termes de qualité et de prix, ce qui semble aujourd’hui le cas (sauf probablement pour la
région de Kayes) : préférence du consommateur pour certaines variétés de riz local,
résistance des prix à la concurrence du riz importé (…).
3) Enfin, exporter dans la sous-région. C’est naturellement un objectif plus ambitieux. Si le
potentiel existe avec la constitution du marché régional et les importations massives des
pays limitrophes8, la compétitivité du riz malien reste dépendante surtout de facteurs
exogènes (prix internationaux, coût du fret, TEC de l’UEMOA, cours du dollar …).
9. Combien d’hectares nouveaux doit-on aménager à l’ON ? Sans tenir compte des
contraintes de production9, des simulations s’appuyant sur des hypothèses raisonnables10
montrent que d’ici 2015, il faudrait aménager 120 000 hectares supplémentaires, dont
une moitié pour satisfaire la demande supplémentaire et l’autre pour reconquérir le
marché des importations. En 2025, soit dans 20 ans, il faudrait mettre en valeur 200 000
ha pour atteindre les mêmes objectifs. L’effort est énorme quand on sait qu’actuellement
l’ON ne couvre que 75 000 ha et que le rythme d’extension de ces dernières années n’a pas
dépassé les 5 000 ha par an (avec des aménagements relativement sommaires). Il paraît
donc essentiel de passer à la vitesse supérieure. Car les rendements moyens de l’ON
s’essoufflent. L’intensification de ces dix dernières années est avant tout liée à une
amélioration des techniques culturales (repiquage, semences, accroissement des doses
d’engrais), qui a déjà fait ses effets. Les gains de productivité seront donc désormais de
plus en plus difficiles et ils dépendront d’une amélioration des conditions de la production
dans son ensemble, ce qui demandera des efforts et des financements en continu sur le long
cours11. Une politique vigoureuse d’extension est la seule voie possible pour
débloquer la situation et tenter de satisfaire une demande en pleine croissance.
7 Il est clair que le marché du riz à l’import regroupe des types de riz et de marchés différents, avec (pour simplifier) : i) des riz
entiers haut de gamme d’origines diverses, correspondant à la petite frange de la population à haut revenu (probablement
moins de 3% des tonnages importés) ; ii) du riz à 15%/25% de brisures, qui représente actuellement les 2/3 du riz importé.
C’est de fait le concurrent direct des riz ON et le premier marché à conquérir ; iii) des brisures, dont des riz de qualité médiocre
surtout destinés aux consommateurs les plus pauvres, mais aussi des « brisures parfumées », très appréciées. Si
l’accroissement de la production de l’ON peut parvenir à satisfaire la demande en riz de qualité médiocre (écarts de triage,
sous-produits), le marché de la brisure parfumée semble plus difficile d’accès (de 15% à 20% des importations actuelles).
8 En se limitant aux marchés les plus proches, dans les régions voisines du Mali, le potentiel d’exportation est estimé à environ
1 million de tonnes (hors contraintes de qualité).
9 Notamment : i) le problème du disponible en terres irrigables, selon les spéculations retenues des modes de gestion de l’eau
(il est estimé à 250.000 ha par SOFRECO (2003), on serait donc loin du million d’hectares de Bélime) ; et ii) le coût des
aménagements (le coût des 70 000 premiers hectares aménagés est estimé entre 2 et 3 millions de FCFA/ha, mais il sera
vraisemblablement supérieur pour les hectares suivants).
10 Rendement de 5 T sur les extensions de l’ON, progression de 3 % par an de la riziculture sans contrôle total de l’eau.
11 Les conflits récents qu’a connu l’ON, avec en particulier l’éviction en 2004 de près de 5.000 exploitants (4 700 ?), ont
certainement de nombreuses causes à la fois structurelles et conjoncturelles (notamment le problème de la fiabilité du système
de suivi/évaluation). Mais ils signent à leur manière la fin d’un cycle et celle de la « sucess story » de ces 10 dernières années.

« Analyse économique de la filière Riz au Mali » Version provisoire (02/11/04) 5
10. Ce programme ambitieux ne peut être réalisé que si le riz malien est compétitif,
d’abord sur son propre marché, ensuite sur celui des pays voisins. Quel que soit la
méthode utilisée (coût en ressources internes, méthode des effets), les indicateurs sont en
général positifs 13. Pour les analyses les plus pessimistes (Trade Mali), le riz de l’Office serait
compétitif sur le marché national, sauf dans les régions de Kayes et Sikasso. Par contre, la
compétitivité ne serait pas assurée sur les marchés des pays voisins dans les conditions
actuelles. Toutefois, une remontée du dollar permettrait de conquérir les marchés de
Tambacounda (Sénégal oriental), Korhogo (Nord Côte d’Ivoire), Bobo Dioulasso (Burkina) et
Siguiri (Guinée) et un arrêt des subventions sur le marché mondial (c’est plus hypothétique)
permettrait au riz de l’ON de s’imposer sur l’ensemble des marchés de l’UEMOA.
11. Au-delà des analyses économiques complexes, souvent limitées par le manque de
données fiables et des biais méthodologiques, la filière riz de l’Office dispose d’un certain
nombre d’atouts, qui ne peuvent que favoriser à terme son développement, en particulier :
- Une bonne rentabilité financière pour la majorité des producteurs (sauf aléas
divers liés au service de l’eau, aux prédateurs ou aux conditions phytosanitaires). Cette
rentabilité témoigne des compétences techniques des producteurs, qui ont su depuis 15
ans accroître sensiblement leur productivité, s’adapter au marché, comme aux contraintes
de production et augmenter leurs revenus en se positionnant sur l’aval de la filière
(décorticage et commercialisation) ;
- Des faibles coûts de transformation, qui s’expliquent entre autres par la multiplication
des petites décortiqueuses et la concurrence qui s’en suit14. Ceci étant, du fait des
matériels utilisés, la qualité de la transformation reste en général très moyenne (en
termes de brisures, triage, propreté), d’où une certaine sous-valorisation du riz produit;
- Un système efficace de commercialisation (avec une diminution des marges sur le
long terme et un effet amortisseur sur les prix à la consommation).
Notons enfin que si la gambiaka se vend plus cher que le riz importé, c’est qu’il y a une
demande pour le riz local qui n’est pas aujourd’hui satisfaite. C’est un atout supplémentaire
pour la filière, en termes de marché.
12. Un autre élément doit être pris en considération : la forte augmentation depuis 6
mois des coûts du pétrole et du fret maritime, qui tend à renchérir le prix du riz import
et donc à accroître la compétitivité du riz malien. Ces hausses sont liées à de nombreux
facteurs (dont la forte croissance chinoise) et, même si on ne peut exclure qu’à terme les
cours baissent à nouveau, il est fort peu probable qu’on retombe à un pétrole à 20 US$ et à
un coût du fret similaire à celui du début des années 2000.
13. Enfin, et ceci est essentiel dans une stratégie de lutte contre la pauvreté et de
meilleure répartition des revenus, la filière riz ON crée près de 50 milliards de FCFA de
revenus, dont les 2/3 reviennent au milieu rural, tout en assurant quelques 3 milliards de
recettes à l’Etat. Limiter l’extension des aménagements sur la zone de l’Office, c’est courir le
risque d’importations massives, avec certes des recettes pour l’Etat, mais par contre une
stagnation des revenus ruraux et un coût en devises important (sans compter les risques liés
à l’évolution des cours du riz sur le marché international).
14. De façon générale, on soulignera que l’Office est un des rares lieux où on puisse
mener de front des politiques différenciées de lutte contre la pauvreté et de
croissance économique par une répartition mieux raisonnée des nouvelles terres.
12 Trade Mali 2004 ; Etude IRAM Compétitivité des filières UEMOA Faivre Dupaigre, Baris et Liagre 2004 ; MaliRiz 2002 (…).
13 Trade Mali 2004 ; Etude IRAM Compétitivité des filières UEMOA Faivre Dupaigre, Baris et Liagre 2004 ; MaliRiz 2002 (…).
14 Le prix actuel du décorticage en zone ON est en moyenne de 6 à 7 FCFA le kg de paddy, pour les petites décortiqueuses
privées, soit moins de 4% du coût de revient du riz
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%