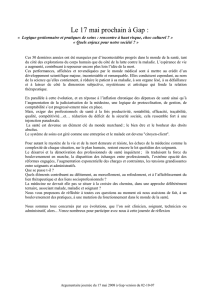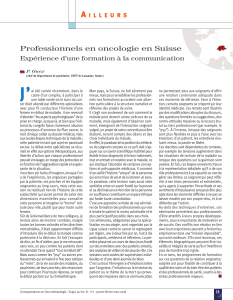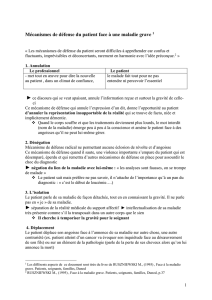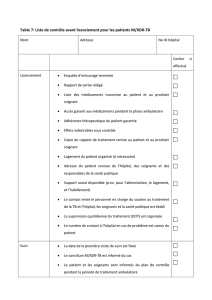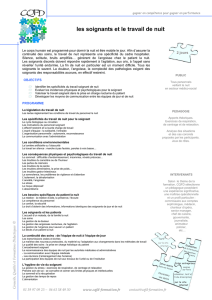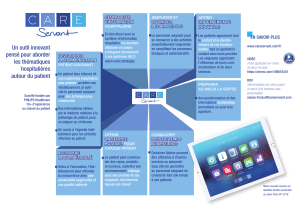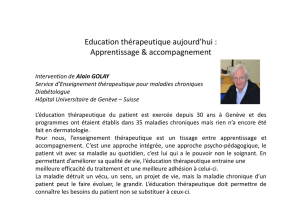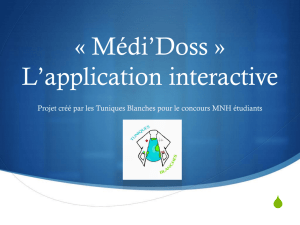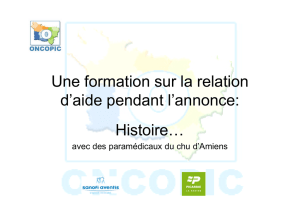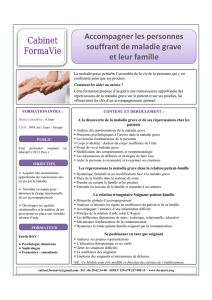Lire l`article complet

Quand le soignant est parent d’un malade
Les références sur ce sujet
sont rares, voire inexistantes.
Pourtant, des demandes d’aide à la
prise en charge de situations de fin
de vie et de stages dans le cadre de
la formation continue sont formu-
lées auprès des équipes mobiles en
soins palliatifs. La souffrance des
professionnels de santé et leur be-
soin d’aide et de soutien sont d’au-
tant plus forts dans le contexte de
fin de vie d’un proche.
Préalables
Lorsqu’un service sollicite une
unité de soins palliatifs pour la
prise en charge d’un patient fai-
sant partie de la famille d’un de
ses infirmiers, médecins ou aides-
soignants, cette information est
transmise systématiquement.
Cependant, la souffrance et les dif-
ficultés de ces soignants sont sou-
vent peu évoquées et ne semblent
pas aboutir à une réflexion spéci-
fique dans les services ou lors de
formations continues.
En effet, la prise en charge des
proches des soignants ne fait pas
l’objet, dans les services, d’une at-
tention ou d’un soutien particulier
et adapté. Ces soignants sont da-
vantage considérés comme des
partenaires de soins que comme
des membres à part entière d’une
famille.
Ils sont ainsi souvent “choisis” par
les équipes soignantes comme
les interlocuteurs privilégiés pour
l’annonce du diagnostic et la dif-
fusion des nouvelles concernant
le patient. Il n’est pas rare que
les équipes aillent jusqu’à inclure
le soignant proche du malade dans
la prise de décision thérapeutique.
D’où un certain malaise dans les
équipes soignantes qui ont en
charge un patient dont un membre
de la famille est un soignant.
Avantage ou inconvénient ?
Le savoir et les connaissances ac-
quis par la formation initiale et
l’expérience professionnelle sem-
blent être un atout pour le soi-
gnant dont un parent est hospita-
lisé. Il connaît le jargon médical,
souvent la pathologie et les exa-
mens prescrits. Il peut donc, de ce
fait, mieux appréhender la situa-
tion du malade, ce qui lui permet
d’agir en conséquence et de se pré-
parer parfois au pire. En revanche,
le fait d’être informé des résultats
des bilans et des examens aug-
mente certainement la souffrance
psychologique, puisqu’ils consti-
tuent aussi des indices de prédic-
tion par rapport au devenir de la
personne soignée. Cela donne une
dimension supérieure au drame
qu’il vit. Ainsi, une infirmière,
sœur d’un patient en fin de vie,
avait dit, à propos des informations
médicales qui lui étaient trans-
mises : «J’envie les autres membres
de ma famille d’être naïfs ! ».
L’exigence
d’une compétence
La plupart des soignants qui ont
un proche hospitalisé portent un
regard plus critique sur la qualité
des soins réalisés. Ils attendent da-
vantage de compétences et sont
souvent plus exigeants vis-à-vis
des différents acteurs de soins.
Toutefois, ils restent lucides. Ils
n’attendent pas de “miracle” de la
part des équipes soignantes mais
simplement le respect dû au pa-
tient et une bonne éthique du soin.
Les attentes du soignant sont donc
sensiblement différentes du ci-
toyen lambda. La recherche d’un
confort et d’une prise en charge
optimums sont sans doute ce qui
les incite à faire appel à l’équipe
mobile de soins palliatifs. La plu-
part du temps, ce sont eux qui sont
à l’origine de la demande. Ils pas-
sent par l’intermédiaire des ser-
vices ou contactent l’équipe mo-
bile directement, pour la prise
en charge du malade ou pour
eux-mêmes. Cela signifie souvent,
pour eux, la garantie de soins
adaptés à l’état du patient, une
prise en charge de la douleur et
aussi la possibilité d’être rassurés.
Sur le terrain
La fille de Monsieur D., infirmière,
avait confié son inquiétude aux
soignants en soins palliatifs quant
aux capacités du médecin traitant
à prendre en charge la douleur
de son père et avait demandé
des informations concernant les
différentes aides possibles aux-
quelles elle pourrait avoir recours
à domicile.
Pour optimiser le confort du pa-
rent hospitalisé, les soignants d’un
patient qui leur est proche vont
parfois vers les équipes afin de dis-
cuter avec elles des thérapeu-
tiques. Telle la sœur d’un patient,
infirmière, qui avait confié que,
devant son frère mal soulagé, elle
avait dû faire des suggestions à
l’équipe soignante.
Il arrive que certains soignants im-
posent leurs propres prescriptions
à l’équipe, situation, il est vrai, as-
sez rare. Mais ce fut le cas de Mon-
sieur C., qui était en fin de vie et
hospitalisé. L’un de ses fils, méde-
cin, avait fait pression sur le corps
médical pour qu’il fasse en sorte
que la fin de vie de son père soit
«la plus paisible possible ». Bien
que son père ne fût pas algique, il
avait souhaité, entre autres, que
l’on augmente la posologie
La prise en compte de la souffrance des soignants est une
préoccupation des acteurs en soins palliatifs. La recon-
naissance et la prise en charge de ce mal-être peuvent leur
être bénéfiques. Un problème reste pourtant méconnu :
celui d’être à la fois soignant et parent d’un malade.
Problématique
5
Professions Santé Infirmier Infirmière - No32 - décembre 2001
●●●

7
Professions Santé Infirmier Infirmière - No32 - décembre 2001
du patch de fentanyl et
qu’on introduise du clorazépate
à forte dose dans le traitement.
Les médecins n’ayant pas accédé
à ses demandes, il avait alors pro-
féré des menaces puis modifié et
augmenté lui-même le débit des
seringues autopulsées à l’insu des
soignants.
La relation entre le soignant
et le malade
Les différents récits et témoignages
recueillis auprès de certains soi-
gnants confrontés à la maladie
grave d’un parent ont permis de
constater quelques faits. On re-
marque une implication impor-
tante de leur part en tant que
proche et en tant que soignant dans
cette situation. Pour pouvoir ac-
compagner un membre de leur fa-
mille dans sa maladie et pour le soi-
gner, les soignants n’hésitent pas à
mettre entre parenthèses leur vie
privée et à mettre à profit leurs
connaissances professionnelles. Par
exemple, ils l’accompagnent à ses
consultations et ses examens, ils or-
ganisent ses déplacements, utilisent
leurs relations professionnelles
pour lui obtenir un rendez-vous ou
simplement pour être conseillés.
On constate que, pour eux, faire bé-
néficier le proche de soins de qua-
lité et des avancées médicales tout
en le protégeant est une priorité.
Toutefois, même si ces intentions
sont louables, elles restent discu-
tables car elles peuvent conduire le
proche à dépasser ses compétences
à la fois en tant que membre de la
famille et en tant que professionnel
de santé. Par exemple, en s’inves-
tissant d’un pouvoir décisionnel ou
en s’octroyant un rôle qui n’est pas
le sien. Ainsi, la sœur d’un patient
hospitalisé, infirmière, avait an-
noncé à son frère son diagnostic de
tumeur maligne parce que, disait-
elle, «il lui avait demandé ». Une
autre infirmière devait accompa-
gner en consultation de cancérolo-
gie sa grand-mère, hospitalisée,
mais elle ne savait comment lui en
expliquer la raison. Elle lui avait dit
précédemment qu’elle souffrait
d’un kyste sur l’ovaire, alors qu’il
s’agissait d’un cancer. On constate
chez ces soignants une souffrance
psychologique importante lors-
qu’il y a une situation de “non-
dit” entre le patient, sa famille et
l’équipe soignante.
La prise en charge de la famille de
Monsieur L. en témoigne. Celui-ci,
aide-soignant à la retraite, était hos-
pitalisé. Son épouse, aide-soignante
elle aussi, avait expressément de-
mandé aux médecins de ne pas
mettre au courant son mari de la
nature et de la gravité de son état.
Lors de l’entretien avec l’épouse et
deux de ses filles, nous avons pu
mesurer les conséquences de cette
décision, notamment sur l’une
d’entre elles. Celle-ci, aide-soi-
gnante, disait : «Je suis investie par
mon père d’une confiance particulière
compte tenu de ma profession. Je me
sens responsable de lui ! ». Elle disait,
vis-à-vis du mensonge : «Je me sens
encore plus responsable que les autres,
c’est très lourd... On est responsable
de ce qu’on ne dit pas ! ».
Les soignants témoignent souvent
de la difficulté d’être investis par le
parent malade d’une confiance par-
ticulière à cause de la fonction pro-
fessionnelle qu’ils exercent. Cela
peut expliquer en partie la rai-
son pour laquelle ils sont si impli-
qués dans leur accompagnement
et dans leurs soins. On observe
d’ailleurs que, souvent, de manière
consciente ou inconsciente, ils mo-
nopolisent la prise en charge du
proche et hésitent parfois à confier
la réalisation des soins à d’autres
personnes qu’eux-mêmes.
Un référent familial
C’est bien souvent le soignant,
missionné par sa famille, qui
prend des nouvelles du parent
hospitalisé, directement auprès
de l’équipe ou par téléphone.
Souvent, la famille le sollicite sous
prétexte que “lui, c’est son mé-
tier”, “qu’il comprendra mieux
qu’eux ! ”. Après s’être informé de
l’état du proche, il retransmet les
informations au reste de la famille
en s’efforçant de les rendre claires,
franches, tout en ménageant les
proches et en restant neutre. Cela
n’est pas toujours facile !
Dès lors, commencent les ques-
tions de l’entourage auxquelles il
lui faut faire face en restant à la
fois rassurant, “soutenant”, mais
tranché. Il arrive que les proches
omettent que le soignant fait aussi
partie de la famille et qu’il peut
être affecté par la situation. Ce cas
de figure est un peu caricatural,
mais réel.
Pire encore, la situation dans la-
quelle la famille n’hésite pas à
mêler le soignant à la prise de dé-
cision thérapeutique ou à l’an-
nonce du diagnostic !
Un référent
de l’équipe soignante
Qui n’a jamais entendu lors des
transmissions en équipe : «Mon-
sieur V., hospitalisé depuis hier
chambre no18, a une fille infır-
mière ». Puis, quelqu’un demande :
«Ah ? Elle travaille dans quel ser-
vice ? ». Curieusement, on observe
que ce type d’informations figure
parmi celles qui sont les mieux et
les plus vite transmises dans une
équipe. Il faut dire que ce fait n’est
pas anodin puisqu’il entre souvent
en ligne de compte dans le dérou-
lement de l’hospitalisation du pa-
tient, dans sa relation avec l’équipe
et entre l’équipe et le soignant
proche du malade.
Pour l’équipe soignante, savoir
que l’un de ses collègues a un
parent hospitalisé dans son service
entraîne deux sentiments : elle se
sent solidaire de son collègue mais,
en même temps, elle ressent une
certaine méfiance vis-à-vis de lui.
Après la première étape, que nous
appellerons étape “de la trans-
mission de l’information en équipe”,
il y a celle de “l’apprivoisement
mutuel” au cours de laquelle
l’équipe soignante et le soignant
font connaissance. Cette période
est nécessaire aux deux parties, car
elle permet à chacun de voir s’il
Problématique
●●●

8Professions Santé Infirmier Infirmière - No32 - décembre 2001
peut trouver un allié en l’autre ou
un partenaire, s’ils sont sur la
même “longueur d’onde”, ce qui
retentira sur l’aisance des médecins
et des soignants (surtout les infir-
mières) dans leur pratique quoti-
dienne au lit du patient. La crainte
du jugement pèse souvent sur l’in-
firmière, lorsqu’elle réalise un soin
au patient en présence du proche
qu’elle connaît ou qu’elle ne
connaît pas, ce qui peut la “stres-
ser”, voire la déstabiliser.
Cette période-test, durant laquelle
les deux parties s’observent, est ca-
ractérisée par le fait que l’équipe
soignante cherche à savoir ce que
le soignant a compris de l’état de
son proche ainsi que de ses at-
tentes. Elle attend également de lui,
de manière informelle, “son ap-
probation” par rapport à la prise en
charge réalisée et aux objectifs thé-
rapeutiques, afin de déterminer
son champ d’action. De son côté,
le soignant concerné observe à dis-
tance la qualité des soins et la com-
pétence des autres soignants, tout
en faisant preuve de discrétion,
dans le but de voir quelle confiance
il peut accorder à l’équipe (s’il ne
la connaît pas) et s’il peut la consi-
dérer comme une équipe “relais”.
Au-delà de la méfiance, il y a, pour
l’équipe, des bénéfices secondaires
à avoir un soignant pour interlo-
cuteur dans la prise en charge d’un
patient. Tout d’abord, il y a le gain
de temps : l’entretien est plus
court, les informations sont plus
condensées grâce à l’utilisation de
mots-clés qui sont des termes mé-
dicaux ou techniques. L’emploi de
ces termes est avant tout bénéfique
pour les médecins, puis pour le
soignant. Ils ont l’avantage d’être
accompagnés de toute une sym-
bolique qui permet à un soignant
de s’imaginer les symptômes qui
y sont associés, le diagnostic, les
traitements qui en découlent et
parfois le pronostic. Autrement
dit, ces termes se suffisent à eux-
mêmes pour donner une idée ra-
pide et précise de l’état du patient.
L’autre avantage, en l’occurrence,
pour le médecin, est de pouvoir
prendre du recul lors de l’annonce
d’une mauvaise nouvelle. Car ces
termes peuvent être un paravent
pour ses propres émotions et per-
mettre au médecin de se préserver
davantage des difficultés de faire
une telle annonce. Le risque est
alors que ces mots soient trop ré-
ducteurs par rapport à la gravité
de la situation, qu’ils réduisent le
patient à sa maladie et que le mé-
decin prenne moins de précau-
tions lors de l’annonce.
A l’opposé, on peut rencontrer des
équipes soignantes très investies
dans leur relation avec le soignant
proche du malade, voire trop in-
vesties, surtout quand elles le
connaissent déjà.
On constate que, souvent, les soi-
gnants sont dans une attitude de
maîtrise de leurs émotions. Ils
sont soucieux de ne pas montrer
leurs affects à leur entourage et à
leur parent malade. Aussi est-ce
fréquemment vers leurs collègues
qu’ils se tournent pour trouver
une oreille attentive à leurs diffi-
cultés et à leurs souffrances, sou-
vent inaudibles par leurs proches.
Les soignants font-ils vraiment
figure de “parents pauvres” en ma-
tière d’accompagnement lorsqu’un
de leur proche est hospitalisé ? On
peut raisonnablement penser
qu’ils sont davantage prémunis
que les autres accompagnants
contre la souffrance, le stress et les
situations de fin de vie. Mais il
n’en est rien. Leur souffrance
semble même être plus impor-
tante du fait, d’abord, de leur
connaissance de la pathologie, de
la gravité de la situation et du pro-
nostic, ensuite de la carence en
soutien de la part des soignants
par sous-évaluation, sinon négli-
gence inconsciente de cette souf-
france. Il s’agit là d’une véritable
problématique qui mérite d’être
étudiée afin d’y apporter une ré-
ponse adaptée.
Sylvie Van Daele
Équipe mobile de soins palliatifs,
CHRU de Lille
Problématique
Quelques pistes
de réflexion
•Quelle est la part d’objecti-
vité des équipes dans une telle
situation ?
•Jusqu’à quel point le soi-
gnant peut-il interférer dans la
prise en charge d’un de ses
proches ?
•Le fait que le soignant et
l’équipe se connaissent ne peut-
il pas entraîner des effets pervers
prévisibles ?
•Qu’est-ce que les équipes at-
tendent du soignant ?
•Sont-elles en droit d’en at-
tendre quelque chose ?
•De quel droit peuvent-elles le
faire passer du statut de témoin
à celui de décideur pour leur
proche ?
•La famille, les soignants peu-
vent-ils lui demander, lorsqu’il
vient visiter un parent ma-
lade, de laisser ses affects “au
vestiaire” ?
•Pourquoi sa profession par-
le-t-elle plus pour le soignant
que sa situation de parent en
souffrance ?
•Peut-on lui demander de ne
pas s’impliquer en tant que soi-
gnant dans sa relation avec le
proche ? Est-ce rationnel ?
•Existe-t-il une attitude idéale ?
•L’investissement important des
soignants vis-à-vis du malade
ne correspond-il pas à un sou-
hait de maîtrise de la situa-
tion, dont la clarté, trop cruelle,
apportée par leur expérience
professionnelle et personnelle,
vient étayer leur souffrance ?
•Leur seule échappatoire ne
réside-t-elle pas dans l’organi-
sation autour de la maladie et
de l’hospitalisation ?
•Le soignant soutient le parent
malade et son entourage, mais
qui le soutient, lui ?
•Être le proche d’un parent
malade et soignant à la fois,
est-ce un avantage ou un incon-
vénient ?
1
/
3
100%