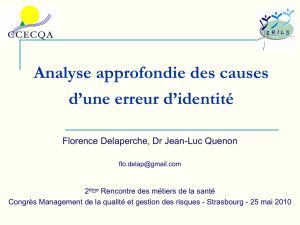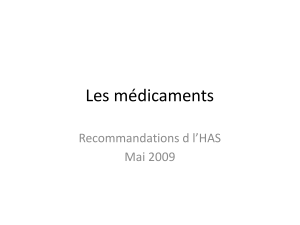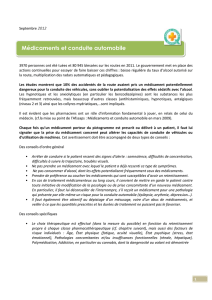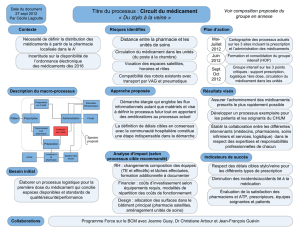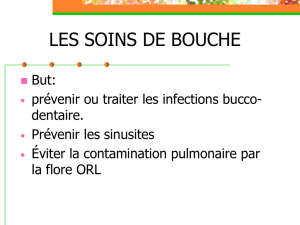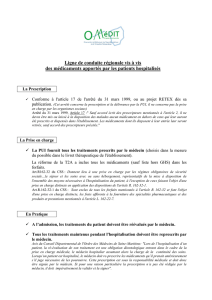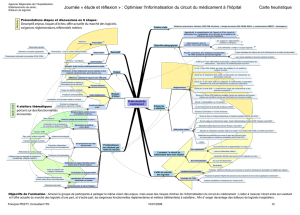Circuit du médicament et accréditation : enquête de pratiques

ARTICLE ORIGINAL
Circuit du médicament et accréditation : enquête de pratiques
“Drug-use-system”and accreditation: a clinical practice survey
S. LETHUILLIER
1
*, R. DELPLANQUE
1
, G. DUMESNIL
2
, J. LACROIX
1
1
Service pharmacie, Groupe hospitalier du Havre, Le Havre
2
Service qualité, Groupe hospitalier du Havre, Le Havre
Résumé
.Suite aux conclusions du rapport d’accréditation, le groupe hospitalier du Havre s’est fixé comme une des
priorités d’améliorer la qualité du circuit du médicament. L’objectif est de déterminer les points faibles de ce circuit afin
d’en déduire les actions préventives et hiérarchiser les actions essentielles. Une enquête de pratiques a été réalisée sur
l’ensemble de l’hôpital du Havre (2 085 lits) grâce à un questionnaire composé de 272 questions sur la prescription, la
dispensation et l’administration. La population cible est composée des médecins et des cadres infirmiers (réponse
collective avec les équipes soignantes), soit 373 questionnaires envoyés. Des échelles de fréquence et de gravité ont été
définies par un comité de pilotage et cotées de1à4.Seules les réponses à risque élevé pour le patient (criticité
supérieure ou égale à 3) sont présentées. Cent trente-sept questionnaires ont été exploités (36,7 %). Les principaux
dysfonctionnements au niveau de la prescription sont la rédaction de l’ordonnance par l’infirmière (34 % des
réponses), les retranscriptions (56 % répondent qu’ilyaaumoins deux retranscriptions), l’absence de validation
médicale des propositions pharmaceutiques d’équivalence thérapeutique (28 %). Les problèmes essentiels de la
dispensation et du stockage sont l’insuffisance des informations fournies pour la préparation et l’administration (44 %)
et la mauvaise lisibilité des mentions légales des formes médicamenteuses stockées dans les unités de soins (14 %). Au
niveau de l’administration, la faisabilité de la modification de la forme galénique est rarement validée (selon 25 % des
réponses) et l’enregistrement de l’administration n’est pas effective selon 35 % des réponses. Les thèmes de travail
retenus et traités successivement sont la rédaction de recommandations concernant la prescription et l’administration
des médicaments, les retranscriptions, la diffusion des informations données par la pharmacie, la gestion des stocks
dans les unités de soins.
Mots clés :
circuit du médicament, enquête de pratique, accréditation, criticité, action préventive
Abstract
.Since the accreditation report, the quality assurance of the drug-use-system of our hospital became a first
priority. The aim of such a process is to identify the weaknesses of the system in order to establish and prioritize
corrective actions. A clinical practice survey has been performed at the hospital of Le Havre (2085 beds) with a tested
questionnaire of 272 questions. The targeted population was composed with physicians and night and day nurse staff
(373 people). Frequency and gravity scales from 1 to 4 were defined by a professional committee. Only answers with
high-risk elements for patients (more or equal to 3) are presented here. One hundred (and) thirty-seven relevant
questionnaires (36.7%) were used. The main dysfunctions in prescriptions were: editing prescription by the nurse
(34%), drugs written twice (56%), lack of medical validation of suggested drug substitutions (16%). The two main
dispense and storage problems derived from a lack of information on how to prepare and administrate drug (44%)
and a mis-understanding of the Summary of Product Characteristics of drugs stored in care units (14%). Drug
administration problems were the lack of validation for the feasibility of oral form’s modification (25%) and
unregistered administrations (35%). Some guidelines have thus being elaborated on: 1) recommendations on drugs
prescription and administration, 2) prescriptions rewriting, 3) information on pharmacy department advices, and 4)
stock management in care units.
Key words:
drug-use-system, clinical practice survey, accreditation, criticality, preventive action
Le groupe hospitalier du Havre (GHH) a reçu la visite
du collège d’accréditation en juin 2002. La sécurisa-
tion du circuit du médicament a été définie comme
une priorité par les experts.
Dans le cadre d’une démarche qualité institutionnelle, le
Comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles
a souhaité la mise en place d’un groupe de travail
multidisciplinaire. Les objectifs sont l’optimisation de la
prise en charge thérapeutique des patients, la sécurisation
du circuit du médicament en réduisant les erreurs évitables
à chaque étape, et l’amélioration de l’efficacité et de
*Correspondance et tirés à part : S. Lethuillier
ORIGINAL ARTICLE
J Pharm Clin 2005 ; 24 (1) : 17-22
J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005 17
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

l’organisation de ce circuit, tant au niveau des unités de
soins que dans les pharmacies à usage intérieur.
Le premier travail de ce groupe consiste, grâce à une
enquête de pratiques, à établir un état des lieux, à
identifier les risques d’erreur aux différentes étapes (pres-
cription, dispensation, administration, surveillance du trai-
tement), à définir les axes d’amélioration et les actions
prioritaires.
Matériels et méthodes
L’étude repose sur une enquête de pratiques descriptives
[1, 2], transversale, conduite sur l’ensemble du Groupe
hospitalier du Havre. Cet hôpital est constitué de 2 085
lits sur 7 sites. Les trois activités principales sont la méde-
cine chirurgie obstétrique (MCO), la psychiatrie et la
gériatrie.
Un groupe de travail multidisciplinaire représentatif de
l’ensemble des acteurs concernés par le circuit du médica-
ment a été constitué. Il est composé de 13 personnes : 4
médecins, 3 pharmaciens, 4 cadres de santé infirmier, 1
cadre de santé préparateur, 1 ingénieur qualité. Ce
groupe a élaboré un questionnaire sur le circuit du médi-
cament à partir des référentiels réglementaires [3-10].
Le questionnaire a été testé par cinq équipes de soins, puis
validé après quelques modifications (Annexe 1). Il est
composé de 272 questions ouvertes et fermées portant sur
l’identification de la personne concernée, la prescription,
la dispensation et l’administration des médicaments (hors
médicaments dérivés du sang humain et hors stupéfiants).
La population cible comprend l’ensemble des prescrip-
teurs, les cadres infirmiers chargés de remplir deux ques-
tionnaires (un avec l’équipe de jour et un avec l’équipe de
nuit). Avant l’envoi des questionnaires, des réunions d’in-
formation ont été effectuées auprès des médecins et des
cadres de santé. Le délai de réponse a été de 50 jours. Un
message intranet a également été diffusé en expliquant les
objectifs de cette enquête de pratiques.
À réception des questionnaires, les données ont été enre-
gistrées sur un logiciel de statistiques Sphinx
®
. Le but étant
de déterminer les points critiques, les données ont été
analysées selon la méthode d’analyse des modes de
défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)
[11-16]. Cette méthode utilise une cotation pour la fré-
quence de la défaillance (F), une cotation pour la gravité
des effets de la défaillance (G) et une cotation pour la non
détection des défaillances (ND). La cotation de la non
détection des défaillances a été jugée non pertinente
puisqu’il s’agissait d’une enquête de pratiques basée sur
un questionnaire, et non une étude d’observation. Le
produit de la fréquence et de la gravité permet de calculer
la criticité de la défaillance (C).
L’indice de fréquence a été calculé à partir des pourcenta-
ges obtenus selon le nombre de réponses positives au
dysfonctionnement cité par rapport au nombre total de
réponses à l’item. L’indice de gravité de chaque dysfonc-
tionnement a été obtenu par les moyennes des gravités
octroyées par chaque membre du groupe de travail. Les
échelles de cotation pour la fréquence et la gravité sont
présentées dans le tableau 1. Seuls les dysfonctionne-
ments critiques (criticité supérieure ou égale à 3) sont
exposés dans le tableau 2. À partir des dysfonctionne-
ments retenus, un plan d’actions préventives a été éla-
boré, en prenant en compte leur faisabilité par rapport à
nos moyens. Plus la criticité est élevée, plus le traitement
du dysfonctionnement sera traité en priorité.
Dans ce type d’analyse (AMDEC), un dysfonctionnement
qui engage le pronostic vital, mais qui est exceptionnel,
est traité avec une priorité moins importante qu’un dys-
fonctionnement fréquent et présentant peu de risque pour
les patients. Le groupe d’experts a pondéré les résultats
obtenus pour assurer une pertinence à l’analyse.
Résultats
Sur 373 exemplaires envoyés, 137 ont été retournés et
exploités, soit un taux de réponse de 36,7 %. L’encadre-
ment infirmier a répondu majoritairement (67,1 % :
92/137). Parmi les 137 exemplaires exploités, 66 %
étaient issus du personnel du secteur « médecine chirurgie
obstétrique » (MCO), 20 % du secteur psychiatrie, 12 %
du secteur gériatrie, soins de suite et rééducation et 2 %
étant d’origine inconnue. Par rapport au nombre de
questionnaires envoyés dans chaque filière, le taux de
réponse est de 36 % pour la MCO, 42 % pour la géria-
trie, soins de suite et rééducation, 37,5 % pour la psychia-
trie.
Pour les items avec indice de criticité élevée (supérieur ou
égal à 3), la cotation sur l’échelle de gravité et de
fréquence est présentée dans le tableau 2.
Prescription
La prescription est souvent et/ou toujours rédigée par le
personnel infirmier dans 34 % des cas. Il existe plusieurs
documents de prescription pour un même patient selon
24 % des réponses. La prescription est écrite sans la
présence de l’infirmière et sans informer l’infirmière selon
13 % des réponses. Il existe plusieurs retranscriptions de
la prescription (2 et plus) pour un même traitement selon
56 % des réponses. Des prescriptions sont faites orale-
ment pendant la nuit et les périodes de garde ou astreinte
(48 %), dont pour 27 % en l’absence de protocoles de
service. Selon 29 % des réponses, il n’existe pas de
protocoles pour effectuer des soins urgents dans le ser-
vice.
Si un produit équivalent au médicament prescrit est pro-
posé par la pharmacie, la prescription n’est pas modifiée
dans 28 % des réponses. Les médicaments des patients
entrant à l’hôpital sont laissés systématiquement, c’est-à-
dire sans accord écrit du médecin selon 11 % des répon-
ses. Concernant l’information nécessaire à la prescrip-
tion, 32 % ne savent pas si la liste des médicaments
référencés au GHH ainsi que les recommandations de la
commission des médicaments et des dispositifs médicaux
Tableau 1.Échelle de cotation pour la fréquence et la gravité
des défaillances.
Survenue de la
défaillance Coefficient
de fréquence Risque pour
le patient Coefficient
de gravité
0 à 01 % 1 Léger 1
10 à 03 % 2 Moyen 2
30 à 60 % 3 Sérieux 3
60 à 100 % 4 Vital 4
S. Lethuillier, et al.
J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005
18
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

stériles sont disponibles dans le service ; 24 % répondent
ne jamais ou rarement informer le patient lors d’une
modification du traitement médicamenteux.
Dispensation
Soixante-sept pour cent des réponses mentionnent des
difficultés à effectuer leur commande informatiquement,
d’où des ruptures dans l’approvisionnement des médica-
ments des services. Au niveau des services de soins, la
réception de la commande de médicament n’est pas
effectuée immédiatement, dans 22 % des cas. Cela pose
les risques de rupture de la chaîne du froid pour les
produits à conserver entre + 2 °C et + 8 °C. La proposi-
tion d’équivalence médicamenteuse effectuée par la phar-
macie est rarement montrée au médecin, selon 16 % des
réponses. Les propositions d’équivalence médicamen-
teuse ne sont pas toujours adaptées aux particularités du
patient (présentation galénique, hypersensibilité à un prin-
cipe actif ou à un excipient). L’entretien et la mise à jour du
contenu de l’armoire et du réfrigérateur ainsi que le
contrôle de la température du réfrigérateur ne sont pas
satisfaisants ou non effectués dans 24 % des cas. Le
rangement des médicaments n’est pas satisfaisant dans
25 % des cas : présence de produits non médicamenteux
dans les armoires mobiles et les réfrigérateurs ; pas de
suivi de la température du réfrigérateur. Selon 14 % des
réponses, la lisibilité des médicaments stockés au niveau
de l’unité de soins est absente : pas de date de péremp-
tion, pas de numéro de lot, voire pas de dosage dans de
rares cas (1,5 %). Dans 64 % des cas, l’armoire à médi-
caments n’est pas fermée à clé, et il n’existe pas de
procédure d’accès. Il n’existe pas de dotation, selon 68 %
des réponses. Les médicaments périmés ne sont pas
toujours retournés à la pharmacie (8,8 %). Ces dysfonc-
tionnements peuvent engendrer des ruptures de traitement
ou l’administration de traitement inefficace.
Administration
Dans 25 % des cas, l’administration des médicaments est
faite par les aide-soignants ; 22 % de l’encadrement
infirmier répond que le personnel infirmier administre des
médicaments non prescrits. Selon 17 % des réponses,
l’administration n’est pas toujours effectuée immédiate-
ment après la préparation. Les comprimés sont écrasés,
rarement après confirmation de la faisabilité (25 %).
Cette pratique est effectuée pour faciliter l’administration
mais peut modifier la biodisponibilité du principe actif ou
le détruire ; 14 % affirment que la date de péremption est
rarement ou jamais vérifiée avant l’administration. Dans
35 % des cas, il n’existe pas ou rarement d’enregistre-
Tableau 2.Résultats de l’analyse pour chaque dysfonctionnement critique.
Dysfonctionnements identifiés Indice de fréquence (F) Indice de gravité (G) Indice de criticité
1à4 1à4 (FXG=C),1à16
Prescription
Rédaction de la prescription par l’IDE 3 3 9
Documents de prescription multiples 2 3 6
Absence d’information à l’IDE lors d’une modification de traitement 2 3 6
Retranscriptions 3 3 9
Prescriptions orales 3 3 9
Absence de protocoles de soins urgents 2 4 8
Prescription non réadaptée avec le référencement de l’hôpital 2 3 6
Pas d’accord écrit pour la poursuite du traitement d’un patient entrant 2 3 6
Méconnaissance des informations sur le médicament 3 2 6
Absence d’information du patient lors d’une modification de traitement 2 3 6
Dispensation
Difficulté d’approvisionnement 4 1 4
Réception non immédiate des médicaments 2 2 4
Proposition d’équivalence médicamenteuse non montrée au médecin 2 3 6
Rangement insatisfaisant du stock médicament 3 2 6
Absence de lisibilité des médicaments stockés 2 3 6
Stock médicament non sous clé 3 1 3
Absence de dotation 3 1 3
Circuit des périmés non adéquat 1 3 3
Administration
Administration par des aide-soignantes 2 2 4
Administration de médicaments non prescrits 2 3 6
Administration non immédiate après la préparation 2 3 6
Retranscription de la validation de l’administration 3 3 9
Modification de formes galéniques orales sans accord de faisabilité 2 3 6
Date de péremption non vérifiée avant l’administration 2 3 6
Absence d’enregistrement de l’administration 2 2 4
Absence d’information pour l’administration 3 2 6
Méconnaissance de la pharmacovigilance 2 2 4
Circuit du médicament et accréditation
J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005 19
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

ment de la validation de l’administration comportant les
différentes mentions légales. Selon 42 % des réponses, il
existe un document intermédiaire pour la validation de
l’administration. L’ensemble de ces dysfonctionnements
est la source d’erreur d’administration et d’événements
indésirables (cotation de la gravité à 3 pour la plupart des
items). Concernant la diffusion de l’information sur la
préparation et l’administration des médicaments, 44 %
répondent qu’elle n’est jamais ou rarement faite ; 18 % ne
connaissent pas la disponibilité de la fiche de pharmaco-
vigilance.
Discussion
Le taux de réponse est assez faible (36,7 %). Ceci s’expli-
que par le temps restreint donné pour le retour des
questionnaires, en période de vacances et de week-end
prolongés, et par la distribution d’une autre enquête sur
cette même période. De plus, certaines équipes se sont
regroupées pour répondre sur un même questionnaire. Le
taux de réponse s’en trouve affaibli mais la représentati-
vité en est d’autant plus renforcée.
La répartition des réponses est équitable entre les différen-
tes filières et les différents acteurs du circuit du médica-
ment.
Les risques induits par les dysfonctionnements observés
sont :
– une erreur de médication : il s’agit, en pratique, d’une
erreur de médicament, d’un oubli de médicament, d’une
administration de médicament non prescrit, d’une erreur
de dosage, de posologie, de rythme ou de voie d’admi-
nistration. Le taux d’erreurs relatives au médicament, avec
une distribution sans analyse pharmaceutique, serait de
l’ordre de 25 % à 45 % des doses administrées, selon les
études épidémiologiques [17, 18]. Ce risque existe avec
les dysfonctionnements observés au niveau de la prescrip-
tion. Les supports de prescription sont différents selon les
unités de soins (dossier médical, ordonnance papier nu-
mérotée, ordonnance papier à usage hospitalier, support
informatique). La retranscription de la prescription s’effec-
tue sur le dossier infirmier, la planification horaire murale,
les feuilles de température et les ordonnances fournies à la
pharmacie en partie. En attendant la solution attendue de
la prescription informatisée généralisée, il est indispensa-
ble de travailler sur le support de prescription ;
– une erreur de prescription : selon le décret du 2 décem-
bre 1994 [19] et l’arrêté du 31 mars 1999 [7], la
prescription est effectué par un médecin. Quand l’infir-
mière écrit une prescription orale d’un médecin, elle
prend le risque de se tromper dans la rédaction. Sa
responsabilité peut être mise en cause pour avoir effectué
un acte médical ;
– une prise en charge du patient inadéquate due à
l’absence de protocoles écrits ou à l’absence de médica-
ments nécessaires ou conservés dans de bonnes condi-
tions ;
– une observance médiocre liée au manque d’adhésion
du patient au traitement.
Actions préventives proposées
Les actions préventives proposées ont été élaborées en
prenant en compte la faisabilité qui permet de définir les
actions réalisables à moyen terme (1 an) et à long terme
(3 ans). Les actions proposées par le groupe de travail
sont regroupées dans le tableau 3.
Les recommandations pour la prescription comprendront
les modalités de prescription lors de l’arrivée d’un patient
à l’hôpital et les modalités de prescription d’un patient
hospitalisé (les personnes habilitées à prescrire, le mo-
ment de la prescription, l’accès au livret du médicament,
le support de prescription, les items de prescription).
L’imprécision des prescriptions manuscrites constitue un
facteur identifié de non qualité [20]. L’objectif est de
limiter au maximum les retranscriptions et d’obtenir une
prescription complète et conforme à la réglementation
[21]. Ce document contiendra également les modalités de
prescription en cas de transfert d’un patient, les situations
d’urgences et les modalités de prescription de sortie avec
les différents statuts des médicaments et les différents types
de prescription de certains médicaments. Une procédure
expliquera la gestion des équivalences entre la pharma-
cie et les services de soins.
Les recommandations sur la gestion du stock médicamen-
teux seront diffusées en rappelant : les différentes listes, la
traçabilité du stock (numéro de lot, date de péremption),
les conditions de température et la maintenance du réfri-
gérateur, les conditions d’hygiène et la fréquence de
vérification des périmés [22].
Les recommandations pour l’administration seront en ac-
cord avec le décret n° 2002-194 relatif aux actes profes-
sionnels et à l’exercice de la profession infirmier [10].
Cela rassemble les différentes étapes de l’administration :
la prise de connaissance de la prescription médicale, la
préparation avec explication des risques liés à la modifi-
cation de la forme galénique (conséquences pharmacody-
namiques et pharmacocinétiques), la délivrance du médi-
cament au patient, l’administration proprement dite au
patient, l’enregistrement de l’administration de la dose de
médicament sur un support unique et la surveillance
clinique du patient.
Suite aux résultats de cette enquête qui ont été présentés
aux différentes instances du groupe hospitalier du Havre
(Commission médicale d’établissement, Direction des
soins infirmiers, Commission du médicament et des dispo-
sitifs médicaux, Commission qualité), le groupe de pilo-
tage a décidé la mise en place de quatre groupes de
travail et établit un échéancier.
Le premier groupe a pour mission de rédiger des « bonnes
pratiques de prescription et d’administration du médica-
ment au GHH » et de les diffuser, après validation, auprès
de chaque unité de soins. Par l’analyse des causes des
risques d’erreur identifiés et les solutions trouvées, elles
insisteront sur les points essentiels et/ou spécifiques, réali-
sables au GHH. Leur prise en compte garantira l’efficacité
de l’organisation du circuit du médicament au sein de
chaque service. Les trois autres groupes de travail ont
pour thème : le support de prescription, les informations
données par la pharmacie, la gestion des approvisionne-
ments et des stocks dans les unités de soins.
Conclusion
Les recommandations pour la prescription et l’administra-
tion sont écrites et validées. Elles vont être diffusées sous
forme d’un guide. Ce dernier sera édité en version petit
format pour les prescripteurs et en version grand format
S. Lethuillier, et al.
J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005
20
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

pour les unités de soins. Le site intranet est créé avec les
actions des différentes sous-commissions, le livret théra-
peutique et les demandes de référencement. La coordina-
tion des vigilances a créé un diaporama dans le cadre du
plan de communication, notamment pour la pharmacovi-
gilance.
Pour effectuer le suivi du projet et l’adhésion du personnel
aux recommandations, une auto-évaluation est prévue, au
sein des services, grâce à une grille synthétique d’évalua-
tion des points critiques. Les erreurs médicamenteuses sont
recensées au niveau des soins infirmiers sous forme de
fiche de déclaration. Ces informations sont partagées
avec la pharmacie et servent d’indicateur.
Il est bien évident que ce travail important sera long et
exigera une communication exemplaire. Il a ses limites,
comme par exemple, en ce qui concerne la question des
retranscriptions. L’informatisation du circuit du médica-
ment, qui est en cours, nous paraît aujourd’hui, être la
solution la plus complète pour répondre à cette exigence
de sécurisation, que nous devons à chaque patient hospi-
talisé. ■
Références
1. Lepaux DJ, Briançon S, Lecompte T, Delorme N, Pinelli C. En-
quête sur les pratiques de prescription du médicament à l’hôpital. –
Concepts et méthode. Therapie 1997 ; 52 : 559-67.
2. Goubier-Vial C, Csajka C, Ferry S, Rochefort F, Boissel JP. Ré-
flexions préalables à l’implantation d’une enquête de prescription du
médicament à l’hôpital. Therapie 1996 ; 51 : 57-66.
3. Article L 4111-1 et 4111-2 du code de la Santé publique.
Professions de santé - Professions médicales - Exercice des profes-
sions médicales - Conditions générales d’exercice.
4. Article L 5111-1 et 5111-2 du code de la Santé publique. Produits
de santé - Produits pharmaceutiques - Dispositions générales relatives
aux médicaments - Définitions.
5. Article L 5126-5 du code de la Santé publique. Produits de santé -
Produits pharmaceutiques - Médicaments à usage humain - pharma-
cies à usage intérieur.
6. Article L 1111-7 du code de la Santé publique. Protection des
personnes en matière de santé – Droit des personnes malades et des
usagers du système de santé – Information des usagers du système de
santé et expression de leur volonté.
Tableau 3.Actions préventives proposées.
Dysfonctionnements identifiés Actions préventives proposées Délai de réalisation
Rédaction de la prescription par l’IDE Rédaction de recommandations
pour la prescription
Support de prescription
Moyen terme
Long terme
Documents de prescription multiples
Absence d’information à l’IDE lors d’une modification de traitement
Retranscriptions
Prescriptions orales
Prescription non réadaptée avec le référencement de l’hôpital
Pas d’accord écrit pour la poursuite du traitement d’un patient entrant
Absence d’information du patient
lors d’une modification de traitement
Proposition d’équivalence médicamenteuse non montrée au médecin
Absence de protocoles de soins urgents Rédaction de protocoles de soins courants
et de soins spécifiques à chaque unité
Long terme
Méconnaissance des informations sur le médicament Création d’un site intranet Comedims Moyen terme
Difficulté d’approvisionnement Rédaction de procédures sur la gestion des approvisionnements,
de la réception et des stocks des médicaments
Long terme
Réception non immédiate des médicaments
Rangement insatisfaisant du stock médicament
Absence de lisibilité des médicaments stockés
Stock médicament non sous clé
Circuit des périmés non adéquat
Absence de dotation Création et/ou révision des dotations Moyen terme
Administration par des aide-soignantes Positionnement de la directions des soins infirmiers Moyen terme
Administration de médicaments non prescrits Rédaction de recommandations
pour l’administration
Moyen terme
Administration non immédiate après la préparation
Retranscription de la validation de l’administration
Modification de formes galéniques orales sans accord de faisabilité
Date de péremption non vérifiée avant l’administration
Absence d’enregistrement de l’administration
Absence d’information pour l’administration
Méconnaissance de la pharmacovigilance Communication du groupe « Coordination des vigilances »
sur la pharmacovigilance
Moyen terme
Circuit du médicament et accréditation
J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005 21
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
1
/
6
100%