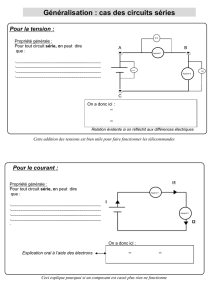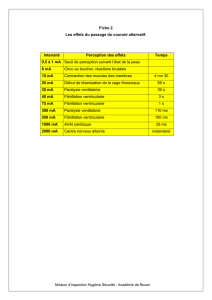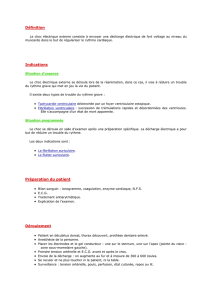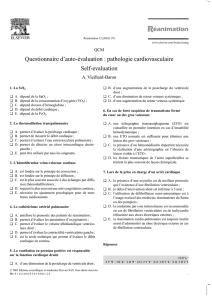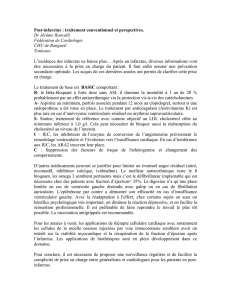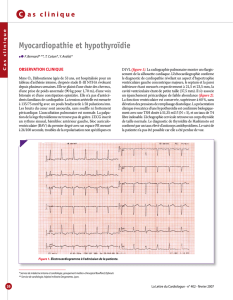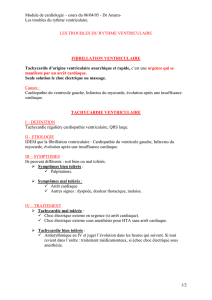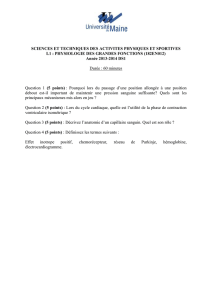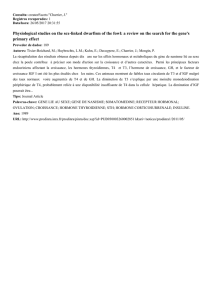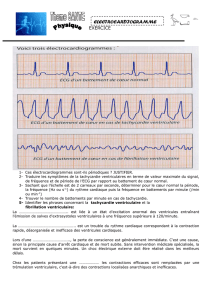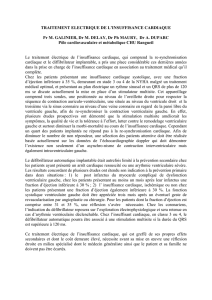Atteinte cardiaque des laminopathies

Revue
Atteinte cardiaque des laminopathies
Karim Wahbi , Christophe Meune, Denis Duboc
Service de cardiologie, hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg Saint Jacques, 75014 Paris
Résumé.Les laminopathies sont des affections génétiques en rapport avec une mutation du gène des lamines A et C, des protéines de la
membrane nucléaire. Les deux présentations cliniques les plus fréquents sont une cardiomyopathie dilatée isolée avec troubles conductifs et
troubles du rythme ventriculaire sévères ou l’association de cette même cardiomyopathie à une myopathie, le plus souvent une dystrophie
musculaire d’Emery Dreifuss. Il peut exister une neuropathie périphérique, une lipodystrophie ou des formes systémiques, notamment des
progeria. L’atteinte cardiaque conditionne le pronostic vital, avec un risque de mort subite rythmique très élevé, le plus souvent chez l’adulte
jeune. Une recherche de la mutation peut être effectuée en routine. Une enquête génétique et un bilan rythmique invasif doivent être
systématiques. Les indications à la pose d’un défibrillateur implantable en prévention primaire sont larges.
Mots clés : lamine, laminopathie, cardiomyopathie dilatée, mort subite
Abstract. Cardiac involvement in laminopathies. Laminopathies are hereditary disorders caused by mutations in the gene of nuclear
envelope proteins, the lamins A and C. They cause dilated cardiomyopathy with severe conductive disease and ventricular
tachycardia/fibrillation or the association with a skeletal muscle disease, like Emery Dreifuss dystrophy. Peripheral neuropathy, lipodystrophy
or systemic disorders like progeria have also been described. Cardiac involvement is responsible for the bad prognosis, with a high risk of
sudden death, in the third decade. Genetic screening can routinely detect the gene mutation. An invasive electrophysiological study has to be
systematicaly performed. An implantable cardioverter defibrillator therapy has to be discussed in primary prevention.
Key words: lamin, laminopathy, dilated cardiomyopathy, sudden death
Les
laminopathies sont constituées
d’un ensemble très hétérogène de
pathologies en rapport avec la muta-
tion d’un gène codant pour les lamines
A et C, des protéines de la membrane
nucléaire d’expression ubiquitaire.
Dans de nombreuses formes clini-
ques, l’atteinte cardiaque conditionne
le pronostic vital. Les formes cliniques
les plus fréquentes sont une cardio-
myopathie dilatée (CMD), isolée ou
une cardiopathie associée à une at-
teinte musculaire périphérique, avec
comme particularité un risque très
élevé de mort subite rythmique chez
l’adulte jeune. Une prise en charge
spécifique est nécessaire, reposant sur
un diagnostic génétique et de larges
indications à la mise en place d’un
défibrillateur implantable.
Phénotype cardiaque :
cardiomyopathie dilatée
avec troubles conductifs
(et rythmiques)
Il existe une grande variabilité
dans l’expression des phénotypes,
mais la séquence suivante est la
plus fréquemment observée [1-16].
D’abord la mise en évidence, entre
20 et 30 ans, alors que la fraction
d’éjection ventriculaire gauche est
normale ou subnormale de troubles
conductifs (bloc auriculoventriculaire
(BAV) de 1
er
degré, le plus souvent,
blocs intraventriculaires) et de trou-
bles du rythme supraventriculaires
(fibrillation, flutter, tachysystolie auri-
culaires), associés à un risque throm-
boembolique élevé [17]. Ensuite,
alors que la fonction systolique ventri-
culaire gauche est modérément alté-
rée, une aggravation des troubles
conductifs, le plus souvent sous la
forme d’un BAV de haut grade néces-
sitant un appareillage et l’apparition
de troubles du rythme ventriculaire
graves, constituent la première cause
de décès chez ces patients. Enfin, une
détérioration importante de la fonc-
tion systolique ventriculaire gauche
peut aboutir à insuffisance cardiaque
terminale, et nécessiter le recours à
une transplantation cardiaque.
m
t
c
Tirés à part : K. Wahbi
mt cardio 2007 ; 3 (2) : 157-63
mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007 157
Revue
doi: 10.1684/mtc.2007.0082
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

La figure 1 qui résume les données d’une méta-analyse
publiée en 2005 [18], reprenant l’ensemble des cas pu-
bliés, resitue la chronologie des différentes étapes. Les
troubles du rythme supraventriculaires ou ventriculaires
concernent un tiers des patients au cours de la seconde
décennie et presque la totalité des patients au delà de
30 ans. Surtout, plus de 40 % des patients ont été appa-
reillés au delà de l’âge de 30 ans. L’insuffisance cardiaque
est plus tardive et concerne plus de 60 % des patients
après 50 ans.
Le pronostic vital est moins bon pour les laminopathies
que pour les autres formes « génétiques » de CMD [19]
(figure 2). L’âge moyen de décès est de 46 ans. Le pronos-
tic est conditionné au premier plan par les troubles du
rythme ventriculaire dont la gravité est le plus souvent
sous estimée par rapport aux troubles conductifs. Beau-
coup de patients ont été appareillés avec un pacemaker et
font une mort subite en rapport avec un trouble du rythme
Liste des abréviations
BAV : bloc auriculoventriculaire
CMD : cardiomyopathie dilatée
Trouble du rythme
Pacemaker
Insuffisance
cardiaque
Pourcentage de patientsPourcentage de patients
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Âge
Âge
<10 10 - 20 20 - 30 >30
A
B
<30 30 - 40 40 - 50 >50
Figure 1.Chronologie d’apparition des complications rythmiques et conductives (A) et de l’insuffisance cardiaque (B) (d’après [17]).
Atteinte cardiaque des laminopathies
mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007
158
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

ventriculaire grave. Les données de la méta-analyse mon-
trent que parmi les 46 % de patients décédés de mort
subite, 43 % étaient porteurs d’un pacemaker. Les décès
étaient en rapport avec une mort subite dans 50 % des cas
pour les patients appareillés contre 43 % pour les patients
sans pacemaker [18]. En second lieu, 12 % étaient décé-
dés d’insuffisance cardiaque terminale, plusieurs trans-
plantés avec succès, du fait de l’absence de comorbidité
invalidante, notamment musculaire périphérique [18].
Formes cliniques
Les lamines sont exprimées de façon ubiquitaire et une
mutation du gène peut être associée à des phénotypes très
divers avec un tropisme pour les tissus musculaires, ner-
veux et adipeux. Toutes ces formes cliniques peuvent être
associées à une atteinte cardiaque du type de celle précé-
demment décrite. Il existe vraisemblablement un conti-
nuum entre ces différentes formes cliniques, les observa-
tions rapportant la combinaison de chacune d’entre elles
étant fréquentes (muscle + nerf, nerf + tissus adipeux,
etc.).
Il existe une grande variabilité inter et intrafamiliale
pour une même mutation. Ainsi, au sein de la première
famille à partir de laquelle a pu être identifié, par clonage
positionnel, le gène des lamines, certains patients présen-
taient une CMD isolée, d’autres une atteinte musculaire
isolée, d’autres des formes combinées [1, 2] (figure 3).
Variants cardiaques
Ont été également décrits des tableaux de non com-
paction du ventricule gauche [20], d’anévrisme apical
ventriculaire gauche [21].
Atteinte neuromusculaire
Elle peut être au premier plan avec des phénotypes très
différents : dystrophie d’Emery Dreifuss caractérisée par
des rétractions tendineuses importantes avec des coudes
bloqués en flexion [1, 2], une atrophie et une faiblesse
tibio-péronière ; myopathie des ceintures scapulaire et
pelvienne (LGMD 1B) [22] ; myopathie avec déficit qua-
dricipital isolé.
Autres atteintes
Elles sont multiples, les plus fréquentes sont une sous
catégorie de la neuropathie axonale de Charcot Marie
Tooth [23], des syndromes lipodystrophiques (dits de type
Dunningan) [24], une dysplasie acro-mandibulaire, des
anomalies systémiques pédiatriques ou néonatales très
sévères (syndrome progéroïde de Hutchinson Gilford,
syndrome de Werner, dermopathie restrictive) [25, 26].
Temps (années)
Survie (% de patients)
CMD avec laminopathie
CMD sans mutation du gène des lamines
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
010 20 30 40 50 60 70 80 90 100
p = 0,0072
Figure 2.Courbe actuarielle comparant la survie des patients atteints
d’une cardiomyopathie dilatée associée à une mutation du gène des
lamines A/C aux autres CMD. Le pronostic est moins bon en cas de
laminopathie (d’après [18]).
I
II
III
IV
V
12
123
12 3
**
1234
*
***
***
*
*********** * ***
**
*
*
*** **********
*
***
***
**
** *
12 3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
78
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
45
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
6
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Figure 3.Arbre généalogique de la première famille a partir de laquelle a été identifiée la mutation du gène des lamines. Il illustre la présence
d’une variabilité intrafamiliale importante. En rouge les patients avec une atteinte musculaire périphérique et cardiaque. En rouge/rosé les
patients avec une cardiopathie isolée. Les étoiles désignent les patients explorés en génétique et les triangles les porteurs de la mutation (d’après
[1, 2]).
mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007 159
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Épidémiologie
La prévalence réelle des laminopathies est difficile à
appréhender compte tenu de l’individualisation récente
du gène, de la méconnaissance fréquente du diagnostic y
compris devant une présentation typique avec une CMD
familiale associée à des troubles conductifs et rythmiques
sévères. On dispose des données de séries où était effectué
un screening systématique de la mutation pour toutes les
CMD ou pour les CMD avec troubles conductifs sévères
[27-29]. Les chiffres de prévalence sont très variables,
mais il apparaît que les laminopathies représenteraient au
moins 5 % des formes génétiques de CMD.
Génétique
Le gène des lamines A/C est situé sur le bras long du
chromosome 1 [30] (figure 4). La transmission est autoso-
mique. Ce gène comprend 12 exons et quatre isoformes
de lamines peuvent être codées par épissage alternatif.
Plus de 200 mutations différentes ont été identifiées, de
tous types [31-33]. La transmission se fait sur un mode
dominant dans la majorité des cas, notamment dans la
forme typique de CMD, d’où l’importance du conseil
génétique du fait du risque élevé que la mutation ait été
transmise à d’autres membres de la famille. Dans d’autres
formes cliniques plus rares, l’expression peut être réces-
sive. Les néomutations sont fréquentes, aussi l’absence de
contexte familial ne doit pas faire éliminer le diagnostic.
Aucune corrélation génotype phénotype n’a été trouvée. Il
existe une forme de dystrophie musculaire d’Emery Drei-
fuss pouvant aussi être associée à une CMD avec un profil
proche, de transmission liée à l’X en rapport avec la
mutation de l’émerine, une protéine nucléaire voisine des
lamines.
Physiopathologie
Les lamines sont des protéines de structure filamen-
taire, classées dans la catégorie des filaments intermédiai-
res de type V avec un domaine central hélicoïdal constitué
de 4 fragments et 2 extrémités globulaires N- et
C-terminales [34] (figure 4). Les formes A et C de lamines
sont dimérisées puis assemblées entre elles. Ce sont un des
principaux éléments constitutifs de la lamina nucléaire, un
réseau protéique qui tapisse le versant interne de la mem-
brane nucléaire. Elle auraient à la fois un rôle de charpente
pour la membrane nucléaire et un rôle d’interface entre la
membrane nucléaire et la chromatine, régulant l’expres-
sion des gènes (réplication de l’ADN, transcription de
l’ARN...) et jouant un rôle dans la différenciation et le
vieillissement cellulaire [35].
Deux théories physiopathologiques s’opposent [36].
La première, mécanique, le rôle de charpente n’étant plus
assuré, il existe une fragilité nucléaire aux contraintes
exercées, qui prédominent dans les tissus les plus sollici-
tés, au premier plan musculaires. L’examen au micros-
cope électronique de la membrane nucléaire montre alors
de nombreuses hernies et excroissances, un aspect en nid
d’abeille [37] (figure 5). La seconde théorie, fonctionnelle
avec des anomalies dans la régulation de la transcription,
des anomalies du vieillissement cellulaire, une apoptose.
Prise en charge des patients
Diagnostic positif
Clinique
Les éléments devant faire suspecter une laminopathie
devant un tableau CMD sont :
–Un contexte familial de CMD, de pathologie neuro-
musculaire, de mort subite, bien que leur absence ne
permette pas d’exclure le diagnostic car les formes spora-
diques sont aussi fréquentes,
–La survenue précoce des troubles du rythme supra-
ventriculaires et conductifs et leur contraste avec une
fonction systolique conservée,
–Des anomalies neuromusculaires associées, mêmes
minimes.
LMNA
Lamine A
Lamine C
Domaine
N-terminal Domaine central Domaine
C-terminal
12345 67 8910 11 12
664
Figure 4.Structure du gène des lamines A/C (12 exons) et des protéines (d’après [1]).
Atteinte cardiaque des laminopathies
mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007
160
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Analyse génétique
Une confirmation génétique est indispensable, la re-
cherche d’une mutation du gène peut être effectuée en
routine. Elle fait partie, à visée protocolaire, du screening
systématique de toute cardiomyopathie dilatée non éti-
quetée, par certaines équipes (aux Pays-Bas notamment).
En routine, les demandes doivent être limitées aux situa-
tions précédemment citées.
Conseil génétique
Compte tenu du mauvais pronostic et du risque élevé
de transmission (autosomique dominant), un conseil gé-
nétique s’impose afin d’évaluer le risque d’atteinte des
enfants et afin d’organiser une enquête génétique au sein
de la famille pour le dépistage chez les collatéraux et les
ascendants.
Évaluation pronostique
Le pronostic est conditionné en premier lieu par les
troubles du rythme ventriculaire. Viennent ensuite les
troubles conductifs, la dysfonction ventriculaire gauche et
enfin les complications emboliques des troubles du
rythme supraventriculaire.
Un bilan rythmologique le plus exhaustif possible doit
être effectué avec une exploration électrophysiologique
systématique ainsi qu’un bilan non invasif associant holter
ECG, épreuve d’effort. La fonction ventriculaire gauche
doit être évaluée, le plus souvent sur des paramètres
échographiques. Notre équipe effectue également systé-
matiquement une IRM cardiaque pour un examen anato-
mique plus complet, à la recherche notamment de corré-
lations entre les anomalies ventriculaires droites
BCD
A
Figure 5.Membranes nucléaires de cellules musculaires cardiaques de patients atteints de laminopathie en microscopie électronique. Les
flèches désignent les anomalies structurelles : blebs, déhissences, pores (d’après [18]).
mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007 161
Revue
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%