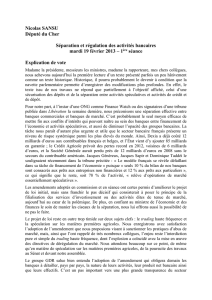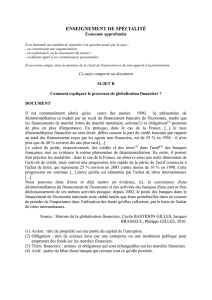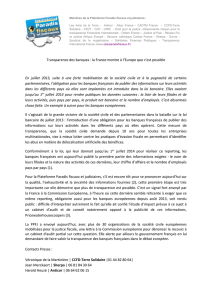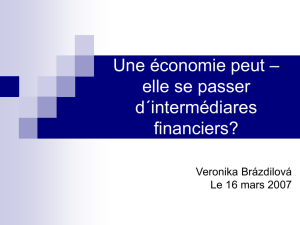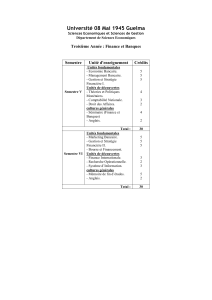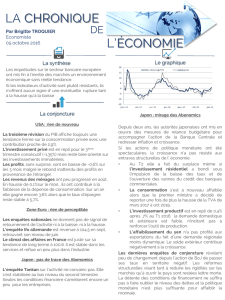À l`aube d`une nouvelle crise bancaire

1
2016/03
Siréas asbl
par Pascal De Gendt
Analyses &
Études
Politique internationale
À l’aube d’une nouvelle
crise bancaire ?
Analyses &
Études
Économie

2
Service International de Recherche,
d’Éducation et d’Action Sociale asbl
Secteur Éducation Permanente
Rue du Champ de Mars, 5 – 1050 Bruxelles
Tél. : 02/274 15 50 – Fax : 02/274 15 58
www.lesitinerrances.com – www.sireas.be
Siréas asbl
Nos analyses et études, publiées dans le cadre de l’Education permanente,
sont rédigées à partir de recherches menées par le Comité de rédaction de
SIREAS sous la direction de Mauro Sbolgi, éditeur responsable. Les ques-
tions traitées sont choisies en fonction des thèmes qui intéressent notre pu-
blic et développées avec professionnalisme tout en ayant le souci de rendre
les textes accessibles à l’ensemble de notre public.
Ces publications s’articulent autour de cinq thèmes
Questions sociales
Droits De l’Homme
migrations
PolitiQue internationale
Économie
Toutes nos publications peuvent être consultées et téléchargées sur nos sites
www.lesitinerrances.com et www.sireas.be, elles sont aussi disponibles en version
papier sur simple demande à [email protected]
Réagissez à cet article sur notre forum : http://www.lesitinerrances.com/site/index.
php?option=com_kunena&view=home&defaultmenu=87&Itemid=54
Avec le soutien
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

3
Le spectre de la crise bancaire de 2008 refait son apparition. Depuis le
début de l’année, l’inquiétude est au plus haut point dans ce secteur.
Cette crainte de vivre une nouvelle crise se reflète dans la cotation des
banques en bourse. La valeur de leurs actions dégringole parfois de manière
plus abrupte qu’en 2008. Et pratiquement tous les établissements bancaires
sont concernés même les plus gros. En février, les investisseurs notaient
qu’en moyenne les banques françaises avaient perdu 25% de leur valeur en
bourse depuis le 1er janvier. En Italie, c’est le niveau des créances douteuses
estimées à plus de 200 milliards d’euros qui donnent des sueurs froides aux
banquiers (1). Et, en Allemagne, la Deutsche Bank a annoncé une perte de
6,7 milliards en 2015 auxquels il faut rajouter les cinq milliards mis de côté
pour payer les amendes des six mille procès en cours. Le risque d’une faillite
dans les cinq ans de la géante allemande est évalué à 20% (2).
Deux autres indices permettent de saisir l’ampleur de l’inquiétude des
investisseurs. Tout d’abord, le cours de l’or ne cesse de remonter. Or, le
métal précieux est traditionnellement une valeur-refuge. En d’autres mots :
quand les marchés dépriment et sont à la baisse, les investisseurs se rabattent
habituellement sur l’or. Ensuite, la demande de « credit default swaps » est
également en forte hausse. Il s’agit d’un produit d’assurance permettant de
s’assurer contre la faillite des entreprises dans lesquelles les investisseurs
ont placé de l’argent (2). La situation semble donc grave, même si un certain
nombre d’experts sont sortis du bois pour dédramatiser. Des discours qui
ne portent plus tant ces mêmes experts n’avaient rien vu venir en 2008.

4
un ensemble De causes
Pour expliquer les raisons de cette crise bancaire, il faut prendre en
compte plusieurs facteurs. Le premier est la situation économique de la
Chine qui n’est actuellement pas favorable. Lorsqu’elle était en plein boum,
l’économie chinoise a attiré beaucoup d’investisseurs occidentaux dont
un certain nombre de banques. Mais la deuxième puissance économique
mondiale connaît désormais une réduction de sa croissance. Et dans notre
système économique mondialisé, cette mauvaise passe se répercute aux
quatre coins du monde. En particulier en Europe puisque la Chine est le
deuxième partenaire économique de l’Union européenne. En 2014, le géant
asiatique représentait 13,8% du total des exportations et importations
des biens de l’Union européenne (3). Certains analystes estiment que si le
taux de croissance de la Chine chute encore de 2% sur les deux prochaines
années, le produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne perdrait 0,6%
de croissance (4). Fait aggravant : la crise chinoise touche de plein fouet les
pays émergents asiatiques pour qui la Chine est un partenaire privilégié. Or,
ces pays asiatiques sont également des partenaires commerciaux de l’Union
européenne. Un fort ralentissement de leur économie entraînerait donc une
baisse des échanges économiques avec les pays européens. On peut voir,
grâce à cette première cause de la mauvaise santé bancaire, à quel point les
économies du monde entier sont désormais imbriquées.
La seconde cause que nous allons évoquer ne fait d’ailleurs que renforcer
ce constat. La baisse de la croissance chinoise a entraîné une baisse de la
demande pétrolière de ce pays. Conjugué à une situation de surproduction
de pétrole, au retour de l’Iran sur les marchés pétroliers et aux velléités
politiques de désinvestissement dans les combustibles fossiles, cela a amené
à une baisse du cours du pétrole. Cette situation a de grandes répercussions
sur le monde bancaire. Les entreprises pétrolières recourent massivement
à l’endettement, à coup de prêts bancaires, pour développer des activités à
haut coût tels que les forages. Si des doutes sur leurs capacités à rembourser
leurs dettes apparaissent, leurs investisseurs vont voir ailleurs. Suivant la
même logique, si une banque risque le non-remboursement de ses prêts à
l’industrie pétrolière, les personnes et institutions qui ont investi dans cette
banque tenteront de récupérer leur argent pour le placer ailleurs. Or, le
secteur bancaire est fort lié à l’industrie pétrolière. Par exemple, 5 à 7% des
prêts accordés par de grosses banques françaises comme le Crédit Agricole
ou Natixis sont liés à ce secteur (4).
Par ailleurs, un pétrole qui reste à bas prix empêche aussi le développement
d’une industrie comme celle du gaz de schiste. En effet, ce secteur énergétique
est moins rentable que celui du simple pétrole. Il faut donc que le baril d’or
noir soit à un prix plus élevé qu’actuellement pour que le gaz de schiste

5
fasse figure d’alternative énergétique viable. Ce n’est pas le cas et, aux États-
Unis, les faillites sont nombreuses dans ce secteur. Or, lorsqu’il y a encore
trois ans, le gaz de schiste faisait figure de nouvelle poule aux œufs d’or,
de nombreuses entreprise se sont créées et tous les groupes énergétiques
d’importance ont investi dans cette activité. Les banques ont évidemment
suivi le mouvement en accordant des prêts ou en investissant elles-mêmes.
Enfin, une dernière cause importante permettant d’expliquer la situation
des établissements bancaires provient des taux d’intérêt qui restent
extrêmement bas, voire négatifs dans certains pays. Quand elles accordent
des prêts (avec intérêts), les banques ne gagnent plus autant d’argent
qu’auparavant. Leur rentabilité est donc en danger. Dans ce domaine,
un cercle vicieux est à l’œuvre : devant les difficultés des banques, les
investisseurs se tournent vers des placements moins risqués. Nous avons
évoqué plus haut, l’or comme valeur-refuge traditionnelle. Ce n’est pas la
seule. Les titres obligataires remplissent la même fonction. En Belgique, ce
système est connu sous le nom de « bons d’États ». La vente d’obligations
permet à un État d’obtenir de l’argent. Mais, à la différence des actions
émises par les entreprises privées, l’investisseur qui achète des obligations
d’État est assuré de toucher un intérêt annuel. De plus, les titres obligataires
ont une durée limitée à l’issue de laquelle l’argent investi est remboursé.
Comme pour tout investissement, il y a des risques mais ceux-ci sont limités
puisque la solvabilité des États (soit leur capacité à rembourser) est évaluée
par les agences de notation. Le problème pour les banques étant que plus les
obligations connaissent du succès, plus les taux d’intérêt baissent (4).
Cette faiblesse des taux d’intérêts ne met pas que les banques en
difficultés. C’est tout le secteur financier qui est touché, notamment celui des
assurances. Or, celui-ci est connecté avec l’ensemble du système financier.
S’il doit tomber malade, les risques de contagion sont donc bien réels (5).
Or, si une nouvelle crise, semblable à celle de 2008, devait se déclarer, il
est fort à parier que ses conséquences seraient encore plus dramatiques. En
effet, pour éponger les dettes bancaires et sauver certaines d’entre elles, les
pouvoirs publics ont mis leurs finances dans le rouge. Ils en payent encore
le prix aujourd’hui et n’ont sans doute plus la même capacité de réaction. La
cure d’austérité qui a suivi a, en plus, affaibli les systèmes de sécurité sociale.
Or, c’est leur existence qui a permis de limiter les dégâts lors de la crise
économique profonde qui a suivi la crise bancaire et financière.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%