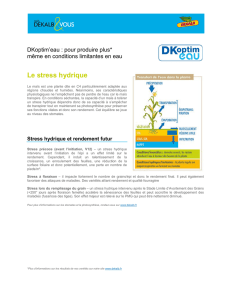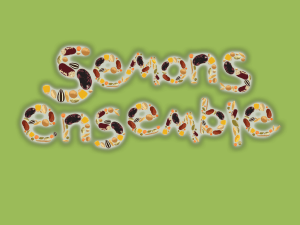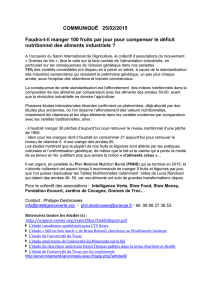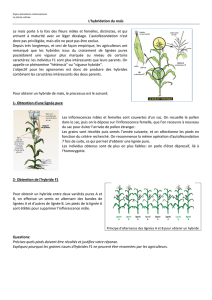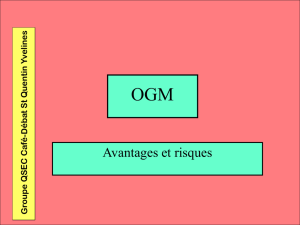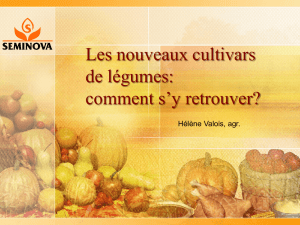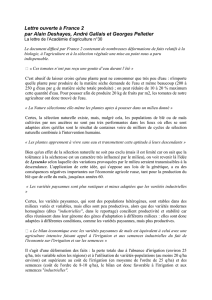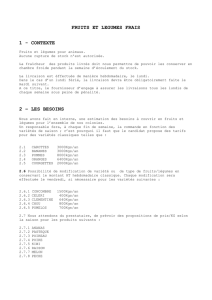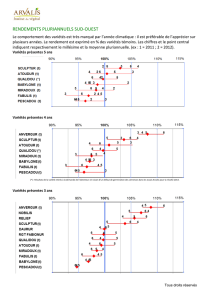nous essayons de - Perspectives Agricoles

N°408 - Février 2014
PERSPECTIVES AGRICOLES
61
LES INNOVATIONS
JULIE FIEVET, AGROPARISTECH
« NOUS ESSAYONS DE
mieux prédire l’effet hétérosis »
Très développées en maïs, les variétés hybrides commencent à faire
leur apparition en blé. Ces croisements de variétés sont guidés par la
recherche de l’effet d’hétérosis. Explications avec Julie Fievet, maître
de conférences à AgroParisTech et chercheuse à l’UMR de génétique
végétale, à la ferme du Moulon.
Perspectives Agricoles : Qu’entend-on par « effet
hétérosis » en sélection végétale ?
Julie Fievet : L’effet hétérosis, qu’on appelle aussi
vigueur hybride, consiste en un gain de vigueur
résultant du croisement entre deux variétés. Il
s’agit d’un phénomène universel qui touche toutes
les espèces à reproduction sexuée, pour les carac-
tères quantitatifs. L’effet hétérosis est bien connu
pour le maïs, mais il est aussi observé chez le col-
za, la levure, les huîtres ou encore les ovins.
P.A. : Comment ce phénomène a-t-il été découvert ?
J.-F. : L’hétérosis est un phénomène observé depuis
très longtemps. Il a notamment été mis en évidence
au niveau interspécifique par Kölreuter en 1794
puis au niveau de croisements intra-spécifiques par
Darwin en 1876. La formalisation de cette obser-
vation remonte elle au début des années 1900 via
les travaux de deux agronomes américains : Shull
et East. Leurs travaux de recherches ont montré
qu’en croisant deux maïs peu productifs, on pou-
vait obtenir un descendant plus vigoureux et que les
autofécondations successives étaient défavorables.
La base génétique principale de ce phénomène est
donc la complémentation entre les deux parents
pour des gènes dominants favorables. Un point im-
portant : l’effet hétérosis s’exprime surtout lorsque
les variétés sont éloignées génétiquement.
LES INNOVATIONS
DANS LES TUYAUX
Julie Fievet, qui partage son temps
entre l’enseignement et la recherche,
est spécialisée dans la culture du maïs.
© L. Monteillet, Perspectives Agricoles
408 heterosis.indd 61 10/01/2014 16:12:29

Février 2014 - N°408
PERSPECTIVES AGRICOLES
62
LES INNOVATIONS
DANS LES TUYAUX
P.A. : comment a-t-il été exploité dans les sché-
mas de sélection ?
J.-F. : Au début du XXe siècle, les champs de maïs
étaient composés d’un mélange de variétés, de
faible vigueur. Les rendements étaient faibles. Il
fallait lever des verrous : les plantes mères res-
taient peu productives, n’offrant qu’une quantité de
semences limitée, et le résultat des croisements
était difficilement prévisible. Pour contourner le
premier obstacle, des hybrides à trois ou à quatre
voies ont été créés. Ainsi, deux variétés étaient
croisées, puis leur descendant, un hybride, était à
nouveau croisé avec une variété pure (pour donner
un hybride 3 voies) ou un autre hybride (pour don-
ner un hybride 4 voies). En parallèle, la sélection
des variétés lignées, qui servent de parents aux
hybrides, s’est développée. Ce travail sur les li-
gnées parentales a permis de produire des lignées
plus vigoureuses et donc d’avoir des semences
d’hybrides simples (hybrides F1) en quantité suf-
fisante, et de structurer la diversité génétique de
façon à pouvoir choisir les lignées qui allaient le
mieux se combiner et donc permettre d’observer
le maximum d’hétérosis.
Le développement des hybrides en maïs a été très
important. Les premières variétés sont arrivées en
France peu après la seconde guerre mondiale. Au-
jourd’hui, les variétés hybrides concernent autour
de 98 % du marché.
P.A. : Pour développer des hybrides, il faut donc
au préalable obtenir des lignées…
J.-F. : Au niveau génétique, à force de réaliser des
autofécondations de variétés, nous sommes arri-
vés à fixer des lignées en six ou sept générations.
L’objectif était d’obtenir des variétés homozygotes
(des lignées), c’est-à-dire porteuses pour chaque
gène de deux copies identiques dans le cas du
maïs. Les lignées pures de maïs sont un matériel
de travail qui n’est pas du tout intéressant d’un
point de vue agronomique, ce qui n’est pas le cas
des lignées de blé. Mais ce sont des variétés qui
vont être croisées pour donner des hybrides, dont
la première génération est 100 % hétérozygote.
C’est sur cette génération que l’effet d’hétérosis
est le plus fort, quand les parents ont réussi à don-
ner leurs bons éléments respectifs à leur descen-
dant. En maïs, on peut obtenir jusqu’à 30 % de gain
de rendement par rapport à des variétés popula-
tion. Mais cela ne marche pas à tous les coups,
c’est pour cela qu’il faut tester des combinaisons.
P.A. : Les nouvelles technologies, telles que le
marquage moléculaire, facilitent-elles le travail
de sélection ?
J.-F. : Oui, car les marqueurs moléculaires peuvent
être comparés à des bornes kilométriques, qui
nous permettent de nous repérer sur le génome
et d’identifier des zones impliquées dans le déter-
minisme d’un caractère. Notre travail de sélection
se pratique maintenant « moins à l’aveugle ». Les
Nous souhaitons mieux utiliser la
diversité génétique pour produire
de nouvelles lignées. »
Un maïs hybride entre ses deux parents :
l’effet hétérosis est plus grand lorsque
les parents sont distants génétiquement.
© D.R.
%, c’est le gain de
rendement potentiel
obtenu avec une variété
de maïs hybride.
30
408 heterosis.indd 62 10/01/2014 16:12:42

N°408 - Février 2014
PERSPECTIVES AGRICOLES
63
LES INNOVATIONS
zones favorables peuvent être suivies au cours des
programmes de sélection, ce qui permet un déve-
loppement plus rapide des complémentarités entre
parents.
P.A. : Les variétés hybrides permettent-elles seule-
ment de gagner en rendement ?
J.-F. : Non, un effet hétérosis peut être observé
au niveau de bien d’autres caractères : hauteur de
plante, résistance à la maladie, résistance au déficit
hydrique, nombre de feuilles, précocité de floraison…
Il est cependant plus important pour les caractères
les plus complexes tels que le rendement.
P.A. : Doit-on encore attendre un progrès génétique
grâce à l’effet hétérosis ?
J.-F. : En maïs, il y a encore des découvertes. Le po-
tentiel des lignées augmente, à tel point que le rende-
ment de certaines lignées a rejoint celui des premiers
hybrides… Mais les hybrides ne cessent de progresser
parallèlement. L’écart entre lignées et hybrides reste
important ce qui justifie le développement de varié-
tés hybrides pour le maïs. Aujourd’hui, nous travail-
lons sur la base des groupes hétérotiques, qui ras-
semblent des lignées génétiquement assez proches.
Dans les schémas de sélection classiques du maïs,
une variété est choisie pour représenter son groupe
hétérotique, on la nomme testeur, et elle est croi-
sée avec les lignées d’autres groupes hétérotiques
de façon à tester de nouvelles combinaisons. La re-
cherche continue d’explorer des voies d’amélioration,
notamment grâce au projet investissement d’avenir
Amaizing. Depuis 2011 et pour une durée de huit ans,
celui-ci fédère tous les acteurs de la filière pour amé-
liorer la résistance des variétés au déficit hydrique, au
froid ou encore leur capacité à valoriser la nutrition
azotée. Nous essayons de mieux prédire l’effet hété-
rosis. De plus, nous souhaitons mieux utiliser la di-
versité génétique pour produire de nouvelles lignées.
P.A. : Est-il opportun de développer des variétés
hybrides en céréales ?
J.-F. : Il faut bien distinguer les espèces allogames,
telles que le maïs, le tournesol ou le seigle, des es-
pèces autogames comme le blé ou le riz. Ces dernières
se reproduisent par autofécondation. Les variétés dis-
tribuées pour les espèces autogames sont majoritai-
rement des lignées homozygotes. Pour cette catégorie
de plantes, l’effet heterosis est très diminué. Pour un
blé hybride, les gains de rendement dépassent rare-
ment 10 %. Il faut quand même ne pas oublier que l’ef-
fet d’hétérosis est plus fort lorsque les conditions sont
peu favorables, les « mauvaises années ». L’avantage
de ces variétés hybrides doit donc être étudié en plu-
riannuel car il risque d’y avoir peu d’avantage à investir
dans des semences hybrides les bonnes années mais
cet investissement sera payant les mauvaises années.
Les variétés hybrides sont certes plus chères à pro-
duire mais elles restent le moyen le plus rapide de
combiner dans un même génotype les gènes domi-
nants favorables. Les blés hybrides, par exemple,
permettent de réunir plusieurs gènes de résistance
aux maladies.
Les premiers blés hybrides commercialisés en
France ne datent que de 1993. Ce développement
récent s’explique par le fait que des semences
hybrides sont beaucoup plus difficiles à produire.
En maïs, il suffit de couper les panicules (fleurs
mâles) des plantes qui serviront de femelles (elles
ne peuvent plus produire de pollen) pour croiser
les variétés. En blé, c’est une autre histoire. Deux
solutions sont envisageables : utiliser des variétés
mâles stériles puis restaurer la fertilité ou bien uti-
liser un agent chimique d’hybridation. Néanmoins,
le développement d’hybrides en blé peut-être une
piste pour obtenir des variétés mieux adaptées aux
conditions de production ou économes en intrants.
Propos recueillis par Lise Monteillet
Pour un blé hybride, les gains
de rendement dépassent
rarement 10 %. »
Les premiers blés hybrides
commercialisés en France
ne datent que de 1993.
© N. Cornec
408 heterosis.indd 63 10/01/2014 16:12:46
1
/
3
100%