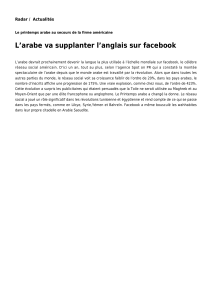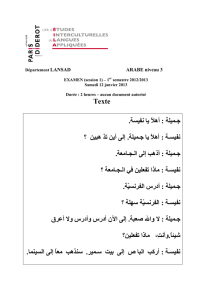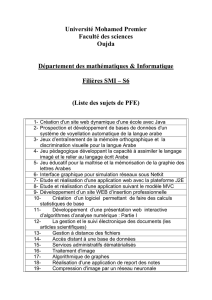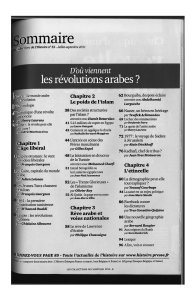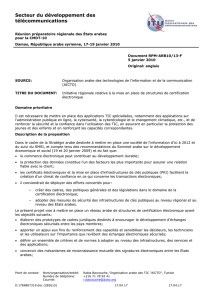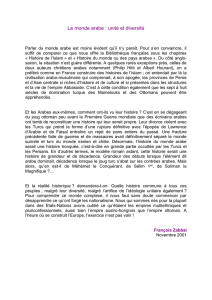ETUDE SUR LA TRADUCTION THEÂTRALE EUROPE/MONDE

© Transeuropéennes, Paris & Fondation Anna Lindh, Alexandrie - 2011
Traduire en Méditerranée
ETUDE SUR LA TRADUCTION THEÂTRALE
EUROPE/MONDE ARABE
Dans le cadre de l’état des lieux de la traduction en Méditerranée, co-
produit par la Fondation Anna Lindh et Transeuropéennes en 2010
Analyse et rédaction
Jumana Al-Yasiri

© Transeuropéennes, Paris & Fondation Anna Lindh, Alexandrie - 2011
Préambule
La présente étude est réalisée par Transeuropéennes en partenariat avec la Fondation Anna Lindh
(Traduire en Méditerranée). Elle est une composante du premier état des lieux de la traduction en
Méditerranée que conduisent à partir de 2010 Transeuropéennes et la Fondation Anna Lindh
(programme euro-méditerranéen pour la traduction), en partenariat avec plus d’une quinzaine
d’organisations de toute l’Union pour la Méditerranée.
Partageant une même vision ample de la traduction, du rôle central qu’elle doit jouer dans les
relations euro-méditerranéennes, dans l’enrichissement des langues, dans le développement des
sociétés, dans la production et la circulation des savoirs et des imaginaires, les partenaires réunis
dans ce projet prendront appui sur cet état des lieux pour proposer et construire des actions de
long terme.
Introduction
L'étude suivante propose un aperçu général de la traduction au théâtre des langues de
l'Union Européenne vers l'arabe et vice versa, retraçant plus d'un siècle de traduction entre les deux
rives de la Méditerranée, avec un intérêt particulier pour les pratiques contemporaines de la dernière
décennie. Elle s'appuie sur les états des lieux conduits par Transeuropéennes et la Fondation Anna
Lindh sur la traduction de la littérature et de la pensée en Méditerranée, ainsi que sur des
bibliographies et des bases de données de maisons d'édition et de moteurs de recherche spécialisés,
des articles et des revues en ligne dédiés au théâtre et à la traduction, et sur des informations du
terrain. L'étude suivante reste toutefois inégale en termes d'information et de données sur la
traduction au théâtre entre l'Europe et les pays arabes.
Malgré l’existence de formes parathéâtrales telles que les "Gestes" ou les Maqamat des
poètes arabes du Xème siècle (Al Hamadhânî par exemple), nous tenons à signaler que le théâtre de
texte – comme l'entend la tradition occidentale – du monde arabe est né de la traduction du théâtre
européen dans la deuxième moitié du XIXème siècle. De là, le théâtre de l'Europe n'a cessé d'être
traduit, publié et joué en arabe classique et dans tous les dialectes de la région. Cependant, l'intérêt
que portent les éditeurs et les praticiens de théâtre européen pour l'écriture théâtrale arabe est
largement inférieur, et cela à cause de différents facteurs que nous tenterons d'analyser ci-dessous.
Aujourd'hui, il est nettement plus facile de parler de la traduction du théâtre français, anglais, italien
ou allemand en arabe, qu'il ne l'est pour ce qui concerne la traduction du théâtre syrien, libanais,
égyptien ou irakien dans les langues européennes. Dans un souci d'approche constructive, nous avons
donc choisi de présenter la traduction du théâtre arabe en Europe en général et de nous arrêter sur
des chapitres clé de l'histoire de ces flux de traduction à titre d'exemple, tout en éclaircissant les
nuances géographiques et linguistiques nécessaires pour les fins de cette synthèse.

© Transeuropéennes, Paris & Fondation Anna Lindh, Alexandrie - 2011
1. Eléments utiles pour un rapide historique de la traduction au théâtre, de la
publication des traductions ou de leur non publication.
Des langues européennes vers l'arabe
Même si les Arabes avaient traduit La Poétique d'Aristote, le monde arabe n'a connu l'écriture
théâtrale dans sa forme occidentale qu'à la deuxième moitié du XIXème siècle, et ceci à travers la
traduction et l'adaptation du répertoire théâtral de pays européens qui avaient une forte présence
dans la région (France, Italie, Angleterre…), et plus particulièrement au Liban, en Syrie et en Egypte.
Ces trois pays du Moyen-Orient ont été le berceau de la création théâtrale du monde arabe, et
restent jusqu'à ce jour le principal foyer de l'écriture, de la traduction et de la publication du théâtre
dans la région.
En 1847, le Libanais Maroun al-Naqach (1817-1855) monte une adaptation de L'Avare de Molière.
Cette libanisation d'une pièce du répertoire classique français, marque le début de trois courants
essentiels dans l'histoire du théâtre arabe: la traduction, l'adaptation ou iqtibas, et l'écriture.
Jusqu'à l'aube de la seconde Guerre mondiale, la majeure partie des traductions du théâtre européen
vers l'arabe œuvraient à donner une couleur locale aux textes traduits, que ce soit par l'utilisation
des dialectes au lieu de l'arabe classique, le changement des noms des personnages, ou même par une
réécriture de ces textes pour les rapprocher de la mentalité et des mœurs locales. Mohamed Osman
Jalal fut l'un des plus grands spécialistes en Egypte de la traduction-adaptation du théâtre français et
particulièrement du théâtre de Molière, alors que Najib al-Hadad transformait Hernani en Hamdan au
Liban.
La traduction théâtrale de qualité n'apparût réellement dans le monde arabe qu'à partir des années
1950-1960, au retour d'une nouvelle génération de praticiens diplômés d'Europe. Le théâtre écrit et
traduit dans la région commença alors à trouver sa véritable théâtralité qui le différenciait des autres
genres littéraires, ainsi que sa reconnaissance en temps qu'expression artistique locale suivie par un
public de plus en plus large et cultivé.
Cette reconnaissance de l'écriture théâtrale en tant que genre distinct de la poésie et de la littérature
prosaïque se concrétise en 1969 avec la création de la série Le Théâtre mondial (al-Masrah al-'alami)
par le Conseil National pour la Culture, les Arts et les Lettres du Koweït. Cette initiative est le fruit
du développement des Ministères de la Culture du monde arabe et de leur souci de transmission de
la littérature et de la pensée mondiale dans la région. Pour la traduction au théâtre, les programmes
nationaux restent les principaux éditeurs dans le monde arabe, où les maisons d'édition privées
publient rarement du théâtre à part quelques exceptions tels que les auteurs ″stars, de préférence
titulaires du Prix Nobel (Gerhart Hauptmann, Maurice Maeterlinck et Dario Fo chez Dar Al Mada),
et parfois dans les meilleurs des cas, les classiques figurant dans les programmes des Facultés de
Lettres (françaises et anglaises), tels que Jean Racine et William Shakespeare.
Bien que les politiques culturelles nationales de certains pays arabes (Egypte, Syrie, Liban, Irak,
Koweït…) aient encouragé la traduction du théâtre européen et mondial, et sa diffusion dans

© Transeuropéennes, Paris & Fondation Anna Lindh, Alexandrie - 2011
l'ensemble de la région, elles ne furent pas sans poser le problème du choix des textes à traduire et
des méthodes appliquées à la traduction, ainsi qu'une véritable distinction au niveau de la
reconnaissance officielle du théâtre traduit publié ou non-publié, et cela particulièrement depuis les
années 1990.
Cette époque voit la chute des moyens des principaux éditeurs du théâtre dans la région, leur
éloignement de cette écriture qui a de moins en moins de lecteurs et de moyens de production, et
l'apparition d'une nouvelle génération de metteurs en scène qui prennent l'initiative de traduire-
adapter eux-mêmes des pièces de théâtre du répertoire européen contemporain, ou leurs propres
textes. C'est aussi le début de l'émergence d'opérateurs culturels indépendants (associations,
espaces, festivals…) de plus en plus présents dans les réseaux régionaux et internationaux, et dont
plusieurs se sont donné comme mission de soutenir cette nouvelle écriture, sa traduction et la
production théâtrale contemporaine en général. Malheureusement, leurs moyens restent limités, et
ils ne sont pas encore en mesure de répondre à l'intégralité de la demande des professionnels de
l'ensemble de la région, surtout pas sans le soutien des services culturels diplomatiques, qui ont eux
de leur part toujours joué un rôle primordial dans la diffusion de l'écriture théâtrale européenne dans
le monde arabe.
Dans ce sens, nous pouvons qualifier la dernière décennie, constituant l'axe principal de cette étude,
d'″âge d'or″ du manuscrit théâtral: ce qui est écrit et traduit pour la scène reste souvent pour la
scène, et dans une situation idéale pourrait peut-être bénéficier d'une traduction dans le but d'un
surtitrage dans le cadre d'une diffusion à l'international, comme nous le verrons ci-dessous.
De l'arabe vers les langues européennes
Les Arabes ayant importé le théâtre d'Europe, à travers la traduction dans un premier temps, ont
encore du mal à trouver leur place auprès des traducteurs et des éditeurs européens; et les metteurs
en scène du Nord de la Méditerranée ont tendance à adapter des textes non-dramatiques arabes
(Les Mille et Une Nuits, contes, poèmes…), plutôt que de se pencher sur l'écriture théâtrale du Sud
proprement dite. Cette écriture fait surtout l'objet d'études littéraires, linguistiques et orientalistes,
dans des cadres universitaires et des revues spécialisées. Ce qui explique par exemple la profusion
des traductions du théâtre de l'auteur égyptien Tawfiq al-Hakim (1898-1987), figure emblématique de
l'écriture théâtrale arabe de la première moitié du XXème siècle et dont la première traduction en
français remonte à 1936 (Schérezade), qui bat jusqu'à ce jour les records en terme de traduction en
langues européennes, alors que son écriture est considérée comme inadaptable à la scène par la
majorité des praticiens arabes, malgré (à cause de) ses qualités poétiques.
Si le théâtre européen bénéficie des programmes nationaux dédiés au soutien à la diffusion
internationale, il n'existe malheureusement pas ou très peu de programmes arabes qui ont pour
mission de diffuser le théâtre écrit dans la région sur le continent européen, et de là au reste du
monde. Paradoxalement, nous verrons que lorsque ces initiatives existent, elles émanent d'entités
étrangères (missions culturelles, universités, centres de traductions et de recherche…).
Les traductions du théâtre arabe sont soumises dans la plupart des cas à l'intérêt personnel d'un
traducteur d'origine arabe pour une pièce provenant dans la plupart des cas de son pays d'origine, ou
aux événements nationaux célébrant la culture d'un autre pays (Année de l'Algérie, Le Printemps
palestinien en France…). Jusqu'à nos jours, il n'y a pas vraiment eu de stratégie globale de traduction

© Transeuropéennes, Paris & Fondation Anna Lindh, Alexandrie - 2011
et de publication du théâtre écrit en arabe vers les langues européennes, et il est bien évident que le
nombre de traducteurs depuis l'arabe est largement inférieur à celui des traducteurs de toutes ou de
la majorité des langues de l'Europe vers cette langue.
Nous notons tout de même l'intérêt croissant que portent certains opérateurs culturels européens
pour la traduction de l'écriture théâtrale contemporaine du monde arabe, est notamment depuis
l'émergence d'une génération de metteurs en scène qui écrivent leurs pièces en arabe (souvent
dialectal), et puis qui les traduisent directement, et parfois même les mettent en scène, dans une
autre langue (majoritairement l'anglais ou le français).
Nous remarquons donc que le théâtre contemporain arabe traduit récemment vers les langues
européennes sans être nécessairement publié, passe directement par la scène et par le surtitrage, et
donc dispose des mêmes conditions de diffusion et de mise à disposition que de celui de son voisin
européen, et cela après près d'un siècle d'inégalité en faveur de ce dernier. Nous citons ici à titre
d'exemple, le travail de l'Egyptien Ahmed El Attar, du Tunisien Fadhel Jaibi et du Libanais Rabieh
Mroué.
2. Eléments utiles de différenciation géographique.
Afin de comprendre les courants de la traduction du théâtre du et dans le monde arabe, il est
essentiel de distinguer la création du Moyen-Orient de celle des pays d'Afrique du Nord, que ce soit
d'un point de vue historique, linguistique ou même esthétique.
L'histoire du théâtre arabe commence au Liban au XIXème siècle avec Maroun al-Naqach, se
poursuit en Syrie avec Abou Khalil al-Qabani (1835-1902), et trouve son apogée en Egypte où
s'exilent des hommes de théâtre libanais et syriens. Cette époque voit l'émergence d'une scène locale
fortement soutenue par la Royauté dans un souci de rayonnement intellectuel et culturel, dont l'une
des figues emblématiques est inconditionnellement l'auteur, metteur en scène et comédien Yacoub
Sanou' (1839-1912). Ce parcours assure une continuité dans un espace géographique qui s'étend de
l'Egypte à la Syrie, en passant par le Liban et la Palestine, ainsi que leur voisin l'Irak. Cette zone
géographique partage une histoire commune (et notamment de part l'héritage de la présence
ottomane), un patrimoine culturel et des dialectes assez similaires. C'est dans cette région que se
concentre jusqu'à nos jours la majorité des traducteurs et des éditeurs du théâtre, institutionnels et
privés.
Les pays d'Afrique du Nord suivirent le mouvement des autres pays arabes mais sous des conditions
assez particulières qui sont celles de la présence française en Tunisie, Algérie et au Maroc, et qui les
isolèrent pendant plusieurs décennies de la création du Moyen-Orient. Le Maghreb qui a sa propre
histoire partagée et ses dialectes, où l'arabe se mêle fortement au français et au berbère, reste assez
éloigné culturellement de la création et des flux de traductions du théâtre du Machreq, berceau des
pionniers de la scène arabe.
L'autre zone importante dans l'évolution de la traduction et de la publication du théâtre dans la
région est sans doute le Golfe, qui a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de l'édition théâtrale
du monde arabe, et particulièrement grâce à la série Le Théâtre mondial, publiée au Koweït et citée ci-
dessus.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%