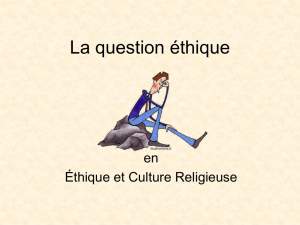Quel impact de l`Internet sur l`éthique de la presse électronique

Quel impact de l’Internet sur l’éthique de la
presse électronique?
Kheira-Zineb Bousmaha
Chercheure au Laboratoire de droit et des nouvelles technologies
Université d’Oran, Algérie
Introduction
Avec son dispositif technique et communicationnel (écran, interface clavier-souris-caméra-
microphone, télécommunications) Internet est un média parmi d’autres, sauf que son réseau
de diusion est à une échelle planétaire (Word Wide Web/www). Considéré comme nouveau, ce
média produit des techniques et des notions inconnues jusqu’à une date récente; Digital Media
News / journalisme en ligne, blogs, photojournalisme numérique, journalisme citoyen, médias
sociaux… Chaque jour, il est créé cinq exabytes de données en ligne. Cette frénésie, favorisée
par internet, disait Marie-Charlotte Roques-Bonnet, génère autant de données, en un jour, que
celles produites depuis le début de l’humanité jusqu’à l’année 2003.1 Données aussi disparates
qu’anodines «qui se présentent tantôt comme mémoire, tantôt comme savoir, tantôt comme message,
tantôt comme programme, tantôt comme matrice organisationnelle».2
L’utilisateur, citoyen-journaliste ou professionnel, s’ore toutes les possibilités des autres
médias, à une diérence près que chaque utilisateur est à la fois récepteur et émetteur, ou l’un
des deux. Or la grande quantité d’informations sociales et comportementales potentiellement
disponibles en son sein a rendu la toile une cible de choix pour tous les actes malveillants.
Et comme tous les autres domaines du savoir possiblement attentatoires à l’intégrité de la
personne, une approche éthique de son usage a été amorcée en sus de l’ordre juridique qui
tente de le réguler. Ainsi, les promoteurs de cet nouvel outil peuvent, comme les médecins, les
avocats… s’enorgueillir d’avoir leur propre code d’honneur.
L’éthique des techniques et des systèmes d’information (TI /SI), l’infoéthique, l’éthique
télématique, informationnelle sont autant de termes et expressions qui s’interrogent sur les
incidences des TI/SI sur les règles de vie et de conduite en société et tente d’asseoir un code de
«bonne conduite» pour tous les utilisateurs de l’Internet. La philosophie du «bien» et du «mal»
peut se révéler fructueuse pour éclairer les questions clés en matière d›éthique de l›Internet,
et de montrer comment les conceptions théoriques de l›agir communicationnel et l›éthique du
discours s’opèrent aussi sur les réseaux électroniques de communication.
(1) In: Le droit peut-il ignorer la révolution numérique? (Paris: Odile Jacob, 2010), 582.
(2) Edgar Morin. Introduction à la pensée complexe (Paris: Ellipse, 2007), 123.
7-F

Le cyberespace ore en eet de nombreuses preuves de comportements dysfonctionnels et de
discours contraires tant à la morale qu’à l’ordre public. Ceux-ci sont catalogués dans diverses
analyses3 et certains sont assez triviaux, comme la pédophilie, l’apologie du terrorisme,
l’incitation à la haine raciale, la négation de crimes contre l’humanité, l’appel au meurtre, le
proxénétisme, le trac de stupéants, les atteintes à la sécurité nationale… Aussi, la facilité
avec laquelle le cyberespace facilite ce type d’études soulève également des questions éthiques
et juridiques de ces recherches.
Peu d’études ont été consacrées au journalisme assisté par ordinateur (JAO) encore moins à son
éthique. C’est pourquoi le papier est une immersion dans un domaine vierge d’où sa principale
diculté.
I. - Le rôle «révélateur» de l’Internet
On est encore qu’au début de l’âge d’Internet (Inter Communication Network)4 et même à
ce stade, il est en passe de devenir un produit naturel, voire un outil de la vie quotidienne
comme l’est le téléphone5 ou la télévision. L’informatique est omniprésente et est directement
impliquée dans au moins trois grandes transformations de notre époque : la convergence des
médias, la redénition des frontières sociales et la transcendance des frontières géographiques.
Ces notions reformulent nos conceptions traditionnelles sur la spatialité et la temporalité au
sein de l’organisation sociale. «Le réseau n’est pas centralisé, il ne connaît pas de frontières, et
aucune structure n’a vocation à le diriger globalement. Pour nir, aucun État ne peut imposer
sa souveraineté sur la moindre parcelle d’«autoroute de l’information».6
Sa démocratisation par l’intermédiaire d’un accès facilité et plus ou moins généralisé, pourrait
sans doute apporter un élément de réconciliation pour les sociétés du monde entier, dont
beaucoup ne connaissent même pas l’existence de ces réseaux. L’internet peut donc être
considéré aujourd’hui comme un simple moyen de communication à ajouter aux autres, une
infrastructure, une suite de «protocoles» ou des normes qui fournissent une base sur laquelle de
précieux services peuvent être construits tels que les messages de transmission (par exemple,
e-mail et de transfert de chiers), l’accès à l’information, et les transactions, y compris les
paiements.7
(3) R. Clarke, “Net ethiquette: Mini Case Studies of Dysfunctional Human Behaviour on the Net,” (April 1995), at:
http://www.rogerclarke.com/II/Netethiquettecases.html. Consulté le 23 oct. 2013.
(4) Frances Cairncross, The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our Lives (London: Orion
Business Books, 1977), 234.
(5) Ithiel De Sola Pool, The Social Impact of the Telephone (Cambridge, Mass: MIT Press, 1977).
(7) Pour plus de détails sur ces questions, cf., Roger Clarke, “The Monster from the Crypt: Impacts and Eects
of Digital Money”, Computers, Freedom & Privacy Conference (CFP’97), San Francisco (March 1997), at http://www.
rogerclarke.com/EC/CFP97.html, revised version presented as a Keynote at QuestNet’97, Brisbane, 4 July 1997, at:
http://www.rogerclarke.com/EC/Monster.html. Consulté le 21 oct. 2013.
(6) Anne-Gaëlle Rico, « Internet: Quelle régulation juridique ? » Mémoire de D.E.A Droit des aaires. Université Paris
XIII, Jean - Philippe Casanova, année 1997. http://www.lemonde.fr/technologies/chat/2007/06/06/sebastien-
bachollet-pour-la-regulation-d-internet-les-lois-sont-utiles-mais-insusantes_919519_651865.htm Consulté le
1er nov. 2013.
8-F

Face à cette présentation aussi neutre et aussi «technicienne» de l’internet, on peut s’interroger
sur les raisons du débat de sa régulation éthique qui se sont développés depuis les travaux
de Clark,8 Bynum,9 Weizenbaum,10 Roszak11… aboutissant à la nécessité d’une prise en charge
juridique. Plus généralement, il s’agit de déterminer dans quelle mesure l’internet fut un
élément de sensibilisation des utilisateurs sur la liberté d’une part et les atteintes à la vie privée
d’autre part.
II.- L’impact social de l’Internet et l’émergence d’une nouvelle éthique
L’internet se présente comme un outil social. Dans le débat qu’il suscite, il n’est pas seulement
question d’organiser l’utilisation rationnelle d’une technologie, mais aussi de s’interroger sur
son impact social. A partir des années soixante-dix déjà, la généralisation de cette technique
renvoie la discussion du thème de l’«informatique» à celui de l’informatisation. En France,
un rapport rédigé par le duo Nora-Minc sur «l’informatisation de la société»12 considère le
développement de l’usage de l’ordinateur comme un facteur de bouleversement, qui touche
aussi bien la vie quotidienne des hommes que leur mode de pensée. D’ailleurs si le phénomène
«Internet» a un impact social, il exerce également lui-même une fonction sociale (les réseaux
sociaux). Ainsi que le fait remarquer M. Vitalis, l’Internet n’est rien sans les données et les
programmes que l’on y introduit. De fait, s’il contribue à modeler la société, il en est également
le reet: on ne peut comprendre l’utilité et la portée, hors du milieu standardisé et rationalisé
qui lui a donné naissance, et dont elle propose un nouveau type de gestion.13
Un nouvel environnement est donc né, ce qui signie comme l’explique John Ladd une nouvelle
morale,14 car les normes et les principes traditionnels sont remis en question et la pratique
éthique n’est plus pertinente dans la nouvelle situation. Jusqu›à présent, la période de transition
a été progressive, et les changements subtils sont presque imperceptibles. Il se pourrait que la
vitesse du changement imposée par l’Internet n›ait pas été compensée par notre adaptation
individuelle, dans ce cas nous voyons une tension éthique comme en témoigne les débats à tous
les niveaux. En d’autres termes, il existe un «décalage» entre notre éthique conventionnelles et
celle du cyberespace que nous nous eorçons de rattraper avec de nouveaux concepts.
(8) Douglas Adeney, “Evaluating the Pleasures of Cybersex,” The Australian Journal of Professional and Applied
Ethics (June 1999) 69-79; John Weckert & Douglas Adeney, “Computer and Information Ethics” (Westport, Connec-
ticut : Greenwood Press, 1997).
(9) Terrell Ward Bynum, “The Development of Computer Ethics as a Philosophical Field of Study,” The Australian
Journal of Professional and Applied Ethics (1,1 June 1999) 1-29.
(10) Joseph Weizenbaum, Computer Power and Human Reason, (San Francisco: W.H. Freeman, 1976).
(11) Theodore Roszak, The Cult of Information (New York: Pantheon Book, 1986).
(12) Simoin Nora et Alain Minc, « Rapport sur l’informatisation de la société » (Paris : La documentation française,
1978), 162.
(13) André Vitalis, « Informatique et liberté, pouvoir et liberté publiques. » Thèse. Sciences politiques (Rennes,
1979), 9.
(14) John Ladd, “Ethics and the Computer World: A New Challenge for Philosophers,” Computers and Society, (Sep-
tember 1997) 8-13.
9-F

(15) Patrice Flichy, L’imaginaire d’Internet (Paris, La découverte, 2001). 78.
(16) La généralisation de l’Internet n’est pas pour demain. Le slogan de l’ISOC : «Internet pour tous et Internet par
tous» relève encore de l’utopie.
D’une façon générale, l’Internet bouleverse les équilibres traditionnels auxquels il substitue
une nouvelle zone a-morale. L’importance de l’enjeu explique ainsi, en partie, le débat qui s’est
développé à ce propos.
Mais, au-delà de la mise en lumière des conits que suscite l’Internet, il permet également, de
manière très positive de cerner les exigences éthiques de son utilisation et de lutter ainsi contre
tout type de dépassement et de dysfonctionnement.
L’évolution extrêmement rapide de ce mass media rend dicile l’analyse prospective et
incite souvent à en exagérer l’impact. Très schématiquement, on constate en général, que les
nouvelles technologies de l’information et la communication sont présentées en des termes
souvent radicalement contradictoires. Il y’a un discours sur l’Internet et un autre de l’Internet.
La première analyse, dominante, tend à magnier la technique de l’Internet, par la démonstration
du caractère positif de ses implications sociales. Cette technologie est présentée comme un
phénomène à la fois «naturel» et «merveilleux», auquel l’homme doit nécessairement s’adapter.
L’Internet est à l’origine d’une véritable révolution qui impose le changement social à un
individu qui se contente de le subir : C’est «le rêve d’une révolution logique et propre, réalisée
par la machine, loin des tumultes de la politique et de l’idéologie, pour une humanité passive et
inerte (…). Au fond, le «progrès numérique» est un conservatisme social que le discours habille
aux couleurs du temps».15 C’est alors une rationalité scientique avec une nouvelle éthique qui
doit dominer la nouvelle organisation sociale.
A l’inverse, une autre perspective se veut critique de l’opinion dominante. Composée de courants
hétérogènes, elle présente Internet comme un instrument de pouvoir, ou tout au moins, un
outil dont la neutralité n’est qu’apparente, puisqu’elle impose sa propre logique à l’organisation
sociale et maintien ce que d’aucuns nomment la fracture numérique.16 Ce courant d’auteurs a
mis en garde contre les impacts énormes que ces technologies peuvent avoir sur les individus
et la société.
Cette distinction, opérée à propos d’une analyse «technicienne» de l’Internet, peut constituer
la trame d’une étude centrée sur l’impact de ce mass media sur les libertés publiques, car
l’Internet incite, plus généralement, à une réexion sur la protection de la vie privée. Celle-ci
est considérée comme une valeur fondamentale, rattachée même à la dignité humaine.
10-F

III.- de l’autorégulation ou l’éthique codiée
Nous n’abordons pas la régulation dans son sens économique mais simplement dans son aspect
sociétal qui prend en compte l’ensemble des règles et des institutions favorisant l’émergence
d’un cadre de vie en société ordonné et paisible. Pour l’autorégulation, nous retiendrons la
dénition de Pierre Trudel qui la dénit comme «le recours aux normes volontairement développées
et acceptées par ceux qui prennent part à une activité».17 Il s’agit donc d’une élaboration de règles
formulées et respectée par les acteurs eux-mêmes sous la forme de codes de bonne conduite18 ou
de bonnes pratiques relevant de la pure éthique, et dont ils assurent eux-mêmes l’application.
Ce système apparaît alors comme «décentralisé, non hiérarchique et confère aux normes un
caractère d’auto-exécution».19
Ces codes,20 parfois volontairement dictés par les prestataires de service Internet (ISP) se
caractérisent par leur nombre relativement élevé qui tantôt s’entrecoupent, tantôt s’en
éloignent. Dans cette panoplie de codes, il en existe même ce qu’on pourrait appeler des
micro codes que les universités ou les grandes entreprises par exemple, édictent à l’endroit de
leurs étudiants ou de leurs collaborateurs, tels que; la charte pour l’utilisation des ressources
informatiques du Crous de la Réunion, le code de bonne conduite de GDF-Suez (éthique de la
gestion d’information), le guide d’utilisation du site internet-charte de bonne conduite de la
fédération française des producteurs des végétaux d’ornement…
Contestée dans les années 9021, l’autorégulation est aujourd’hui largement admise dans son
principe auprès de la majorité des acteurs du réseau.22 Diverses études ont été menées sur cette
question. La plus importante nous semble-t-il est celle réalisée par le Internet Action Plan CODE
Projet (IAPCODE) du Programme in Comparative Media and Law Policy (PCMLP, 2003-2001) de
l’Université d’Oxford.23 Ces programmes ont débouché sur la nécessité de contrôles la conduite
(17) Pierre Trudel, « Les eets juridiques de l’autoréglementation », Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke,
(1989, vol. 19, n° 2), 251.
(18) Tels que les chartes, déclarations de droits, commandements, principes, codes de déontologie etc. Voir en
France par exemple, La charte française de l’Internet (1997), la charte d’édition électronique…
(19) Cf., Bertrand du Marais, « Analyses et propositions pour une régulation de l’Internet .» Revue électronique du
Centre de recherche en droit public (Université de Montréal, Regroupement droit et changement, Lex Electronica, vol.
7, n°2, Printemps/Spring 2002 http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/dumarais.htm.
(20) Il faut entendre par code le sens qui renvoie «davantage à une certaine manière de se comporter, propre à un groupe
social ou à une classe, dont les membres se reconnaissent entre eux par l’adhésion et la pratique de ce code et qui relève donc de
l’éthique, voire de l’étiquette, plutôt que du droit au sens strict.» Benoit Frydman et Gregory Lewkowicz, « Les codes de
conduite: source de droit global? » Working Papers du Centre Perelman de Philosophie du Droit, 2012/02, http://
wwwphilodroit.be consulté le 5 nov. 2013.
(21) Flichy, L’imaginaire d’Internet, 56.
(22) Jose Do-Nascimento, L’Internet entre acteurs publics et privés: Vers une régulation centrifuge ou centripète ? (Paris:
L’Harmattan, 2007), 34.
(23) Des questionnaires envoyés par les promoteurs de ce programme aux ns d’élaborer le schéma des attitudes
par rapport aux activités illégales (la limitation de l’accès aux publications préjudiciables aux mineurs, les propos
incitant à la haine, le multipostage par voie électronique, la protection des données et de la vie privée, les modali-
tés prévues pour les plaintes, la coopération avec les autorités chargées de l’application des lois et avec les tierces
parties, ainsi que les mécanismes de sanction).
11-F
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%