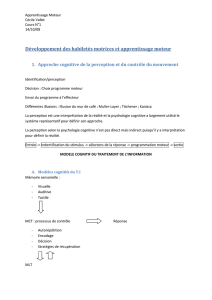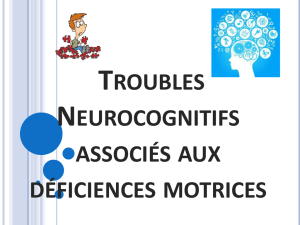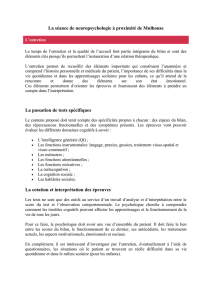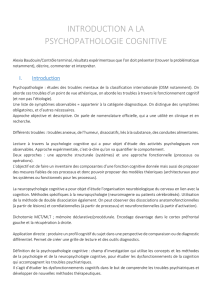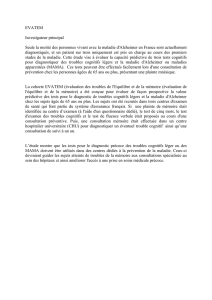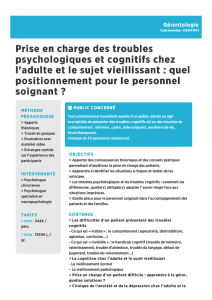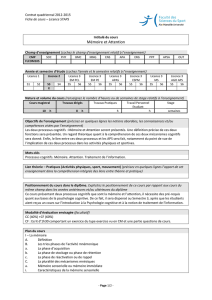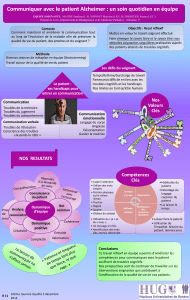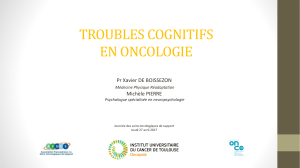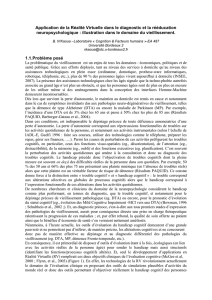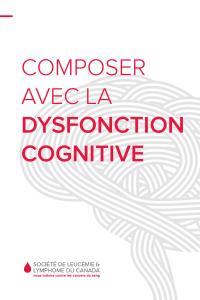Intérêts et limites de la prise en charge individuelle centrée sur la vie

08/04/2013
1
« Intérêts et limites de la prise en
charge individuelle centrée sur
la vie quotidienne dans le
vieillissement normal et
pathologique. »
Troubles cognitifs dans le vieillissement :
du vieillissement « normal » au
vieillissement « pathologique »
•« Epidémiologie galopante »
•Notion de handicap cognitif : Impact potentiellement marqué des troubles
cognitifs dans la vie quotidienne, y compris pour l’entourage
•Coût de santé publique +++
Prise en charge des troubles cognitifs
dans le vieillissement ?
•Très faible efficacité des traitements médicamenteux dans la maladie
d’Alzheimer (Massoud & Gauthier, 2010 ; HAS, 2012)
•Absence d’efficacité de traitements médicamenteux dans les troubles
cognitifs légers de la personne âgée (Gauthier et al., 2006)
Développement depuis les années 1980 d’interventions
« non-médicamenteuses » / psycho-sociales
(pour revue, voir par exemple Van der Linden, Adam et Juillerat, 2003, Rev Neurol)
Prise en charge non médicamenteuse des
troubles cognitifs dans le vieillissement ?
•Font partie intégrante de la PEC
des « démences »
•Contenu et objectifs globalement
flous et assez mal précisés
Prises en charges des troubles
cognitifs en neuropsychologie ?
Stimulation
cognitive
Entraînement
cognitif
Réhabilitation
cognitive
Trois grandes approches
(Clare et al., 2003, Rev Clin Gerontol)
Stimulation cognitive et entraînement cognitif = Approches restauratrices
Rehabilitation cognitive = Approche compensatrice
•Entraînement de la mémoire et souvent d’autres fonctions pour
En améliorer le fonctionnement (restaurer la fonction déficitaire)
En limiter/ralentir le déclin (en maintenant une activation des processus cognitifs au
moyen d’exercices répétitifs et de stimulations indifférenciées)
La plupart du temps en groupe
De plus en plus avec l’outil informatique
Apparition de nombreux programmes destinés aux professionnels, ou
au grand public
Conception « musculaire » de la mémoire
Approches restauratrices : « Stimuler les
fonctions cognitives ? »

08/04/2013
2
•Idée que l'on a intérêt à stimuler son cerveau à tous les âges de la
vie, pour augmenter la « réserve cognitive » et utiliser la plasticité
cérébrale
Approches très répandues sur le terrain (accueils de jour,
ESA, EHPAD, … )
Approches restauratrices : « Stimuler les
fonctions cognitives ? »
Approches restauratrices : Efficacité ?
•Nombreuses données sur l’efficacité potentielle de la stimulation
cognitive chez les personnes âgées sans troubles cognitifs, avec
des « troubles cognitifs légers » et présentant une maladie
d’Alzheimer (par ex : Grandmaison et al., 2001 ; Clare et al., 2003, 2004 ; Jean et al., 2010 ; Martin et
al., 2011 ; George et Withehouse, 2011 ; Woods et al., 2012 ; Orrell, Woods et Spector, 2012, …)
•Martin et al., 2011 : Revue systématique de la Cochrane Library
Efficacité de l’entraînement cognitif sur les fonctions cognitives chez
les sujets âgés « normaux » et dans le « MCI » ?
Martin M, Clare L, Altgassen AM, Cameron MH, Zehnder F, 2011,
Cochrane Database Syst Rev
Approches restauratrices : Efficacité ?
CONCLUSIONS
Peu de données intégrable à la revue (faiblesses méthodologiques)
Effets bénéfiques légers et équivalents dans les deux populations
sur le fonctionnement cognitif
Non spécifiquement attribuables aux interventions
comparable aux conditions contrôles « activités »
•George et Withehouse, 2011 : Chez sujets « normaux », les
bénéfices de « jeux cérébraux » se limitent aux tâches pratiquées,
sans généralisation significative à la vie quotidienne
•Clare et al., 2003 : Revue systématique de la Cochrane Library
Efficacité de l’entraînement cognitif et de la stimulation cognitive chez
les sujets atteints de maladie d’Alzheimer ?
Approches restauratrices : Efficacité ?
Clare L, Woods RT, Moniz Cook ED, Orrell M, Spector A., 2003 (4),
Cochrane Database Syst Rev
CONCLUSIONS
Peu de données intégrable à la revue (limites méthodologiques +++)
Pas d’effets bénéfiques sur les variables étudiées dans ces études (le
fonctionnement cognitif, l’évolution de la démence, l’humeur, le
comportement).
•Woods et al., 2012 : Revue systématique de la Cochrane Library
Efficacité de différents programmes chez les sujets atteints de
différents types de démence ?
Approches restauratrices : Efficacité ?
Woods, B., Aguirre, E., Spector, A.E., & Orrell, M., 2012 (2),
Cochrane Database Syst Rev
CONCLUSIONS
Pas d’effets sur l’humeur, les activités de la vie quotidienne simples ou
complexes, les problèmes de comportement, l’état émotionnel et le fardeau
des aidants
Amélioration modeste à des tests cognitifs, pouvant se maintenir après un suivi
de 1 à 3 mois
Effets également sur la qualité de vie, le bien-être auto-évalué, la
communication et les interactions sociales, évalués par des membres du
personnel
MAIS : Effets positifs comparables à des données obtenues sur des conditions
« activités relationnelles », sans lien avec la cognition, dans d’autres études
(Thacker, 2012)
Approches restauratrices : Limites
•Approche standardisées : Postulat implicite que les troubles sont
homogènes, MAIS :
•MAIS : Hétérogénéité majeure des troubles cognitifs dans le
vieillissement pathologique (Mc Khann et al., 2011, Alzheimers
Dement)
•MAIS : Hétérogénéité majeure des problématiques et difficultés
rencontrées dans la vie quotidienne : Notion de Handicap (OMS,
1998)
•Faible efficacité sur le fonctionnement cognitif
•Pas d’efficacité sur l’autonomie et le fonctionnement en vie
quotidienne, sur l’évolution des troubles
•Non prise en compte des aspects personnels et culturels (Buts et
souhaits, insertion dans la communauté, sentiment d’identité,
sentiment d’efficacité personnelle, etc.)

08/04/2013
3
Approche compensatrice : La
réhabilitation cognitive ?
•Prise en charge des troubles cognitifs et de leur
retentissement dans la vie quotidienne
•Approche individualisée Point de départ =
identification de buts pertinents pour la personne
et/ou son entourage
•Elaboration de stratégies spécifiques par le
thérapeute, la personne et ses proches visant à
atteindre ces buts
I. Notion de handicap = centrale dans le
domaine des prises en charge (CIDIH, 1991;
1998)
II. Evolution des connaissances sur la
maladie d’Alzheimer et les démences en
général au cours des trois dernières
décennies
Approche compensatrice : Deux points
cruciaux
Cadre conceptuel de la CIDIH
(« Classification Internationale des Déficits, Incapacités et Handicaps ». OMS, 1998)
•Les démences ne sont PAS des maladies diffuses de
l’ensemble du fonctionnement cognitif
d’une grande hétérogénéité des troubles cognitifs
d’une personne à l’autre
•Mémoire implicite
•Mémoire procédurale
•Lecture
•Expertises antérieures
de capacités cognitives préservées
Evolution des connaissances en neuropsychologie:
Mise en évidence
Approche compensatrice : La
réhabilitation cognitive
Optimiser le fonctionnement
psychologique et social de la
personne à chaque moment de
son évolution ; favoriser son
autonomie et son bien-être
En se basant sur
ses capacités
préservées
objectifs
limités
Charge de la
famille
Autonomie
Humeur
etc.
Réhabilitation cognitive : Objectifs ?
Perspective écologique :
Centrée sur la vie quotidienne
Plusieurs approches complémentaires…

08/04/2013
4
Apprentissage de nouvelles connaissances ?
•Créations de « nouveaux automatismes »
• Connaissances verbalisables, procédures motrices, …
Mémoire implicite et procédurale préservées jusqu’aux
stades les plus sévères : Mémorisation de
connaissances, de compétences ou de comportements
reste donc possible
•Ex : adresse, n° de téléphone, trajets, utilisation d’appareils de la vie
quotidienne (téléphone portable, cuisinière, etc.) , associations nom-
visage, dénomination et utilisation d’objets, localisations d’objets,
utilisation d’une aide externe…
Apprentissages en vue d’améliorer l’autonomie et le
fonctionnement de la personne, en fonction de ses buts
personnels
Quelles méthodes d’apprentissage ?
Ne pas oublier l’apprentissage sans erreurs…
•Méthode de récupération espacée permettant de faire
mémoriser une information factuelle donnée (Camp et al., 2000 ;
Erkes et al., 2009)
Utilisation de la mémoire implicite
•Acquisition de procédures via la répétition « encadrée » d’une tâche
données
•Progressivement : AUTOMATISATION de la procédure
Utilisation de la mémoire procédurale
•Efficacité des techniques d’apprentissage largement démontrée,
y compris aux stades sévères
•Nombreuses études en cas unique : Clare et al., 2000 ; 2002 ;
Adam et al., 2000 ; Camp et al., 1996, 2000 ; Fontaine et al.,
1995 ; Bird, 2001 ; Kinsella et al., 2003, etc.
•Etudes de groupe : Voir par exemple
•Bourgeois et al., 2003, J Commun Disord : Apprentissage par
récupération espacée de l’utilisation d’aides externes variées chez
des personnes présentant de troubles cognitifs modérés à sévères
•Deschamps et al., 2011, Am J Alzheimers Dis Other Demen :
Réapprentissage d’activités variées de la vie quotidienne par
apprentissage sans erreur chez des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer à des stades de léger à sévère
Apprentissage de nouvelles
connaissance : Efficacité ?
Utilisation d’aides externes ?
Confier à un support externe les opérations
cognitives hors de portée du patient
Utilisation notamment des capacités préservées de lecture
Carnet-Mémoire
Fiches d’utilisation d’un appareil
Fiches descriptives de trajets
Tableau avec tâches du jour, calendrier
Tableau, montre, etc. affichant la date
Pilulier
Supports électroniques délivrant des
messages pré-enregistrés
… presque tout est possible, selon les besoins et
capacités du patient… et l’imagination du
thérapeute !
Utilisation d’aides externes ?
Confier à un support externe les opérations
cognitives hors de portée du patient
•Nombreuses études montrant l’efficacité de l’utilisation
de supports externes pour pallier aux déficits cognitifs:
Par exemple : Bourgeois, 1990 ; Bourgeois et al., 2003 ;
Clare et al., 2000, Bird et Kinsella, 2000 ; Adam et al.,
2000
•Doivent être construits « sur-mesure » en fonction des
besoins et capacités de la personne
•Impliquent la plupart du temps un apprentissage pour
en automatiser l’utilisation !
•Implication des aidants au quotidien !!!
•PEC de l’entourage idéalement associée
Diminuer la charge du conjoint
Counseling, psychoéducation, formation à la maladie
Apprentissage de moyens pour mieux interagir avec le patient
Soutien psychologique
Soutien administratif et logistique (assistante sociale)
Réhabilitation cognitive individualisée
Améliore +++ l’efficacité d’une PEC cognitive individualisée
(Clare & Woods, 2000, Neuropsychol Rehab)

08/04/2013
5
•Revues de la littérature : Kessels et de Haan, 2003 ;
Grandmaison, 2001 ; De Vreese et al., 2001 ; Van der Linden et
al., 2003 ; Clare et al., 2003 ; Clare et Woods, 2004
•Majorité des études en cas unique : Problème pour exploiter les
données en méta-analyse (variabilité des mesures et des
protocoles)
•Manque d’études expérimentales de groupe avec groupe contrôle
randomisé
•Concluent cependant à l’efficacité des approches utilisées,
notamment sur l’autonomie dans la vie quotidienne
Réhabilitation cognitive individualisée :
Efficacité ?
•Première étude de groupe randomisée, en simple aveugle
•69 patients atteints de MA ou démence vasculaire (MMS >17/30)
•3 groupes : 1 groupe expérimental, 2 groupes contrôles
•Groupe XP : 8 séances de réhabilitation visant à répondre à des
souhaits et besoins spécifiques selon les patients et leur entourage,
en utilisant des techniques de réhabilitation et stratégies variées
•Groupes contrôles : Relaxation, pas d’intervention
•Résultats :
•Améliorations significatives des performances pour les objectifs
fixés dans la condition de réhabilitation (46% des buts
totalement atteints, 50 % partiellement)
•Satisfaction du quotidien améliorée dans la condition
réhabilitation, pour les patients et les aidants, mais pas dans els
deux autres conditions
•Démontre également que les patients atteints de démence légère
à modérée sont capables de formuler des buts et objectifs
personnels → utilisation de la « Canadian Occupation
Performance Measure » (COPM, Law et al., 2005)
Efficacité : En résumé ?
•Difficultés intrinsèques à démontrer l’efficacité des
approches compensatrices
Individualisation de la prise en charge
Pas de protocole en double aveugle : En faut-il vraiment ?)
Qu’est-ce qu’être efficace ? Quel critère ? Quid de
l’évolution dans le temps ?
•De plus en plus de données cependant
Revues de littérature indiquent des résultats favorables sur
les études en cas unique
Apparition d’études de groupe, randomisées appliquant
les principes à des buts individualisés (Bourgeois et al.,
2003 ; Clare et al., 2010 ; 2011 ; Deschamps et al., 2011)
Approches individualisées : Lieu des
interventions ?
•Au domicile ?
Intérêt +++ : Pertinence écologique
Travail avec les équipes de soins à domicile, ESA
Sans doute l’avenir… Mais formation nécessaire et implication de
professionnels capables d’intégrer els différents aspects du
fonctionnement des personnes atteintes de troubles cognitifs
(psychologues !)
•Hôpitaux de jour / Accueil de jour
•Consultations dédiées ?
•En EHPAD ?
Formation du personnel indispensable
Méthode Montessori : Données prometteuses mais encore
insuffisantes
Réhabilitation cognitive individualisée :
Limites ?
•Rapport coût/bénéfice ? Complexité des approches ?
•Nécessité +++ de développer la formation
•Intérêt surtout souligné pour les troubles cognitifs légers à
modérés ?
•Voir cependant Hopper et al., 2005 : Démarche applicable également
aux troubles cognitifs sévères, mais nécessité de simplifier les objectifs
•Méthode Montessori (Camp et al., 1989 ; Camp, 2011) : Principes de
réhabilitation individualisée appliqués aux démences sévères, en vue de
permettre la réalisation d’activités, applicable par du personnel soignant,
des familles, etc. préalablement formé
•Nécessité d’un modèle plus globale de prise en charge des
personnes présentant des troubles cognitifs, incluant également
des aspects psychopathologiques et pas uniquement cognitifs
 6
6
1
/
6
100%