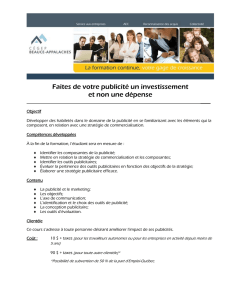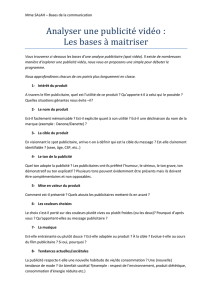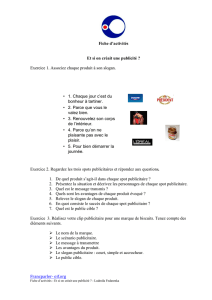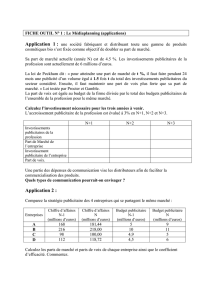Paroles de pub: les usages créatifs de la langue

STUDIA UBB PHILOLOGIA, LIX, 3, 2014, p. 97 - 110
(RECOMMENDED CITATION)
PAROLES DE PUB: LES USAGES CREATIFS DE LA LANGUE
FRANÇAISE ACTUELLE DANS LA PUBLICITE
PAOLA APPETITO1
La publicité est une grande dévoratrice de mots.
Marcel Galliot2
ABSTRACT. The words of advertising: creative usage of the modern French
language in advertising. This paper presents a study of the creative aspects of
French advertising language and aims at exploring the puns and lexical
inventions used as the main linguistic communication strategy. Its purpose is to
show the linguistic and cultural relevance of advertising through quoted and
commented examples.
Keywords: advertising language, creative processes, puns
REZUMAT. Lexicul publicității, uzaje creative ale limbii franceze actuale în
publicitate. Propunem un studiu al aspectelor creative ale limbajului publicitar
francez vizând în mod special întrebuințarea jocuriolor de cuvinte ca principală
strategie lingvistică. Dorim să arătăm, parcurgând exemplele citate și comentate,
interesul lingvistic și cultural al publicității.
Cuvinte cheie : limbaj publicitar, procedeu creativ, jocuri de cuvinte
Introduction
La publicité constitue un sujet d’étude captivant aussi bien d’un point de
vue sociologique que sur le plan linguistique. En effet, bien qu’on puisse critiquer
ses intentions mercantiles, il est indéniable qu’elle fait partie de la culture et de la
mémoire collectives et que, pour atteindre ses buts, elle utilise une langue vivante
et créative, avide de nouveautés qui influencent parfois la langue quotidienne. Ce
1 Università di Roma Tor Vergata, E-mail: [email protected]
2 Marcel Galliot cité par M. Baldini in Il linguaggio della pubblicità, le fantaparole, Armando
editore, 1996.
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-05-25 03:24:32 UTC)
BDD-A8180 © 2014 Editura Presa Universitară Clujeană

PAOLA APPETITO
98
travail analyse les aspects créatifs du langage publicitaire français et vise
notamment l’exploration des jeux de mots et des inventions lexicales utilisés
comme principale stratégie linguistique de communication. Notre but est de
relever, à partir d’exemples choisis dans un vaste répertoire de messages
publicitaires actuels, les atouts jouant en faveur d’un emploi didactique de cet
énorme patrimoine qui permet d’analyser les phénomènes socioculturels qui
soutiennent le «système langue», d’accéder indirectement à la culture française
contemporaine, d’apprendre la langue d’une manière moins conventionnelle, de
découvrir de nouvelles techniques de communication.
Publicité, culture et société
La publicité est un véhicule important de la langue, que cette dernière soit
écrite ou parlée. D’autant plus important que la publicité est quantitativement
très présente dans notre vie et que ses messages ont un impact élevé sur notre
quotidien et notre imaginaire. Profitant du passage d’une société de consommation
à une société de communication, elle est devenue de plus en plus puissante et elle
a renforcé ses positions en tant que caisse de résonance de la culture dans
laquelle elle s’inscrit en façonnant nos comportements et nos désirs. En tant que
phénomène socioculturel, elle «reflète les normes, les croyances, les systèmes de
valeurs» (HOUSSA 1993: 44) et les stéréotypes de la société, c’est une «machine à
rêves» créant ou prévenant de nouveaux besoins, un «périscope de nos attentes et
de notre avenir immédiat» (SEGUELA 1997), un miroir «déformant» (TILIETTE
1983: 196) dont le désir serait celui de nous décrire mieux que nous ne sommes.
Vil commerce ou art au service de la vie économique, la publicité demeure
en tout cas un excellent moyen d’accéder au contexte culturel d’une société, de
regarder vivre des représentations collectives, de percer un imaginaire.
Le slogan constitue à cet égard le dispositif par excellence qui, en gommant
subtilement la dimension commerciale, inscrit hyperboliquement dans la langue
les lois du miracle –vs les lois de la nature– en faisant directement appel aux
représentations de notre “potentiel imaginaire” (Baudrillard 1968: 204). Mais le
slogan est en même temps un message révélateur de la société qui le produit et le
légitime. (SANTONE 2009: 183).
Selon B. Cathelat, ce qui importe le plus dans n’importe quelle publicité
c’est que le message soit d’abord et avant tout «au diapason» (CATHELAT 2001:
68) du modèle socioculturel auquel il s’adresse; tout est fait de telle sorte que la
publicité, produit de la culture, en soit également le miroir. L. Porcher, quant à lui,
déclare, dans un travail réalisé exclusivement sur des images publicitaires
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-05-25 03:24:32 UTC)
BDD-A8180 © 2014 Editura Presa Universitară Clujeană

PAROLES DE PUB: LES USAGES CREATIFS DE LA LANGUE FRANÇAISE ACTUELLE DANS LA PUBLICITE
99
fixes non séquentielles, que «l’image publicitaire peut exprimer la totalité
d’une «culture déterminée à un moment historique donné et en un lieu donné»
(PORCHER 1976: 120)
En tant que représentation culturelle assez fidèle du groupe social auquel
elle est prédestinée, la publicité peut donc devenir un auxiliaire précieux si nous
voulons associer l’approche de la culture de l’autre à l’enseignement de sa langue.
L’intérêt d’intégrer la lecture des documents publicitaires dans un parcours
d’apprentissage de FLE est double puisque cette approche nous permet d’aborder
la dimension culturelle et interculturelle de ce phénomène tout en analysant la
spécificité des aspects linguistiques.
Publicité et langue française
La publicité et la langue française entretiennent une relation complexe: la
virtuosité rhétorique et l’art du mot juste côtoient un goût prononcé pour les
audaces de style, pas forcément «orthodoxes», et le recours aux langues
étrangères et en particulier à l’anglais (des mots comme «game», «battle»,
«goodies», «drink», «dreamteam», «playlist», «lover», «hotline», «welcome», «team»
etc., ainsi que des expressions de type «let’s go», «home sweet home», «hair
design», «speed dating», «lowcost», etc.) qui est devenu de plus en plus tentant
dans le contexte de mondialisation qui domine l’économie depuis la fin des
années 80. L’annonce publicitaire devient ainsi un «laboratoire» lexical en
constante évolution, un lieu d’innovation, de fantaisie et de renouveau langagiers
que nous proposons de mettre à profit de l’enseignement du français langue
étrangère. La publicité est souvent l’objet de critiques de la part de ses
détracteurs, selon lesquels elle altère et maltraite le français en s’autorisant des
libertés qui diffuseraient des versions impropres de la langue. Dans ce contexte,
volontiers polémique et pessimiste, les études de certains spécialistes ainsi que le
bilan 2009 de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) et la
DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France) se
veulent résolument constructifs en montrant que la publicité n’est pas forcément
un lieu d’appauvrissement et d’affaiblissement de la langue mais au contraire un
lieu de création et de circulation linguistique. En particulier, Vincenza Costantino
définit les slogans publicitaires comme «des miroirs des tendances et des modes
langagières, des évolutions et des ‘involutions’ de la langue» et elle précise que
«leur langage, emprunté à la langue courante, est manipulé sur le plan
sémantique et/ou formel. Ainsi, différemment connoté, est-il réabsorbé par la
langue et contribue parfois à l’enrichissement de celle-ci» (COSTANTINO 2000:
14). Karine Berthelot-Guiet est convaincue que,
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-05-25 03:24:32 UTC)
BDD-A8180 © 2014 Editura Presa Universitară Clujeană

PAOLA APPETITO
100
«loin d’être une simple chambre d’enregistrement des nouveautés lexicales,
[la publicité] apparaît plutôt comme une tribune d’honneur pour la néologie sous
toutes ses formes, y compris les plus exceptionnelles. La publicité assume donc un
rôle de lieu de circulation de la langue française et loin de détruire celle-ci, elle
semble être une des preuves par excellence de sa vivacité» (BERTHELOT-GUIET
2004: 34).
La publicité, à cause de son exigence de répondre à un impératif de
différenciation, de rareté, de dire l’innovation par des mots nouveaux et
inattendus qui suscitent la curiosité et la mémorisation, fait souvent recours à des
néologismes et à des jeux de mots qui apparaissent dans le texte et dans le nom
du produit ou de la marque. Ces opérations concernent le travail poétique sur la
langue: il s’agit par exemple du double sens d’un mot, «La mâche ça change de la
salade», ou bien d’un jeu de mot dans une formule figée, qui se fonde sur une trace
mémorielle préexistante: «Au printemps ne te découvres pas d’un Dim»
(BERTHELOT-GUIET 2011). Il y a enfin un autre mouvement de lexique entre
langue française et publicité concernant l’entrée dans le langage quotidien de
termes, syntagmes et expressions issues de la publicité: c’est le cas par exemple
de «c’est du béton», «positiver», «bienvenue au club», «plus blanc que blanc»
(BERTHELOT-GUIET 1998: 17), etc. Lydia Stefanova compare cette créativité du
langage publicitaire, avec sa profusion d’images et de mots toujours nouveaux, à
un «volcan socio-langagier» ne cessant jamais son activité démiurgique et
accompagnant tous les moments de la vie. Elle va jusqu’à tracer un parallèle entre
le langage poétique et le langage de la publicité. Le discours publicitaire emprunte
la plupart de ses procédés au répertoire de la rhétorique et il emploie des
«acrobaties» lexicales qui renvoient plus ou moins directement à la ferveur
créative de certains poètes. Naturellement le slogan, loin d’être tout simplement
l’étalage d’une recherche esthétique conclue en soi, vise surtout l’attention et
l’intérêt des lecteurs:
«La publicité française est poétique parce que ses moyens figuratifs se
rapprochent ou se recouvrent formellement et sémantiquement avec ceux de la
poésie. Mais fonctionnellement elle en reste très éloignée. Elle ne vise pas un effet
à long terme, mais une incitation à l’action immédiate» (STEFANOVA 1991: 184).
Denis Bachand rapproche également la publicité du discours poétique:
il désigne la publicité comme la poésie de notre temps car elle contribue «à
l’enrichissement esthétique des sociétés contemporaines. Ainsi la publicité
agirait à titre de conservateur et de transformateur de formes traditionnelles
d'expression» (BACHAND 1986: 22). À notre époque, la poésie, qui semblait avoir
disparu des activités quotidiennes, s’est en réalité déplacée vers les médias qui
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-05-25 03:24:32 UTC)
BDD-A8180 © 2014 Editura Presa Universitară Clujeană

PAROLES DE PUB: LES USAGES CREATIFS DE LA LANGUE FRANÇAISE ACTUELLE DANS LA PUBLICITE
101
occupent une grande partie de notre temps de loisir, et particulièrement vers le
discours publicitaire. Comme la poésie, la publicité s’inspire de la rhétorique
ancienne pour convaincre, mais elle est à la fois un lieu d’innovation perpétuelle.
En analysant «toutes ces stratégies polysémiques de ma(s)quillage linguistique –
et poétique– que déclenchent le slogan», Laura Santone affirme à juste titre que
«le slogan exploite, d’un côté, les ressources poétiques du langage en réalisant
avec les mots de véritables jeux d’alchimie, de l’autre côté il s’avère aussi être le
lieu où la culture exerce un rôle décisif sur la mise en place des cadres énonciatifs
choisis» (SANTONE 2009: 185).
On peut conclure cette première partie théorique de notre étude en
relevant que le langage publicitaire, loin d’être un langage ordinaire, se trouve
contraint par cette même efficacité qui doit être sa caractéristique principale à
monter bien plus haut du degré zéro de la langue. Pour faire vendre, la publicité
met en œuvre tout son art afin de sauter aux yeux du lecteur-consommateur,
susciter son intérêt et garder son attention. Il s’avère donc particulièrement
intéressant d’essayer de relever et d’analyser ses structures dominantes pour
mettre en évidence les procédés stylistiques, sémantiques et linguistiques
privilégiés.
Les procédés créatifs du langage publicitaire
L’aspect créateur des messages publicitaires concerne la sphère entière
du langage, dans toute son extension. Toute l’organisation interne du discours est
concernée par les manipulations de la parole écrite dans un but commercial. La
tendance générale est de faire coexister dans le texte des opérations graphiques,
phoniques, lexicales, syntaxiques et sémantiques afin de susciter l’ambiguïté et la
surprise: les publicitaires emploient toute sorte de jeu linguistique créé à partir
de figures de style3, formules figées, phrases célèbres, utilisation de clichés,
invention de mots nouveaux. Laura Santone parle notamment de procédés de
«contaminazione creativa» que la publicité, «discorso di per sé ibrido, meticciato»
(SANTONE 2009: 49), met en œuvre afin de produire «un’eloquenza intersemiotica
sottilmente connotata» (SANTONE 2009: 56).
En ce qui concerne notre corpus, nous avons rassemblé quelques
exemples significatifs de ces manipulations effectuées sur le langage ordinaire
afin de montrer la richesse du langage publicitaire; nous avons choisi de limiter
3 Voir à ce propos les études de Adam J-M., Bonhomme M., L’argumentation publicitaire:
rhétorique de l’éloge et de la persuasion, 1997, de Durand J. Rhétorique et image publicitaire, in
Communications, n. 15, 1970, p. 70-95 et de Santone L., Habitus retorici della seduzione nella
pubblicità dei profumi. In C. Giorcelli (Ed.), Abito e identità. Ricerche di storia letteraria e
culturale, pp. 211-224, Palermo-Roma-São Paulo, Ila Palma, 2009.
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-05-25 03:24:32 UTC)
BDD-A8180 © 2014 Editura Presa Universitară Clujeană
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%