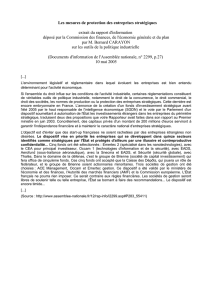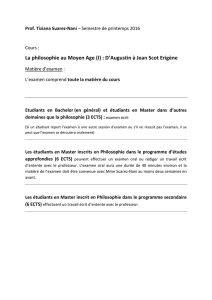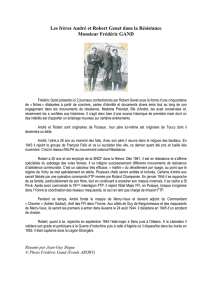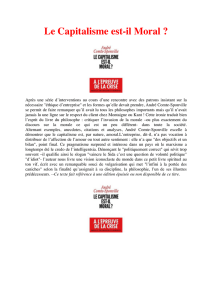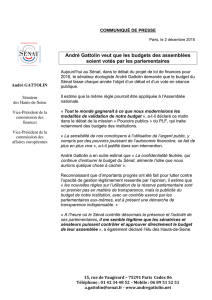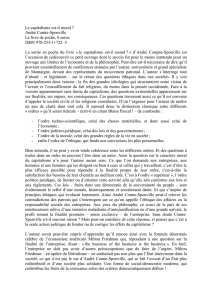André de Muralt, L`unité de la philosophie politique

André de Muralt, L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et
Suarez au libéralisme contemporain, Paris, Vrin, 2002 (Histoire de la
philosophie), 198 p.
OUT à la fois philosophe, historien de la philosophie et théologien,
André de Muralt est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages portant
sur les principales périodes de la pensée, avec une prédilection
particulière pour les périodes ancienne et médiévale1. Connu d’abord pour ses
travaux brillants sur la phénoménologie et le criticisme kantien2, il s’est par
la suite surtout intéressé aux rapports entre la pensée ancienne et surtout
médiévale et la pensée moderne, s’attachant à montrer comment les systèmes
philosophiques de l’époque moderne sont régis par des « structures de
pensées » qui se mettent en place à la fin du Moyen Âge et dont les grands
artisans ont noms Jean Duns Scot et Guillaume d’Occam.
T
Une « structure de pensée » c’est la manière dont un auteur comprend
le rapport entre termes ou concepts corrélatifs : forme et matière, intellect et
objet d’intellection, volonté et objet de volonté, corps social et forme
politique. Selon André de Muralt, c’est, chez un auteur donné, une seule et
même structure de pensée qui explique comment cet auteur conçoit le rapport
de la forme et de la matière à l’égard de la substance concrète, le rôle et la
fonction de l’intellect et de son objet dans la genèse de l’acte intellectif, le rôle
et la fonction de la volonté et de son terme dans la genèse de l’acte volitif,
1 Voir la bibliographie des œuvres d’André de Muralt jusqu’en 1999 dans le mélange
d’études en son honneur, Métaphysiques Médiévales. Études en l’honneur d’André de Muralt,
C. Chiesa et L. Freuler (éds.), Genève, Lausanne, Neuchâtel, 1999 (« Cahiers de la Revue de
Théologie et de Philosophie », 20), p. 149-157.
2 La conscience transcendantale dans le criticisme kantien. Essai sur l’unité d’aperception,
Paris, Aubier, 1958; L’idée de la phénoménologie. L’exemplarisme husserlien, Paris, PUF,
1958.
1

enfin, le rapport du corps social à l’égard de sa forme politique. Bref, la
structure de pensée d’un philosophe c’est en quelque sorte l’algorithme de son
système philosophique : Comprendre la structure de pensée d’un auteur c’est
détenir la clef de son système, voire d’une époque.
Ainsi, pour « l’aristotélisme », la forme et la matière sont
quidditativement mais non réellement distinctes; seule existe, réellement, la
substance dont elles sont les composantes « physiques »; entre la forme et la
matière règne un rapport naturel de convenance réciproque. Ainsi en va-t-il
aussi de l’intellect et de l’objet connu, de la volonté et de l’objet voulu pour
Thomas d’Aquin : l’intellect est naturellement ordonné à son objet, comme la
volonté est naturellement ordonnée au bien comme à sa cause finale.
Il en va tout autrement chez Duns Scot. Pour ce dernier, la forme et la
matière sont chacune pourvues d’une réalité propre. L’unité de la substance ne
peut donc plus s’expliquer par l’union des deux en vertu d’une relation de co-
appartenance réciproque : elle nécessite une forme unitive qui confère certes
l’unité à la chose, mais sans entamer en rien la distinction réelle de chacune
des composantes3. L’unité de la chose n’est donc plus organique, endogène si
l’on veut; c’est une unité extrinsèque, surajoutée.
Scot brise également l’unité de l’acte intellectif en introduisant entre
l’objet et le sujet un monde intermédiaire de représentations dont l’aptitude de
chacune à être pensée indépendamment des autres est l’indice de sa réalité.
L’ordre des objets de connaissances, c’est-à-dire des êtres représentés, vient
ainsi peu à peu à se substituer à l’ordre des objets tout court.
3 Henri de Gand incline déjà nettement en ce sens. Voir notre étude, « Henri de Gand,
Quolibet X, 1. Introduction, traduction et notes », Science et Esprit, 55/2 (2003), p. 197-216.
2

Enfin, sur le plan de l’acte volitif, Scot affirme le caractère
essentiellement indifférent de la volonté à l’égard de tout objet. Il rejette donc
la causalité finale de l’objet sur la volonté, en déclarant que cette dernière est
« la seule cause totale de la volition dans la volonté », pour n’accorder
finalement à l’objet voulu qu’une causalité sine qua non. (cité p. 30)
La tendance inaugurée par Scot à envisager la réalité comme
composée de principes hétérogènes se confirme et se radicalise chez Occam.
À maints égards, il est vrai, et André de Muralt en lecteur avisé des
médiévaux est loin de l’ignorer, la philosophie d’Occam est aux antipodes de
celle de Scot, les exemples bien connus de sa critique de la distinction
formelle, de son refus sans compromis d’admettre d’autres réalités que
singulières et réelles, sa conception de l’acte de connaissance ne nécessitant
aucune species sont là pour nous le rappeler. En revanche, Occam a aussi été
le continuateur de Scot dans la mesure où il a contesté comme lui, mais avec
bien plus de vigueur, notamment par son recours à l’hypothèse de la toute-
puissance absolue de Dieu, le caractère naturel, organique, du lien entre le
sujet et son objet, volitif ou intellectif. De cette radicalisation occamienne de
la tendance scotiste à considérer l’intellect et son objet, la forme et sa fin,
comme des entités absolues l’une de l’autre, de Muralt cite deux exemples
bien connus : l’hypothèse, soulevée à maintes reprises par Occam, d’une
vision intuitive d’un non existant, c’est-à-dire d’une connaissance vraie sans
objet, et le thème de la haine méritoire de Dieu, censé illustrer l’extrinsécisme
et même l’indifférence, au regard de la toute-puissance divine, de l’action
humaine par rapport à sa fin.
3

Concernant le premier point, rappelons en effet que le Venerabilis
inceptor demande en plusieurs endroits de son œuvre si Dieu pourrait se
substituer à la causalité seconde exercée par l’objet pour engendrer une
connaissance intuitive d’un objet qui n’existerait pas, question à laquelle il
répond par l’affirmative, en invoquant notamment la « fameuse proposition
des théologiens » selon laquelle Dieu peut faire directement tout ce qui est fait
par une cause seconde. La mise en œuvre de cette hypothèse par Occam aurait
pour conséquence, selon André de Muralt, de détacher la connaissance de son
objet :
Certes, il s’agit pour lui [sc. Occam] d’une hypothèse de potentia
absoluta dei, non pas d’une réalité attestée. Cette hypothèse
théologique suffit pour jeter un doute radical sur l’union du sujet à
l’objet, sur la causalité objective, formelle ou efficiente, de la chose
sur le sujet dans l’acte de connaître, en un mot sur l’objectivité du
connaître (p. 18) 4.
Le thème de la haine de Dieu a une conséquence analogue, cette fois sur le
plan de l’acte volitif : rejetant le lien nécessaire de la volonté avec un
quelconque objet, Occam affirme que Dieu pourrait de par sa toute-puissance
absolue faire que l’adultère, le vol et même la haine de Dieu soient méritoires
du salut éternel (p. 30).
Les deux cas de la vision intuitive et de la haine de Dieu sont des
applications distinctes du principe selon lequel Dieu peut faire tout ce qui
n’implique pas contradiction. La thèse de de Muralt est que la structure qui
4

conditionne la réflexion politique à l’époque moderne, et dont elle se nourrit
d’ailleurs encore actuellement, est « défini[e] par l’hypothèse occamienne de
potentia absoluta dei ». Son problème peut s’énoncer ainsi : « comment
assurer la moralité de l’action pratique en l’absence d’une intentionnalité
spontanée à ce qui est bon. » (p. 50). Car en régime occamien, la volonté
divine comme la volonté humaine, sont indifférentes et absolues vis-à-vis de
tout objet (p. 32-33). L’acte moral ne dérive sa rectitude que de l’obligation
qui lui est faite par le décret de Dieu – lequel est libre de puissance absolue de
décréter autre chose – d’agir d’une certaine façon, étant entendu qu’aucune
spontanéité propre ne la porte ou ne la prédispose à agir d’une façon de
préférence à une autre. Ainsi, la plupart des systèmes politiques de l’époque
moderne peuvent se ramener à deux types principaux : ceux pour qui la forme
politique émane de la volonté toute-puissante et absolue de Dieu (les diverses
théories du droit divin); ceux pour qui elle émanerait au contraire de la liberté
absolue de l’homme.
André de Muralt offre des exemples nombreux et saisissants de cette
dépendance des philosophies politiques modernes à l’égard de la structure
occamienne : de Suarez et Luther à l’éthique de la discussion en passant par
Spinoza, Hobbes et Rousseau et même Locke5 : autant d’exemples de la mise
en œuvre d’une même structure de pensée, modulée suivant la personnalité
propre de chaque philosophe. Prenons l’exemple du concept de « démocratie
originelle » chez Suarez. Pour le jésuite espagnol, en effet, un peuple est doté
d’une unité politique démocratique originelle, antérieure à toute constitution
positive, doctrine qui constitue une sorte d’analogue politique de la distinction
4 Voir aussi, André de Muralt, « La doctrine occamienne de la toute-puissance divine », dans
L’enjeu de la philosophie médiévale. Études thomistes, scotistes, occamiennes et
grégoriennes, Leiden, E.J. Brill, 1993, p. 393.
5 Seul Hegel semble échapper à l’emprise du mode de penser occamien. Cf. p. 82-83.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%