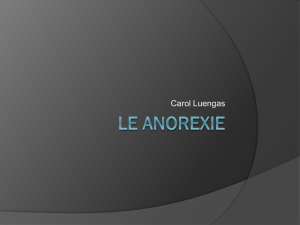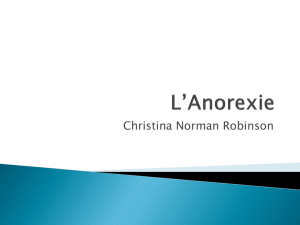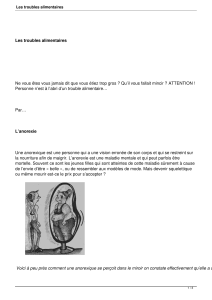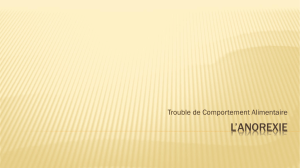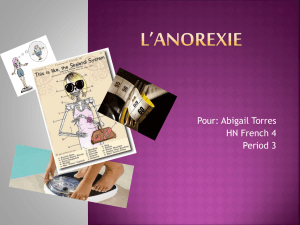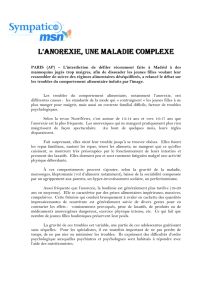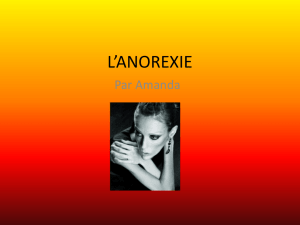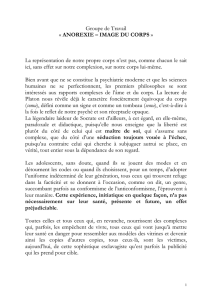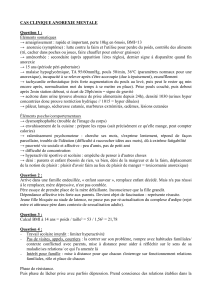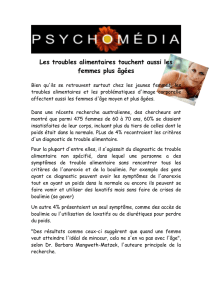Pages 1 ‹ 4 - AgEcon Search

COMPTESRENDUS
A
NDRÉ
TORRE (éd.), Le localàl’épreuvedel’économie spatiale.
Agriculture, environnement,espaces ruraux.
Paris,INRAÉditions, Collection Études et recherches surles Systèmes
Agraires et le Développement,n°33, 2002, 216 p.
Ce cahier,publié par l’INRA, illustre très bienlarichesse de la probléma-
tique et du courant de recherche sur le «local »enéconomie spatiale.Courant
de recherche en pleine éclosion depuisplus de deux décennies et qui atteint
une certaine maturitéscientifiquesil’onenjuge par cet ouvrage. Auxfacteurs
classiques facilement mesurables tels que la distance et la dotation en res-
sourcesnaturelles, la recherchesur la dimension locale des phénomènes spatio-
économiques désire parfaire nos connaissancessur des facteurs reliésaux rela-
tions de proximité, àl’atmosphère industrielle, àlacoordination des acteurs, à
l’appropriationcollective de fonctions stratégiques. Il va sans direque ces
nouveaux facteurs s’avèrent beaucoup plus difficiles àmesurer. Les sciences
humaines et socialespossèdent encore peu d’outils pourcettetâche,mêmesi
des gainsont été réalisés sousl’angle des «coûts de transaction », de «l’éco-
nomie des conventions », des «réseaux sociaux »etdes «institutions ». Dans
cetesprit, lescontributionsscientifiques livréespar cette publicationrecensée
offrent certes de nouvelles avancées méthodologiques, limitées cependant
devantles besoins, mais tout àfait réelles face aux acquisducorpus de
connaissances cumulées. Àcet égard, un chapitreintroductif de nature géné-
rale sur l’économie spatiale aurait bien servi les lecteurs peu familiers de cette
discipline en positionnant le courant concerné par ce cahier.
Deux textes majeurs d’unegrande valeur pédagogique ouvrent l’ouvragede
l’INRA, en offrant un cadre conceptuel très pertinent pourlesujet traité. Ces
textes inédits deviennent désormais des incontournablespour les chercheurs et
lesétudiants de cycles supérieurs en illustrant ce que l’ondésignecomme
étant «the state of the art».AlainRallet effectue la synthèsedelalittérature
très actuelle sur «l’économie de proximité », alors que Claude Courlet se
charge de présenter lesavancéesconceptuellesdelanotion de «systèmepro-
ductiflocalisé».Les deux auteurs nousconduisent au-delà de la présentation
fort bien articulée des composantes conceptuelles. La maturité de cescher-
cheursnousoffreune analyse critique qui bonifie substantiellementlecorpus
théorique traité en lui donnant de la perspective. Rallet démontre notamment
que la concentration géographiquedes agentss’explique davantagepar les
réseaux de relations économiques tissés au fil du temps que par les besoins
fonctionnelsdecoordination. Le contexte social et institutionnel qui sied sur
un territoire donné joue alors un rôle très important. Rôle qui n’estcertespas
facile àsaisiretàmodéliser. Comme unité d’analyse locale de ce contexte
social et institutionnel, le systèmedeproduction localisé (SPL) offre judicieu-
sement une forme d’organisationterritorialepertinente pourexpliquer les
avantages de la proximité. Il s’agit, en réalité,de«l’aire» des géographes qui
sert pertinemment àdécouper la réalité locale analysée,enl’occurrence,sous
l’angle du jeu relationnel entre les acteurs. Selon Courlet, cettenotion de SPL
tellequ’offerte parlalittérature scientifiquedemeure limitée au niveau
conceptuel. Elle ne propose pas réellement de nouveauxoutils. Il faut alors
s’en remettreaux autres sciences humainesetsociales pour saisir la dimension
118

COMPTESRENDUS
relationnelle qui structure les territoires locaux. Ce qui expliquesûrementcet
appel lancé par A. Torre àlamultidisciplinarité dans sa présentation de
l’ouvrage de l’INRA.
Àlasuite de ces deux contributions majeures, quatreséries de textes cher-
chent àillustrer le caractère opérationnel du «local »enéconomie spatiale.
Pour la majorité, cestextes variés représentent des résultats d’études de cas
trèsfouillées, livrés dans un format d’excellente qualité. Les outils d’observa-
tionetdemesure des phénomènes et problèmes ciblés sontfinementpoussés
dans leurs limitesanalytiques. De nouvelles lumières jaillissentdans la plu-
part des contributions, particulièrement àpropos de la nature de l’imbrication
des activités agricoles et agro-alimentaires dans leur espace, pourainsiformer
desterritoires ruraux. Certains textes, comme celui de Saives, possèdent un
niveauélevé de formalisation. Le texte de Filippi nous éclaire notamment sur
le rôledes coopérativesagricoles dans la structuration résiliaire de leur tissu
économique local.Tous fortintéressants,certains articlesapportentcependant
une contributionplutôt marginale par rapportaux questionsprincipales de
l’ouvrage collectif reliées àlaproximité et aux SPL. Néanmoins, la richesseet
la diversité des propos apportent du matériel très utileàl’économie spatiale,
notamment afindemieuxsaisir et comprendredésormais un phénomène cen-
tralducourant d’analyse locale.
Terminons notre compterendu en soulignant que le recours au multidisci-
plinarisme, évoqué comme potentiel dans la présentation de l’éditeur André
Torre, faitquelques pas en avant dans cetouvrage. Devant les difficultés de
saisie et de mesure des phénomènes isolés par le courant «local »enéconomie
spatiale,nul doute que les diversessciences humaines et sociales éventuel-
lement mises àcontributionpourraient apporter certaines lumières. Lumières
similaires àcelles quel’économie spatialepeut, par ailleurs, offriraux autres
disciplines. L’abolition récentedes frontières entre plusieurs payspourrait être
inspirante pourles divers scientifiques qui s’intéressentàl’espace.
Marc-UrbainPROULX
CRDT,Université du Québec, Chicoutimi
119

COMPTESRENDUS
M
URIEL
DARMON,Deveniranorexique. Uneapprochesociolo-
gique.
Paris, Éditions La Découverte,CollectionLaboratoire des Sciences
Sociales, 2003,350 p.
Si l’anorexie appartient aux thématiques àlamodedans la presse féminine
et faitl’objet d’unelittératuremédicale abondante, elle reste peu étudiée d’un
pointdevue sociologiqueetles rarestravaux existants,pourlaplupart améri-
cains, s’intéressentdavantage àl’histoire de la maladie ou au «contexte
social »deson essoràlafin du XXesiècle. C’est un toutautrepartique
Muriel Darmon adopte dans son livre « Devenir anorexique. Une approche sociolo-
gique», tiré de sa thèse de sociologie et paru aux éditions La Découverte en
2003. Elle formule le projet d’étudierl’anorexied’un pointdevue strictement
sociologique, en «mettant entre parenthèses »son caractère pathologique dont
l’analyse revientaux disciplines médicales(ce qui ne signifiepas que lesdisci-
plines médicales soient les seules àpouvoir tenir un discours légitime sur
l’anorexie). Elles’inscrit ainsi, dès l’introduction, sous le double parrainage
théorique de Durkheim et de la sociologie de la déviance.Nousreviendrons
plusloinsur l’apparent paradoxedecette inscription théorique.
La première partie de l’ouvrageest consacrée àlarestitution des enjeuxde
cetteposture disciplinaire initiale, notamment en ce qu’elle nécessitela
constitutiond’un matériauempirique spécifique :une sociologie de l’anorexie
doit avant tout se donner les moyens d’appréhender l’anorexiedirectement,
sans se cantonner àcequ’en disent les professionnels de santé, maisenaccé-
dant àlaparole des jeunes filles concernées.S’inspirant pourcefaire des
approches interactionnistes,Muriel Darmon s’attache, dans la deuxième par-
tie, àdécrire lesactivités des jeunes filles enquêtées. Elle montreque cesacti-
vitésnesont pas du tout réductiblesàunarrêtd’alimentation, mais conver-
gent vers l’organisationd’unsystème de vie, tourné vers un objectifde
transformationdesoi et qui,s’ilpasseévidemment par une modification de
l’alimentation, reposeaussisur la pratique,progressivement intensifiée,d’acti-
vitéssportives et, chose plus surprenante, sur un investissementscolaire crois-
sant.Muriel Darmon proposelanotion de «carrière anorexique» pour rendre
compte du déroulement dans le temps de ces activités. Dans une troisième
partie, elle montre que les pratiques –alimentaires, corporellesouscolaires –
des anorexiques sont socialementorientées, au sens où ellessont explicitement
tournées versl’excellence et s’avèrent être des pratiques de classessupérieures,
comme si la carrière anorexiquecorrespondait àune trajectoire ascendante
dans l’espace social des goûts et des pratiques (corporellesetculturelles).
L’anorexie n’étant pas un thème usuelpour la sociologie (du moins dans la
tradition française), la construction de l’objet occupeune partie entière de
l’ouvrage. La présentation de la littérature sur le sujet, notammentdes
approches historiques de l’anorexie(que ce soitàlapériode médiévale ou sur-
tout au XIXesiècle), permet de dégager des pistesd’analysequi pourrontêtre
reformulées pour une étude surlapériode contemporaine, qui vontdes enjeux
conflictuels autour du diagnostic d’anorexie àl’inscriptionsociale des pra-
tiques anorexiques, en passant par l’importance de la surveillance exercée par
l’entouragefamilial ou par d’autresfigures (du prêtreaumédecin).Maisle
120
1
/
3
100%