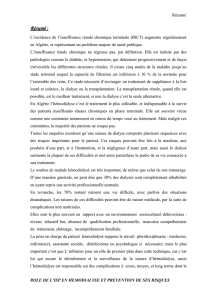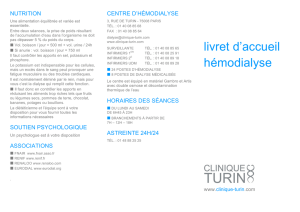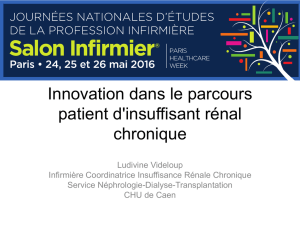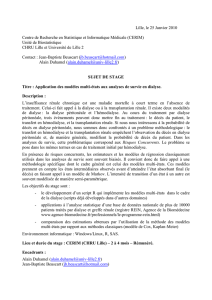Approche anthropologique d`un amalgame.

Sciences Sociales et Santé, Vol. 29, n° 3, septembre 2011
«L’hémodialyse, cette maladie».
Approche anthropologique
d’un amalgame
Aurélie Desseix*
Résumé. Certains patients insuffisants rénaux chroniques, traités par
hémodialyse, développent une représentation particulière de ce traitement
en l’amalgamant à une maladie. En partant des définitions de l’expérience
de la maladie en lien avec les notions de «rupture biographique», de
symptômes et d’exposition à la mortalité, nous avons étudié les raisons
menant à un vécu de l’hémodialyse selon ces modalités. Il apparaît que le
caractère asymptomatique de l’insuffisance rénale chronique et le
manque de représentation liée à son diagnostic ne permettent pas la prise
de conscience de la gravité de la maladie. A contrario, le traitement, par
ses effets secondaires et par les représentations liées au corps qu’il sus-
cite, expose le patient à sa vulnérabilité et à sa mortalité. Cet amalgame,
s’il devient confusion, a des conséquences négatives pour les patients
traités par hémodialyse mais aussi pour ceux traités, ensuite, par une
transplantation rénale.
Mots-clés: hémodialyse, insuffisance rénale chronique, rupture biogra-
phique, représentation, entrée dans la maladie.
doi: 10.1684/sss.2011.0303
* Aurélie Desseix, anthropologue, CHU Pellegrin Tripode, Service Transplantation
Rénale, place Amélie Raba Léon, 33076 Bordeaux Cedex, France ; aurelie.des-
L’auteur remercie vivement Isabelle Gobatto pour ses relectures et ses conseils.
Certaine références dont l’appel est dans le texte ne figurent
pas ds la liste en fin d’article. Elles sont surlignées en jaune.
Merci de compléter.
JOHN LIBBEY EUROTEXT
EPREUVES

42 AURÉLIE DESSEIX
«Alors si la dialyse n’est pas contraignante euh… Je ne connais pas
beaucoup de maladies qui le sont! » (Bernard, région bordelaise).
«Et comme je dis, la dialyse, ce n’est pas une maladie qui s’attrape,
hein?» (Serge, région bordelaise).
Deux phrases anodines au cœur des entretiens. Deux phrases que ne
relèvera pas la plupart des médecins, soignants ou proches de ceux qui les
ont prononcées mais qui révèlent pourtant un fait essentiel: pour certains
patients insuffisants rénaux chroniques, l’hémodialyse est une maladie.
L’hémodialyse est pourtant l’un (1) des traitements de l’insuffisance
rénale terminale (IRT) qui permet aux malades de survivre à cette patho-
logie mortelle. Ce traitement est une véritable substitution à la fonction
rénale (2). Le patient est piqué, «rattaché» à une machine qui a pour but
de pomper le sang, le filtrer afin de le restituer débarrassé des substances
toxiques et du liquide excédentaire qui encombrent l’organisme. Le
malade doit se plier à cette épuration trois fois par semaine durant quatre
à cinq heures, le temps de dialyse dépendant du poids pris entre deux séan-
ces. Ainsi traité, le malade voit son insuffisance rénale perdurer alors qu’il
y a encore cinquante ans il en serait mort. L’IRT fait partie de ces affec-
tions devenues chroniques grâce aux avancées médicales de la seconde
moitié du XXesiècle, au même titre que le diabète.
Pourtant lorsqu’une personne souffre d’un diabète, elle ne souffre
pas de l’insuline, lorsqu’une personne est asthmatique, elle ne souffre pas
de la Ventoline®, mais quand une personne est atteinte d’insuffisance
rénale chronique (IRC), elle est susceptible de «souffrir d’hémodialyse»,
le traitement étant alors amalgamé à une maladie. Cette constatation a été
relevée de manière récurrente au contact de personnes affectées par une
IRC et interrogées sur leur vécu. Comment comprendre cette représenta-
tion qui semble structurer l’expérience profane de l’hémodialyse ?
Comment un traitement peut-il être amalgamé à une maladie?
Un amalgame qui questionne
En préalable au développement de cette interrogation, il convient de
définir ce que nous entendons par «amalgamer». Nous utilisons ce terme
dans l’acception suivante:«Mélanger, réunir des personnes ou des cho-
(1) La dialyse péritonéale et la greffe rénale sont deux autres traitements possibles de
l’insuffisance rénale terminale.
(2) On parle d'ailleurs de « rein artificiel » à propos de la machine qui est au centre du
processus.
JOHN LIBBEY EUROTEXT
EPREUVES

« L’HÉMODIALYSE, CETTE MALADIE » 43
ses de nature, d’espèce différente» (3). Il apparaît important pour justifier
le raisonnement qui a guidé les analyses présentées ici, de préciser que si
le mot amalgamer signifie «mélanger ou réunir des choses différentes»,
il s’agit très généralement de « choses » qui peuvent être rappro-
chées.Nous faisons l’hypothèse que lorsque les patients amalgament un
traitement, l’hémodialyse, à une maladie, ce processus repose sur certains
éléments de leur expérience de la dialyse qui épousent quelques-uns des
contours d’une expérience de maladie. Mais lesquels? Quelles logiques
président à cette situation particulière d’amalgame ? Pour les patients,
l’hémodialyse est-elle une maladie supplémentaire, les malades subissant
alors non pas une mais deux maladies? Est-elle au contraire une compo-
sante supplémentaire d’une même maladie, l’IRC?
Il est intéressant de remarquer que l’association des termes dialyse et
maladie n’est pas uniquement présente dans les mots des patients mais
apparaît également dans les propos des médecins qui parlent «d’hémo-
dialyse chronique » (4). Par cet intitulé, ils décrivent le caractère régulier
des séances de dialyse, la lourdeur de ce traitement et ses effets secondai-
res. L’accolement des deux mots n’est cependant pas anodin car c’est
l’hémodialyse qui permet à un insuffisant rénal en phase terminale, nor-
malement condamné à mourir, de rester un IRC, condition que les malades
endossent jusqu’à ce que leurs reins n’assument plus que 5 % à 10 % de
leur fonction. Le processus de dégradation rénale peut s’étaler sur plu-
sieurs années mais, au terme de ce processus, si ces personnes sont encore
malades, c’est bien grâce à l’hémodialyse, ou plutôt à cause de l’hémo-
dialyse. Les patients insuffisants rénaux sont donc susceptibles de subir
successivement deux cycles de leurmaladie chronique liés mais cepen-
dant distincts car marqués par différentes spécificités.
Nous allons dans un premier temps porter attention aux premiers élé-
ments de l’expérience des patients affectés par cette maladie qu’est l’IRC,
pour comprendre ensuite comment la mise en hémodialyse s’articule dans
«la trajectoire » du patient (Strauss et al., 1975). La littérature sociolo-
gique et anthropologique offre quelques pistes de réflexions liminaires au
regard des définitions relatives à l’expérience de la maladie grave. L’une
des caractéristiques qui détermine l’entrée en maladie est la «rupture bio-
graphique » (Bury, 1982) vécue par les individus. Dans la lignée de ces
développements, nous montrerons que l’expérience de la « rupture bio-
graphique» des patients affectés par l’IRC s’établit avec la mise en place
du traitement par hémodialyse, constituant le premier pilier de l’amal-
game entre traitement et maladie.
(3) Définition Littré.
(4) Ce qui se retrouve avec l’ouvrage médical de Man et al. (1996).
JOHN LIBBEY EUROTEXT
EPREUVES

44 AURÉLIE DESSEIX
Dans un second temps, nous montrerons que l’amalgame entre trai-
tement et maladie repose également sur une perception aiguë de change-
ments corporels qui se dessinent «pour» l’entrée en dialyse, et «avec»
ce traitement par dialyse. C’est la maladie qui fait habituellement souffrir
les êtres, or, pour les patients rencontrés, c’est l’hémodialyse qui concen-
tre leur vécu douloureux. L’hémodialyse met le patient sous le coup d’un
traitement qui englobe les définitions habituellement attribuées à la
maladie chronique (Baszanger, 1986, 1991): périodicité et détérioration
lente de l’état de santé (conséquences médicales de la dialyse). Les rap-
ports que les individus entretiennent avec leurs soins ont fait l’objet d’une
importante littérature. De nombreux auteurs se sont intéressés aux raisons
de la « non compliance » des patients aux traitements (Adams et al.,
1997; Boutry et al., 2001; Conrad, 1985; DiMatteo et al., 2002; Ferreira
et al., 2010 ; Kravitz et al., 1993 ; Pound et al., 2005 ; Shoemaker et
Ramalho de Oliveira, 2008). Certains se sont plus particulièrement pen-
chés sur le vécu des patientset ont montré que les traitements, parfois dif-
ficiles à supporter, sont appréhendés comme des obligations (Collin,
2003; Shoemaker et Ramalho de Oliveira, 2008), ou encore chargés d’une
fonction symbolique (DiMatteo et al., 2002 ; Montagne, 1988; Pierron,
2009). Cependant, s’il arrive aux patients de dire que les traitements les
«rendent malades » (Aïach et al., 1989: 74), comme cela est le cas avec
la chimiothérapie ou la radiothérapie, ils ne considèrent pas pour autant
ces traitements comme une maladie mais bien comme un moyen de
«combattre» le cancer (Dany et al., 2005a, 2005b). Les patients vont jus-
qu’à être rassurés par la violence des effets secondaires du traitement,
vécus comme un « signe d’efficacité », et peuvent être réticents face à la
chimiothérapie orale (Reignier-Denois et al., 2005 ; Soum Pouyalet,
2007). De même, si les patients contaminés par le VIH et traités par tri-
thérapie «(…) construisent une représentation plus importante des effets
secondaires du traitement que celle des symptômes attribués à leur
maladie » (Ferreira et al., 2010: 32), ce qui explique en partie leur moin-
dre adhérence thérapeutique, il n’est jamais question d’un amalgame entre
un traitement et une maladie.
C’est souvent l’apparition de symptômes, révélateurs d’une anorma-
lité corporelle, qui signe l’entrée dans la maladie pour le patient. Ainsi, les
patients contaminés par le VIH et traités revendiquent que la notion de
séropositivité soit dissociée de celle de maladie (Herzlich, 1998; Pierret,
1997). Dans le cas du cancer, Soum Pouyalet (2007) fait remarquer que:
«Le cancer n’est pas une maladie qui “se voit” (…) Aussi, ce n’est pas
tant la maladie qui est “stigmatisante” mais bien le traitement de cette
maladie et ses effets secondaires définis par certaines comme “une
seconde maladie” » (Soum-Pouyalet, 2007 : 120). Dans ce cas, c’est l’ap-
JOHN LIBBEY EUROTEXT
EPREUVES

« L’HÉMODIALYSE, CETTE MALADIE » 45
parition de signes possiblement «stigmatisants» (alopécie, en particulier)
qui rapproche l’expérience du traitement et celle d’une maladie. Comme
le cancer, l’insuffisance rénale n’est pas une maladie «qui se voit». Mais
à la différence du cancer, le traitement par hémodialyse n’expose pas le
patient à une transformation physique extérieure flagrante. C’est la raison
pour laquelle nous préférons parler ici de signes que de stigmates liés à
l’hémodialyse. Nous nous intéresserons aux formes particulières prises
par ces signes (en dehors de la fatigue et des malaises) qui peuvent
conduire les patients à ressentir les changements corporels et à amalgamer
le traitement avec une maladie.
Enfin, nous montrerons que l’exposition à la mort que les patients
disent ressentir lors de la mise en place du traitement revêt un caractère
central dans l’expérience de l’hémodialyse comme maladie (Aïach et al.,
1989; Grimaldi, 2006). Nous nous efforcerons de comprendre ce qui fait
naître ce sentiment, associé au traitement — l’hémodialyse — plutôt qu’à
la maladie elle-même — l’IRT.
Ainsi, nous montrerons que la rupture biographique, l’apparition de
symptômes et de changements corporels et l’exposition à la mortalité —
éléments généralement associés à l’irruption d’une maladie et à son
développement — étayent l’amalgame que les patients font entre l’hémo-
dialyse et une maladie (5). Nous nous plaçons ainsi dans une perspective
proche de celles développées par Herzlich et Pierret (1984), Pierret (1975,
1976), ainsi que Douguet (2000) sur le caractère traumatisant de certains
traitements, sur l’infraction des techniques dans le corps des malades, et
leurs effets sur les représentations qu’ils ont de leur maladie. Ces dimen-
sions dressent les contours d’une expérience partagée de l’hémodialyse
comme maladie dans la population enquêtée (6).
(5) Peu d’écrits sur l’expérience des patients dialysés ont analysé ce phénomène. En
revanche, de nombreuses recherches ont étudié la prise en charge par les patients de
leur traitement dans une perspective interactionniste (Corbin et Strauss, 1998 ; Strauss,
1992 ; Strauss et al., 1975 ; Waissman in Aïach, 1989).
(6) Précisons que d’autres éléments contribuent à faire de l’hémodialyse une épreuve
et sont parfois convoqués par les personnes interrogées pour décrire leur relation à leur
traitement : les questions de dépendance (aux proches, aux soignants, aux ambulan-
ciers, aux caisses d’assurance et, bien sûr, à la machine), des contraintes (de lieu, d’ho-
raire, alimentaires, etc.) ou encore les sentiments de régression et d’impuissance.
JOHN LIBBEY EUROTEXT
EPREUVES
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%