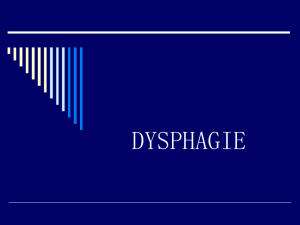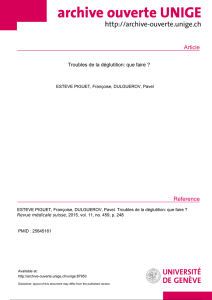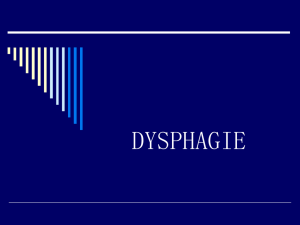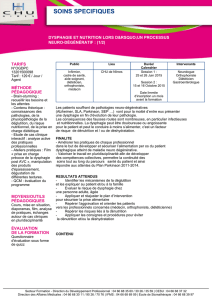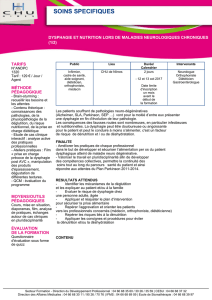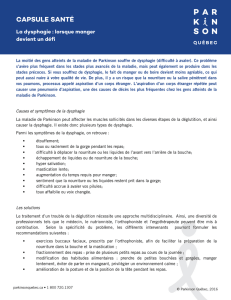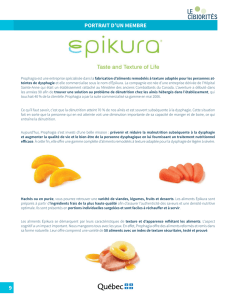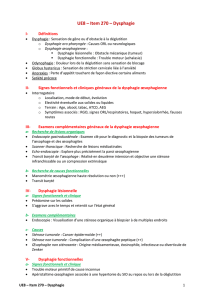Télécharger l`article au format PDF

L’Encéphale
(2012)
38,
351—355
Dis
ponib
le
en
l
igne
sur
www.science
d
irect.com
journal
h
omepage:
www.em-consulte.com/produit/ENCEP
CAS
CLINIQUE
Une
ou
des
dysphagies
lors
d’un
traitement
par
neuroleptiques
?
Dysphagia
or
dysphagias
during
neuroleptic
medication?
N.
Chaumartin∗,
M.
Monville,
B.
Lachaux
UMD
Henri-Colin,
EPS
Paul-Guiraud,
54,
avenue
de
la
République,
94800
Villejuif,
France
Rec¸u
le
8
octobre
2010
;
accepté
le
20
avril
2011
Disponible
sur
Internet
le
11
octobre
2011
MOTS
CLÉS
Dysphagie
;
Neuroleptiques
;
Fausses
routes
Résumé
La
dysphagie
est
un
symptôme
fréquent
dans
la
population
générale,
et
encore
plus
chez
le
patient
psychiatrique,
mais
rarement
considéré
comme
un
signe
de
gravité.
Elle
est
à
l’origine
de
décès
par
suffocation,
et
de
complications
plus
ou
moins
graves,
et
doit
faire
l’objet
d’une
démarche
diagnostique
complète
et
d’une
prise
en
charge
adaptée
à
l’étiologie.
Chez
le
patient
psychiatrique,
on
a
identifié,
des
étiologies
organique,
iatrogène,
et
des
facteurs
de
risque,
qui
associés,
aggravent
ce
symptôme.
Les
neuroleptiques
agissent
par
plusieurs
voies
physiopathologiques
sur
les
différentes
composantes
de
la
déglutition,
qui
peuvent
être
identifiées
par
des
épreuves
dynamiques
en
endoscopie
des
voies
aérodigestives
supérieures.
Nous
présentons
ici
le
cas
d’un
patient
traité
pour
la
première
fois
par
un
neuroleptique
pour
une
schizophrénie
paranoïde.
La
dysphagie
a
provoqué
des
fausses
routes,
des
régurgitations,
et
une
perte
de
poids.
Le
symptôme
a
disparu
à
l’arrêt
de
la
molécule
remplacée
par
une
autre,
mais
le
mécanisme
n’a
pu
être
identifié
suite
à
une
coordination
défaillante
avec
le
médecin
gastro-entérologue.
©
L’Encéphale,
Paris,
2011.
KEYWORDS
Dysphagia;
Neuroleptics;
Cafe
coronary
Summary
Introduction.
—
Dysphagia
is
a
common
symptom
in
the
general
population,
and
even
more
among
psychiatric
patients,
but
rarely
seen
as
a
sign
of
seriousness.
It
is
a
cause
of
death
by
suffocation,
and
more
or
less
serious
complications,
and
therefore
should
be
diagnosed
and
treated.
Among
psychiatric
patients,
organic
and
iatrogenic
aetiologies,
as
well
as
risk
factors
are
identified,
which
worsen
this
symptom
when
associated.
It
is
now
accepted
that
neuroleptics
can
aggravate
or
cause
dysphagia.
They
act
by
several
pathophysiological
ways
on
the
different
components
of
swallowing,
which
can
be
identified
by
dynamic
tests
in
the
upper
aerodigestive
tract
endoscopy.
Literature
findings.
—
This
symptom
is
rarely
reported
by
patients
and
often
underestimated
by
caregivers.
The
frequency
of
swallowing
disorders
is
not
known.
Dysphagia
is
a
cause
of
complications
and
an
increase
in
mortality
rates
among
psychiatric
patients.
It
has
also
been
found
that
the
average
number
of
psychotropic
drugs
in
patients
who
die
by
cafe
coronary
is
significantly
higher
than
in
other
patients.
There
are
several
phases
in
swallowing:
oral,
∗Auteur
correspondant.
Adresse
e-mail
:
nadia.chaumartin@ch-pgv.fr
(N.
Chaumartin).
0013-7006/$
—
see
front
matter
©
L’Encéphale,
Paris,
2011.
doi:10.1016/j.encep.2011.07.002

352
N.
Chaumartin
et
al.
pharyngeal,
and
oesophageal.
Swallowing
disorders
can
affect
each
of
these
phases,
or
several
at
once:
(a)
Extrapyramidal
syndrome:
dysphagia
is
present
in
drug
induced
Parkinson’s
syn-
dromes,
but
prevalence
is
not
known.
It
is
most
often
associated
with
another
symptom
of
the
extrapyramidal
syndrome,
but
can
also
be
isolated,
making
its
diagnosis
more
difficult.
Dysphagia
is
due
to
a
slowing
down
in
the
oral
and
pharyngeal
reflex,
called
bradykinesia;
(b)
Tardive
dyskinesia:
the
oro-pharyngo-oesophageal
dyskinesia
is
the
most
common
type.
Oeso-
phageal
dyskinesia
causes
asynchronous
and
random
movements
of
the
oesophagus,
resulting
in
dysphagia.
It
appears
mostly
beyond
3
months
of
treatment
with
neuroleptics;
(c)
Acute
laryn-
geal
or
oesophageal
dystonia,
associated
or
not
with
orofacial
dystonia,
is
characterised
by
an
impairment
in
the
oesophageal
muscle
contraction
and
a
hypertonia
of
the
upper
sphincter
of
the
oesophagus;
(d)
Polyphagia
or
‘‘binge
eating’’,
is
frequent
in
psychotic
patients;
(e)
Finally,
there
are
risk
factors
for
dysphagia:
xerostomia,
poor
dental
status,
advanced
age,
neurological
diseases,
polypharmacy,
sedative
drugs,
CNS
depression,
etc.,
which
worsen
the
symptom.
Case
report
Mr
J.,
aged
28,
with
no
psychiatric
history,
is
admitted
to
the
Unit
for
Difficult
Patients
in
Villejuif
for
behavioural
disorder
with
homicide
on
the
street.
The
patient
was
restrained
by
passers-by
and
suffers
a
head
injury
and
a
fracture
of
the
transverse
process
of
L1
verte-
bra.
A
cranial
CT
scan
is
performed
in
the
emergency
room,
it
is
normal.
The
patient
is
not
known
to
psychiatric
services,
and
has
never
taken
neuroleptics.
Mr
J.
is
homeless,
known
in
his
neighbourhood
for
‘‘his
noisy
delirium
on
the
street
and
repeated
alcohol
abuse.’’
After
being
arrested
by
the
police
in
this
context,
a
first
psychiatric
examination
is
conducted.
The
medical
certificate
states
that
his
condition
is
not
compatible
with
custody.
Mr
J.
remains
mute;
he
has
stereotyped
gestures
and
strange
attitudes.
No
delusion
is
verbalized.
He
receives
vials
of
loxapine
50
mg
causing
sedation.
At
his
arrival
in
the
department,
Mr
J.
has
the
same
clinical
picture,
with
a
rigid
and
inexpressive
face,
reluctance,
major
unconformity,
poor
speech.
The
search
for
drugs
in
urine
is
positive
for
cannabis.
The
diagnosis
of
schizophrenia
is
rapidly
rai-
sed,
motivating
further
prescription
of
loxapine
300
mg
daily
in
combination
with
clonazepam
6
mg
daily.
From
the
earliest
days,
dysphagia
to
solids
with
choking
and
regurgitation
is
noted,
aggravated
by
the
increase
of
loxapine
treatment
of
450
mg
/
day
to
700
mg
/
day,
7
days
after
admission.
A
physical
examination
is
performed
before
the
worsening
of
dysphagia,
it
is
normal,
and
in
particular,
reveals
no
extrapyramidal
syndrome.
An
anti-cholinergic
corrector
is
intro-
duced,
without
clinical
improvement.
A
new
physical
examination
is
performed;
it
is
normal
except
for
sedation
and
a
slight
deviation
of
the
uvula.
Upper
gastrointestinal
endoscopy
shows
no
anatomical
lesion.
No
functional
assessment
of
swallowing
is
done
however.
At
this
stage,
the
suspicion
of
neuroleptic
induced
dysphagia
appears
to
be
the
most
likely
hypothesis.
Treat-
ment
with
loxapine
is
then
stopped,
resulting
in
a
very
rapid
clinical
improvement.
Aripiprazole
15
mg
/
d
is
introduced.
Dysphagia
does
not
reoccur.
Discussion.
—
Loxapine
is
an
atypical
antipsychotic,
with
a
lower
risk
of
neurological
side
effects
than
first
generation
of
antipsychotics.
These
side
effects
are
however
numerous
and
from
diverse
pathophysiological
mechanisms.
Loxapine
is
an
antagonist
of
dopamine
and
serotonin
which
is
involved
in
the
regulation
of
several
neurotransmitters,
explaining
the
multiple
mecha-
nisms
involved
in
the
onset
of
dysphagia:
first,
blocking
dopamine
D2
receptors
in
the
striatum,
causing
motor
side-effects
of
central
origin,
in
addition
to
peripheral
effects
of
the
molecule,
which
impairs
swallowing.
In
principle,
the
antagonist
activity
on
serotonin
5-HT2A
receptors
increases
dopaminergic
activity
in
the
striatum,
reducing
the
risk
of
extrapyramidal
symptoms
and
tardive
dyskinesia,
without
avoiding
them
completely.
In
addition
to
these
mechanisms,
cholinergic
blockade
reduces
oesophageal
mobility
and
pharyngeal
reflex.
Moreover,
the
anti-
histamine,
anti-cholinergic
and
adrenergic
receptor
blocking
alpha-1
can
cause
sedation,
which
aggravates
the
symptom.
Finally,
the
depression
of
the
bulbar
centres
reduces
the
swallowing
reflex
and
gag
reflex
altering
the
intake
of
food.
Conclusions.
—The
swallowing
disorder
caused
by
neuroleptics
may
occur
regardless
of
the
molecule
or
drug
class
to
which
it
belongs.
It
can
be
found
even
in
the
absence
of
any
other
neurological
signs.
It
is
important
to
search
for
the
aetiological
diagnosis
for
treatment.
At
the
crossroads
of
several
specialties,
swallowing
disorders
are
difficult
to
diagnose
and
treat.
They
are
frequently
underestimated,
partly
because
patients
rarely
complain.
In
our
case
report,
the
diagnosis
was
ascertained
by
the
removal
of
the
medication,
without
functional
evidence,
probably
by
a
lack
of
collaboration
between
the
physician
and
the
endoscopist
who
had
not
per-
formed
any
dynamic
investigation
of
swallowing.
This
case
illustrates
the
importance
of
knowing
the
different
mechanisms
underlying
dysphagia
in
psychiatric
patients,
and
good
communication
with
gastroenterologists
to
establish
a
precise
diagnosis
of
the
disorder,
and
adapt
the
therapy.
©
L’Encéphale,
Paris,
2011.

Une
ou
des
dysphagies
lors
d’un
traitement
par
neuroleptiques
?
353
Introduction
La
dysphagie
est
un
trouble
de
la
déglutition
pouvant
entraî-
ner
des
fausses
routes,
à
l’origine
de
multiples
complications
allant
jusqu’au
décès.
Ce
symptôme,
fréquent
dans
la
popu-
lation
générale,
était
également
connu
et
fréquent
chez
les
patients
psychiatriques
avant
l’avènement
des
psycho-
tropes
[5].
Il
est
maintenant
reconnu
que
les
neuroleptiques
provoquent
et
aggravent
la
dysphagie
[2,5].
Les
troubles
de
la
déglutition
sont
peu
abordés
en
psy-
chiatrie.
Dans
la
littérature,
les
études
portant
sur
les
effets
indésirables
neurologiques
des
psychotropes
n’évoquent
que
peu
les
troubles
de
la
déglutition,
et
la
prévalence
et
les
mécanismes
de
ce
symptôme
ne
sont
pas
abordés
le
plus
souvent.
Les
étiologies
en
sont
nombreuses
et
de
mécanismes
variés.
Toute
dysphagie
nécessite
une
démarche
diagnos-
tique
précise
car
les
traitements
et
le
pronostic
de
cette
affection
dépendent
de
sa
cause.
Nous
décrirons
les
caractéristiques
épidémiologiques
et
physiopathologiques
des
dysphagies
rencontrées
chez
le
patient
psychiatrique,
ainsi
que
le
rapport
aux
neurolep-
tiques,
puis
nous
présenterons
un
cas
clinique
survenu
à
l’unité
pour
malades
difficiles
Henri-Colin
de
Villejuif,
démontrant
les
difficultés
diagnostiques
rencontrées.
Épidémiologie
La
fréquence
des
troubles
de
la
déglutition
est
difficile
à
connaître.
Le
taux
de
mortalité
en
France
dans
la
popula-
tion
générale
en
rapport
avec
une
suffocation
par
trouble
de
la
déglutition
est
de
5,99
cas
pour
100
000
chez
les
hommes,
et
6,1/100
000
chez
les
femmes
d’après
les
données
les
plus
récentes
(1999)
de
l’institut
national
d’études
démogra-
phiques
(INED)
[13].
La
dysphagie
est
à
l’origine
de
complications,
et
d’une
surmortalité
chez
les
patients
psychiatriques
par
rapport
à
la
population
générale
décrite
dans
une
étude
de
mortalité
chez
des
patients
schizophrènes
[2].
Il
était
apparu
que
le
nombre
moyen
de
psychotropes
chez
les
patients
décédés
par
fausse
route
était
nettement
supérieur
à
celui
des
autres
patients
décédés.
Les
étiologies
La
déglutition
comprend
des
phases
:
orale,
pharyngée,
et
œsophagienne.
Dans
le
trouble
de
déglutition,
l’atteinte
peut
intéresser
chacune
de
ces
phases,
voire
plusieurs
à
la
fois.
On
distingue
quatre
étiologies
principales
du
trouble
de
la
déglutition
chez
les
patients
psychiatriques.
Ce
sont
:
•
le
syndrome
extrapyramidal
[5,11].
La
dysphagie
est
pré-
sente
chez
50
%
des
patients
porteurs
d’une
maladie
de
Parkinson,
elle
est
également
très
fréquente
dans
les
syn-
dromes
parkinsoniens
secondaires
sans
que
l’on
puisse
en
donner
une
prévalence
[4].
Elle
est
le
plus
souvent
asso-
ciée
à
un
autre
symptôme
du
syndrome
extrapyramidal,
mais
peut
également
être
isolée,
rendant
son
diagnostic
plus
difficile
[3,12].
La
physiopathologie
de
cette
dyspha-
gie
correspond
à
un
ralentissement
de
la
phase
orale
et
du
réflexe
pharyngé,
appelée
bradykinésie
[3]
;
•
les
dyskinésies
tardives
[5].
La
forme
oro-pharyngo-
œsophagienne
est
la
plus
fréquente
et
peut
être
isolée.
Les
dyskinésies
œsophagiennes
correspondent
à
des
mouvements
œsophagiens
asynchrones
et
aléatoires,
entraînant
des
fausses
routes,
des
régurgitations,
et
des
inhalations.
Elles
apparaissent
au-delà
de
trois
mois
de
traitement
par
neuroleptiques
[1]
;
•
plus
rarement,
la
dystonie
aiguë
laryngée
ou
œso-
phagienne
[7—9],
associée
ou
non
a
des
dyskinésies
orofaciales,
est
caractérisée
par
une
réduction
des
contractions
musculaires
œsophagiennes
et
une
hyperto-
nie
du
sphincter
supérieur
de
l’œsophage,
plus
rare
avec
les
neuroleptiques
atypiques
et
dose
dépendante
;
•la
polyphagie
[5]
ou
frénésie
alimentaire,
fréquente
chez
les
patients
psychotiques
est
également
grande
pour-
voyeuse
de
fausses
routes,
sans
qu’il
s’agisse
d’une
dysphagie
à
proprement
parler
;
•
il
existe
enfin
des
facteurs
de
risque
favorisant
les
dys-
phagies
:
la
xérostomie,
le
mauvais
état
dentaire,
l’âge
avancé,
les
pathologies
neurologiques,
la
polymédication,
le
reflux
gastro-œsophagien,
les
médicaments
sédatifs,
la
dépression
du
SNC,
etc.
[5].
Le
diagnostic
Le
diagnostic
de
dysphagie
était
autrefois
réalisé
par
la
vidéoradiographie
avec
étude
dynamique
de
la
déglutition
d’un
bolus
baryté,
ou
par
la
manométrie
œsophagienne.
De
plus
en
plus,
la
fibroscopie
gastrique
avec
évaluation
fonctionnelle
de
la
déglutition
tend
à
remplacer
les
autres
examens,
dans
la
mesure
où
celle-ci
permet
d’observer
les
différentes
phases
de
la
déglutition
en
temps
réel,
sans
irra-
dier
le
patient
[3,10].
La
prise
en
charge
La
complication
la
plus
grave
de
la
dysphagie
est
le
décès
par
suffocation.
Les
autres
sont
représentées
par
:
l’inhalation,
la
pneumopathie,
l’anorexie
réactionnelle,
la
perte
de
poids
[3].
Ce
symptôme
est
rarement
déclaré
spontanément
par
les
patients
et
souvent
même
sous-estimé
par
les
soignants
en
milieu
hospitalier.
La
prise
en
charge
se
fait
à
plusieurs
niveaux.
La
préven-
tion
passe
par
la
limitation
des
associations
de
médicaments
anticholinergiques
et
dopamine
bloqueurs.
Lorsqu’une
dysphagie
est
constatée,
des
mesures
peuvent
être
prises
lors
des
repas,
telles
que
l’éducation
du
patient
à
la
prise
alimentaire
(limiter
le
volume
et
la
vitesse
d’ingestion
des
aliments).
La
formation
des
soignants
aux
gestes
de
survie,
notamment
la
manœuvre
de
Heimlich
en
cas
de
suffocation
a
également
son
importance
pour
réduire
le
risque
de
mortalité.
Une
rééducation
par
un
orthophoniste
peut
aussi
être
ini-
tiée.
Aucun
traitement
médicamenteux
n’a
vraiment
fait
la
preuve
de
son
efficacité
pour
corriger
ce
symptôme,
il
faut
notamment
éviter
les
correcteurs
anti-parkinsoniens.
Cas
clinique
M.
J.,
marocain,
âgé
de
28
ans,
sans
antécédents
psy-
chiatriques,
est
admis
à
l’unité
pour
malades
difficiles

354
N.
Chaumartin
et
al.
de
Villejuif
en
hospitalisation
d’office
pour
des
troubles
du
comportement
avec
acte
d’homicide
et
tentative
d’homicide
sur
la
voie
publique.
Au
cours
de
son
passage
à
l’acte,
le
patient
est
maîtrisé
par
des
passants
et
subit
notamment
un
traumatisme
crânien
avec
plaies
du
cuir
che-
velu,
et
une
fracture
de
l’apophyse
transverse
de
la
vertèbre
L1.
Un
scanner
cérébral
est
réalisé
lors
de
son
passage
aux
urgences.
Il
est
normal.
Le
patient
n’a
par
ailleurs
aucun
antécédent
médical
ni
chirurgical.
Il
n’est
pas
connu
des
services
de
psychiatrie,
et
n’a
jamais
pris
de
neuroleptiques.
M.
J.
est
sans
domicile
fixe,
connu
des
habitants
de
son
quartier
pour
«ses
bruyants
délires
en
pleine
rue
et
des
alcoolisations
répétées
».
Après
avoir
été
interpellé
par
les
forces
de
l’ordre
dans
ce
contexte
de
passage
à
l’acte
hétéro-agressif
par
arme
blanche,
un
premier
examen
psychiatrique
est
réalisé.
Le
certificat
mentionne
que
son
état
n’est
pas
compatible
avec
une
garde
à
vue,
M.
J.
présente
une
réticence,
reste
mutique.
On
note
une
stéréotypie
gestuelle
ainsi
que
des
attitudes
bizarres.
Aucune
idée
délirante
n’est
verbalisée.
Il
rec¸oit
alors
un
traitement
sous
forme
injectable
associant
quatre
ampoules
de
loxapine
de
50
mg
provoquant
une
séda-
tion
importante.
À
son
arrivée
dans
le
service,
M.
J.
présente
le
même
tableau
clinique,
avec
un
faciès
figé
et
inexpressif,
une
réticence,
une
discordance
majeure,
un
discours
pauvre
(barrière
de
la
langue).
La
recherche
de
toxiques
urinaires
est
positive
au
cannabis.
Le
diagnostic
de
schizophrénie
est
rapidement
posé,
motivant
la
poursuite
du
traitement
symptomatique
par
loxapine
300
mg
par
jour
associé
à
du
clonazépam
6
mg
par
jour.
Dès
les
premiers
jours,
une
dysphagie
aux
solides
avec
fausses
routes
et
régurgitations
est
constatée,
aggravée
par
la
majoration
du
traitement
par
loxapine
de
450
mg/j
jusqu’à
700
mg/j,
sept
jours
après
son
hospitalisation.
Un
examen
somatique
est
réalisé
devant
l’aggravation
de
la
dysphagie,
il
est
normal,
et
notamment,
ne
révèle
pas
de
syndrome
extra-pyramidal.
Un
correcteur
anti-
cholinergique
est
introduit,
sans
aucune
amélioration
clinique.
Un
nouvel
examen
somatique
est
réalisé,
il
reste
nor-
mal
en
dehors
d’une
sédation
et
d’une
légère
déviation
de
la
luette.
Devant
ce
tableau,
une
endoscopie
des
voies
aériennes
et
digestives
supérieures,
ainsi
qu’un
avis
neuro-
logique
sont
programmés.
L’endoscopie
digestive
haute
ne
montre
pas
de
lésion
anatomique
et
ne
retrouvera
qu’une
gastrite
à
gros
plis.
Aucune
évaluation
fonctionnelle
de
la
déglutition
n’est
cependant
réalisée
pendant
le
geste.
Le
neurologue
retrouve
un
examen
normal
en
dehors
d’un
réflexe
nauséeux
faible.
À
ce
stade,
la
suspicion
d’une
dysphagie
due
aux
neu-
roleptiques
apparaît
être
l’hypothèse
la
plus
probable.
Le
traitement
par
loxapine
est
alors
suspendu
dans
les
jours
suivant
les
résultats
de
l’endoscopie,
entraînant
une
amé-
lioration
très
rapide
de
la
symptomatologie.
Le
traitement
de
fond
introduit
est
l’aripiprazole
15
mg/j.
La
dysphagie
n’est
pas
réapparue.
Le
diagnostic
retenu
est
celui
de
dysphagie
par
bra-
dykinésie
isolée,
sans
autres
symptômes
du
syndrome
extra-pyramidal.
Cela
pose
tout
de
même
la
question
de
sa
physiopathologie,
car
bien
que
reproduisant
les
troubles
de
déglutition
de
la
maladie
de
Parkinson,
les
caractéristiques
sémiologiques
de
cette
dysphagie
sont
assez
contradictoires
avec
son
appartenance
à
un
syndrome
parkinsonien.
Le
facteur
médicamenteux
La
loxapine
est
un
des
premiers
neuroleptiques
atypiques
découverts,
dont
le
risque
d’induire
des
effets
indésirables
neurologiques
est
réduit
à
environ
un
tiers
des
patients.
Ces
effets
indésirables
restent
cependant
nombreux
et
de
mécanismes
physiopathologiques
variés.
La
loxapine
est
un
antagoniste
de
la
dopamine
et
de
la
sérotonine
qui
intervient
dans
la
régulation
de
plusieurs
neu-
rotransmetteurs,
expliquant
la
multiplicité
des
mécanismes
provoquant
l’apparition
d’une
dysphagie.
Tout
d’abord,
le
blocage
des
récepteurs
D2
de
la
dopa-
mine
dans
le
striatum,
entraîne
des
effets
indésirables
moteurs
d’origine
centrale,
s’ajoutant
à
des
effets
périphé-
riques
de
la
molécule,
et
qui
altèrent
la
déglutition
[6].
En
principe,
l’activité
antagoniste
sur
les
récepteurs
sérotoni-
nergiques
5-HT2A,
augmente
l’activité
dopaminergique
dans
le
striatum,
réduisant
le
risque
de
symptômes
extrapyrami-
daux
et
de
dyskinésies
tardives,
sans
pour
autant
les
éviter
complètement.
À
ces
mécanismes
s’ajoute
le
blocage
cho-
linergique
qui
réduit
la
mobilité
œsophagienne
et
le
réflexe
pharyngé
[6].
Par
ailleurs,
les
effets
antihistaminiques,
anti-cholinergiques
et
le
blocage
des
récepteurs
adréner-
giques
alpha-1
peuvent
provoquer
une
sédation
qui
aggrave
le
symptôme.
Enfin,
la
dépression
des
centres
bulbaires
réduit
les
réflexes
de
déglutition
et
le
réflexe
pharyngé
alté-
rant
l’ingestion
de
trop
gros
aliments.
Un
case
report
de
Dziewas
et
al.
avec
revue
de
litté-
rature
recense
les
différents
types
de
dysphagies
induites
par
les
neuroleptiques
;
sur
11
cas
rapportés,
huit
sont
en
rapport
avec
la
prescription
d’antipsychotiques
typiques,
et
trois
d’antipsychotiques
atypiques.
Il
apparaît
que
la
dys-
phagie
peut
survenir
à
n’importe
quel
âge.
Elle
survient
dans
le
cadre
d’un
syndrome
extrapyramidal
(4
cas)
d’origine
iatrogène
ou
de
fac¸on
isolée
(6
cas).
Le
délai
d’apparition
des
symptômes
après
l’introduction
d’un
neuroleptique
est
variable,
allant
de
quelques
jours
à
trois
mois,
avec
une
majorité
de
patients
ayant
des
troubles
de
la
déglutition
à
partir
du
premier
mois
(82
%)
[3].
Un
autre
case
report
de
Sokoloff
décrit
une
dysphagie
par
bradykinésie
lors
du
trai-
tement
par
la
loxapine,
évoluant
favorablement
à
l’arrêt
de
celle-ci
[11].
Discussion-Conclusion
Les
troubles
de
la
déglutition
dus
aux
neuroleptiques
peuvent
survenir
quelle
que
soit
la
molécule
ou
la
classe
médicamenteuse
à
laquelle
elle
appartient.
Ils
sont
à
rechercher
même
en
l’absence
de
signes
neurologiques
asso-
ciés.
La
recherche
étiologique
est
importante
à
réaliser.
Au
carrefour
de
plusieurs
spécialités,
les
troubles
de
la
déglutition
sont
difficiles
à
diagnostiquer
et
à
prendre
en
charge.
Ils
sont
fréquemment
sous
estimés,
en
partie
car
les
patients
s’en
plaignent
rarement.
Dans
le
cas
de
notre
patient,
le
diagnostic
s’est
fait
par
élimination
d’une
cause
organique,
sans
preuve
fonction-
nelle,
probablement
par
un
manque
de
collaboration
entre

Une
ou
des
dysphagies
lors
d’un
traitement
par
neuroleptiques
?
355
le
médecin
généraliste
du
patient
et
le
gastro-entérologue
qui
n’a
donc
pas
réalisé
d’examen
dynamique
de
la
déglu-
tition.
Cela
souligne
l’importance
de
la
connaissance
des
différents
mécanismes
sous-tendant
une
dysphagie
chez
le
patient
psychiatrique,
et
une
bonne
communication
avec
les
médecins
gastro-entérologues
afin
d’établir
un
diagnostic
précis
du
trouble,
et
d’adapter
la
prise
en
charge.
Déclaration
d’intérêts
Les
auteurs
déclarent
ne
pas
avoir
de
conflits
d’intérêts
en
relation
avec
cet
article.
Références
[1] Bourgeois
M.
Les
dyskinésies
tardives
des
neuroleptiques.
Psy-
chol
Med
1987;19(10):1731—4.
[2]
Casadebaig
F,
Philippe
A.
Mortalité
chez
des
patients
schi-
zophrènes.
Trois
ans
de
suivi
d’une
cohorte.
Encéphale
1999;XXV:329—37.
[3] Dziewas
R,
Warnecke
T,
Schnabel
M,
et
al.
Neuroleptic-induced
dysphagia:
case
report
and
literature
review.
Dysphagia
2007;22:63—7.
[4]
Edwards
LL,
Pfeiffer
RF,
Quigyley
EMM,
et
al.
Gastrointestinal
symptoms
in
Parkinson’s
disease.
Mov
Disord
1991;6:151—6.
[5]
Fioritti
A,
Giaccotto
L,
Melega
V.
Choking
incidents
among
psychiatric
patients:
retrospective
analysis
of
thirty-one
cases
from
the
West
Bologna
psychiatric
wards.
Can
J
Psychiatry
1997;42:515—20.
[6] Leopold
NA.
Dysphagia
in
drug-induced
parkinsonism:
a
case
report.
Dysphagia
1996;11:151—3.
[7]
Mann
SC,
Cohen
MM,
Boger
WP.
The
danger
of
laryngeal
dysto-
nia.
Am
J
Psychiatry
1979;136:1344—5.
[8]
Menuck
M.
Laryngeal-pharyngeal
dystonia
and
haloperidol.
Am
J
Psychiatry
1981;138:394—5.
[9]
Moss
HB,
Green
A.
Neuroleptic-associated
dysphagia
confirmed
by
esophageal
manometry.
Am
J
Psychiatry
1982;139:4.
[10]
Pouderoux
P.
Troubles
de
la
déglutition
:
étiologies
et
prise
en
charge.
Hépato-Gastro
1999;6(4):247—57.
[11]
Sokoloff
LG,
Pavlakovic
R.
Neuroleptic-induced
dysphagia.
Dys-
phagia
1997;12:177—9.
[12]
Stewart
JT.
Reversible
dysphagia
asssiciated
with
neuroleptic
treatment.
J
Am
Geriatr
Soc
2001;49:1260—1.
[13]
www.ined.fr
:
taux
de
mortalité
par
suffocation
dans
la
popu-
lation
générale.
1
/
5
100%