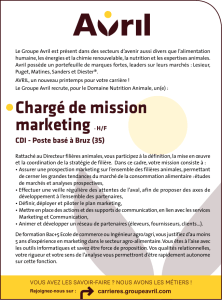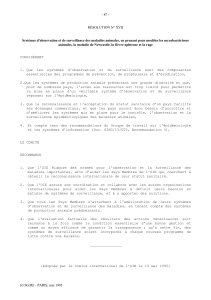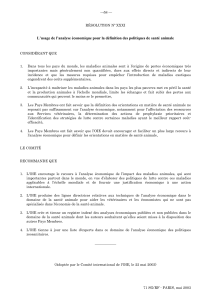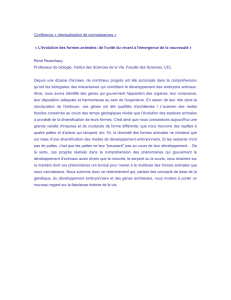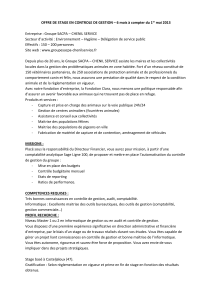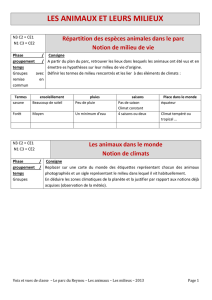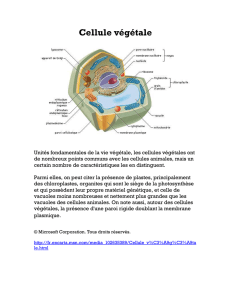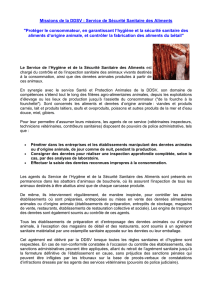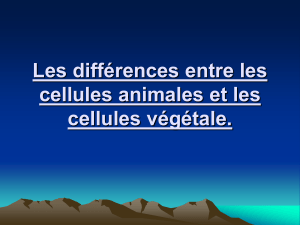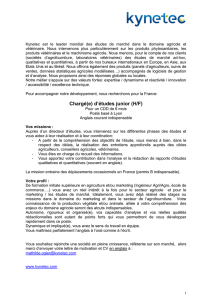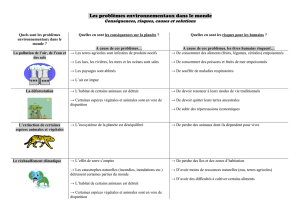l`usage de l`analyse économique

L’USAGE DE L’ANALYSE ÉCONOMIQUE
POUR LA DÉFINITION DES POLITIQUES DE SANTÉ ANIMALE
Andrew James
Veterinary Epidemiology & Economics Research Unit, The University of Reading
School of Agriculture, Policy & Development, Reading RG6 6AR, Royaume-Uni
Original : anglais
Résumé : Les maladies animales ont un impact évident et direct sur la production. Elles ont
également des effets socio-économiques indirects moins patents, difficiles à mesurer, mais qu’il est
important de prendre en compte lors des prises de décisions en matière de politique de lutte contre
ces maladies. Un questionnaire a été diffusé aux 162 Pays Membres de l’OIE pour évaluer le
recours actuel à l’économie de la santé animale et les besoins futurs en la matière. Les 124 pays
qui ont répondu au questionnaire ont tous manifesté un vif intérêt pour le sujet, et ont fait savoir,
en grande majorité, qu’ils avaient besoin de faire reposer leurs prises de décisions concernant le
contrôle des maladies animales sur un plus grand nombre d’analyses économiques. La plupart des
pays ont jugé utile d’avoir accès aux résultats non publiés des analyses économiques réalisées
dans d’autres pays. La préparation d’un guide à utiliser en vue de réaliser une analyse
économique des maladies animales et la création d’ateliers régionaux pour faciliter l’utilisation de
ces analyses ont fait l’objet d’une forte demande.
1. INTRODUCTION
On considère dans le présent rapport que l’impact économique intègre l’ensemble des effets produits, dont
certains peuvent être mesurés en termes monétaires (par ex., pertes de production ou commerciales) et d’autres
pas (par ex., souffrance humaine ou sécurité alimentaire). L’analyse économique, par opposition à l’analyse
financière, doit prendre en compte l’ensemble des coûts et des bénéfices, que l’on puisse ou non leur attribuer un
prix de marché. Son objectif est de guider le processus de prise de décision en faveur de la société dans son
ensemble. Il n’en demeure pas moins que l’analyse financière est une composante importante de l’analyse
économique des maladies animales, puisqu’elle révèle la motivation financière des propriétaires d’animaux dans
les prises de décision concernant la lutte contre les maladies animales. Même si cette lutte profite à la société
toute entière, les propriétaires d’animaux ne sont pas disposés à subir des pertes financières pour que d’autres en
tirent avantage.
Les maladies animales provoquent, directement et indirectement, des pertes économiques. Elles entraînent des
pertes directes parmi lesquelles figurent les animaux morts et les pertes de production, et des pertes indirectes,
notamment les coûts engendrés par le contrôle et la prévention des maladies. Ainsi, une maladie animale peut
avoir un impact économique, même là où elle n’est pas présente, si des mesures préventives sont nécessaires
pour l’éviter.
L’analyse économique peut servir à établir si des investissements dans la lutte contre les maladies animales se
justifient, et aussi à comparer le rapport coût-efficacité des autres stratégies visant à juguler une maladie donnée.
Au cours des trente dernières années, les techniques d’analyse économique appliquées au contrôle des maladies
animales ont été plus fréquemment utilisées, mais la plupart des résultats restent dans la littérature ‘grise’ des
rapports non publiés des gouvernements et des agences internationales. L’auteur a pu constater que la plupart des
évaluations montrent que l’investissement dans le contrôle des maladies de la Liste A et de la Liste B de l’OIE
produit un rapport coût-bénéfice économique très élevé à condition qu’il soit techniquement réalisable. Il est
important de formuler cette réserve car de nombreux pays ne disposent pas de moyens efficaces et durables
permettant d’appliquer des programmes nationaux de prophylaxie. Toutefois, il est devenu de plus en plus
courant, ces dernières années, que des ressources provenant d’organisations non gouvernementales et du secteur
privé soient affectées aux services vétérinaires d’État. Le contrôle des maladies épidémiques (principalement les
maladies de la Liste A) pose un problème supplémentaire aux pays ayant des frontières terrestres étendues et
« perméables ». Dans ces cas, la coordination internationale a permis de mener à bonne fin le contrôle, voire

l’éradication de la maladie, comme l’illustrent certains programmes de lutte contre la fièvre aphteuse en
Amérique du Sud, et contre la peste bovine en Afrique et en Asie.

Une analyse récente des aspects économiques de la fièvre aphteuse (James et Rushton, 2003) a permis d’établir
que l’ensemble des études passées en revue aboutissait à la conclusion suivante : un certain degré de contrôle
produit des retombées économiques positives. Quand elle était possible, l’éradication a généralement été la
politique la plus économique puisqu’elle a permis d’éviter les coûts à long terme de la vaccination. Toutefois,
dans les cas où l’éradication ne faisait pas partie des solutions envisagées, les stratégies de vaccination à long
terme produisaient encore des retombées économiques positives. D’après les données recueillies par l’auteur (par
ex., James et Ellis, 1978) la vaccination dans les systèmes à faible rapport et à faible rendement peut aussi
produire des retombées économiques positives, de même qu’elle peut améliorer la protection des animaux ayant
une bonne production dans la même région. Il ne fait pas de doute qu’un investissement accru en faveur de la
lutte contre les maladies de la Liste A serait économiquement justifié, d'autant plus si on prend en compte des
facteurs tels que la sécurité des moyens de subsistance et de l’approvisionnement alimentaire. Ce n’est pas une
coïncidence si les pays les plus pauvres sont ceux qui ont tendance à être les plus touchés par les maladies de la
Liste A : ils ne disposent pas des ressources qui leur permettraient de réaliser des investissements très utiles dans
la lutte contre les maladies.
Dans une perspective internationale, cette situation représente une menace économique pour le monde entier. Le
coût de l’épizootie de fièvre aphteuse de 2001 au Royaume-Uni a été estimé à plus de 12 milliards de dollars EU
(Anderson, 2002). En outre, les coûts engendrés à l’échelle mondiale par la prévention de l’introduction des
maladies exotiques sont énormes, mais ils n’ont pas été chiffrés. Au-delà des coûts directs liés à la prévention, la
distorsion des marchés internationaux et du commerce des produits d’origine animale inflige d’énormes pertes
économiques aux importateurs potentiels, ainsi qu’aux exportateurs.
Les nombreuses analyses économiques non publiées réalisées par l’auteur révèlent qu’il est possible de réaliser
d’importantes réductions de coûts en ajustant la stratégie appliquée aux programmes permanents de prophylaxie.
De ce fait, pour de nombreux pays, un investissement accru dans l’analyse économique des programmes de
prophylaxie produirait en soi des retombées économiques positives en améliorant le rapport coût-efficacité de
l’investissement dans la lutte contre les maladies.
Le présent rapport a pour objectif d’évaluer le degré d’utilisation de l’analyse économique pour guider la prise
de décision en matière de politique zoosanitaire, l’intérêt pour les services vétérinaires de recourir plus largement
aux analyses économiques et les moyens qui permettraient de faciliter une utilisation accrue des analyses
économiques des maladies animales.
Un questionnaire a été adressé aux 162 Pays Membres de l’OIE, dont 125 ont répondu : l’Afghanistan, l’Afrique
du Sud, l’Algérie, l’Allemagne, Andorre, l’Angola, l’Australie, l’Autriche, l’Azerbaïjan, le Bahreïn, la Barbade,
la Belgique, le Bénin, la Biélorussie, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Burkina Faso, le
Canada, le Chili, Chypre, la Colombie, le Congo, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Croatie, Cuba, le Danemark,
l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, l’Erythrée, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis d’Amérique, l’Ethiopie, la
Finlande, la France, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, le Guyana, le Honduras, l’Inde, l’Indonésie, l’Islande,
Israël, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kenya, le Kirghizistan, le Koweït, la Lettonie, le Liban, le Lesotho, la
Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine, Madagascar, le Malawi, la Malaisie, le Mali, Malte, le Maroc, Maurice,
le Mexique, la Mongolie, le Mozambique, le Myanmar, la Namibie, le Népal, le Nicaragua, le Nigéria, la
Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Oman, l’Ouzbékistan, le Pakistan, le Panama, le
Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Portugal, le Qatar, la République centrafricaine,
la République Tchèque, la République dominicaine, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, Sao Tome et
Principe, le Sénégal, Singapour, la Slovaquie, la Slovénie, la Somalie, le Soudan, le Sri Lanka, la Suède, le
Surinam, la Suisse, la Syrie, Taipeh China, la Tanzanie, le Tchad, la Thaïlande, le Togo, Trinité-et-Tobago, la
Tunisie, la Turquie, l’Ukraine, l’Uruguay, le Vanuatu, le Venezuela, le Vietnam, le Yémen, la Zambie et le
Zimbabwe. Une réponse était incomplète et ne précisait pas le pays d'origine.
2. RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
Q1. Votre pays procède-t-il à une analyse économique de l’impact des maladies animales?
Les pays ont majoritairement (59 %) fait savoir qu’ils effectuaient occasionnellement une analyse économique
de l’impact des maladies animales. Les autres réponses étaient les suivantes : systématiquement pour toutes les
maladies importantes (9 %), souvent (11 %) et jamais (21 %).

Q2. Quand une analyse économique de l’impact des maladies animales a été effectuée, avez-vous été satisfait
de la qualité de la recherche et de l’exactitude des résultats?
Les réponses ont été les suivantes : généralement satisfait (41 %), généralement insatisfait (2 %), variable (30 %)
et non applicable (27 %). Ces réponses indiquent que, dans de nombreux pays, les services vétérinaires ne se
contentent pas d’accepter les résultats d’une analyse économique et peuvent mettre en question la base qui sous-
tend ce travail. Cela est compréhensible dans la mesure où les résultats de l’analyse économique de l’impact
d’une maladie animale sont généralement très sensibles aux hypothèses sur lesquelles elle repose, et notamment
à celles relatives à l’effet des mesures de prophylaxie sur l'incidence de la maladie.
Q3. Quand une analyse économique de l’impact des maladies animales a été effectuée, quelle(s) est (sont)
parmi les questions ‘épineuses’ suivantes, celle(s) qui, selon vous, n’a (n’ont) pas été suffisamment traitée(s),
s’il en est?
On considère que les réponses à cette question révèlent les problèmes qui préoccupent au plus haut point les
services vétérinaires et qui, selon eux, ne sont pas suffisamment pris en compte dans les prises de décision
concernant le contrôle des maladies. Parmi les pays qui ont répondu, 73 % considéraient que les analyses
disponibles étaient suffisantes pour se forger une opinion. Les problèmes cités, par ordre de fréquence
décroissant, étaient les suivants : impact humain (56 %), incidence sur l’environnement (56 %), bien-être animal
(48 %), coût potentiel des maladies exotiques et émergentes (41 %) et incidence sur les exportations (36 %). Ces
réponses traduisent une forte prise de conscience des problèmes qui n’étaient pas traditionnellement la
préoccupation essentielle des services vétérinaires.
Q4. Considérez-vous que, dans votre pays, les prises de décision concernant le contrôle des maladies
d’animaux reposent suffisamment sur une analyse économique?
L’analyse économique peut aider la prise de décision concernant le contrôle des maladies animales à plusieurs
niveaux. Elle peut servir à affecter des ressources aux services vétérinaires en général, répartir les ressources
entre les différentes actions prioritaires de contrôle des maladies et améliorer le rapport coût-efficacité des divers
programmes de prophylaxie. Les pays ont été invités à indiquer s’ils jugeaient le recours aux analyses
économiques, à chaque niveau, insuffisant, suffisant ou excessif. Aucun pays n’a considéré que les analyses
économiques étaient excessivement utilisées, à quelque niveau que ce soit. Quand l’utilisation de ces analyses
était jugée insuffisante, les réponses étaient ventilées de la façon suivante : affectation des ressources aux
services vétérinaires en général (67 %) ; répartition des ressources entre les différentes actions prioritaires de
contrôle des maladies (67 %) ; et amélioration du rapport coût-efficacité des divers programmes de prophylaxie
(68 %). L’uniformité globale de ces réponses cache des variations considérables entre les évaluations des pays, à
chacun des trois niveaux. Seulement 16 % des pays ont estimé qu’aux trois niveaux, l’usage fait des analyses
économiques était suffisant.
Q5. À votre avis, quel critère économique doit être utilisé pour établir un ordre de priorité dans les
programmes de prophylaxie?
Cette question avait pour but de permettre d’évaluer si les services vétérinaires étaient dans la logique de la
théorie économique classique, qui accorde la priorité aux programmes de prophylaxie assurant la plus forte
rentabilité économique par rapport à l'investissement économique, à savoir les programmes produisant le rapport
coût-bénéfice économique le plus élevé. Les autres critères proposés pour établir une hiérarchie étaient le
contrôle des maladies dont l’impact économique est le plus important ou de celles dont l’impact économique
possible est le plus important. Cependant, le contrôle de ces maladies peut être coûteux au point que les
avantages tirés ne justifient pas l’investissement. D’autres maladies exotiques peuvent avoir un impact
économique potentiel important, mais le risque qu’elles s’introduisent peut être faible. Une analyse coûts-
avantages viserait à comparer les coûts et les bénéfices attendus des différentes activités de lutte contre les
maladies et à identifier les programmes qui, à partir des ressources limitées disponibles pour le contrôle des
maladies, produisent les meilleurs rendements. Seuls 21 % des pays ayant répondu ont choisi le critère "exact",
ce qui indique l’existence possible de problèmes de communication entre les services vétérinaires et les
économistes, notamment ceux qui ne sont pas spécialisés dans l’économie de la santé animale. Plusieurs pays ont
formulé, ailleurs dans le questionnaire, des observations sur l'importance de l’intégration des aspects
économiques de la santé animale dans les programmes des écoles vétérinaires.

Q6. Avec ou sans analyse formelle, dans quelle mesure estimez-vous que les décisions politiques relatives au
contrôle des maladies animales dans votre pays reposent sur des critères socio-économiques?
Les 121 réponses à cette question ont été les suivantes : totalement (4 %), principalement (36 %), dans une
certaine mesure (53 %) et pas du tout (7 %). Elles révèlent que la grande majorité des services vétérinaires
estime que les facteurs économiques entrent en ligne de compte dans les décisions politiques de lutte contre les
maladies animales. Il apparaît aussi que nombre d’entre eux reconnaissent que d’autres facteurs pèsent sur ces
décisions.
Q7. Si l’on disposait dans votre pays d’un plus grand nombre d’analyses socio-économiques de l’impact des
maladies animales, pensez-vous que les critères économiques joueraient un rôle important dans les prises de
décision politiques?
Sur les 122 réponses à cette question, 93 % étaient “oui”, ce qui indique que le manque d’informations sur les
facteurs économiques représente une entrave importante à la prise de décision politique en matière de contrôle
des maladies animales.
Q8. Souhaiteriez-vous qu’il existe, dans votre pays, plus d’analyses économiques de l’impact des maladies
animales?
Seuls trois des 122 pays ayant répondu ont fait savoir qu’ils ne souhaiteraient pas qu’il existe plus d’analyses
économiques de l’impact des maladies animales sur leur territoire. Cela signifie que certains des 20 pays qui ont
estimé que l’utilisation des analyses économiques était suffisante à tous les niveaux pensent néanmoins qu’un
plus grand nombre d’analyses serait utile. Il a également été demandé aux pays interrogés d’indiquer les
maladies qui bénéficieraient en priorité d’une analyse économique. Un nombre considérable de maladies ont été
citées sans logique perceptible. Cela révèle que les pays souhaitent être orientés dans leurs prises de décision ou
disposer de plus d’éléments pour justifier leurs choix concernant de nombreuses maladies animales.
Q9. Souhaiteriez-vous qu’il existe plus d’analyses socio-économiques de l’impact des maladies animales dans
votre pays, même si elles devaient être financées sur le budget existant des services vétérinaires?
Sur les 122 pays ayant répondu, 101 (83 %) ont indiqué qu’ils seraient disposés à réaffecter une partie de leur
budget destiné aux actions de lutte contre les maladies à l’analyse économique. Cela laisse entendre qu’ils
considèrent qu’une amélioration du processus de prise de décision aboutirait à ce que les fonds restants pour le
contrôle des maladies produisent de plus grands bénéfices. Parmi les pays ayant indiqué qu'ils ne souhaitaient
pas détourner les ressources budgétaires en faveur de l'analyse économique, certains ont souligné que c’était
uniquement en raison de l’insuffisance des budgets existants. Cet enthousiasme pour l’analyse économique est
surprenant, mais on peut dès lors se demander pourquoi les services vétérinaires n’ont pas été plus nombreux à
réaffecter les ressources dans cette direction. Les pressions extérieures en faveur de la mise en oeuvre du plus
grand nombre possible de programmes de prophylaxie ou le manque de compétences nécessaires pour
entreprendre les analyses économiques pourraient expliquer ce paradoxe.
Q10. Dans votre pays, le public peut-il avoir accès aux résultats des analyses économiques de l’impact des
maladies animales?
Sur les 94 pays ayant indiqué que les analyses étaient disponibles, 11 % ont signalé que les résultats étaient
toujours à la disposition du public, 24 % qu’ils l’étaient généralement, 57 % occasionnellement et 7 % jamais.
Un petit nombre de pays semble avoir pour politique de préserver la confidentialité des résultats des analyses
économiques de l’impact des maladies animales, mais les rapports sont rarement publiés sous une forme qui
permettrait de les retrouver par le biais d'une recherche bibliographique. C’est un problème pour ceux qui
entreprennent de nouvelles recherches dans le domaine de l’économie de la santé animale, puisqu’il leur est
difficile de tirer profit des résultats des travaux précédents ainsi que de l’expérience acquise à partir de ceux-ci.
Q11. Les résultats des analyses économiques de l’impact des maladies animales dans votre pays sont-ils
utilisés pour influencer les vétérinaires libéraux et leurs clients par l’intermédiaire d’articles de presse ou
d’autres supports d’information?
Sur les 94 pays ayant indiqué que les analyses étaient disponibles, 3 % ont précisé que les résultats étaient
toujours utilisés dans des documents de vulgarisation, 23 % qu’ils l’étaient généralement, 59 %
occasionnellement et 15 % jamais. Ces résultats sont similaires à ceux de la question précédente.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%