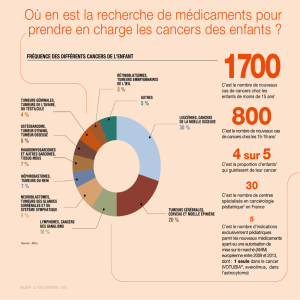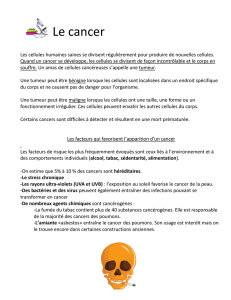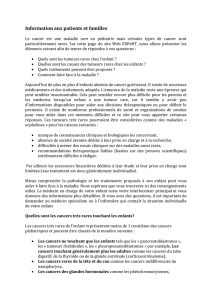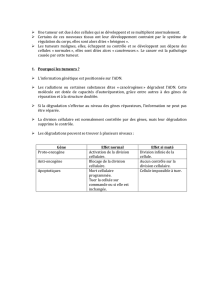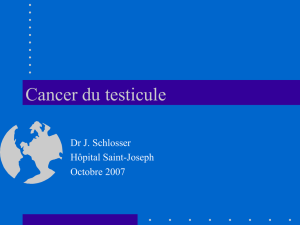Cancers de l`Enfant

1
Examen Classant National / Programme Officiel (2013)
Question N° 294.
Cancer de l'enfant
Particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques
- Expliquer les particularités épidémiologiques, diagnostiques et
thérapeutiques des principaux cancers de l'enfant.
Pr Marc-David LECLAIR et Dr Sébastien FARAJ (Chirurgie Pédiatrique, Nantes)
Pr Hélène MARTELLI et Pr Sabine SARNACKI-FERAY (Chirurgie Pédiatrique, Paris)
Avril 2015
Epidémiologie
Les cancers de lʼenfant sont des maladies rares : environ 1 700 nouveaux cas sont
diagnostiqués par an en France avant lʼâge de 15 ans, ce qui représente environ 1% de
lʼensemble des cancers. Un enfant sur 440 est susceptible de d velopper un cancer avant
lge de 15 ans. Les cancers de lʼenfant sont des tumeurs le plus souvent embryonnaire dont
les caract ristiques cliniques, biologiques et pronostiques sont tr s diff rentes des cancers
de l adulte. Malgré les avancées thérapeutiques et lʼaugmentation de la survie à 5 ans (plus
de 80% dans les pays industrialisés), les cancers de lʼenfant représentent la première cause
de maladie mortelle après lʼâge de 1 an. Le sex ratio de 1,2 montre une légère prédominance
des cancers chez le garçon.
La répartition des cancers de lʼenfant diffère de celle des cancers de lʼadulte (figure 1). Les
leucémies sont les cancers les plus fréquents (29%) et représentent, associées aux
lymphomes, 40% des cancers de lʼenfant. Les tumeurs solides représentent ainsi 60% des
cancers de lʼenfant. Parmi les plus fréquents, on retrouve les cancers du système nerveux
central (19%), les neuroblastomes (9%) et les néphroblastomes (8%) alors que les
carcinomes, souvent retrouvés chez lʼadulte, sont exceptionnels.

2
En période néonatale, les tumeurs sont rarement malignes. Seulement 2% des tumeurs
surviennent lors du premier mois de vie. Près de la moitié des cancers de lʼenfant
surviennent avant lʼâge de 5 ans. Les leucémies deviennent moins fréquentes après lʼâge de
10 ans, alors que les tumeurs cérébrales, les tumeurs osseuses, les tumeurs des tissus
mous, les lymphomes et les tumeurs germinales malignes sont plus fréquentes.
La survenue des cancers chez lʼenfant est en très grande majorité sporadique (>95%). Peu
de facteurs environnementaux sont retrouvés dans la genèse de ces cancers. On retrouve
toutefois les irradiations à fortes doses (accidentelles le plus souvent et rarement
thérapeutiques ou diagnostiques) et les cancers dʼorigine virale : les virus Epstein-Barr
(impliqué dans certains types de lymphomes), le VIH (augmentant le risque de lymphome et
de léïomyosarcome) et le VHB (augmentant le risque dʼhépatocarcinome à lʼâge adulte).
Plusieurs syndromes de prédisposition génétique à la survenue de cancers chez lʼenfant ont
été clairement identifiés, bien que leur proportion reste faible. Des formes héréditaires de
rétinoblastome (40% des cas) sont dues à une anomalie constitutionnelle du gène RB1,situ
en 13q14 et chef de file des g nes suppresseurs de tumeurs. Le syndrome de Li-Fraumeni
expose à un risque augmenté de tumeurs chez lʼenfant (tumeurs des tissus mous, des os, du
système nerveux central et lymphomes). Lʼanomalie responsable est une mutation
constitutionnelle en région 17p13 provoquant un dérèglement de la protéine p53 intervenant
dans la régulation du cycle cellulaire. Le syndrome de Beckwith-Wiedmann (anomalie le plus
souvent pig ntique de la r gion 11p15 soumise empreinte parentale), le syndrome de
Denys Drash (mutation de WT1) et le syndrome de WAGR (d ltion du bras court du
Leucémies et lymphomes (39%)
Tumeurs cérébrales (19%)
Neuroblastomes (9%)
Néphroblastomes (8%)
Tumeur des tissus mous (7%)
Tumeurs osseuses (5%)
Tumeurs germinales malignes (4%)
Rétinoblastomes (4%)
Tumeurs du foie (2%)
Autres (3%)

3
chromosome 11 contenant le g ne WT1) exposent à un risque accru de néphroblastome. La
trisomie 21 est associée à un risque très élevé de leucémie. Les neurofibromatoses de type
1 et 2 sʼaccompagnent principalement de tumeurs du système nerveux central ou
périphérique.
Diagnostic
Signes dʼappel
Le diagnostic de cancer chez l enfant est une urgence conditionnant le pronostic pour
certains cancers. Les symptômes sont souvent dʼapparition et dʼévolution rapide contrastant
avec une bonne conservation de lʼétat général. Ces symptômes sont souvent aspécifiques et
peuvent être en rapport direct avec la tumeur elle-même ou indirectement par compression
des organes de voisinage ou par envahissement métastatique. Il est important de garder en
mémoire que les signes initiaux peuvent être frustres, voire considérés comme banals. La
persistance de symptômes aspécifiques doit faire répéter les examens (en particulier
lchographie qui est un examen simple et tr s performant chez l enfant) ou élargir les
examens complémentaires, même en lʼabsence dʼanomalie évidente à lʼexamen clinique.
Dans tous les cas, la découverte ou la suspicion dʼun cancer chez lʼenfant nécessite de
lʼadresser rapidement en milieu spécialisé pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique.
Les signes pouvant être en rapport direct avec la tumeur sont :
- une masse abdominale ou abdominopelvienne: souvent de découverte fortuite lors de
lʼexamen clinique. Elle peut être intra ou rétro péritonéale et fait évoquer un
neuroblastome, un néphroblastome, un lymphome de Burkitt ou une tumeurs germinale
maligne.
- une tuméfaction : en regard dʼun os ou des tissus mous, localisée au niveau des membres
ou des parois du tronc. Elle fait évoquer principalement un ostéosarcome, un sarcome
dʼEwing ou un sarcome des parties molles.
- des masses ganglionnaires persistantes : surtout si les adénopathies ne sont pas
inflammatoires ni douloureuses. Elles font évoquer une leucémie ou un lymphome.
- une masse péri ou intra-orificielle ou un saignement orificiel : ces signes font évoquer
avant tout un rhabdomyosarcome.
- une augmentation du volume scrotal, faisant évoquer un rhabdomyosarcome
paratesticulaire ou une tumeur germinale maligne.
- un reflet blanc pupillaire (leucocorie) ou strabisme, faisant évoquer un rétinoblastome.
Les signes pouvant être en rapport indirect avec la tumeur sont :

4
- une hypertension intracrânienne (HTIC) : par compression par la tumeur ou due à une
hydrocéphalie par gêne à lʼécoulement du LCR. Une imagerie cérébrale doit être réalisée
en cas de doute.
- des signes neurologiques déficitaires : dépendant du siège des lésions intracrâniennes ou
intraspinales (essentiellement neuroblastome en sablier). A noter que les convulsions sont
rarement révélatrices de tumeurs chez lʼenfant.
- une dyspnée : par compression des voies respiratoires par une tumeur médiastinale.
- une obstruction respiratoire haute ou un trouble de la déglutition : par compression par une
tumeur ORL.
- une protrusion oculaire : faisant évoquer une métastase (de neuroblastome) ou une
tumeur primitive orbitaire (rhabdomyosarcome, gliome du nerf optique).
- des douleurs osseuses localisées persistantes : faisant évoquer une tumeur osseuse
(ostéosarcome, sarcome dʼEwing). Ces signes doivent entraîner la réalisation de
radiographies standard, voire dʼune IRM ou dʼune scintigraphie osseuse au Technétium.
- des douleurs osseuses diffuses : faisant évoquer des métastases osseuses ou une
atteinte diffuse de la moelle osseuse (leucémie, neuroblastome, sarcome métastatique).
- une difficulté dʼémission dʼurines ou de selles : faisant évoquer une tumeur abdomino-
pelvienne. Ces signes doivent entrainer la réalisation dʼune échographie abdomino-
pelvienne à la recherche dʼun rhabdomyosarcome, dʼun neuroblastome ou dʼune tumeur
germinale maligne.
Affirmation du diagnostic
Devant toute suspicion de cancer chez lʼenfant, un examen clinique complet doit être réalisé.
Celui-ci permet dʼorienter les différents examens complémentaires nécessaires à lʼorientation
diagnostique. Ces examens sont biologiques et radiologiques dans un premier temps et
nécessitent dans la très grande majorité des cas une analyse cyto-histologique, par analyse
de la tumeur primitive ou des métastases.
Cʼest la convergence de tous ces éléments cliniques et paracliniques qui permet de poser le
diagnostic avec certitude. La démarche diagnostique doit être organisée en collaboration
avec une équipe spécialisée afin dʼéviter tout retard de prise en charge.
Certaines situations sont particulières :
- le rétinoblastome peut parfois être diagnostiqué par lʼexamen clinique seul, lʼaspect du
fond dʼœil étant caractéristique (souvent réalisé sous anesthésie générale)
- le néphroblastome, dont le diagnostic peut reposer sur un ensemble dʼarguments cliniques
et radiologiques sans nécessité de confirmation histologique avant le début du traitement
par chimiothérapie

5
- le neuroblastome, pouvant être confirmé par une augmentation des catécholamines
urinaires et/ou une scintigraphie à la MIBG positive. Une biopsie sera obligatoirement
ralis e si ce diagnostic est voqu .
- certains marqueurs tumoraux demand s devant des lments cliniques et radiologiques
particuliers peuvent fortement orienter, voir affirmer le diagnostic : catécholamines
urinaires pour le neuroblastome, alphafoetoprotéine pour lʼhépatoblastome,
alphafoetoprotéine et HCG pour les tumeurs germinales malignes.
- les leucémies, dont le diagnostic repose essentiellement sur lʼanalyse de la NFS et du
myélogramme.
Lannonce du diagnostic
Il s'agit d'une situation d licate o le m decin doit d livrer une tr s mauvaise nouvelle que
les parents redoutent d'entendre. C est une tape psychologiquement tr s prouvante pour
les parents et tous les mots qui vont tre prononc s vont tre fondateur pour la suite de la
prise en charge. En cons quence, il faut que le m decin qui s engage dans cette annonce ait
une bonne connaissance des cancers de l enfant. Si ce n est pas le cas, ce m decin doit
rester tr s prudent et diriger les parents au plus vite vers un m decin ou chirurgien
sp cialiste. Il est impossible d' tablir des r gles id ales pour l'annonce du diagnostic,
cependant, certaines recommandations doivent tre respect es. En effet, de la qualit de cet
change entre le m decin et les parents va d pendre la relation de confiance tout au long de
la maladie, et au-del . Cette annonce ne doit en aucun cas tre rapide, debout dans un
couloir, en pr sence d'autres parents. Au contraire, elle doit se d rouler dans une pi ce
isol e afin de respecter la confidentialit , mais aussi la stupeur et l'effondrement des parents.
Elle doit durer le temps n cessaire la bonne compr hension des parents et pour qu'ils
puissent poser toutes les questions qui leur viennent l'esprit. Il n'est pas rare que le
mdecin informe pr cocement les parents du diagnostic le plus probable, de fa on ne pas
les laisser dans une situation insupportable de doute. Cependant, d s cette tape, les
parents souhaitent conna tre dans le d tail l'ensemble du traitement et les chances de
gu rison. Or, le m decin ce moment pr cis ne conna t pas forc ment le diagnostic exact ni
les r sultats des examens suppl mentaires r alis s pour valuer une possible diss mination
(m tastases) de la maladie. Le m decin doit alors temp rer les nombreuses questions des
parents en leur expliquant le cheminement du diagnostic se fait donc souvent pas pas dans
les situations complexes. Dans ce cas, le m decin propose aux parents de les revoir d s
qu il poss dera toutes les informations n cessaires pour tablir le diagnostic pr cis et
lextension de la maladie, ainsi que la strat gie de traitement. Le m decin a conscience
durant cet entretien que les parents sont le plus souvent "sid rs" par ce diagnostic et qu'ils
ne se souviendront presque plus des informations autres que le diagnostic et les chances de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%