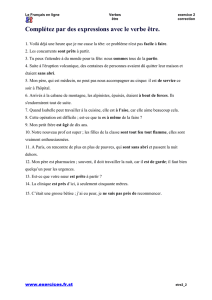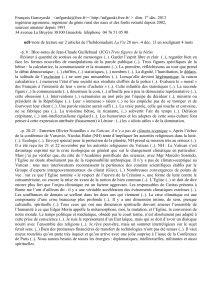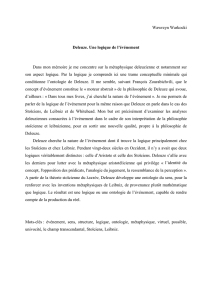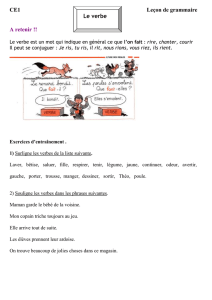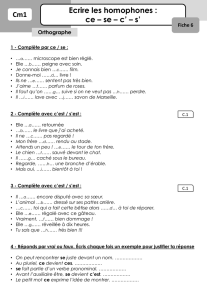Revue Flaubert, n° 7, 2007 La bêtise : « faculté pitoyable » ou

Revue Flaubert, n° 7, 2007
La bêtise : « faculté pitoyable » ou « faculté royale » ?
– Deleuze lecteur de Flaubert
Dork Zabunyan
Maître de conférence, Lille 3
La présence de l’œuvre de Flaubert est discrète dans la
philosophie de Deleuze, une référence au travail de l’écrivain
pouvant même survenir de façon indirecte et sous une forme
relativement brève. Ainsi, lorsqu’il avance l’idée d’une « supé-
riorité de la littérature anglaise-américaine » sur la littérature
française – « supériorité » caractérisée par le fait que les auteurs
anglo-américains savent concilier « écriture » et « devenir » par-
delà les motifs de la ressemblance ou de l’identification –,
Deleuze évoque l’expression célèbre « Madame Bovary, “c’est”
moi », avant d’ajouter : « Il y a un devenir-femme dans l’écri-
ture. Il ne s’agit pas d’écrire “comme” une femme [...] Même les
femmes ne réussissent pas toujours quand elles s’efforcent
d’écrire comme des femmes »
1
. La formule de Flaubert n’est pas
plus explicitée dans ce passage des Dialogues ; elle est
mentionnée en passant, et sert davantage – depuis le concept de
« devenir » (devenir-femme, devenir-animal, devenir-imper-
ceptible, etc.) – à énoncer une distinction spécifique entre le
roman français et le roman américain, qu’à présenter un
commentaire de Madame Bovary à proprement parler. Une autre
référence à Flaubert se trouve dans l’Abécédaire, document
audiovisuel au cours duquel Deleuze aborde entre autres ses
manières de travailler, à l’écrit ou comme professeur, ses
collaborations, aussi, puisqu’il a co-signé plusieurs ouvrages, en
particulier avec Félix Guattari. Une vaste entreprise de type
« encyclopédique » fut lancée avec ce dernier, précise-t-il, en
raison de l’ampleur des disciplines abordés en commun ; avec
Félix, « nous étions un peu comme Bouvard et Pécuchet »
déclare ironiquement Deleuze
2
. Évocation concise, là encore,
mais qui peut éclairer en retour le caractère systématique d’une
œuvre qui se revendique d’ailleurs comme telle ; Deleuze a
toujours défendu la notion de « système » en philosophie, celle
–––––
1. Gilles Deleuze, Dialogues, en collaboration avec Claire Parnet, Paris, Flammarion,
1977 (coll. Champs, 1996, p. 55).
2. Voir L’Abécédaire de Gilles Deleuze, en collaboration avec Claire Parnet, éd.
Montparnasse, 2004, « F comme Fidélité ».

2
d’un « système ouvert » cependant, contre la tradition
hégélienne d’un « savoir absolu » ; la difficile détermination
d’une science du siècle voulue par Bouvard et Pécuchet a peut-
être indirectement inspiré Deleuze et Guattari, sachant que cette
détermination, comme en témoignent les mésaventures des deux
héros de Flaubert, n’est et ne peut pas être close.
Nous trouvons ailleurs chez Deleuze une référence à Bouvard
et Pécuchet, décisive à bien des égards. Référence multiple,
cette fois, qui parcourt l’ouvrage fondamental de Deleuze :
Différence et répétition, publié en 1968. Elle a trait au problème
qui va nous intéresser dans ces pages, celui de la bêtise. Il n’est
pas exagéré de dire que ce problème traverse l’œuvre
deleuzienne de façon obsédante : de Nietzsche et la philosophie
(1962) jusqu’à Qu’est-ce que la philosophie ? (1991), en passant
par Pourparlers (1990) et même les livres sur le cinéma
(principalement L’Image-temps), la bêtise occupe et préoccupe
grandement Deleuze. Il y va en définitive de la pratique même
de la philosophie, car si la philosophie a un ennemi qui la
concerne intimement, dans son commencement aussi bien que
dans ses actes – le philosophe est toujours confronté à un
ennemi, parce qu’il n’y a pas de philosophie sans « miso-
sophie », parce que « tout part d’une misosophie » – cet ennemi
n’est pas l’erreur, mais bien la bêtise
3
. C’est la bêtise, en effet,
qui constitue le véritable « négatif » enveloppant un exercice
supérieur de la faculté de penser, détermination négative
« transcendantale » dira Deleuze, dans la mesure où elle renvoie
aux « structures de la pensée comme telle ». De telle sorte que la
bêtise, précisons-le d’emblée, n’est pas entendue ici en fait, mais
en droit, c’est-à-dire en tant qu’elle engage la genèse de la
pensée, la possibilité même de l’acte de penser
4
. Que la bêtise
soit examinée en droit, c’est justement la leçon que la philo-
sophie doit recevoir de la littérature, qui a su investir ce
phénomène au-delà de ses déterminations empiriques, celles de
la psychologie commune ou de la simple anecdote, irrémé-
diablement condamnées aux « sottisiers », ce « genre pseudo-
littéraire particulièrement exécrable ». C’est pourquoi, si « la
plus mauvaise littéraire fait des sottisiers [...] la meilleure fut
hanté par le problème de la bêtise, qu’elle sut conduire
jusqu’aux portes de la philosophie, en lui donnant toute sa
–––––
3. Voir Gilles Deleuze, Différence et répétition (dorénavant abrégé DR), Paris, PUF,
1968, p. 182.
4. Voir DR, p. 196, et déjà p. 195, où Deleuze souligne la nécessité d’une recherche,
par-delà le « concept d’erreur », des « vraies structures transcendantales de la
pensée ».

3
dimension cosmique, encyclopédique et gnoséologique
(Flaubert, Baudelaire, Bloy) »
5
. Selon Deleuze, la philosophie
doit reprendre cette entreprise avec ses moyens propres, en
élevant la bêtise au niveau du concept, et cerner le problème
essentiel qu’elle contraint la pensée à poser, par-delà l’oppo-
sition convenue entre bêtise et intelligence (autrement la
tentation du sottisier pourrait ressurgir). Problème de nature
« transcendantale », donc : « comment la bêtise (et non l’erreur)
est-elle possible ? »
6
.
Le nom de Flaubert (davantage que les deux autres écrivains
cités, qui ne le seront plus) va accompagner l’exploration de ce
problème au sein de Différence et répétition, jusqu’à sa conclu-
sion, où nous retrouverons les « deux bonhommes » du roman
inachevé que demeure Bouvard et Pécuchet. C’est en décrivant
ce qu’il nomme le « mécanisme de la bêtise », et les dangers liés
à cette description – dangers qui résultent de pressentiments
peut-être « à l’origine de la mélancolie » : ceux « d’une hideur
propre au visage humain [...], d’une déformation dans le mal,
d’une réflexion dans la folie » – que Deleuze mentionne un
fragment de la phrase célèbre du livre de Flaubert : « “Alors une
faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la
bêtise et de ne plus la tolérer…” »
7
Notre propos n’est pas ici
d’apprécier le commentaire que Deleuze proposerait de ce
passage de Bouvard et Pécuchet (à supposer qu’un tel commen-
taire existe), mais d’essayer de comprendre la reprise, sur un
plan strictement philosophique, de cette « faculté » que serait la
bêtise. Remarquons que la faculté n’est pas simplement « pito-
yable » ; bien plus, elle possède son contraire, puisqu’elle
s’avère être en outre dans la même page une « faculté royale » –
« royale » dans la mesure où elle permet de répondre positi-
vement à la question transcendantale auparavant soulevée, et
favoriser par-là même la plus haute détermination de la pensée
(la misosophie est devenue philosophie). Nous allons y revenir,
en vue d’étudier la relation à la fois très rigoureuse et pourtant
énigmatique qui se nouent entre ces deux facultés de la bêtise ;
et quel sens, surtout, après Flaubert, Deleuze attribue au mot
« faculté ».
–––––
5. DR, p. 196-197.
6. Ibid., p. 197.
7. Ibid., p. 198.

4
Les deux concepts de la bêtise
Avant cela, il convient de mettre en évidence un geste de
pensée constant chez certains philosophes français qui, tous
grands lecteurs de Flaubert, ont cherché, chacun à sa manière, à
donner consistance à la notion de « bêtise ». Cette constante
pourrait se résumer ainsi : c’est qu’il existe toujours deux
concepts de bêtise, jamais un seul, comme si le philosophe,
après une traversée de l’œuvre flaubertienne, opérait un
redoublement du phénomène de la bêtise, redoublement qui
correspond sans doute au travail de l’écrivain lui-même : une
fois sur un plan empirique, celui qui s’offre à lui dans l’expé-
rience la plus quotidienne ; une autre fois sur un plan littéraire,
qui élève la bêtise à un niveau où elle atteint des intensités
(affectives, perceptives) si importantes, qu’elle ne dépend plus,
ou ne peut plus même dépendre du sujet qui en a fait
l’expérience. Ainsi, quand Flaubert écrit dans une lettre à
George Sand : « Nous ne souffrons que d’une chose : la Bêtise.
– Mais elle est formidable et universelle »
8
, le régime de
fonctionnement de cette phrase, très précieuse par ailleurs pour
saisir la conception que se fait l’écrivain de la « chose » en
question, se distingue des opérations qui inscrivent la bêtise,
dans ses romans, au sein d’un projet que Deleuze juge
encyclopédique, mais également « critique »
9
. Une double
appréhension de la bêtise, donc : la première qui relève d’une
certaine passivité, aboutissant parfois à la pétrification de celui
qui la contemple, jusqu’à se confondre avec elle ; la seconde qui
cherche au contraire à la disséquer, à la sonder, sans pour autant
nier la réceptivité première qui a brouillé la frontière entre
l’esprit et la matière. Nous retrouvons ce double mouvement par
exemple chez Sartre, qui affirme que « Flaubert réunit sous le
même nom deux Bêtises contradictoires dont l’une est la
substance fondamentale et l’autre l’acide qui la ronge ». La
bêtise fondamentale est solidaire d’une « objectivité diffuse des
conduites », d’une « réification » des sentiments, d’une « ma-
tière qui agite l’esprit » jusqu’à la réduire à l’état de caillou.
L’autre bêtise appartient au « prince de l’analyse », à celui qui
scrute suivant un « regard-bistouri » la « fondamentale » ; pour
Sartre, ce procédé est voué à l’échec ; au mieux, a-t-il une
–––––
8. Voir Correspondance, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1998, lettre du
14 novembre 1871, t. IV, p. 411.
9. Deleuze, dans sa lecture de Flaubert, reprend en ce sens une exigence énoncée par
Nietzsche en son temps, condition de toute critique : « nuire à la bêtise », « faire de la
bêtise quelque chose de honteux ». Voir Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962
(1991), p. 120.

5
fonction de parasitage, mais jamais il ne saura égaler la
« pensée-matière » de la première. D’où l’idée d’une « Bêtise
analytique » : celle-ci « est tout juste la négation de la Bêtise
fondamentale qui, seule, possède l’épaisseur positive de la
matière »
10
.
Jacques Rancière reprendra plus tard ce double mouvement
de la bêtise, dans une tout autre perspective cependant, loin de la
forme d’opposition dialectique qui caractérise encore la lecture
sartrienne. Dans La Parole muette, il montre comment l’œuvre
de Flaubert accomplit une conversion de « la bêtise du monde
en une bêtise de l’art », les passages consacrés à Madame
Bovary mettant au jour de quelle façon l’écrivain « soulève
imperceptiblement la grande nappe étale du langage qui se dit
lui-même – la bêtise du monde – pour faire exister, comme un
seul et même accroc à sa surface, les phrases du livre et les vies
muettes des personnages ». Les « accrocs » à la surface, ce sont
les jugements de Rodolphe, les amours d’Emma, le bavardage
d’Homais, et le vide qui règne dans l’interstice de ces manifes-
tations de la bêtise ordinaire. Le tour de force de Flaubert, selon
Rancière, c’est de redoubler ce vide et la platitude de la parole
qui l’environne, en leur offrant, dans ce « livre sur rien », un
écho à peine audible. « Le mutisme ne résonne sous le
bavardage qu’à la condition de redoubler son silence » : trans-
formation « du rien en un autre rien »
11
. Or, précisément, il y a
transformation à travers l’écriture, transformation « imper-
ceptible » néanmoins, sinon le risque serait grand de restaurer
une position de surplomb (en décalage avec l’abandon
contemplatif auparavant évoqué), et reconduire par-là même
l’écueil d’une présomption de l’intelligence par rapport à la
bêtise. Rancière demeure en ce sens assez éloigné du constat
négatif dressé par Sartre. Parler d’un « échec » de Flaubert au
regard de la « Bêtise fondamentale » a peu de pertinence ; ce qui
importe, outre l’attention portée aux inventions littéraires et à la
manière dont elles fonctionnent au niveau du style, c’est de
noter que les procédés de Flaubert s’inscrivent plus largement
dans un « régime esthétique » de l’art dont il est l’un des grands
représentants, « régime d’indétermination où plongent les
–––––
10. Voir Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille, Paris, Gallimard, 1971 (1988), t. I,
respectivement p. 613-615 et 645. Pour Sartre, malgré tout, « rien n’interdit d’espérer
que celle-là [la Bêtise analytique], en dissolvant celle-ci [la Bêtise fondamentale], se
prive de tout support et s’active dans le non-être » ; mais cette dissolution reste en
définitive un leurre : en témoigne « l’énorme et monotone Bouvard et Pécuchet »,
« qui n’y parviendra jamais » (p. 639).
11. Jacques Rancière, La Parole muette – Essai sur les contradictions de la
littérature, Paris, Hachette, 1998 (2005), p. 118-119.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%