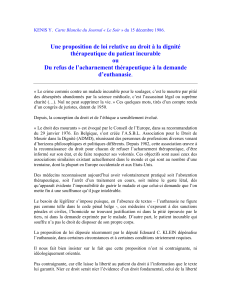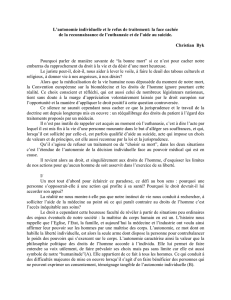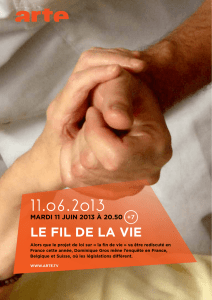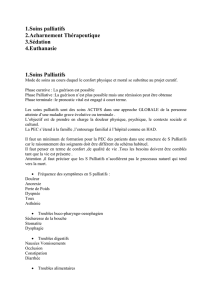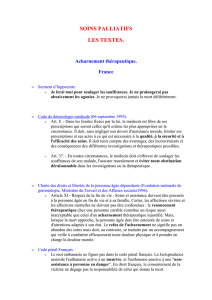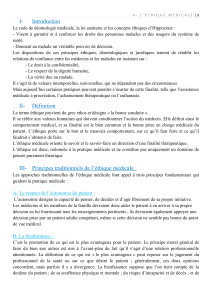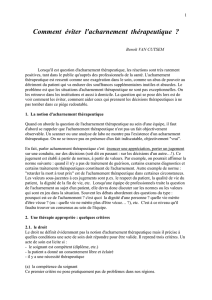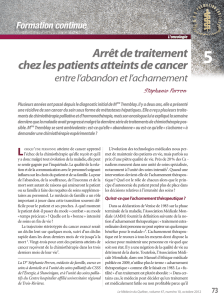Problèmes éthiques en rapport avec l`euthanasie. Bulletin de la

KENIS Y. Bulletin de la Société belge d’éthique et de moral médicale, 1985, 10 : 192-
194.
Problèmes éthiques en rapport avec l’euthanasie.
Mon activité professionnelle est celle d’un cancérologue traitant principalement
des patients atteints d’un cancer avancé, incurable par les méthodes classiques de la
chirurgie et de la radiothérapie. Je suis chimiothérapeute et j’ai souvent été amené à
pratiquer ce que beaucoup considèrent comme de l’acharnement thérapeutique. Mais la
vie du médecin n’est-elle pas précisément un acharnement contre la maladie, une lutte
contre la mort, même si cette lutte se termine souvent par un échec, en particulier dans
ma spécialité ? Cet acharnement que l’on dénonce aujourd’hui, a été considéré naguère
comme un progrès. Il y a 15 ou 20 ans, l’enthousiasme suscité par les méthodes de
réanimation entraînait une attitude active dans tous les cas, si faible fût l’espoir d’un
retour à la normale. Le rôle du médecin était d’agir, d’intervenir en toutes circonstances,
on pourrait presque dire, de façon automatique, sans se poser de questions. Actuellement,
les médecins se posent des questions sur l’opportunité d’une réanimation chez un malade
en phase terminale. Les médecins, comme les autres membres de la société, reconnaissent
que le traitement à tout prix peut constituer un abus. Les indications d’une réanimation
sont soigneusement examinées dans chaque cas et il arrive fréquemment que l’on décide
de ne pas réanimer un malade au stade terminal, chez lequel survient une complication
comme un arrêt cardiaque ou une insuffisance respiratoire. De telles décisions sont prises
collectivement par l’ensemble de l’équipe soignante, si possible en accord avec le malade
et/ou ses proches. L’acharnement thérapeutique n’est plus une pratique constante contre
laquelle il faut lutter de toutes ses forces ; loin de là. De plus en plus de médecins
reconnaissent que, dans certains cas, maintenir un organisme en état de fonctionnement –
on ne peut parler ici de maintenir un individu en vie – aboutit seulement à prolonger une
interminable agonie.
Par contre, dans le public, beaucoup de gens pensent que l’acharnement thérapeutique
reste un problème fréquent. J’ai souvent entendu la famille d’un malade accuser les
médecins d’acharnement thérapeutique, surtout à posteriori, lorsque les choses ont mal
tourné. J’ai rencontré beaucoup moins souvent – et ceci s’adresse particulièrement à
Monsieur D’Hose* – des malades qui demandaient que l’on cesse un traitement actif,
même très près de la fin. Au contraire, beaucoup de patients, à ce stade, acceptent avec
reconnaissance des traitements parfois pénibles, même lorsqu’ils savent que l’espoir
d’une amélioration est quasi nul. C’est la situation que l’on rencontre dans les études des
nouveaux médicaments en cancérologie et je vous assure que, lorsque l’on explique en
détail, sans aucune restriction, ni complaisance, les risques possibles – non négligeables –
et les avantages potentiels – très faibles – d’un tel traitement, on reçoit beaucoup plus
d’acceptations que de refus. L’être humain, même incurable et parfaitement informé de
son état, garde un espoir et s’il n’a plus d’espoir pour lui-même, il trouve un réconfort
* Député, qui venait de déposer une proposition de loi relative à l’euthanasie.

dans l’espoir d’un progrès pour les autres. Il garde ainsi, jusqu’au bout, le sentiment de
participer et de conserver sa dignité d’homme.
C’est dire que je ne suis pas un adversaire absolu et inconditionnel de
l’acharnement thérapeutique, bien au contraire. Néanmoins, pourquoi suis-je quand
même président d’une association qui s’appelle « Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité », association qui a précisément pour but de lutter contre l’acharnement
thérapeutique ? C’est que je crois que, dans notre société, ce problème est fortement
ressenti par la majorité de la population. Pour beaucoup, la notion d’acharnement
thérapeutique est vague, voire erronée, mais la crainte en est grande. Par exemple, pour
les bien-portants, le simple fait de placer une sonde gastrique ou des perfusions peut
représenter quelque chose d’horrible qui s’apparente à une torture, alors que pour le
malade qui subit cet acte, ce n’est certes pas agréable, mais c’est rarement ressenti
comme un sévice. Nous devons être conscients que les réactions des malades et de leurs
proches ne sont pas nécessairement les mêmes.
C’est pourquoi je pense que chacun devrait s’efforcer de s’interroger sur ce qu’il
désirerait pour soi-même, s’il se trouvait dans cette situation. A fortiori, le malade, qui est
dans cette situation, doit faire connaître son avis. Pour qu’un véritable dialogue
s’établisse entre le malade et le médecin, il est indispensable qu’un maximum de sincérité
existe entre ces deux individus. Le malade doit demander des informations sur son état,
sur le diagnostic et le pronostic de sa maladie, sur les caractéristiques des traitements
proposés. Sauf de rares exceptions, le médecin est tenu de donner ces informations. C’est
seulement lorsqu’il est en possession de toutes ces données que le malade peut prendre
une décision d’accepter un traitement ou de le refuser. C’est lui seul qui peut établir le
critère de ce qui est, pour lui, acharnement thérapeutique abusif. C’est lui qui peut définir
ce qui lui paraît intolérable, mais j’insiste, intolérable pour lui et non pour la famille. J’ai
d’innombrables exemples, dans ma pratique personnelle, de cas où la famille ne peut plus
supporter la phase terminale de la maladie d’un être proche. La tension a été trop forte
pendant trop longtemps : la fin est – inconsciemment – attendue comme une délivrance.
Je pense que ce sentiment est normal, mais ce n’est certainement pas ce qui doit
déterminer l’arrêt d’une thérapeutique active et, moins encore, amener une décision
d’abréger la vie.
L’A.D.M.D. encourage donc ses membres à signer une déclaration concernant la
fin de la vie. Pour nous, c’est le point essentiel : donner à l’individu lui-même le droit de
décider ce qui est pour lui la façon la plus digne de terminer sa vie, que ce soit en luttant
jusqu’au bout ou, au contraire, en acceptant la fin inévitable ou même en hâtant celle-ci,
soit seul, par ses propres moyens (suicide), soit avec l’aide de quelqu’un (euthanasie
active volontaire). En face de ce terrible problème, deux individus doivent se rencontrer :
le malade et le médecin. Je regrette que la proposition de Monsieur D’Hose néglige le
rôle du médecin traitant, l’écarte des décisions ou même donne l’impression de le tenir en
suspicion. Il me semble, à moi, que les derniers moments de la vie sont ceux où la vérité
et la profondeur du dialogue, du colloque singulier, comme on dit, sont les plus
nécessaires.
1
/
2
100%