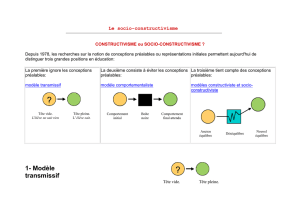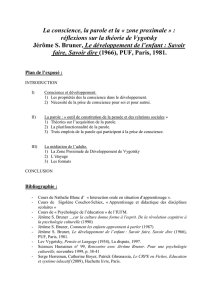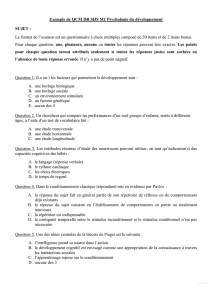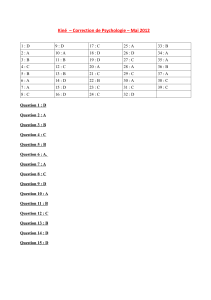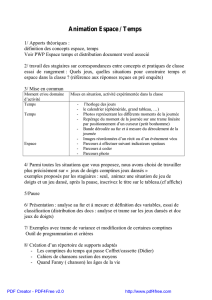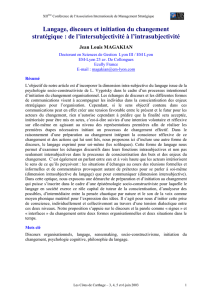Apports théoriques - Académie de Toulouse

1
Apports théoriques
Recherche Action SVT
1- L’évaluation
1-1-Evaluer/contrôler
Pour J. Ardoino (1991), l’évaluation est « dans quatre-vingt-dix pour cent des cas, n’est que
du contrôle déguisé ». Nos observations en classe nous permettent de dire qu’il n’en est
plus ainsi aujourd’hui. Toutefois il convient de poser la distinction entre évaluation et
contrôle. J. Ardoino et G. Berger (1989) définissent le contrôle comme étant, tout à la
fois, «un système, un dispositif et une méthodologie, constitués par un ensemble de
procédures, ayant pour objet (et visée) d’établir la conformité (ou la non-conformité), si ce
n’est l’identité, entre une norme, un gabarit, un modèle, et les phénomènes ou les objets
qu’on y compare, ou, à défaut de l’établissement de cette conformité ou de cette identité, la
mesure des écarts ». Les deux auteurs insistent notamment sur le fait que le contrôle
s’effectue à partir d’un modèle de référence qui est toujours construit de manière extérieure
et antérieure à l’opération de contrôle proprement dite. Il existe donc un « référent » défini
préalablement et qui, s’agissant de l’apprentissage, représente un ensemble d’objectifs
parfaitement définis. Dès lors, contrôler consiste à comparer les résultats obtenus, « les
produits finis » aux objectifs poursuivis qui ont été définis préalablement sans prendre
en compte le processus d’apprentissage lui-même. La subjectivité du contrôle n’intervient
pas (ou peu…) puisqu’il s’agit de confronter des résultats obtenus à des résultats attendus
inventoriés avec précision. Le contrôle s’intéresse à l’existence d’une série de
connaissances répertoriées sans se préoccuper de l’usage que peut en faire l’élève, de
l’attitude de l’élève face à elle, du processus qui a présidé à ces constructions.
Toutefois, dans la pratique, l’évaluation et le contrôle sont difficilement dissociables. En effet,
lorsqu’on contrôle, on ne dispose pas de la totalité des référentiels et dans cette situation on
en construit. A l’inverse, il ne peut y avoir d’évaluation sans outils de contrôle : si on souhaite
évaluer la compétence d’un élève à résoudre des problèmes centrés sur l’addition des
nombres décimaux, on ne peut que passer par le contrôle de l’exactitude des opérations
faites et de leur enchaînement logique.
Pour illustrer l’ensemble de ces propos, nous proposons un tableau récapitulatif des
différences que l’on peut faire entre les notions de contrôle et d’évaluation à la suite des
travaux de J. Ardoino et G. Berger (1989), C. Hadji (1992), R. Bobichon, G. Gauzente et
J.P. Rocquet (1994), L. Talbot (1997) et M. Vial (2001).

2
CONTROLE
EVALUATION
Processus qui relève plutôt de l’objet :
processus plutôt objectif
Processus qui relève plutôt du sujet :
processus plutôt subjectif
Constat d’écart entre un référé et un
référent extérieur au système
enseignement-apprentissage servant
d’étalon, de norme.
La référentialisation (élaboration du référent)
est intégrée au processus d’enseignement-
apprentissage
Elle a une fonction :
-diagnostique ou de départ
- régulatrice ou formative
- terminale ou sommative (validation,
certification).
La norme (le référent) est intérieure au
système enseignement-apprentissage
Les contrôleurs sont interchangeables de
part leur situation d’extériorité
Il y a implication de l’évaluateur, ce qui
suppose que celui-ci élucide sa propre
position institutionnelle et sa place dans le
système de part sa situation d’intériorité.
Simple mise en conformité par rapport à la
norme
Interrogation sur les valeurs (valeurs morales,
esthétiques, philosophiques, politiques,
existentielles).
Feed-back négatifs (sanction).
Le contrôle est souvent destiné à la
hiérarchie.
Le processus est sanctionnant et clôturant.
Feed-back positifs (évaluation).
L’évaluation, en tant que processus, est
partagée par le groupe. Elle pose la question
de sa divulgation : à qui et à quoi sert-elle, qui
en profite ?
Se limite à la performance
Vise l’activité de l’acteur
Il utilise des dispositifs construits et
transparents. C’est une approche
monoréférentielle, le référent est externe et
posé d’emblée.
Les dispositifs (les référents) ne sont pas
donnés a priori : il s’agit d’élaborer des
systèmes d’interprétation, à partir
d’indicateurs, d’analyseurs. C’est une
approche multiréférentielle.
Aspatial, universel. La conception du
processus est antérieure à celui-ci, il y a
atemporalité.
Ici et maintenant (hic et nunc), local,
contextualisée. Elle est simultanée au
processus, consubstantielle à celui-ci.
Ponctuel. Il apporte une appréciation
conclusive qui annule toute émergence
d’un dynamisme potentiel.
S’inscrit dans la durée. Le processus
accompagne l’action, il a une visée
prospective.
Quantitatif
Qualitatif
Approche expérimentale
Approche clinique
Faute
Erreur
Rigidité
Souplesse, adaptation, négociation

3
1-2-Evaluation diagnostique/formative/sommative
Les finalités de l’évaluation scolaire sont multiples. A partir des travaux de J.-M. de Ketele
(1986) et de J. Vogler (1996), nous pouvons dresser le tableau synoptique suivant qui
regroupe les grandes modalités que peut adopter en classe cette régulation qu’est
l’évaluation. Elles sont au nombre de trois : l’évaluation diagnostique, formative et
sommative. Celle qui est la plus proche de la régulation, de la médiation et de l’aide aux
difficultés d’apprentissage est l’évaluation formative.

4
EVALUATION
DIAGNOSTIQUE
EVALUATION
FORMATIVE
EVALUATION
SOMMATIVE
Fonction
Fournir des
informations relatives
aux compétences et
aux connaissances
d’ores et déjà
construites par les
apprenants
Fournir des
informations relatives
aux compétences et
aux connaissances
en construction à
l’évalué et à
l’évaluateur
Fournir des informations
relatives aux
compétences et aux
connaissances au terme
d’une unité
d’enseignement-
apprentissage
Intérêt tourné
vers…
L’aval (réussite
ultérieure)
L’amont (progrès
réalisés, difficultés
rencontrées)
L’aval (certification,
admission)
Moment de
passation
Au tout début, avant
d’introduire une
nouvelle unité de
cursus
Au cours de l’unité
d’enseignement-
apprentissage
Au terme de l’unité
d’enseignement-
apprentissage
Décisions à
prendre
Adaptation du
programme,
orientation et
admission des
apprenants
Adaptation,
régulation,
amélioration des
activités
d’enseignement-
apprentissage,
remédiation
Certification, admission
au palier suivant,
conclusion
institutionnalisée (à ne
pas confondre toutefois
avec le contrôle)
Type de
comparaisons
effectuées
Inter-élèves
Intra élève
Inter-élèves
Finalités
Plutôt pédagogiques
et didactiques,
adapter
l’enseignement,
orienter, faire un
pronostic
Pédagogiques et
didactiques,
améliorer le
processus
d’apprentissage et
donc
d’enseignement,
diagnostiquer les
réussites futures
Plutôt sociales,
améliorer le résultat,
orienter, faire un bilan
Qualités métriques
prédominantes
Validité pronostique
Validité des
contenus et des
constructions
Fidélité aux
enseignements effectués
Destinataires
Le professeur
Le professeur et
l’élève
Le professeur, le conseil
de classe, l’institution
globale, les parents
Enseignement
pratiqué
Plutôt collectif
Plutôt individualisé et
individualisant, prise
en compte des styles
et des stratégies
d’apprentissage
Plutôt collectif, modes de
présentation constants
Fréquences
Haute
Haute
Basse
Questionnement
Quelles sont les
connaissances
d’ores et déjà
construites ? Sont-
elles suffisantes ?
Quelles sont les
Comment s’effectue
l’apprentissage des
élèves ? Quelles
sont les difficultés
rencontrées en cours
d’apprentissage ?
Quel est le niveau ?
Quels sont les
résultats d’apprentissage
construit ?

5
représentations
initiales ? Les
objectifs prévus sont-
ils les plus adaptés ?
Quelles
modifications dans
l’enseignement sont-
elles nécessaires
Objets
Les représentations
d’ores et déjà
construites sur
lesquelles pourront
s’appuyer les
apprentissages et les
enseignements
nouveaux.
L’élève, ses
connaissances, ses
démarches, sa
motivation, ses
difficultés, le
processus
d’apprentissage
dans sa globalité
La performance
indicatrice d’un niveau
atteint, le produit final
1-3-Les finalités de l’évaluation
Nous utilisons le pluriel car les finalités ne sont pas uniques puisqu'elles dépendent des
perspectives et des objectifs poursuivis par les maîtres. Ce point est essentiel. Une
distinction que l’on peut faire entre l’enseignement et l’animation par exemple est liée à
l’évaluation. A la question : faut-il évaluer quand on enseigne? La réponse est assurément
positive. Il n’y a pas d’enseignement sans possibilité d’évaluation, nous l’avons dit. Un
premier élément de réponse à cette question est donc que les pratiques d’évaluation sont
caractéristiques des pratiques d’enseignement. Si enseigner c’est mettre en place des
conditions qui vont permettre l’apprentissage, enseigner est donc aussi évaluer. Faut-il tout
évaluer ? Sûrement pas, trop d’évaluation risque de tuer l’évaluation.
Globalement l’évaluation est un moyen pour l’enseignant de le conforter dans ses choix
pédagogiques et didactiques, de réguler ses pratiques d’enseignement éventuellement,
de les valoriser aussi. Elle a pour but de rendre intelligible l’apprentissage des élèves, de
valider et de réguler l’action des acteurs (enseignants et élèves).
Un deuxième élément nous est donné par J. Daniau (1989) qui distingue deux fonctions
essentielles de l’évaluation, une fonction sociale et une fonction plus pédagogique.
1-3-1- L’évaluation est une pratique sociale
L’évaluation a pour fonction de communiquer, de donner des informations. Dans ce cadre,
l’évaluation peut permettre d’apprécier si les investissements engagés en matière de
personnels, bâtiments, crédits de fonctionnement sont à la mesure des objectifs fixés. Elle
peut viser à déterminer le degré de satisfaction des usagers de l’éducation nationale
considéré comme service public qui sont les élèves, les parents ou de l’opinion publique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%