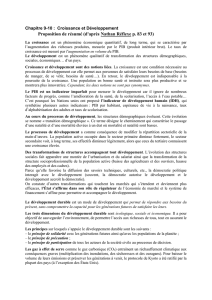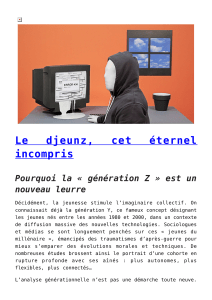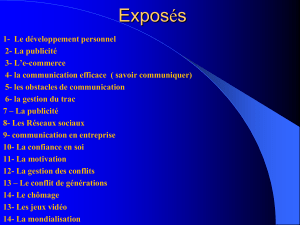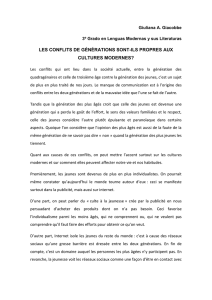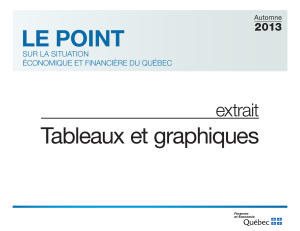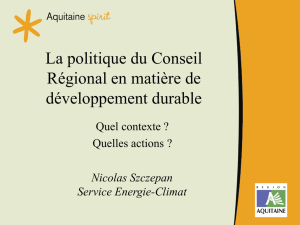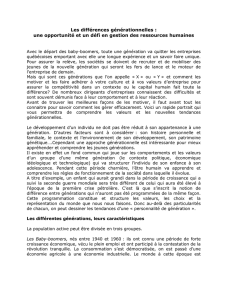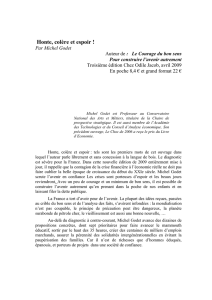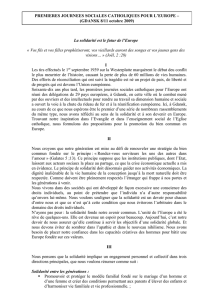Introduction A l`heure où les stratégies de gestion des

Groupe d’appui Politiques Jeunesse
1
Introduction
A l'heure où les stratégies de gestion des finances publiques ainsi que les conséquences
de la crise économique pèsent sur la société française, le rôle de l'Etat en tant qu'acteur
central de la régulation entre les générations tend à s'effacer.
Ce déclin de l’« Etat-providence » est fortement ressenti par les générations les plus
exposées et les plus vulnérables, car les moins « productives » : les jeunes, et les plus
âgés d'entre nous.
Dans ce cadre, le Cnajep a tenté de construire, en partant des fondements de l’éducation
populaire, un autre modèle de répartition des richesses et de solidarités entre les
générations, tout en mettant en avant les principes qui fondent le modèle de société que
nous souhaitons promouvoir : autonomie, éducation, participation, mais aussi place du
travail, droits de l'Homme…
Ce travail ne vise en aucun cas à mettre en concurrence les générations. Il s’agit de
réfléchir à la manière dont les différentes générations participent à la création de la
richesse collective, et de s'interroger sur la manière dont celle-ci peut être mieux répartie
pour permettre à tous d’accéder à l’autonomie et à la citoyenneté.
Il s’agit, surtout, de proposer un modèle de société plus solidaire, dans laquelle chacun
puisse trouver sa place.
La première partie de ce séminaire vise à constituer un fonds documentaire et d'élaborer
une note de synthèse permettant au grand public de se familiariser avec les termes de la
problématique.

Groupe d’appui Politiques Jeunesse
2
Qu'est ce que la richesse ?
La définition qui prédomine aujourd'hui est quasiment exclusivement économique, et les
indicateurs privilégiés pour mesurer le progrès des nations (PIB, taux de croissance)
ignorent la plupart des dimensions du bien-être individuel et collectif : cohésion sociale,
activités non rémunérées, pression humaine sur l'environnement…
Aussi, depuis les années 1990, de nombreuses initiatives, émanant de chercheurs,
d'associations et d'ONG, d'institutions statistiques, ou d'organisations internationales,
visent à évaluer la richesse ou le progrès sur la base d'indicateurs "alternatifs".
Ces nouveaux indicateurs, visant à contrer ou du moins à compléter le PIB, incluent dans
leurs calculs des taux de bien-être.
La mise en place de ces nouveaux indicateurs est-elle suffisante pour "repenser la
richesse" ? Peut-on imaginer une nouvelle définition du terme richesse ?
La richesse comme accumulation de biens matériels
Richesse et productivité
Les travaux de Malthus (1766 – 1834) et sa définition de la richesse
Dans une période de construction et de légitimation de l’économie politique comme
science objective, Malthus a cherché à quantifier l'accroissement des richesses d’une
nation, et à démontrer ainsi sa puissance. Pour cela, il écarte de la mesure de la richesse
tous les biens immatériels. Il pose donc une séparation entre la richesse, dont les
accroissements se mesurent à travers des prix et des quantités, et les travaux
« improductifs », non mesurables, dont il reconnaît la légitimité mais qui ne seront pas
pris en compte dans sa définition de la richesse.
La comptabilité nationale (mise en place en France en 1938)
La comptabilité nationale a été conçue dans la même logique, visant à permettre
d’« exhiber » la puissance des nations. Elle entérine l’idée que la richesse d’une nation se
mesure à l’aune de l’accroissement de son PIB : ce qui compte, c’est l’augmentation des
biens et services produits, amenés sur le marché et appropriés par des individus.
Richesse et satisfaction des désirs
Les économistes du 19ème Jean-Baptiste Say et Walras (Auguste puis Léon) ont posé
comme postulat le lien entre utilité et satisfaction d’un désir individuel : un bien est utile
dès lors qu’il permet de satisfaire un désir (quelle que soit la légitimité de ce désir).
Celui-ci se transforme alors en besoin.
Cette théorie a été reprise dans la comptabilité nationale. Elle envisage la richesse du
point de vue de l’individu : il n’y a de richesse que s’il y a production d’un bien apporté
sur le marché puis approprié par un individu.
Richesse et consommation
Si cette vision des choses s’est développée au 19ème siècle, c’est parce qu’elle sous-
tendait l’idée qu’à travers la production, l’homme aménageait la nature, remettait de
l’humain dans le monde (cf. Hegel et Marx). De même, la consommation était vue
comme un moyen pour l’individu de se transformer, de développer ses facultés par l’acte
de consommer.
Quant au travail et à sa place prépondérante dans nos sociétés, Dominique Méda analyse
le fait qu’au 18ème siècle, le choix a été fait d’instaurer pour réguler la société un ordre
économique plutôt qu’un ordre politique. Cet ordre économique, où travail et production

Groupe d’appui Politiques Jeunesse
3
jouent un rôle essentiel, est fondé sur des lois naturelles : la contribution à la production
et la rétribution qui y correspond.
La richesse comme préservation d'un patrimoine collectif
Les indicateurs de richesse traditionnels ne prennent nullement en compte la
question du "patrimoine collectif" d'une société.
Ce patrimoine pourrait être décomposé de la manière suivante :
- capital « naturel » ou écologique
- capital social / humain : état de santé, d’éducation, situation face à
l’emploi, aux protections sociales, systèmes collectifs, accès à la culture et
aux loisirs …
Il s’agit donc de trouver un moyen de mesurer l’impact de certaines décisions de
production sur ces capitaux, de les considérer comme un stock de ressources auquel il
peut être porté atteinte.
Il faut s’intéresser à la croissance d’un ensemble beaucoup plus large que la seule
production, celui d’un patrimoine général qui nous échoit, que la production contribue à
augmenter mais aussi à diminuer (capital naturel, humain, social).
Travail et richesse
Les alternatives au travail doivent également être prises en compte dans
l’appréhension du concept de richesse.
Depuis le 18ème siècle, en France, on tend à confondre l'ensemble des activités humaines
avec le travail. Notre modèle de société, qui promeut la toute puissance du marché et un
individualisme exacerbé, prévoit que l'existant tout entier est susceptible d'être
transformé en réponse à un besoin et que la vie elle-même peut-être comprise comme la
mise en valeur d'un capital de base, le capital humain.
A l'inverse, les activités amicales, familiales, les activités culturelles (formation de soi et
mise en forme de soi à titre gratuit), et enfin les activités politiques (définition des
conditions de notre vie commune), sont ignorées par notre modèle de société.
1
D'après Dominique Méda, Qu'est-ce que la richesse, Champs-Flammarion, Février 2000, 420 pages
La monnaie, entre échange et domination
Dans nos sociétés contemporaines, n’a de valeur que ce qui
possède une capacité d’échange monétaire. Ce qui n’a pas de prix
en vient à être considéré comme sans valeur.
La monnaie est "fétichisée", c'est-à-dire qu'on transfère la valeur
de l’échange entre humains sur la monnaie elle-même.
Organisée par les dominants, la rareté de la monnaie "oblige les
dominés à n’utiliser qu’une faible partie de leur potentiel
d’échange et d’activité. Cette question est d’autant plus décisive
que l’économie mondiale est aujourd’hui doublement menacée
par l’insuffisance de monnaie à un pôle et par son excès à
l’autre ".
Or, comme l'ont montré Marcel MAUSS et Karl POLANYI,
l’échange monétaire n’est qu’une des formes possibles du rapport
entre les êtres humains.

Groupe d’appui Politiques Jeunesse
4
Selon Dominique Méda, la réalisation de l’ensemble de ces activités constitue un idéal
d’enrichissement collectif, et il faut donc circonscrire le travail pour laisser du champ aux
autres formes de la richesse individuelle et collective.
L’enjeu décisif du temps
2
Patrick Viveret propose d'accorder une attention particulière aux comptabilités
exprimées en temps.
Elles peuvent permettre non seulement l’échange mais aussi l’épargne et le crédit ce qui
ouvre la possibilité de transformations profondes dans la manière d’aborder des
problèmes majeurs tels que la retraite, la formation continue, la réduction du temps de
travail ou l’organisation ambitieuse d’un temps civique et social en partenariat avec les
associations.
La principale question, dans cette perspective, est d’éviter de basculer dans une
obsession de la mesure, plus large encore que celle de sa forme monétaire, et de
sauvegarder le droit au secret du temps de vie privée.
Le PIB, instrument de mesure de la richesse matérielle
3
« Le PIB est la mesure de l’activité économique la plus utilisé ; c’est une mesure de la
production marchande et monétaire ».
Le PIB prend en compte tous les biens finaux, qu’ils soient consommés par les ménages,
les entreprises ou les gouvernements.
Il est composé de deux parties :
- la valeur marchande de tous les biens et services qui se vendent dans un pays
pendant une année
- le coût de production des services non marchands des administrations publiques.
Les limites du PIB
1- Le PIB ne prend pas en compte la notion de bien-être. Tout ce qui peut se
vendre et qui a une valeur ajoutée va "gonfler" le PIB, indépendamment de ce
que cela apporte au bien-être individuel ou collectif.
2- De nombreuses activités qui contribuent au bien-être ne sont pas prises
en compte dans le calcul du PIB parce qu’elles ne sont pas marchandes ou
qu’elles n’ont pas de coût de production monétaire direct.
Ex : activités bénévoles, travail domestique, temps libre…
3. Le PIB ne mesure que les outputs (quantité produites) et pas du tout les
outcomes (satisfaction et bien-être après la consommation de ces biens et
services).
La mesure du PIB est indifférente à la répartition des richesses comptabilisées, aux
inégalités, à la pauvreté, à la sécurité économique… On ne sait pas à qui profite la
croissance.
4. Enfin, le PIB prend en compte les activités réparatrices ou défensives,
c'est-à-dire qu'il prend en compte des activités qui diminuent le bien-être actuel
de la population ou celui des générations futures (destruction des forêts…)
2
Source : "Reconsidérer la richesse", Patrick Viveret, Editions de l'Aube, 2002
3
d'après Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, La Découverte, 2009.

Groupe d’appui Politiques Jeunesse
5
Les indicateurs élaborés par le PNUD
(Programme des nations unies pour le développement)
L’IDH
(Indice de
développement
humain)
Il se base sur le PIB par
habitant, l’espérance de
vie et le niveau
d’instruction d’un pays.
L’ISDH
(Indicateur
sexospécifique de
développement
humain)
qui permet d’évaluer les
différences entre hommes
et femmes de l’IDH.
L’IPF
Indicateur de
participation des
femmes à la vie
économique et
politique
L’IPH
Indicateur de
pauvreté
humaine
Les autres indicateurs
L’ISS (Indice de santé sociale) prend en compte :
- Le taux de mortalité infantile, de maltraitance des enfants et de pauvreté
infantile.
- Le taux de suicide des jeunes, l'usage de drogues, l'abandon d’études
universitaires et enfants nés de mères adolescentes pour les jeunes
- Le taux de chômage et le salaire moyen pour les adultes
- La pauvreté des plus de 65 ans et l'espérance de vie à 65 ans
En plus de ces données liées à l'âge, l'ISS prend en compte le nombre de délits violents,
d'accidents de la route mortels liés à l’alcool, l'accès au logement à un prix abordable et
l'inégalité de revenu familiale.
L’ISS est spécifique aux Etats-Unis. Or, les grands problèmes sociaux doivent en effet
être hiérarchisés différemment d’un pays à l’autre et les pathologies sociales mesurées
den fonction du contexte institutionnel et culturel.
Le BIP 40 (Baromètre des inégalités et de la pauvreté en France), c’est une sorte
de transposition de l’ISS en France. Il se base sur six dimensions : l’emploi et le travail,
les revenus, la santé, l’éducation, le logement et la justice.
L’ISP (Indice de sécurité personnelle) retient des dimensions peut présentes dans
les autres indicateurs. La sécurité est vue à travers trois dimensions : sécurité
économique, sécurité devant la santé et sécurité physique.
L’IBED (Indicateur de bien-être économique durable) est calculé de cette façon :
IBED= consommation marchande des ménages + services du travail domestique +
dépenses publiques non défensives – dépenses privées défensives – coût des
dégradations de l’environnement – dépréciation du capital naturel + formation de capital
productif.
Autres indicateurs : l’IPV (Indicateur de progrès véritable), l’Indicateur d’épargne
véritable.
L’empreinte écologique
C’est le seul indicateur purement environnemental. La notion d’empreinte écologique ne
s’intéresse qu’aux ressources renouvelables, parce que ce sont elles qui vont poser le
plus de problèmes à long terme. Elles fournissent les inputs (matières premières) et
absorbent les déchets (dont le CO2).
L’empreinte écologique se mesure en surface, avec l’hectare globale comme unité de
mesure.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%