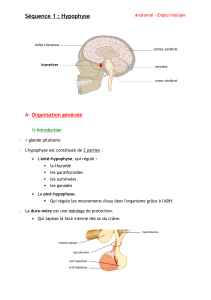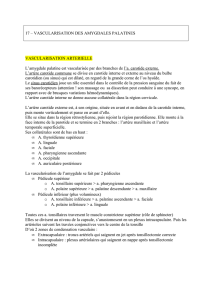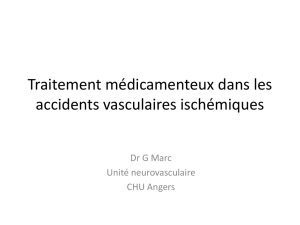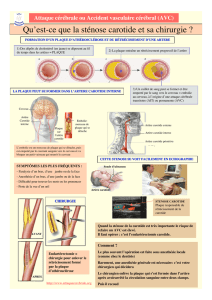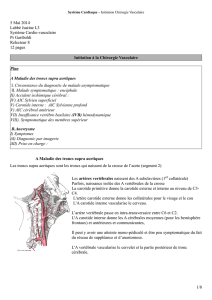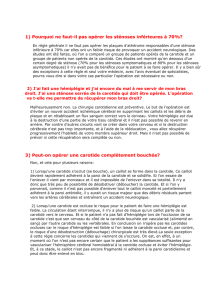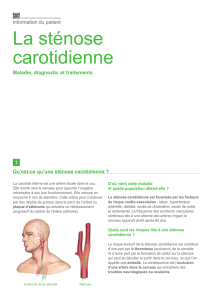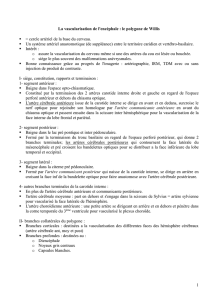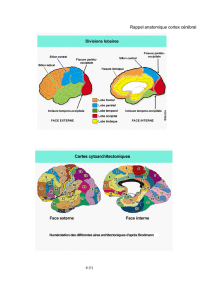La sténose carotide expliquée au patient

Dossier patient
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007
393
patient
Dossier
Figure 2.
Examen par ultrasons de l’artère carotide.
Figure 1.
Irrigation du cerveau par les artères carotides. À droite,
la plaque d’athérosclérose dans la carotide.
La sténose carotide expliquée au patient
●● Dossier préparé par :
Sophie Crozier (urgences cérébrovasculaires), Fabien Koskas (chirurgie vasculaire), groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
Michael Obadia (neurologie), Laurent Spelle (neuroradiologie interventionnelle), Fondation Rothschild,
et Pierre Amarenco (centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale), hôpital Bichat.
Sous la direction de Sophie Crozier
QU’ESTCE QU’UNE STÉNOSE CAROTIDE
ET QUEL EST SON RISQUE ?
Nous avons deux artères carotides, une à droite et une à gauche.
L’artère carotide interne est un vaisseau de grande importance
qui traverse le cou et irrigue la majeure partie du cerveau ainsi
que l’œil (figure 1). Cette partie du cerveau commande des fonc-
tions aussi capitales que la motricité des membres, la sensibilité,
le langage, la vision, etc.
Qu’est-ce qu’une sténose carotide ?
Une sténose carotide est un rétrécissement de l’artère, le plus
souvent lié à un dépôt d’athérome. Cet athérome consiste en une
infiltration des couches internes de la paroi artérielle par des
graisses (plaque d’athérome). C’est l’accumulation de ce matériel
qui finit par obstruer le vaisseau. L’athérosclérose est liée à des
facteurs de risques cardiovasculaires comme l’hypertension
artérielle, le diabète, un cholestérol élevé ou le tabac. Elle affecte
toutes les artères, notamment celles du cœur (coronaires), des
jambes, du cou et du cerveau.
Le degré de sténose, exprimé en pourcentage, correspond
à la réduction de diamètre de l’artère carotide liée au dépôt
d’athérome sur la paroi (figure 1). Il est évalué par des examens
comme l’échographie Doppler des vaisseaux du cou (au moyen
d’ultrasons) [figure 2] ou l’angiographie par résonance magné-
tique (ARM), qui ne comportent presque aucun risque, par
l’angioscanner ou, plus rarement, par une artériographie.
Quels sont les risques d’une sténose carotidienne ?
Le principal risque est l’aggravation du rétrécissement du calibre
de l’artère, aboutissant à l’obstruction complète de la carotide
(votre médecin parle alors d’“occlusion carotide”), ce qui cause
un arrêt de la circulation du sang vers le cerveau et l’œil.
Lorsque la carotide ne fonctionne plus en raison de l’obs-
truction complète causée par la sténose, deux cas de figure se
présentent :
soit le côté du cerveau irrigué normalement par cette caro-
tide peut l’être par une autre artère (par exemple la carotide du
côté opposé, qui apporte le sang grâce à un pont naturel entre
les deux côtés, situé à l’intérieur du crâne et présent chez 70 %
des personnes). Si, grâce à ce pont, la carotide opposée peut
immédiatement apporter du sang au cerveau, certains patients
ne se rendent même pas compte de l’occlusion carotide.
Si, en revanche, le pont ne fonctionne pas, ou s’il fonctionne
seulement un peu, alors malheureusement le patient développe
une attaque cérébrale, dont la gravité dépend de l’importance
de la chute du débit du sang arrivant au cerveau du côté de la
carotide malade.
Cette occlusion de la carotide est causée par un caillot sur la
plaque d’athérome qui rétrécissait l’artère. Parfois, ce caillot
n’obstrue pas complètement la carotide, laissant passer du sang
vers le cerveau, mais une partie du caillot peut se détacher et être
emportée par le courant sanguin vers le cerveau (votre médecin
parle alors d’“embolie au cerveau”) pour boucher une artère plus
loin à l’intérieur du crâne. Dans ce cas, il peut se produire une
paralysie de la moitié du corps et des membres (“hémiplégie”),
ou une perte de la parole (“aphasie”) ou de la vue.
LN-NN-10-1207.indd 393 17/12/07 18:39:37

Dossier patient
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007
394
patient
Dossier
La durée de l’hémiplégie, de l’aphasie ou de la perte de la vue
peut être de quelques secondes seulement, si la circulation du
sang se rétablit toute seule ; votre médecin parle alors d’“accident
ischémique transitoire” (AIT) du cerveau ou de l’œil. Si l’hémi-
plégie dure (la circulation du sang ne se rétablit pas), votre
médecin parle d’“infarctus cérébral”, ce qui désigne la destruction
d’une partie plus ou moins étendue du cerveau.
Alors devant une sténose carotide,
que disent les statistiques ?
Il y a deux cas de figure. Le premier est celui où la sténose n’a
jamais causé d’attaque cérébrale : votre médecin parle de sténose
carotide “asymptomatique”. Le risque d’attaque cérébrale dans ce
cas est faible. Si le rétrécissement est inférieur à 70 %, le risque est
de 1 % par an ; s’il est supérieur à 70 %, le risque est de l’ordre de 2 %
par an (c’est-à-dire que, sur 100 patients qui ont une telle sténose
carotide, chaque année 2 patients ont une attaque cérébrale).
Le deuxième cas de figure est celui d’une sténose découverte
après une attaque cérébrale : votre médecin parle de sténose caro-
tide “symptomatique”. Le risque de refaire une attaque cérébrale
à court terme est majeur. Il s’agit d’une urgence thérapeutique,
c’est-à-dire que le traitement médical doit être commencé sur-
le-champ, et, si une opération de la carotide est décidée, elle
doit être faite dans les 15 jours. Le risque de refaire une attaque
cérébrale est d’autant plus élevé que le rétrécissement de la
carotide est important, et inversement.
QUELS TRAITEMENTS MÉDICAUX
POUR LES STÉNOSES CAROTIDES ?
Le traitement d’une sténose de l’artère carotide repose toujours,
et avant tout, sur le traitement des facteurs susceptibles d’ag-
graver ce rétrécissement et d’augmenter le risque d’attaque
cérébrale (votre médecin parle de “facteurs de risque vascu-
laire”). Parfois votre médecin décidera d’opérer la carotide pour
rétablir un calibre normal de l’artère en enlevant la sténose : il
s’agit de cas très particuliers de rétrécissement de la carotide
supérieur à 70 %.
Le traitement médical des sténoses carotides repose essentiel-
lement sur l’utilisation de médicaments appelés antiagrégants
plaquettaires et sur le contrôle des facteurs de risque vasculaire.
Ce traitement doit être entrepris dans tous les cas, même si
l’on décide par la suite de pratiquer une opération. Il s’agit en
principe d’un traitement à vie. L’efficacité du traitement médical
repose sur son observance. Bien suivi, il peut diminuer le risque
d’attaque cérébrale de 80 %.
Le contrôle des facteurs de risque vasculaire
Le risque de faire ou de refaire une attaque cérébrale en cas
de sténose carotide est d’autant plus important qu’il existe des
facteurs de risque vasculaire. Ces facteurs sont l’hypertension
artérielle (HTA), l’hyperlipidémie (excès de cholestérol ou
de triglycérides dans le sang), l’intoxication par le tabac, et le
diabète.
Quels sont les objectifs à atteindre ?
Hypertension artérielle : le premier objectif est d’avoir une
pression artérielle inférieure à 14/9 cmHg ; cela permet de
diminuer le risque d’attaque cérébrale de 40 %. Si cet objectif
est atteint, ou si votre pression artérielle est déjà naturelle-
ment à ce niveau, votre médecin vous proposera un deuxième
objectif : diminuer encore la pression artérielle de 1 cmHg pour
le premier chiffre et de 0,5 cmHg pour le deuxième chiffre ;
cela permet de diminuer le risque d’attaque cérébrale de 30 %
supplémentaires.
Pour atteindre ces objectifs de pression artérielle, et pour
aider votre médecin à vous traiter, il vous faudra pratiquer
l’“automesure” de la tension à la maison, après avoir acheté un
tensiomètre automatique (qui prend la tension au bras et non
au poignet) [cet appareil n’est pas remboursé ; comptez entre
30 et 50 euros], en respectant la “règle des 3” recommandée
par la Société française d’hypertension artérielle : une série de
mesures tous les 3 mois, 3 jours de suite, à raison de 3 mesures
le matin à jeun de médicaments (en position assise, le bras posé
sur la table, le brassard du tensiomètre placé sur le bras) et de
3 mesures le soir dans les mêmes conditions, après le dîner.
Vous devez noter les résultats de ces mesures dans un carnet et
apporter celui-ci à chaque consultation médicale (ne l’oubliez
pas). La semaine qui précède chaque consultation médicale,
vous ferez de nouveau 3 mesures le matin, 3 mesures le soir,
3 jours de suite. On sait désormais que l’automesure pratiquée à
la maison représente la “vraie” tension artérielle du patient. Son
résultat est plus fiable que la tension prise par le médecin ou le
pharmacien, et que la tension prise par l’infirmière à l’hôpital.
Pour plus d’informations et pour télécharger le carnet de suivi,
consultez le site Internet :
www.auto-mesure.com
.
Cholestérol : en cas de sténose carotide “asymptomatique”, le
taux de “mauvais” cholestérol (on parle de “LDL-cholestérol”)
doit être inférieur à 1 g/l (ou 2,6 mmol/l) ; atteindre cet objectif
diminue le risque d’attaque cérébrale de 20 %. Si vous avez une
sténose carotide révélée par une attaque cérébrale, votre taux
de LDL-cholestérol doit être inférieur à 0,7 g/l (ou 1,8 mmol/l) ;
atteindre cet objectif diminue le risque de refaire une attaque
cérébrale d’environ 30 %.
Tabac : l’arrêt est impératif et diminue le risque d’attaque
cérébrale de moitié dès le sixième mois.
Une activité physique régulière est nécessaire, ainsi que la
perte de poids en cas d’obésité et la réduction des apports en
sel. L’excès d’alcool est interdit.
Le traitement antithrombotique
Bien suivi, le traitement antithrombotique (anticaillot) réduit
le risque d’attaque cérébrale de 20 %, mais aussi celui d’attaque
cardiaque et de décès par maladie vasculaire. Il vise à éviter
la formation des caillots de sang dans les artères, et en parti-
culier sur les plaques d’athérosclérose qui forment la sténose
carotide. On utilise pour cela des médicaments qui empêchent
les plaquettes du sang de se coller sur la paroi de l’artère (votre
médecin parle d’“antiagrégants plaquettaires”). C’est l’amas (ou
agrégation) des plaquettes et d’autres substances qui forme le
LN-NN-10-1207.indd 394 17/12/07 18:39:37

Dossier patient
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007
395
patient
Dossier
Figure 3.
Principe de l’opération chirurgicale que l’on appelle
“endartérectomie carotide”.
caillot de sang. Le chef de file des médicaments antiagrégants
plaquettaires est l’aspirine, à des doses faibles. Les autres sont
le Plavix® et l’Asasantine LP®.
TRAITEMENT CHIRURGICAL DES STÉNOSES
DE LA CAROTIDE
L’opération de la sténose de l’artère carotide (votre médecin
parle d’“endartérectomie carotide”) est une intervention
chirurgicale dont le but est de redonner un calibre normal à
l’artère carotide en enlevant la sténose, qui s’étend en général
sur 1 à 3 cm de hauteur. Elle est le plus souvent décidée quand
la sténose carotide est de plus de 70 % et qu’elle a été respon-
sable d’une attaque cérébrale (que sa durée ait été très brève
ou prolongée).
L’intervention se fait sous anesthésie. Suivant les cas, l’anesthésie
est purement locale (comme chez le dentiste) ou, parfois, géné-
rale. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. C’est votre
chirurgien qui décidera en fonction de votre cas.
Cette opération nécessite trois à cinq jours d’hospitalisation. Elle
comporte cependant un risque de complications neurologiques
ou cardiaques dont certaines peuvent être mortelles ou laisser
des séquelles. Ce risque n’est pas supérieur à 6 %, c’est-à-dire
que moins de 6 % des opérations sont suivies de complications.
Plus le chirurgien vasculaire est entraîné, plus le risque est infé-
rieur à 6 % (il ne faut pas se faire opérer par un chirurgien dont
le risque opératoire est supérieur à 6 %). Ce risque opératoire
justifie la prudence des indications : l’opération ne se justifie
que si le risque d’attaque cérébrale est largement supérieur au
risque de l’opération, ce qui explique que cette opération est
surtout réservée aux cas de sténoses “symptomatiques”, dont
le risque de récidive est majeur.
Pour réduire le risque de complication cardiaque postopératoire
et pour prévenir une attaque cardiaque à plus long terme, des
explorations cardiaques doivent être faites avant l’opération.
L’athérosclérose des artères coronaires, qui irriguent le muscle
cardiaque, relève en effet du même processus que la sténose
carotide.
Conduite de l’opération
L’opération nécessite une incision de quelques centimètres le
long du cou. C’est une opération minutieuse : à l’aide de clamps,
le chirurgien interrompt la circulation dans la carotide et ouvre
celle-ci pour en extraire le matériel qui l’obstrue (figure 3).
Ensuite, l’artère est refermée par suture au fil très fin, en général
à l’aide de procédés visant à augmenter le calibre de l’artère (on
parle d’“angioplastie” ou de “patch d’élargissement de l’artère”).
Ce geste doit laisser une surface lisse sans ressauts ou marches
d’escalier d’aval et d’amont, susceptibles d’être autant de points
d’appel à la formation d’un caillot. Aussi, nombre de chirurgiens
procèdent à un contrôle per- ou postopératoire par ultrasons
(échographie Doppler), angiographie par résonance magné-
tique ou scanner. Durant le clampage, l’irrigation du cerveau
est assurée par les autres artères du cerveau, ce qui nécessite
un contrôle parfait de la pression artérielle par l’anesthésiste.
Dans certains cas, avant le clampage, lorsque plusieurs autres
artères cérébrales sont déjà occluses, on peut craindre que l’irri-
gation du cerveau au cours du clampage soit insuffisante. Dans
ce cas, un “shunt”, c’est-à-dire un tuyau en matière plastique,
est installé temporairement de part et d’autre de la carotide
clampée pendant que le chirurgien la désobstrue (figure 3).
Pendant l’opération et durant une période postopératoire plus
ou moins prolongée, un traitement anticoagulant par héparine
est administré, qui vise à protéger de la formation d’un caillot
de sang sur l’endroit opéré. En outre, le malade est traité par
des antiagrégants plaquettaires comme l’aspirine avant, pendant
et après l’opération.
Après l’opération, le risque de resténose (réobstruction) de la
carotide opérée est faible mais non nul. Surtout, le risque de
voir s’aggraver une sténose de l’autre artère carotide est suffi-
samment élevé pour justifier un suivi par échographie Doppler,
en général tous les 6 à 12 mois. Un traitement médical irré-
prochable comprend le contrôle des facteurs de risque (tabac,
hypertension, lipides, diabète, etc.) et des visites régulières chez
le médecin traitant, le cardiologue et le neurologue pour adapter
les traitements de prévention d’une nouvelle attaque cérébrale
ou cardiaque.
QUELLE PLACE POUR L’ANGIOPLASTIE
CAROTIDIENNE ?
Lorsqu’une opération de la sténose carotide est décidée par votre
médecin, le traitement de référence est la chirurgie. Une autre
technique est actuellement proposée pour traiter le rétrécisse-
ment : l’angioplastie (appelée aussi “dilatation endovasculaire”).
Elle consiste à dilater la sténose en gonflant un petit ballon, puis
à poser un “stent” (ressort) qui maintient écartées les parois
de l’artère carotide à l’endroit de la sténose. Elle est réalisée
par l’intérieur de l’artère. Pour cette raison, elle est séduisante,
mais, pour l’instant, cette technique prometteuse ne peut pas
LN-NN-10-1207.indd 395 17/12/07 18:39:38

Dossier patient
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007
396
patient
Dossier
remplacer le traitement chirurgical, car toutes les études qui ont
comparé l’opération par chirurgie et l’angioplastie endovasculaire
ont conclu à la supériorité de la chirurgie. Ainsi cette nouvelle
technique ne peut-elle vous être proposée que dans deux cas :
soit dans le cadre de la recherche médicale, qui nécessitera votre
signature de consentement à cette recherche (loi Huriet), soit
lorsque la chirurgie ne peut pas être effectuée pour une raison
technique et que l’angioplastie peut l’être. Dans ce dernier cas,
il faut savoir que l’évaluation de ce geste opératoire n’a pas été
validée par des études scientifiques et que l’intervention peut
réussir merveilleusement comme se solder par une complication
grave ou le décès. L’importance de ce risque est inconnue.
Déroulement de l’angioplastie
La procédure est réalisée en salle de cathétérisme équipée
d’appareils de radiologie vasculaire. Après une anesthésie locale
au pli de l’aine (ou éventuellement une anesthésie générale),
une sonde est introduite dans l’artère du pli de l’aine. Dans un
premier temps, on réalise une radiographie de l’artère (artério-
graphie) pour localiser précisément la sténose et évaluer son
importance et son étendue.
Le traitement de la zone rétrécie consiste à la dilater par voie
endovasculaire. Pour cela, la sténose est franchie à l’aide d’un
cathéter appelé “guide”. Ce guide, sorte de long tuyau creux très
fin, sert de tuteur à la montée ultérieure du matériel de dilatation
à l’intérieur de celui-ci. À l’heure actuelle, l’extrémité distale
de ce guide est de plus en plus souvent munie d’un système de
protection cérébrale, sorte de parapluie que l’on déploie au-
dessus de la sténose. Celui-ci agit comme un filtre qui protège
le cerveau d’une embolie. Il évite la migration des nombreux
petits débris qui se détachent de la paroi sténosée lors de la
réalisation de la dilatation.
Une fois la sténose franchie à l’aide du guide et le filtre mis en
place, un stent autoexpansible est amené en regard de la zone
rétrécie. Un stent est un petit cylindre grillagé qui est intro-
duit par voie fémorale artérielle replié sur lui-même, amené
jusqu’au site de la sténose, puis déployé comme un parapluie en
regard de la sténose. Il est fabriqué dans un alliage à mémoire
de forme. Ainsi, une fois déployé à la température du sang, ce
cylindre possède une force radiale suffisante pour maintenir le
vaisseau ouvert en écartant ses parois sur les côtés. Ce stent est
comparable à ceux utilisés en cardiologie interventionnelle pour
le traitement des sténoses coronaires, mais il doit présenter des
qualités techniques particulières.
Lorsque la sténose est serrée ou que la plaque athéromateuse
est trop rigide, la force radiale du stent n’est pas suffisante pour
redonner un calibre normal à l’artère. On réalise alors une dilata-
tion de la zone rétrécie restante par gonflement d’un petit ballon
de façon à redonner à l’artère un calibre satisfaisant.
L’ensemble est opéré après administration d’importantes doses
d’anticoagulant par voie intraveineuse. Un traitement antiagrégant
plaquettaire visant à éviter la formation d’un caillot de sang est débuté
quelques jours avant le début de l’opération. Le patient est ensuite
systématiquement surveillé en unité de réanimation ou en unité de
soins intensifs. La durée d’hospitalisation est de quelques jours.
En plus des médicaments habituels, un traitement par aspirine
et clopidogrel (Plavix®) est administré pendant un mois après
l’angioplastie pour éviter la formation d’un caillot. Au-delà, on
continuera soit le clopidogrel, soit l’aspirine.
Risques de l’angioplastie
Le risque de cette technique est l’embolie cérébrale lors de la
mise en place du matériel, avec pour conséquence une destruc-
tion plus ou moins importante du cerveau. Il existe aussi des
complications propres aux techniques d’angioplastie quelle
que soit l’artère traitée : allergie à l’iode injectée durant le geste
opératoire, hématome au niveau du point de ponction de l’artère
fémorale. Un ralentissement du rythme cardiaque ou une baisse
de la pression artérielle peuvent être observés ; ils sont parfai-
tement connus et sont toujours prévenus par administration
intraveineuse de médicaments appropriés.
QUEL SUIVI EN CAS DE STÉNOSE CAROTIDE ?
Le suivi d’une sténose carotide repose sur une surveillance
clinique et par échographie Doppler des artères cervicales. Le
neurologue doit apprécier le risque que cette sténose cause une
attaque cérébrale. Ce risque s’apprécie sur l’apparition de signes
cliniques d’attaque cérébrale (appelés accidents ischémiques
transitoires [AIT]) : perte de force ou de sensibilité d’un côté du
corps, perte du langage ou de la vue d’un œil ; il s’apprécie aussi
sur les caractéristiques de la sténose analysées par échographie
Doppler : importance de la sténose, progression de celle-ci sur
deux examens successifs, retentissement sur la quantité de sang
qui arrive au cerveau.
Que faire en cas de signes d’attaque cérébrale ?
En cas d’AIT malgré une prise régulière du traitement médical,
ce dernier pourra être renforcé par d’autres médicaments, ou
une opération de la carotide sera décidée. En cas de survenue
de symptômes, même transitoires, vous devrez consulter votre
médecin en toute urgence.
Que faire en cas d’aggravation de la sténose ?
Une échographie Doppler des artères du cou doit être réalisée
tous les trois à six mois selon la survenue de signes cliniques
et la progression de la sténose. Cette surveillance est ensuite
espacée (une fois par an ou tous les deux ans) en l’absence de
symptômes et en cas de stabilité de la sténose carotidienne.
Si la sténose reste inférieure à 70 %, sans symptôme d’attaque
cérébrale, il faut simplement poursuivre le traitement médical
des facteurs de risque vasculaire (voir plus haut). Si la sténose
progresse au-delà de 70 %, même sans symptômes, le risque
qu’elle provoque une attaque cérébrale passe à 2 % par an
(c’est-à-dire que chaque année, sur 100 malades qui ont une
sténose carotide de plus de 70 %, 2 auront une attaque céré-
brale). Dans ce cas, votre médecin discutera avec vous de la
possibilité d’une opération de la carotide. Cette opération
ramène le risque à 1 % par an. Le risque opératoire est de 3 %
LN-NN-10-1207.indd 396 17/12/07 18:39:39

Dossier patient
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007
397
patient
Dossier
Agenda▶
Annonce presse A4 23/11/07 11:17 Page 1
Annonce presse A4 23/11/07 11:17 Page 1
Annonce presse A4 23/11/07 11:17 Page 1
Les articles publiés dans La Lettre du Neurologue le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© février 1997 - EDIMARK SAS - Dépôt légal : à parution. Imprimé en France - Point 44 - 94500 Champigny-sur-Marne
Un numéro spécial intitulé “Forme modérée de la maladie d’Alzheimer : nouvelles données cliniques de la mémantine” (12 pages) est routé avec ce numéro.
à 30 jours (c’est-à-dire que 3 malades sur 100 opérés d’une
sténose carotide “asymptomatique” ont une complication de
l’opération dans le mois qui suit l’opération). Compte tenu de
ce risque opératoire de 3 %, il faut attendre plusieurs années
pour que le bénéfice de l’opération devienne évident : ainsi,
avec un risque spontané d’attaque cérébrale de 2 %, le risque
à opérer la sténose (3 %) est supérieur au risque spontané
la première année. Mais à 5 ou 10 ans, le risque spontané
est respectivement de 10 ou 20 % ; après une opération sans
complication, il est ramené à 5 ou 10 % à 5 ou 10 ans respec-
tivement : l’opération est alors clairement bénéfique. Enfin,
sachez que ce bénéfice n’a été observé que chez les hommes
et pas chez les femmes (on ne sait pas pourquoi), ni chez les
patients âgés de plus de 75 ans. ■
LN-NN-10-1207.indd 397 17/12/07 18:39:56
1
/
5
100%