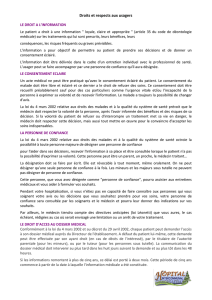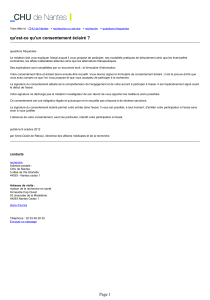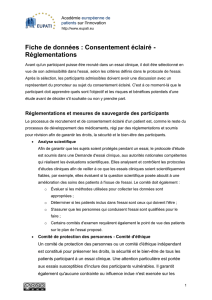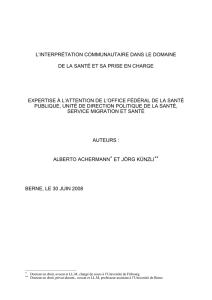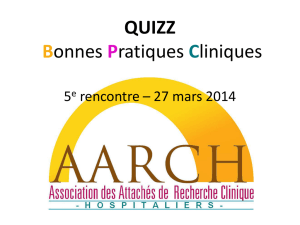Éditorial

Version pré-print : pour citer cet article
E. Vergès, « La recherche biomédicale sous le feu de l’actualité juridique »,
Cahiers Droit, Sciences et Technologies 2010, p. 9.
Éditorial
La recherche biomédicale sous le feu de l'actualité juridique
La Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales fut la première grande loi adoptée en France pour règlementer les
expérimentations scientifiques. La célèbre affaire Milhaud - du nom du médecin qui avait mené des
expérimentations sur des personnes en état de mort cérébrale - semblait annoncer une vive réaction
du législateur, mais également de la jurisprudence. Pourtant, vingt ans après l'entrée en vigueur de la
loi huriet-serusclat (et ses réformes successives), il faut se rendre à l'évidence : les condamnations pour
des recherches illégales sur la personne humaine ont été rares, pour ne pas dire inexistantes. Aussi,
l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 février 2009 (n°08-84.436) a-t-il retenu l'attention et suscité
de nombreux commentaires. Dans cette espèce, un patient avait été admis à l'hôpital souffrant d’un
syndrome respiratoire. Il fut alors intégré dans un essai clinique qui visait à comparer l'efficacité
thérapeutique de deux médicaments. Son consentement ne fut pas sollicité et l'arrêt précise même que
le patient "était très affaibli et manifestement dans l’impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et
exprès". La condamnation semblait ne pas faire de doute, mais le médecin invoqua un argument
pertinent du point de vue du droit pénal. En effet, l'article 223-8 du Code pénal, qui incrimine le fait
de "pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et
exprès de l'intéressé", n'exige pas que ce consentement soit recueilli par écrit. L'investigateur avait alors
invoqué un consentement reçu par oral de la part de son patient. L'interprétation stricte de l'article
223-8 du Code pénal aurait pu conduire à la relaxe du chercheur, s'il avait pu prouver que ce
consentement oral avait été libre, éclairé et exprès. Les faits de l'espèce démontrent qu'il n'en était rien.
Au moment où l'essai clinique avait débuté, le patient n'était pas en état de donner son consentement.
Par la suite, le médecin lui avait délivré un formulaire à signer sans explication complémentaire.
Enfin, l'investigateur alléguait que son patient "n’avait pas formulé d’opposition sur le protocole
présenté". L'affaire semblait donc entendue. Elle en était même caricaturale. L'investigateur avait
d'abord intégré le patient dans un protocole avant d'essayer d'obtenir, en vain, son consentement. La
Cour de cassation dut constater que le consentement du sujet de l'expérimentation n'avait été recueilli
ni pas écrit, ni d'aucune autre façon.
L'arrêt est intéressant à un double titre. D'une part, il constitue une intéressante illustration de la
responsabilité pénale encourue par les chercheurs qui vient compléter le dispositif préventif mis en
place par la loi du 20 décembre 1988. Ce contrôle a priori des protocoles de recherche clinique a
transformé les pratiques expérimentales en profondeur. En revanche, le processus de sanction a
posteriori constitué par les responsabilités civile et pénale des chercheurs semble ne pas avoir connu le
même succès. Le constat est particulièrement vrai s'agissant des conséquences dommageables des
recherches biomédicales. Le régime de responsabilité, pourtant favorable à la victime, n'est pas mis en
œuvre devant les tribunaux. Plusieurs explications sont avancées par les praticiens. La première serait

liée au succès des règlements amiables des litiges. La seconde tiendrait au fait que les dommages
inhérents aux essais cliniques seraient ventilés dans la catégorie des dommages liés à l'activité de soin.
Responsabilité médicale et responsabilité pour recherche biomédicale seraient ainsi confondues en
pratique. Quelle que soit la valeur de ces explications, le juriste s'interroge toujours, avec ou sans
raison, sur l'effectivité d'un régime de responsabilité qui ne trouve pas d'application en jurisprudence.
Mais l'arrêt rendu par la chambre criminelle présente un autre intérêt. Il signale les défauts
rédactionnels de l'incrimination de recherche biomédicale illicite qui conduisent le législateur à se
replonger une nouvelle fois dans la réforme du régime juridique des recherches sur la personne
humaine.
On se souvient que la loi du 20 décembre 1988 a fait l'objet d'une importante révision à l'occasion
de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Depuis le début de l'année
2009, le parlement examine une proposition de loi relative aux recherches sur la personne. Le texte
aurait pu, comme tant d'autres propositions de loi, rester sans suite. Bien au contraire, il suit son
chemin et a déjà fait l'objet d'une navette parlementaire. On peut donc penser que le processus
législatif ira jusqu'à son terme.
La loi en préparation contient plusieurs modifications techniques, parmi lesquelles une réécriture
de l'article 223-8 du Code pénal. La nouvelle rédaction de cette disposition prévoit que l'investigateur
devra obtenir "le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit" du sujet de la recherche. Si la
proposition de loi était adoptée en l'état, le texte d'incrimination reprendrait ainsi l'exigence du
consentement écrit posée par le Code de la santé publique (article L. 1122-1-1 al.2).
Au-delà de cette modification technique, la proposition de loi en cours d'examen prépare une
importante réforme du droit des recherches sur la personne humaine. Elle vise, en effet, à redéfinir les
catégories de recherches et à élargir le contrôle a priori exercé par les comités de protection des
personnes (CPP). Les recherches sur la personne devront être scindées en plusieurs catégories :
recherches interventionnelles et non-interventionnelles. Par ailleurs, les recherches interventionnelles
devraient être, à leur tour, distinguées entre celles qui portent sur des essais de médicament et celles
qui "ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes".
L'objectif est de séparer plus nettement les différentes catégories d'essais au regard du critère du
risque encouru par le sujet qui se prête à cette recherche. L'enjeu est évidemment d'appliquer des
régimes juridiques propres à chaque catégorie. C'est pour cette raison que la typologie des recherches
fait l'objet de divergences au sein du parlement.
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit de soumettre l'ensemble des recherches sur la personne à
l'avis favorable d'un comité de protection des personnes. Cette mesure de contrôle peut s'analyser en
une contrainte supplémentaire, mais elle a surtout été édictée dans l'intérêt des chercheurs. En effet,
les revues scientifiques dans le domaine médical exigent que tout essai sur la personne humaine ait
respecté les standards éthiques pour que les résultats puissent être publiés. L'avis favorable d'un
comité d'éthique facilite ainsi la preuve du respect des normes éthiques par les expérimentateurs.
L'extension de la compétence des comités de protection des personnes présente des aspects positifs,
mais également des risques de dérive. En effet, dans les pays anglo-saxons, les International Review
Board sont des comités d'éthique qui examinent l'ensemble des protocoles de recherche "impliquant"
des personnes. Cette compétence élargie conduit ces comités à contrôler de nombreux protocoles dans
le domaine des sciences humaines et sociales. Le résultat de ces contrôles est parfois surprenant. Par
exemple, il a été demandé à un anthropologue qui travaillait sur la transmission des savoirs dans les
sociétés n'utilisant pas l'écrit, de recueillir le consentement des sujets de la recherche au moyen d'un
formulaire de consentement éclairé ! La notion de recherche non-interventionnelle est
particulièrement vaste. Elle concerne certaines recherches médicales, mais bien au-delà, les recherches
comportementales, les recherches en marketing etc. En d'autres termes, chaque fois qu’une personne
est impliquée dans une étude (questionnaire, entretien, etc.), on se trouve en présence d'une recherche
non-interventionnelle. Certaines de ces recherches sont intrusives ou présentent des risques de nature
psychologique, mais nombre d'entre elles sont anodines. En France, l'extension de la compétence des
CPP aux recherches non-interventionnelles devra faire l'objet d'une définition précise et être
accompagnée d'un inventaire, si l'on souhaite éviter les dérives du système anglo-saxon qui contrôle
sans discernement toutes les recherches impliquant les sujets humains, aussi inoffensives soient-elles.

Une définition abstraite qui ne serait pas assortie d'un inventaire risquerait d'entraîner d'importantes
difficultés d'application.
Etienne VERGES
1
/
3
100%