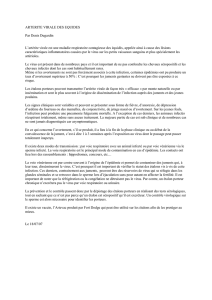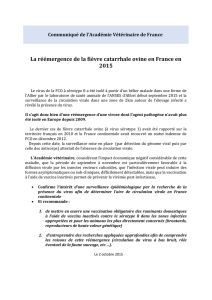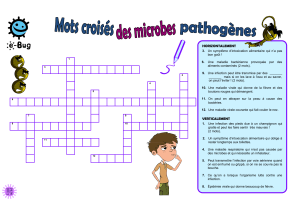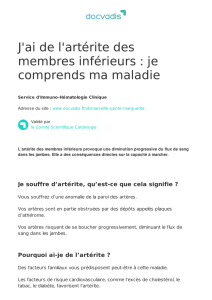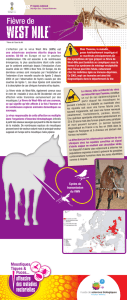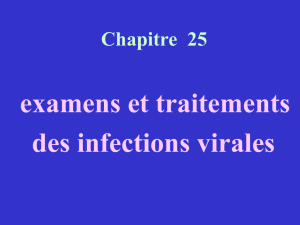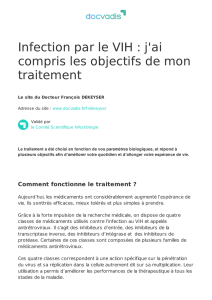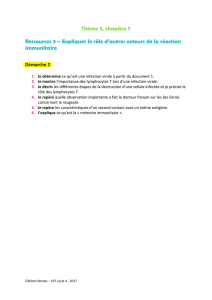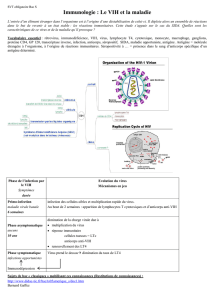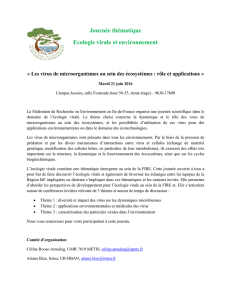Artérite Virale

L’ARTERITE VIRALE DES EQUIDES
Introduction
L’artérite virale est une maladie transmise soit par voie vénérienne (étalon excréteur) soit par voie
respiratoire (dans les jours qui suivent la contamination). A l’exception d’un foyer au Kentucky
(USA) où des mortalités de chevaux ont été constatées et, si ce n’est le fait que certaines souches
provoquent des avortements, cette pathologie n’entraîne pas actuellement par elle-même de
conséquences sanitaires majeures. Il s’agit plus d’un impact international lié à l’image de l’élevage
équin qui concerne principalement les éleveurs de chevaux de race pur-sang.
Agent pathogène
Ce virus appartient à une (nouvelle) famille des Arteriviridae dans l'ordre des Nidovirales
Epidémiologie
L'artérite virale a été identifiée sur les cinq continents. En Europe, la prévalence est de 20 % en
1995 en Allemagne, 4,8 % en Suisse, plus de 30% en Italie. En Suède, 70 à 80 % des trotteurs
seraient séropositifs. En Irlande, la prévalence serait de l'ordre de 0,5 % sur les sérums testés. Les
autorités sanitaires britanniques font état d'une prévalence sérologique très faible. En France le taux
de prévalence est inférieur à 10%. Ces faibles valeurs des taux de prévalence à l'échelle nationale ne
doivent cependant pas masquer une réelle hétérogénéité quant à la circulation du virus dans les
effectifs équins (dans certains établissements, plus de 50 % des chevaux sont séropositifs).
Les modes de transmission de l'EAV sont d'une part la voie vénérienne (jument saillie par un
étalon excréteur ou inséminée avec du sperme infecté), d'autre part la voie aérienne (contamination
par les sécrétions respiratoires d'un cheval récemment infecté).
Les étalons peuvent excréter le virus dans leur sperme. Deux états de portage sont décrits : les
étalons dits porteurs à court terme pendant la phase de convalescence (de quelques semaines) et les
étalons dits porteurs à long terme (le virus persiste pendant plusieurs années). Selon les souches, ce
sont 30 à 60 % des étalons qui sont susceptibles de devenir porteurs sains. Aucune donnée ne
permet de supposer que les juments puissent devenir porteurs sains de virus ou excrétrices
chroniques..
Tableau clinique
Les signes cliniques peuvent être très variables. Classiquement, la maladie se caractérise
initialement par de l'hyperthermie pendant 4 à 5 jours, de l'anorexie et de l'abattement ("fièvre
typhoïde"), puis apparaissent des signes de conjonctivite, de larmoiement, d'œdème des jambes ("en
chaussette") et d'œdème du scrotum chez les étalons. On observe également du jetage et une
congestion de la muqueuse nasale. Peut parfois être observé un oedème des fosses supra-orbitales.
D'autres symptômes tels que de la photophobie, une uvéite, de la toux, de la diarrhée
mais aussi un rash cutané, voire une stomatite ulcéreuse, ont également été signalés.
C'est chez la jument gestante que les manifestations les plus graves peuvent survenir; l'infection
peut entraîner des avortements dans la proportion de 50 à 70 % survenant dans les deux à quatre
semaines après contamination. Les avortements se produisent aussi bien chez les juments ayant
présenté des signes cliniques que chez celles ayant fait une maladie asymptomatique.

Diagnostic
Sérologique : sang sur tube sec : pour dépistage ou pour cinétique : deux sérums à 15-21
jours d’intervalle (une augmentation (x 4 ou plus) du titre en anticorps neutralisants signe
une infection précoce).
Virologique et moléculaire
- en cas d'avortement : prélèvements nécropsiques de foie, rate, poumons, thymus adressés au
laboratoire sous régime du froid (+ 4°C ou -80°C ; éviter -20°C si possible).
- Forme systémique : écouvillons naso-pharyngés adressés au laboratoire sous régime du froid et en
milieu liquide. Détection du virus à partir des cellules sanguines (sang total -sur EDTA ou
héparine- réfrigéré).
- détection d’étalons excréteurs : sperme : fraction riche, adressée sous régime du froid.
Traitement-Prophylaxie
Pas de traitement.
Prophylaxie sanitaire
Isolement des malades. Pour les étalons mis à la monte publique : une sérologie négative est exigée.
En cas de sérologie positive, une recherche de virus dans le sperme doit ëtre effectuée.
Prophylaxie médicale
Vaccination non autorisée en Fance (vaccins atténués utilisés aux Etats-Unis -Etat du Kentucky-).
Réglementation
Note de service DGAL/SDSPA/N2002. Tous les étalons de race pur sang sont soumis dans les trois
mois qui précèdent la demande de cartes de saillies à un contrôle sérologique vis à vis de l’artérite
virale réalisé par un laboratoire agréé. En cas de résultat négatif, les conditions nécessaires vis à vis
de l’artérite virale sont satisfaites. En cas de résultat positif, si l’étalon a été régulièrement vacciné
(voir paragraphe suivant), aucun contrôle complémentaire n’est exigé. Les conditions nécessaires
vis à vis de l’artérite virale sont alors satisfaites.
Une note de service 2003 sera éditée en septembre-octobre.
Laboratoires agréés pour la sérologie artérite virale : LDV 14, 44, 53, 72, 76, Pasteur Cerba.
Laboratoire de référence : AFSSA Alfort
Diagnostic différentiel
Grippe, rhinopneumonie ou viroses mineures (adénovirose, rhinovirose, )
Bibliographie
- ZIENTARA S., VALLARINO G., SCHLOTTERER C., LABIE J.et GICQUEL B. 1995. A
propos d'un foyer d'artérite virale équine en France. Pratique Vétérinaire Equine, vol 27,
n° 1, 23-29.
- ZIENTARA S., LABIE J., GICQUEL B. et BERNADAC M. 1998. L'artérite virale des
équidés en France. Le Point Vétérinaire
Cette fiche a été rédigée par S.Zientara
1
/
2
100%