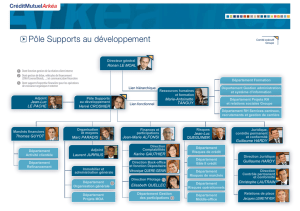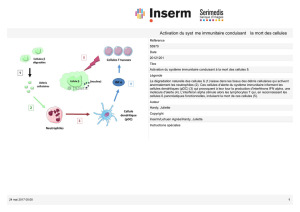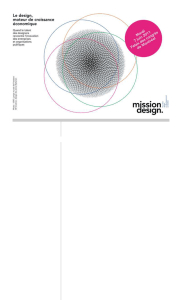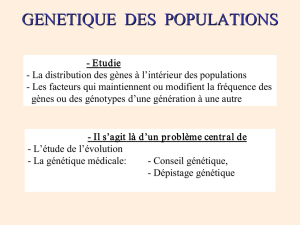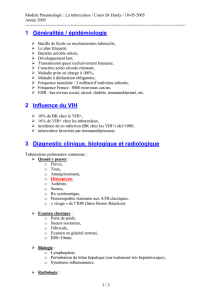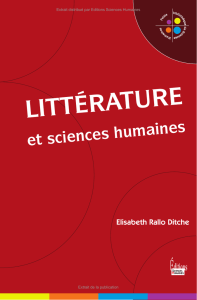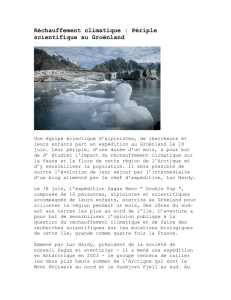Fortune du théâtre d`Alexandre Hardy: la cour et

Fortune du théâtre d’Alexandre Hardy: la cour et la tradition poétique à
l’aube du classicisme
Vincent Dupuis
Département de langue et littérature françaises
McGill University, Montréal
October 2009
A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the
degree of Vincent Dupuis

ii
Résumé / Abstract
Le théâtre d’Alexandre Hardy (1572-1632), non seulement est d’une importance
notable en ce qui concerne les transformations de la sensibilité au XVIIe siècle, mais
encore discrédite à tous les niveaux ce qui doit former la psychologie de l’homme
moderne. En refusant la modernité poétique, au nom de la libre inspiration héritée des
poètes de la Pléiade, l’auteur s’oppose aux contraintes qui dorénavant s’exercent sur
scène, et qui concernent tout autant la censure et la psychologie, que le théâtre et sa
langue. En s’attaquant à la préciosité, il s’en prend à toute la cour, de manière que ses
pièces éprouveront tantôt la morale de l’honnêteté, tantôt la philosophie des apparences.
Ainsi le théâtre d’Alexandre Hardy, qui se veut le dépositaire d’une tradition ancestrale,
repose sur une morale de la virilité, apparaissant d’autant plus désuète à la cour, qu’elle
s’oppose à la grâce et à la désinvolture dont fait montre le courtisan.
The theatre of Alexandre Hardy (1572-1632), is of notable importance not only
with regards to the transformations of the sensibility in the 17the century, but also because
it discredits on all levels that which will form the psychology of modern man. By refusing
poetic modernity in the name of the free inspiration inherited from the poets of the
Pléiade, the author opposes the constraints which were henceforth exerted on the stage,
and which relate as much to censure and psychology as to the theatre and its language. In
attacking the preciosity, he takes on the entire court, such that his plays will sometimes
test the morals of honesty and at other times the philosophy of appearances. Thus the
theatre of Alexandre Hardy, who presents himself as the agent of an ancestral tradition, is
defined by a moral of virility, all the more obsolete at court because it is opposed to the
grace and the ease displayed by the courtier.

iii
Remerciements
Ce travail a profité des conseils et des encouragements d’un
grand nombre de personnes auxquelles je souhaite exprimer ma
gratitude.
Mes remerciements vont tout d’abord à monsieur Normand
Doiron, qui a dirigé mon mémoire et pour qui j’ai une estime sans
bornes. Son enseignement, ses critiques et nos précieux échanges ont
été des sources permanentes de motivation. Je lui suis reconnaissant
de sa constance et de son soutien; il a relu et commenté, avec une
rigueur inépuisable, les différents états de ce travail. Pour sa
disponibilité et son accueil bienveillant, je le remercie encore
profondément.
Je remercie également le Professeur Diane Desrosiers-Bonin
pour l’intérêt qu’elle a porté à mon progrès, pour sa générosité dans
les projets qui m’ont plusieurs fois permis d’enrichir mes recherches.
Un merci tout particulier à Anne Millaire et Guy Beausoleil,
dont l’amitié à été un puissant stimulant intellectuel au cours des
dernières années.
Mes remerciements vont enfin au Département de langue et
littérature française de l’Université McGill pour son soutien.

iv
Table des matières
Note sur le texte………………………………………………………………………v
Introduction ………………………………………………………………………….1
CHAPITRE 1 Ŕ De la cruauté sur scène : le personnage tragique …………………....9
La tyrannie des passions : l’exemple de Mariamne …………………………………10
Cruauté et folie : l’exemple de Didon se sacrifiant …………………………………16
Une morale de la virilité : l’exemple de La Mort d’Achille ………………………... 25
CHAPITRE 2 Ŕ Du pathétique : la poétique du crime …………………………….... 31
Le pouvoir ………………………………………………………………………….. 34
L’adultère ……………………………………………………………………………40
La trahison ………………………………………………………………………….. 46
CHAPITRE 3 Ŕ De la rhétorique : l’éloquence tragique ……………………………...52
La sentence et la vérité ………………………………………………………………54
Vérité et imposture …………………………………………………………………. 59
Vérité et virilité ………………………………………………………………………63
Conclusion …………………………………………………………………………...71
Bibliographie ………………………………………………………………………...76

v
Note sur le texte
La rareté des œuvres complètes d’Alexandre Hardy représente une
première difficulté pour quiconque souhaite entreprendre une étude de
son théâtre. À ce jour, seulement deux éditions sont parues :
1. L’édition originale, contenant de nombreuses erreurs d’imprimerie
desquelles Hardy se serait plaint :
Le Théâtre d’Alexandre Hardy, Parisien, 5 vol., Paris Jacques
Quesnel (vols. I-III), 1624-1625; Rouen, David du Petit val (vol.
IV), 1626; Paris, François Targa (vol. V), 1628.
2. L’édition de Stengel1, qui reprend les pièces dans le même ordre
d’apparition que dans l’édition originale. Cette édition reproduit un
certain nombre de fautes déjà présentes dans celle de 1624-1628 :
elle est d’ailleurs reconnue depuis longtemps comme étant truffée
d’erreurs. Si imparfaite soit-elle, l’édition de Stengel demeure à
nos jours la référence pour le théâtre d’Alexandre Hardy. C’est à
partir de celle-ci que nous travaillerons : toute indication de vers,
de page ou de tome, dans l’étude qui suit, renvoie à cette édition :
Théâtre d’Alexandre Hardy, éd. Edmund Stengel, 5 vol., Marburg,
Elwert et Paris, Le Soudier, 1883-1884.
1 On trouvera également une réimpression de l’édition de Stengel : Théâtre d’Alexandre Hardy, 2 vols,
Genève, Slatkine Reprints, 1967.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
1
/
85
100%