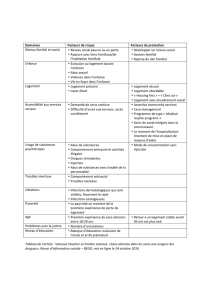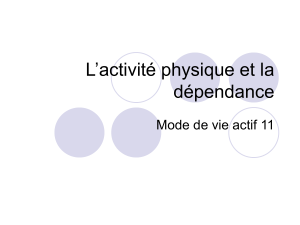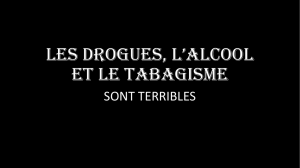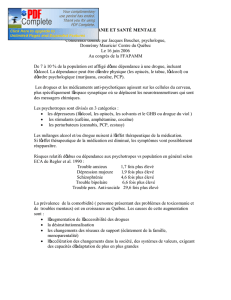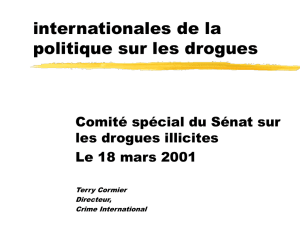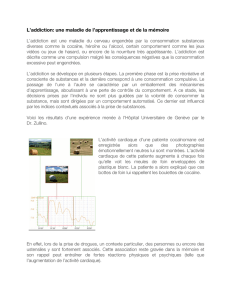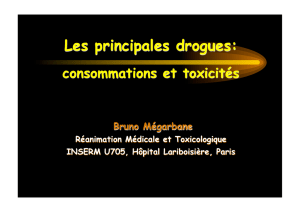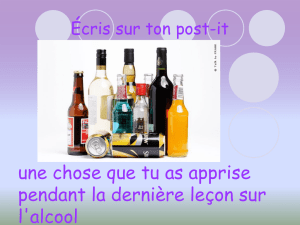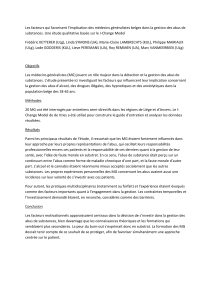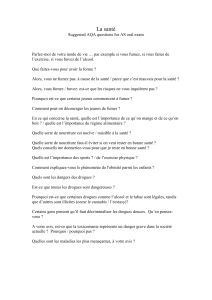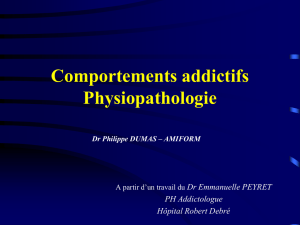Problèmes médicaux lors de la consommation de

279
Problèmes médicaux lors de la consommation
de drogues illégales
Hugo Kupferschmidt
Centre suisse d’information toxicologique (CSIT), Zurich
Karin Fattinger
Division de Pharmacologie et Toxicologie cliniques, Département de Médecine interne, Hôpital Universitaire
de Zurich
1 Introduction
Classification: L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) distingue neuf classes de substances psycho-
tropes différentes:
– alcool
– opioïdes
– cannabinoïdes
– sédatifs et hypnotiques
– cocaïne
– autres stimulants, caféine incluse
– hallucinogènes
– tabac
– solvants volatils
Ces substances peuvent être classifiées en drogues lé-
gales et illégales; le présent chapitre ne traite que des
drogues illégales.
Un risque d’abus existe pour les substances qui
possèdent deux caractéristiques: (1) les non-primates
les consomment également de leur plein gré, et (2)
elles activent de façon aiguë le «système de récom-
pense» («rewarding system») du système nerveux
central. Dans toutes les dépendances à des sub-
stances, le système dopaminergique méso-cortico-
limbique est mis à contribution, dont les neurones se
trouvent dans l’aire du tegmentum ventral avec des
liens vers les noyaux du système limbique (Nucleus
accumbens, Amygdala, Hippocampus). Ce système
favorise la répétition de toutes les activités qui aug-
mentent le sentiment de bien-être; en assurant la prise
de nourriture, la sexualité et les soins à la descen-
dance, il sert directement à la survie de l’espèce. Alors
que la prise de nourriture et la sexualité conduisent
rapidement à une diminution du circuit de récom-
pense avec la répétition des stimuli, les substances fai-
sant l’objet d’abus provoquent une nouvelle libéra-
tion de dopamine à chaque fois.
Dépendance psychique et physique: La dépendance
psychique est définie comme le besoin impérieux d’at-
teindre toujours et encore l’état d’euphorie, de dé-
tente et de contentement que provoque la drogue.
Elle est reliée à l’envie de consommer la drogue de fa-
çon périodique afin de conserver le sentiment de bon-
heur et d’éviter malaise et déplaisir. Une dépendance
physique se manifeste lorsque des symptômes de se-
vrage apparaissent à l’arrêt de la substance: la dispari-
tion de l’inhibition du système nerveux sympathique
peut alors entraîner des symptômes neurologiques et
cardiovasculaires potentiellement mortels. Les symp-
tômes de sevrage dépendent nettement de la durée de
l’abus; comme une nouvelle consommation de drogue
peut les faire disparaître rapidement, un cercle vicieux
s’établit en cas d’abus chronique. Survient alors une
tolérance ou une tachyphylaxie supplémentaire: une
augmentation continuelle de la dose est nécessaire
pour obtenir un effet identique, jusqu’à ce qu’un nou-
vel équilibre s’établisse à haute dose et à intervalles
rapprochés. Des processus d’adaptation fonctionnels
et morphologiques ont alors lieu au niveau cérébral.
Leur rôle dans la dynamique de la toxicomanie n’est
pour l’heure que partiellement connu. Une chose est
cependant sûre: la dépendance psychique peut persis-
ter bien longtemps après une cure de désintoxication
réussie.
Abus de drogues: L’abus de drogues est un comporte-
ment acquis; les propriétés euphorisantes des drogues
permettent de prendre de la distance avec les conflits
liés à la personnalité et perçus comme une menace.
De ce fait, l’abus chronique de drogues est une mala-
die: le «gain» ressenti au départ comme une victoire
sur la vie débouche sur un processus autodestructeur,
modulé par des facteurs biologiques (génétiques),
psychologiques et sociologiques. Dans ce contexte, la
classification des drogues uniquement en fonction de
leur mécanisme d’action ou de leur tableau clinique
est presque impossible à établir. Le tableau clinique
présente de nombreux recoupements, car les effets
sur le cerveau sont le résultat de l’influence molécu-
laire de très nombreux systèmes, pouvant être activés
ou inhibés simultanément.
Drogues de substitution et polytoxicomanie: En de-
hors des stupéfiants à proprement parler, toutes les
substances qui modifient la perception de l’envi-
ronnement et qui s’accompagnent de sensations eu-
phoriques peuvent être utilisées comme drogues de
substitution et conduire à la dépendance. C’est ainsi
qu’à côté des véritables drogues, une multitude de
médicaments (comme les antidépresseurs tricycli-
ques, les phénothiazines ou les anti-H1) ou de consti-
tuants de plantes et de champignons (comme noix/

280
fleurs de muscade ou psilocybine/psilocine) peuvent
déclencher une perception chimérique de la réalité.
L’inhalation de solvants, un problème sanitaire qui
échappe en grande partie aux statistiques, peut égale-
ment générer euphorie et illusions. Depuis long-
temps, l’intérêt des toxicodépendants ne se porte plus
seulement sur la codéine, le flunitrazépam ou la mé-
thaqualone pour compléter ou remplacer les drogues
«dures» usuelles. Des médicaments de prime abord
anodins peuvent être utilisés dans ce but (comme
l’acide méfénamique). La polytoxicomanie est égale-
ment répandue, surtout chez les grands toxicomanes.
En utilisant des substances dont le profil d’action est
différent, ils cherchent non seulement à renforcer
l’euphorie, diminuée par les effets de tolérance, mais
aussi à réduire l’apparition d’effets indésirables diffi-
cilement supportables. L’héroïne permet ainsi de
contrer l’énorme stimulation du système nerveux
adrénergique engendrée par la cocaïne. Combiné
avec la cocaïne, l’alcool provoque des problèmes à
plusieurs niveaux: il exerce certes un effet sédatif,
mais le métabolite qui en dérive provoque un nou-
veau tableau d’intoxication, similaire à celui de la co-
caïne.
Drogues de synthèse: Pour augmenter de façon ciblée
les effets «souhaités», mais surtout pour éviter l’illéga-
lité, aussi bien des drogues connues que des médica-
ments voient leurs structures modifiées pour être ven-
dus sur la scène de la drogue (drogues de synthèse ou
«designer drugs»). Les exemples les plus connus sont
les dérivés de l’amphétamine et les drogues dérivées
du fentanyl. La naissance de la 3,4-méthylènedioxy-
méthamphétamine (MDMA ou «ecstasy») a suivi un
parcours classique: la 3,4-méthylènedioxyamphéta-
mine (MDA ou «Adam»), la «drogue de l’amour» des
soixante-huitards, a été déclarée illégale par l’OMS en
raison de ses propriétés neurotoxiques. L’ecstasy ne se
distingue de la MDA que par un groupe méthyle sup-
plémentaire. Lorsque l’OMS classe également l’ecsta-
sy dans la liste des drogues illégales à cause de son po-
tentiel toxique, la 3,4-méthylènedioxyéthylamphéta-
mine (MDEA ou «Eve») fait son apparition sur le
marché; d’autres dérivés montrant un spectre d’action
et des effets indésirables comparables ont suivi pour
contourner l’illégalité de l’ecstasy. MDA, MDMA et
MDEA ne sont que quelques exemples d’une série de
drogues de synthèse dérivées de l’amphétamine ou de
la méthamphétamine. Ces dérivés amphétaminiques
sont également vendus sous le nom «d’ecstasy».
Substances de substitution: En dehors de l’offre no-
toire de substances apparentées, l’adjonction de sub-
stances de substitution bon marché («adulterants»)
complique l’appréciation du tableau clinique en cas
de consommation de drogues. Caféine, quinidine,
mannitol, procaïne et lidocaïne, ainsi que glucose,
dextrose, lactose et amidon sont souvent détectés lors
de contrôles. Les amphétamines et la phencyclidine
ont également été utilisées comme substances de
substitution. L’évolution devient inquiétante lorsque
de l’amphétamine, de la cocaïne ou d’autres drogues à
potentiel de dépendance élevé sont mélangées aux
comprimés d’ecstasy. Les impuretés issues durant la
synthèse peuvent également modifier considérable-
ment le tableau clinique.
Symptomatologie et principes thérapeutiques: En rè-
gle générale, les problèmes médicaux apparaissent
lors de la consommation de drogues illégales soit suite
aux effets aigus toxiques immédiatement après la
consommation, soit en relation avec les manifesta-
tions de dépendance lors de prise chronique. Les pa-
ragraphes suivants donnent un aperçu des problèmes
somatiques aigus liés à un abus des drogues illégales
sous forme de brefs résumés tirés de la littérature. Les
publications contiennent malheureusement peu de
données quantitatives sur l’incidence des symptômes
et leur gravité. La liste de symptômes chroniques est
destinée à mettre en évidence la dynamique liée à la
toxicomanie. Pour une meilleure compréhension,
chaque passage débute par une courte présentation
des processus neurophysiologiques importants – pour
autant qu’ils soient connus. Les directives formulées
pour le traitement des intoxications aiguës (voir le
chapitre «Intoxications médicamenteuses») valent
également en cas d’intoxication par des drogues illé-
gales. Outre les mesures d’urgence, l’administration
d’antidotes – s’ils existent – constitue les piliers du
traitement. Le lavement intestinal orthograde avec
une solution de Fordtran a fait ses preuves lors de
«body packing» pour accélérer l’élimination des pa-
quets de drogue hors de l’intestin. Les principes théra-
peutiques qui suivent se rapportent ainsi principale-
ment à des mesures d’urgence plus ou moins spécifi-
ques. La collaboration d’une équipe médicale pluri-
disciplinaire est indispensable pour le traitement des
effets d’un abus chronique et le suivi à long terme des
personnes dépendantes, car le sevrage ainsi que l’éta-
blissement et le maintien de l’abstinence représentent
davantage qu’un simple problème toxicopharmacolo-
gique.
2 Présentation détaillée des
drogues illégales
2.1 Marijuana/Haschisch
Le tétrahydrocannabinol (THC) est le principe actif
majeur de trois préparations qui sont principalement
fumées ou consommées sous forme de gâteaux ou de
boissons: (1) la marijuana («herbe») est constituée des
feuilles séchées et des inflorescences du chanvre fe-
melle; la teneur en THC s’élève aujourd’hui à environ
15% (1–5% par le passé) par des cultures spéciales
(«herbe indoor»), parfois même à 25%; (2) le ha-
schisch («kif») est une résine contenant 10% de THC

281
et (3) l’huile de haschisch est un extrait qui contient
50% et plus de THC. Environ 60 cannabinoïdes sup-
plémentaires partiellement actifs, ainsi que 360 autres
constituants ont été répertoriés, ce qui complique
énormément l’évaluation du profil toxicologique.
La caractéristique du THC repose sur ses proprié-
tés stimulantes sur le SNC, en plus d’un effet psycho-
dépresseur. Le THC réagit avec la plupart des sys-
tèmes de neurotransmetteurs; il se lie à des récepteurs
spécifiques (CB1 et CB2) dans le cervelet et la zone
du cortex frontal. L’effet anticonvulsivant, analgé-
sique et antiémétique des cannabinoïdes est partielle-
ment dû à cette liaison spécifique. Ils abaissent la tem-
pérature corporelle au niveau central et augmentent
l’appétit.
Tableau clinique: Euphorie, détente et somnolence
sont des effets aigus à faibles doses, accompagnés gé-
néralement d’une légère ataxie et d’une faiblesse
musculaire. Le THC provoque une vasodilatation gé-
nérale et une tachycardie. Lorsque la dose augmente,
l’intensité des perceptions sensorielles se modifie, ain-
si que la notion d’espace et de temps. Se produit alors
une perte du sens de la réalité, accompagnée d’une ap-
préciation erronée des performances personnelles et
de troubles de la mémoire à court terme. Chez les néo-
phytes (intoxication accidentelle!) et à hautes doses
apparaissent une sensation d’oppression au niveau de
la poitrine, de l’anxiété et des états d’excitation allant
jusqu’à la panique. Une terrible sensation de soif, des
vertiges, ainsi que des nausées et des vomissements –
malgré des propriétés antiémétiques – constituent
d’autres symptômes végétatifs. Une augmentation
supplémentaire de la dose cause égarement, illusions
et hallucinations avec induction de psychoses. Une
évolution vers la psychose se rencontre plus fréquem-
ment lorsqu’il y a association à d’autres psychostimu-
lants.
Contrairement aux symptômes d’intoxication co-
gnitifs et végétatifs, l’utilisation chronique de marijua-
na provoque rapidement une tolérance qui touche
l’euphorie recherchée et conduit ainsi à une augmen-
tation de la consommation. Un «syndrome d’absence
de motivation» a été décrit après un abus chronique,
accompagné d’humeur dépressive, de léthargie, de
troubles de la concentration et altération de la pensée.
Le contraire reste cependant possible, à savoir qu’un
«syndrome d’absence de motivation» latent pourrait
prédestiner à la consommation de marijuana. La
question sur le potentiel toxicologique des cannabi-
noïdes reste encore ouverte, surtout concernant leurs
effets sur le fœtus; vu le nombre de consommatrices,
cette question n’est pas seulement d’intérêt scienti-
fique. Les lésions chroniques respiratoires dues, entre
autres, à la forte teneur en goudron des cigarettes de
marijuana restent par contre incontestées. L’appari-
tion d’un léger syndrome de sevrage est un phéno-
mène connu, accompagné de nervosité, de troubles de
l’humeur anxio-dépressifs, de tremblements et de
troubles du sommeil, et peut persister quatre à cinq
jours.
Mesures thérapeutiques: En règle générale, des
mesures spécifiques sont rarement nécessaires en cas
d’intoxication aiguë par la marijuana:
– en cas de psychose (le plus souvent auto-limitée et
de courte durée): environnement calme;
– en cas d’anxiété ou d’agitation: benzodiazépines;
– en cas de troubles dépressifs: consultation psychia-
trique et traitement antidépresseur.
2.2 Opioïdes et opiacés
Les opiacés regroupent les constituants naturels et
semi-synthétiques de l’opium (codéine, morphine,
héroïne), alors que la notion d’opioïdes englobe
également les substances entièrement synthétiques.
Malgré des structures très différentes, les opioïdes
possèdent une gamme d’effets désirables et indésira-
bles comparable, principalement dus à leur liaison à
différentes classes de récepteurs aux opioïdes (récep-
teurs µ,δet κ). Les agonistes purs sont à différencier
des antagonistes partiels (comme buprénorphine,
pentazocine, nalorphine). Tous les opioïdes peuvent
engendrer une toxicomanie et une dépendance, qui
semblerait toutefois moins forte pour les antago-
nistes partiels. Les drogues de synthèse dérivées du
fentanyl, appelées «héroïne synthétique» (α-méthyl-
fentanyl «china white» et 3-méthylfentanyl «persian
white») sont jusqu’à 3000 fois plus puissantes que la
morphine. Elles engendrent presque immédiatement
une euphorie prononcée, ainsi qu’une rigidité thora-
cique extrême et une dépression respiratoire, même
à petites doses, qui aboutissent souvent à la mort.
Des impuretés contenues dans les esters de la péthi-
dine (MPPP, PEPAOP) ont provoqué un syndrome
parkinsonien grave et irréversible. En règle générale,
une réaction de sevrage apparaît lorsque l’opioïde
faisant l’objet de l’abus, quel qu’il soit, n’est plus pris;
une réaction de sevrage aiguë peut également être
déclenchée lorsqu’un antagoniste des opiacés est ad-
ministré (naloxone, naltrexone). La synthèse et la li-
bération de noradrénaline est inhibée au niveau pré-
synaptique par l’intermédiaire des récepteurs aux
opioïdes. Cette inhibition est supprimée durant le
sevrage, laissant place à une véritable «marée de nor-
adrénaline». L’administration de clonidine, un ago-
niste α2, permet d’inhiber similairement la synthèse
de noradrénaline au niveau présynaptique et de trai-
ter les symptômes adrénergiques durant une réaction
de sevrage. De très graves intoxications peuvent
avoir lieu durant un traitement de sevrage par la nal-
trexone lorsque les patients essaient de contre-carrer
son effet antagoniste par une augmentation massive
des doses d’opiacés. Les anciens toxicomanes dépen-
dant des opioïdes ne devraient pas être réexposés
trop facilement aux opioïdes, car la dépendance psy-
chique persiste bien plus longtemps que la dépen-
dance physique.

282
Tableau clinique: D’abord survient une euphorie,
qui fait place à des sentiments dysphoriques rapide-
ment après le «kick» obtenu lors d’abus répétés. L’in-
toxication aiguë se caractérise par les symptômes sui-
vants: sédation allant jusqu’au coma; myosis; à des
doses plus élevées, inhibition de la réaction du centre
respiratoire à l’irritation due au CO2avec dépression
respiratoire; également typiques: bradycardie, hypo-
tension artérielle, hypothermie et diminution des ré-
flexes allant jusqu’à l’aréflexie, y compris inhibition
du réflexe de la toux, également rigidité des muscles
striés, surtout au niveau du tronc, augmentation du to-
nus des muscles lisses avec constipation et rétention
urinaire; prurit, ainsi que vasodilatation générale et
bronchoconstriction dues à la libération d’histamine.
Le stade chronique est marqué par une importante dé-
pendance psychique et physique, ainsi que par le
développement d’une tolérance. La tolérance peut ré-
gresser dès quelques jours d’abstinence; un risque de
dépression respiratoire existe réellement lors d’une
réexposition. Comme la polytoxicomanie s’accom-
pagne souvent d’isolement social, les données sur les
lésions chroniques altérant les fonctions cérébrales
sont rares. Une évolution vers la dépression est cepen-
dant fréquente. De plus, des troubles du système im-
munitaire accompagnés d’infections virales et bacté-
riennes locales se manifestent. Une lésion directe
toxique peut apparaître sous forme de cardiomyopa-
thie ou d’un œdème pulmonaire, bien connu avec l’hé-
roïne. Si la stimulation des récepteurs aux opiacés par
des opioïdes exogènes disparaît, l’activité du sympa-
thique augmente rapidement et une réaction de se-
vrage apparaît, qui débute par le besoin intense de
drogue («craving») et des sentiments d’anxiété, suivis
de bâillements, de nervosité, d’insomnie, de transpira-
tion, de larmoiement et de rhinorrhée, puis de my-
driase, chair de poule, tremblements, spasmes et dou-
leurs musculaires, bouffées de chaleur. Un syndrome
de sevrage marqué verra l’apparition supplémentaire
de tachycardie, élévation tensionnelle, tachypnée,
nausées, fièvre, ultérieurement diarrhée, vomisse-
ments, transpiration excessive et douleurs massives
des membres. Avec l’héroïne et la morphine, les pre-
miers symptômes apparaissent après 8 à 10 heures; ils
atteignent leur maximum après 2 à 3 jours. Avec la
méthadone, les premiers symptômes s’observent
après 12 à 24 heures et persistent 1 à 3 semaines. La
réaction de sevrage est éventuellement un peu plus
faible avec les agonistes partiels. L’arrêt de drogues
«coupées» peut également provoquer des symptômes
d’abstinence. Des vasospasmes accompagnés d’in-
farctus cérébral et du myocarde ont été occasionnelle-
ment observés.
Mesures thérapeutiques: Administrer la naloxone
comme antagoniste spécifique des opioïdes en cas de
dépression respiratoire potentiellement mortelle et
de risque d’insuffisance cardiovasculaire; surveiller le
rythme cardiaque, car des troubles du rythme ventri-
culaire et des fibrillations ventriculaires sont possi-
bles, spécialement en cas d’intoxications mixtes avec
de la cocaïne:
– intoxication chez l’adulte: 0,4 mg (–2 mg) de na-
loxone, à doser en fonction des signes cliniques (di-
latation pupillaire, fréquence respiratoire, pression
sanguine, conscience);
– intoxication chez le toxicomane dépendant des
opiacés: après la dose initiale, titrer la naloxone par
palier de 0,2 mg afin d’éviter les symptômes de se-
vrage aigus; une éventuelle perfusion après la dose
initiale permet d’antagoniser l’effet des opioïdes
de longue durée d’action (comme la méthadone) et
la «remorphinisation»;
– intoxication chez le petit enfant: naloxone
0,01 mg/kg de poids corporel;
– en cas d’œdème pulmonaire toxique: respiration
avec PEEP, les diurétiques sont le plus souvent in-
utiles;
– en présence de symptômes de sevrage: clonidine
(HCl) 3 × 0,3 mg p.o. en surveillant la pression san-
guine et le pouls, augmenter éventuellement jus-
qu’à 1,2 mg p.o. par jour; diminuer progressive-
ment la clonidine après 4 à 7 jours pour l’héroïne,
ou après 14 jours pour la méthadone (attention:
augmentation de la pression sanguine à l’arrêt du
traitement!); les benzodiazépines peuvent momen-
tanément être utiles, mais doivent être utilisées
avec retenue (dépendance);
– en cas de vasospasmes: inhibiteurs calciques ou
magnésium i.v.
2.3 Cocaïne
La cocaïne stimule la libération de neurotransmet-
teurs biogènes et inhibe la recapture synaptique de la
noradrénaline et de la dopamine. La cocaïne pro-
voque ainsi une intoxication aux catécholamines ful-
gurante, aiguë et dose-dépendante; les réserves de
tous les neurotransmetteurs biogènes s’appauvrissent
rapidement. Dynamique d’action: forte euphorie
après quelques secondes (i.v., «crack») ou quelques
minutes («sniffer») avec augmentation de la
conscience de sa propre valeur, sensations intenses et
diminution de l’anxiété. Disparition de l’euphorie
après quelques minutes («crack») ou 1⁄2heure (i.v.,
«sniffer») avec augmentation des sentiments d’anxié-
té, illusions et hallucinations allant jusqu’à des per-
ceptions paranoïdes; besoin impératif d’une nouvelle
dose («craving»). Sans nouvelle dose, «crash» accom-
pagné de fatigue, perte d’entrain et forte tendance
dépressive; besoin intense de cocaïne. L’euphorie gé-
nérée par la cocaïne devient un objectif vital («junkie
state»). Augmentations des doses dues au développe-
ment d’une tolérance et passage à un abus chronique
en cas de «craving» fréquent. En cas d’application
chronique, carence permanente en neurotransmet-
teurs, avec mécanismes d’adaptation fonctionnels et
structuraux au niveau du cerveau, ainsi que symp-

283
tômes de toxicité directe ou indirecte de la cocaïne,
touchant potentiellement tous les systèmes organi-
ques. La consommation simultanée d’alcool atténue
l’hyperactivation du SNC; l’alcool provoque simulta-
nément l’apparition de l’éthylcocaïne, un métabolite
de la cocaïne dont le potentiel de toxicité et de dé-
pendance est comparable à celui de la cocaïne elle-
même.
Tableau clinique: En cas d’intoxication aiguë, la sti-
mulation massive du système nerveux adrénergique
provoque mydriase, agitation prononcée, transpira-
tion, tachycardie et hypertension artérielle. La vaso-
constriction générale accompagnée de spasmes ou de
la formation de thrombi, et l’augmentation des be-
soins en oxygène peuvent provoquer des signes isché-
miques allant jusqu’à l’infarctus du myocarde. Ary-
thmies ventriculaires par surcharge en calcium intra-
cellulaire, plus blocage des canaux sodiques; des bra-
dyarythmies accompagnées de torsades de pointes
sont également possibles. Comme au niveau car-
diaque, des accidents vasculaires peuvent se produire
au niveau cérébral (lésions ischémiques et hémorra-
gies cérébrales), le facteur pathogénétique étant un
appauvrissement en magnésium intracellulaire en
plus de l’activation sympathique. Panique, psychoses
et crises épileptiques sont d’autres symptômes graves
touchant le SNC, en dehors d’illusions marquées et
d’hallucinations. L’apparition supplémentaire d’une
rhabdomyolyse accompagnée d’insuffisances rénale
et hépatique et d’hyperthermie débouche sur un pro-
nostic sérieux. L’intervalle libre de drogues lors d’un
abus chronique est caractérisé par un important syn-
drome d’anhédonie, partiellement accompagné de
troubles dépressifs graves et de réactions psychoti-
ques ou d’idées délirantes. Désintégration sociale
croissante avec augmentation du risque de polytoxi-
comanie et ses conséquences. Augmentation du nom-
bre d’infections, y compris endocardite, pas seule-
ment en cas d’application i.v. Dissection aortique,
hypertrophie ventriculaire gauche et cardiomyopa-
thie sont les conséquences à long terme. La toxicité de
la cocaïne est probablement plus élevée durant la
grossesse et la période prénatale. L’influence de la co-
caïne sur le fœtus et le développement précoce de
l’enfant fait l’objet d’une recherche intensive.
Mesures thérapeutiques:
– benzodiazépines en cas d’anxiété et d’agitation,
également lors d’élévation de la température cor-
porelle et en cas de crises épileptiques;
– substitution volumique, refroidissement physique
par enveloppements de glace; éventuellement sul-
fate de magnésium i.v. en cas d’hyperthermie po-
tentiellement mortelle;
– en cas de réactions psychotiques: halopéridol;
–α-bloquant (phentolamine) en cas d’hypertension
artérielle (attention: un blocage uniquement bêta
entraîne une aggravation à cause de la fraction al-
pha-adrénergique non bloquée);
– nitroglycérine sublinguale en cas d’arythmies; suite
du traitement selon les directives valables en car-
diologie (attention: pas d’antiarythmiques de
type I, car la cocaïne bloque déjà les canaux sodi-
ques);
– en cas de toxicité hépatique: N-acétylcystéine en
raison de l’appauvrissement en glutathion dû à la
cocaïne, éventuellement traitement antioxydant
par les vitamines C et E;
– en cas de craving massif: traitement psychiatrique,
éventuellement antidépresseur.
2.4 Amphétamines
Les amphétamines possèdent des propriétés dopami-
nergiques et de puissantes propriétés adrénergiques.
A doses élevées, elles provoquent en plus une libéra-
tion de sérotonine et inhibent la recapture synaptique
des amines biogènes. L’effet s’amenuise avec l’épuise-
ment des réserves d’amines. Les principaux sites d’ac-
tion se trouvent dans les neurones nigrostriataux (sté-
réotypies), l’hypothalamus (inhibition de l’appétit),
la formation réticulée (augmentation de l’activité) et
le système nerveux sympathique périphérique (symp-
tômes végétatifs). De nombreuses substances d’action
similaire sont produites illégalement par modification
de la structure phényléthylaminique commune; cer-
taines pénètrent mieux à l’intérieur du cerveau et
agissent plus longtemps que l’amphétamine elle-
même, comme entre autres la méthamphétamine
(«ice») et la phentermine. Le khat (Catha edulis)
est une plante d’Afrique de l’Est dont la substance
active est la norpseudoéphédrine; son effet stimulant
sur le SNC est d’environ 10% de celui de l’amphéta-
mine.
Tableau clinique: La toxicité aiguë touche essen-
tiellement le SNC et le système cardiovasculaire. Eu-
phorie, chez certains patients états anxieux dysphori-
ques, agitation motrice, augmentation de l’excitabilité
allant jusqu’à l’agressivité, ainsi que stéréotypies sont
caractéristiques. Les hallucinations sont typiques et
peuvent faire partie du délire amphétaminique à côté
de troubles du discernement, de l’orientation, de la
mémoire et de la conscience. Les réactions psychoti-
ques sont fréquentes et vont souvent de pair avec un
délire de persécution et une mégalomanie. Mydriase,
tremblements, transpiration, tachycardie et hyperten-
sion artérielle sont des symptômes végétatifs cou-
rants. Des crises épileptiques et des arythmies ventri-
culaires apparaissent à hautes doses. Une élévation
excessive de la pression sanguine et des vasospasmes
peuvent entraîner une dissection aortique, des infarc-
tus et des hémorragies cérébrales. L’apparition d’une
hyperthermie est également défavorable pour le pro-
nostic, surtout si elle s’accompagne d’un syndrome de
coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et
d’une rhabdomyolyse avec insuffisance rénale crois-
sante. En cas d’application chronique, la perte de l’ef-
fet conduit à une augmentation de la posologie. Une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%