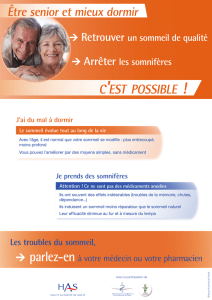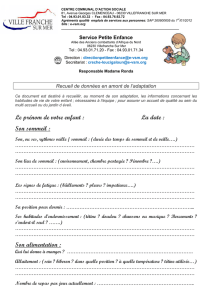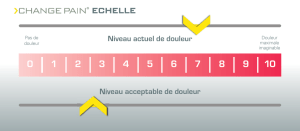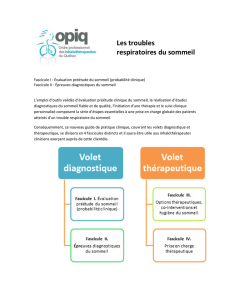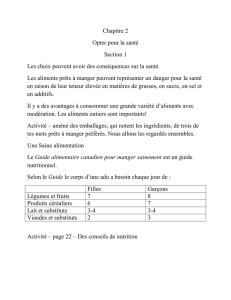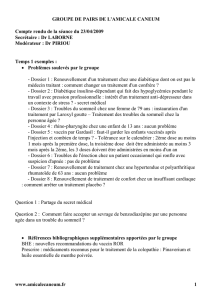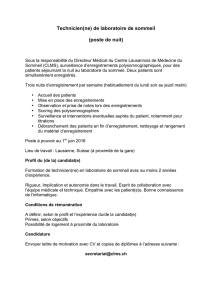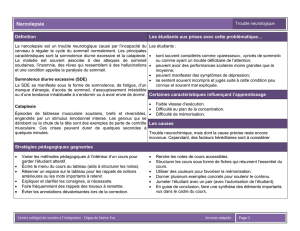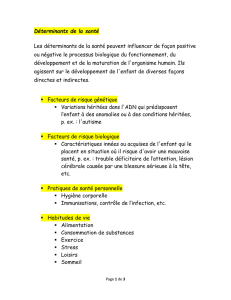Anthropologie de la nuit

1
I- PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL ADN : L’ETAT DE LA QUESTION
ANTHROPOLOGIE DE LA NUIT: INTERROGER LA NOCTURNITÉ1
Présentation La nuit, des fantômes volans, claquetans leurs becs violans,
en sifflant mon âme espovantent
P. De Ronsard
Parmi les sciences humaines, l’anthropologie a pour vocation d’étudier le lointain pour
s’en approcher et le proche pour s’en éloigner. Or nul domaine plus que celui de la nuit ne se
prête autant à ce double exercice tant notre regard, nos habitudes et notre vécu nous semblent
universels et rationnels, tandis que ceux des autres, exotiques de l’espace ou du temps,
paraissent étonnants, incompréhensibles sinon follement déraisonnables. Dans leur approche,
les anthropologues se sont surtout attardés sur les événements exceptionnels qui ponctuent le
temps nocturne, tels les rituels d’initiation, de sorcellerie, les séances chamaniques, les
veillées funèbres ou le culte des ancêtres, mais jusqu’à une époque récente, ils n’avaient pas
accordé une attention suffisante aux pratiques du quotidien nocturne, aux préparations
minutieuses du corps avant sommeil, aux routines du temps consacré ou volé au sommeil, tant
dans les sociétés qu’ils étudient que dans la leur.
La nuit place les sociétés humaines devant des défis majeurs — obscurité, abandon de la
vigilance dans le sommeil, perceptions modifiées, évaluations sensorielles altérées… —
auxquels elles répondent par des échafaudages de règles, de contraintes, qui enserrent les
individus dans des cadres rigides destinés à contrôler des forces étranges et délétères, à
réparer les corps brisés ou malades des hommes, et aussi à assurer leur protection ou à
favoriser leur sommeil. Tout comme les épuisantes nuits d’apprentissage des chamanes
amazoniens, les rythmes soutenus du travail en milieu hospitalier, sur les routes, ou sur les
chalutiers de la pêche hauturière témoignent d’un ressenti dans lequel s’exprime le sentiment
de vivre dans un « ailleurs » du social, au prix parfois d’une souffrance insigne. Mais l’on sait
que la nuit permet aussi l’ouverture au champ infini des possibles, laissant libre cours à la
création, au désordre, au débordement, à la fête, aux jeux de Thanatos et aux larmes d’Eros.
Cette contradiction, que nous ressentons particulièrement en termes de contraintes et de
libertés, nous paraît généralisable partout et de tous temps. Or il n’en est pas exactement ainsi.
De fait, nous avons l’habitude de penser et de vivre sur un certain nombre d’alternances
qui nous semblent évidentes ou naturelles : clarté diurne/obscurité nocturne, veille/sommeil,
activité/repos, sécurité/danger. Il nous est ainsi difficile de nous convaincre que d’autres
sociétés ne les conçoivent pas et ne les vivent pas de la même façon. Historiens, sociologues
et psychologues nous en donnent d’excellents exemples : les uns remontent le temps et les
autres scrutent la modernité, dans des visées comparatives2. L’ethnographie prend acte du fait
que la nuit n’est pas « l’envers du jour » mais qu’elle a, dans chaque culture, des propriétés
1 Notion introduite par le groupe « Anthropologie de la nuit » de Nanterre. Voir Galinier, J. et al., 2010.
Anthropology of the night. Cross-disciplinary investigations, Current Anthropology, 51(6) : 819-847.
2 Koslofsky, Craig. 2011. Evening’s Empire. A History of the Night in the Early Modern Europe. Cambridge,
Cambridge University Press. Cabantous, A. 2009. Histoire de la nuit. XVIIe-XVIIIe siècle. Paris, Fayard.
Gwiazdzinski, L. 2005. La nuit, dernière frontière de la ville. La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube. Ekirch, A.
R. 2005. At day’s close: Night in times past. London, New York, Norton. Steger, B. and L. Brunt (eds). 2003.
Night-time and sleep in Asia and the West: Exploring the dark side of life. London, Routledge. Simon, W. 2005.
Sleep and society: Sociological ventures into the (un)known, London, Routledge.

2
spécifiques. Dans sa quête d’exhaustivité et son désir jamais comblé d’inventorier toutes les
figures possibles du vivre dans l’obscurité, l’ethnographie peint l’infinie diversité des modes
de traitement de la nuit, et la complexité de ses représentations et des modes d’agir qui lui
sont afférents. Que se passe-t-il aujourd’hui durant la longue nuit hivernale de deux-trois mois
chez les Inuit du haut Arctique Les jeunes, conditionnés par l’éclairage a giorno, bien souvent
24h sur 24, dans les habitations en préfabriqué, inventent des modes de relation rétifs au
respect de la marche des horloges et de la régularité des pauses réservées au repos. La
répulsion pour le sommeil dans ces populations met à mal le calcul d’un repos réparateur pour
chaque nycthémère3. Les chamanes amérindiens, comme les Huichol du Mexique, luttent
jusqu’à épuisement contre le sommeil pour rendre propice une visite épiphanique, favoriser
un état d’accueil des forces de l’esprit, seul capable d’apprivoiser les interlocuteurs du monde
autre. Les Wolof du Sénégal, rompus au respect méticuleux d’une étiquette de la nuit,
s’assurent par des paroles et des gestes que leur voisin est bien assoupi pour lui souhaiter une
nuit harmonieuse. Les Yukuna de Colombie amazonienne n’accordent aucune confiance aux
états éveillés du jour pour transmettre les connaissances de leurs experts chamanes : seule la
nuit est susceptible de faire circuler les savoirs, d’en asseoir l’autorité, grâce à des mises en
condition précises — alimentaires, sexuelles, et à l’aide raisonnée de psychotropes —, et par
l’ouverture des dispositifs perceptifs indispensables à la transmission des chants, des mythes
et des prières4. Les Mohave d’Arizona, vivant au milieu du désert dans le dénuement le plus
total, disposaient d’une véritable « science des rêves » servant à alimenter une mythologie
nocturne étourdissante. Dans les textes védiques, la nuit, que Charles Malamoud qualifie
d’« onctueuse », cède la place à l’Aurore, objet de contemplation et matrice d’où surgira la
civilisation5. Dans la Chine taoïste, à la nuit qui tombe, le Yang reprend ses droits sur le Yin
et les équilibres du masculin et du féminin se recomposent. Partout à travers le monde, la nuit
pose une redoutable interrogation aux pouvoirs en place, contraignant à instituer, comme dans
certaines royautés du Sahel, un rôle de « gardien du sommeil » du souverain afin de préserver
la vigilance d’un porteur d’autorité, ou encore, en Afrique orientale, à concéder au chef une
fonction de surveillance de l’activité onirique de ses sujets, décrétant quels rêves peuvent être
autorisés tandis que d’autres doivent rester interdits. En Papouasie, les rêves assoient la
légitimité du pouvoir en place alors que chez les Diegueños de Californie, ils pouvaient être
hiérarchisés en deux catégories, avec une prédominance du masculin sur le féminin. Si dans
ces sociétés du bout du monde les rêves font l’objet d’un traitement aussi systématique, c’est
qu’ils permettent de définir les modes de délimitation et de transgression des frontières des
différents états psychiques, conscients et inconscients, dans leurs rapports à l’état de la société
et du cosmos. Encore aujourd’hui, les indiens Zapara d’Equateur interrogent chaque jour leurs
rêves avant de prendre la moindre décision engageant la vie de la communauté, quitte à
solliciter ceux de l’anthropologue sur internet pour fortifier leur jugement. Les Maya Tzotzil
peuvent arriver à engager des travaux communautaires d’importance à la suite d’un rêve dont
l’interprétation prescrit de telles opérations6.
Si nous nous tournons vers nos sociétés, au-delà d’une apparente uniformité, de
nombreuses questions relatives à la nuit restent ouvertes et demandent des enquêtes de terrain
3 Bordin, Guy. 2011. On dansait seulement la nuit. Fêtes chez les Inuit du nord de la Terre de Baffin. Nanterre,
Publications de la Société d’ethnologie, coll. « Anthropologie de la nuit ».,
4 Fontaine, Laurent. 2014. La nuit pour apprendre. Le chamanisme nocturne des Yucuna. Nanterre, Publications
de la Société d’ethnologie, coll. « Anthropologie de la nuit ».
5 Malamoud, Charles. 2014. Communication personnelle.
6 Laughlin, Robert. 1988. The people of the bat: Mayan tales and dreams from Zinacantán. Washington,
Smithsonian Institution.

3
précises qui déferont bien des préjugés. Les formes diverses de percevoir, concevoir et vivre
la nuit montrent l’urgence de la regarder non seulement comme un complément du jour —
parfois un substitut, dans ses formes extrêmes —, mais comme générant une multiplicité
d’espaces, de temps et de modes de pensée spécifiques. Comprendre comment on pense la
nuit, comment on pense dans la nuit, et quelles sont les capacités cognitives exercées,
différentes de celles qui sont mobilisées le jour, voilà, entre autres, les tâches que s’assigne
l’anthropologie. On observe alors que les unités spatiales et temporelles diurnes sont
transposées en « mesures nocturnes » : l’espace est dilaté ou rétréci par les perceptions et
l’expérience, et traduit dans des concepts et des comportements (par exemple les propriétés
attribuées à des lieux « privés », « publics », « secrets », « intimes », « interdits » etc. dont le
statut change au cours du cycle circadien). La psychophysiologie met d’ailleurs elle aussi
l’accent sur la variabilité et l’élasticité des espace-temps perçus et vécus dans différents
contextes.
Le sommeil lui-même n’échappe pas à cette malléabilité ; il a été libéré des conditions
dites « naturelles » : on ne se couche plus guère avec les poules pour se lever dès potron-
minet. Les experts indigènes eux aussi modifient volontairement les cycles du sommeil des
apprentis chamanes, ouvrant l’accès à des états de conscience altérés. Témoins aussi les faits
d’activité rituelle, de guerre, de travail, de fêtes (cérémonies, initiations, rave parties, etc.),
occasions pour lesquelles, et selon l’urgence, les psychotropes retardent le sommeil tandis que
les somnifères le favorisent. Le sommeil et sa gestion ne sont donc pas des universaux
intouchables, ils sont aussi objets de contraintes et de stratégies déployées par les acteurs, et le
déterminisme physiologique est culturellement aménagé. En scrutant les habitudes et les
croyances de mères florentines et napolitaines à propos du sommeil de leur enfant avant et
après la naissance, les neurophysiologistes expliquent le contraste entre les configurations
différentes du sommeil de leurs nouveaux nés7. En sont aussi les témoins des diverses
interventions relatives à ce temps consacré au repos : apprentissage des veilles, injonctions
aux enfants, actes à portée persécutrice, militaire, répressive, ce qui relève de la violence
individuelle ou de ce qui fait intervenir la nuit comme un des paramètres de l’action politique.
Autre point fascinant abordé par les neurophysiologistes et touchant en même temps au
formatage culturel du sommeil et aux croyances qui y sont attachées, l’activité cérébrale dans
cet état d’absence périodique de conscience et de vigilance permet de poser des hypothèses
fortes sur les relations entre le savoir et la part nocturne de ses sources, de sa conservation, ou
de sa transformation. S’ils analysent de façon de plus en plus fine les réseaux
extraordinairement complexes existant entre les nombreuses et différentes sortes de
mémoires, les anthropologues doivent de leur côté montrer que chaque société dispose de tout
un corpus de savoirs et d’imaginaires portant sur les liens entre l’apprentissage et la nuit, et
sur les interactions entre humains, entités surnaturelles, rêves et savoirs, seulement alors
possibles. A partir de cette corrélation se construisent des ensembles mnémotechniques
sophistiqués, et des procédés d’utilisation ou d’oblitération de la mémoire.
Du travail nocturne, l’abondante littérature sociologique nous donne, à l’aide de
statistiques et de questionnaires, les différents décors, les dramatis personnae, les costumes de
la hiérarchie, le script ou sous un autre terme, les scénarios. Sur cet essentiel canevas,
l’ethnographe de terrain sonde les reins et les cœurs des acteurs, analyse les inférences sous le
discours, et tente d’atteindre le niveau profond où le rôle social s’ancre dans la culture ou
plutôt, dans nos sociétés globalisées, dans les cultures. Pour ne prendre qu’un seul exemple,
l’hôpital est le cas emblématique du travail de nuit et nombreuses sont les études qui
7 Toselli, M., P. Farneti et P. Salzarulo. 1998. Maternal representation and Care of Infant sleep, Early
development and parenting, 7 : 73-78.

4
analysent des récits à ce propos mettant en évidence des cadres nocturnes très différents de
ceux fonctionnant pour le même travail de jour, différents dans la gestion du temps, dans le
type de tâches à effectuer, dans celle des relations interindividuelles et dans l’acception même
de la notion de « nuit »8. Dans une usine automobile, au dernier tiers des 3/8, il n’y a que les
chaînes de production qui fonctionnent. Point de secrétaire, de cadre, de réunion syndicale, de
cantine : la nocturnité ancre un vécu différent. Dans un rapport étonnant sur l’économie
nocturne d’un site minier dans le nord de la Tanzanie, une ethnologue a montré le contraste
entre les conceptions de la nuit des mineurs-squatters issus des villages noirs proches du site,
déferlant au soleil tombé pour s’emparer clandestinement des outils et des lieux, et celles des
agents miniers blancs enfermés dans leurs habitations à la nuit qui se lève9.
Un autre point important, qui nécessite également une fine description, concerne les
marges qu’offrent les frontières entre jour et nuit. Aube et crépuscule, dans nos termes, sont
peu étudiés, quoique ces étapes limites recouvrent des mouvements annonciateurs de la phase
qui suit. Si nous nous écartons de la ville et de l’Occident, chez les Nahua du Mexique comme
dans d’autres communautés mésoaméricaines, l’anthropologue des temporalités montre le
déclenchement progressif des rituels nocturnes dans la partie défaillante du jour, minime sous
ces latitudes, ce qui signifie que les frontières sont mouvement et que la nuit n’est pas
coextensive à l’obscurité, ni la clarté au jour.
Domestiquer ou familiariser la nuit (ou l’administrer ?), c’est d’abord en comprendre les
différentes textures, analysées jusque dans les profondeurs des pratiques conscientes et
inconscientes et des croyances qui leur sont associées. Traditions et représentations changent :
entre l’arrivée de « la lumière artificielle » — évolution depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe
siècle si heureusement analysée par Ekirch, Koslofski ou Cabantous en Europe— et « la
pollution lumineuse » d’aujourd’hui cernée par les géographes associés aux écologues et aux
médecins, l’évolution des conceptions relatives à la nuit est manifeste. Idées et mœurs
peuvent aller jusqu’à l’inversion. La littérature, la tradition orale, les rumeurs, les sermons et
les chansons portent un ensemble de croyances qui se structurent autour d’attracteurs cognitifs
et font et défont les physionomies de la nuit fatale ou celles de la nuit faste ou fastueuse. La
promotion de la vie nocturne peut transformer la nuit en « hyper-jour », comme le font les
spectacles de music-hall dans lesquels le corps transfiguré des jeunes femmes les rend non
reconnaissables par leurs proches, tant l’intensité d’une lumière « solaire » associée à des
artifices destinés à la magnifier, aveugle littéralement les spectateurs10. Il ne s’agit alors plus
de jour ni de nuit. En accroissant désirs et exigences la nuit durant, comme s’il s’agissait de la
journée — manger, travailler ou s’instruire, se divertir ou se cultiver — en même temps que
les activités, s’instaure une gigantesque mobilité avec ses impératifs11. Il existe aussi des
effets de « mode » qui touchent à la nuit : sur les précautions à prendre pour le sommeil des
nourrissons ou les moments propices à la somnolence sans manquer à la bienséance. Modes
des « happy hours », mode de la Nuit de la Déprime à Paris, des Nuits Blanches, tous
intervalles de moments plus ou moins longs qui font surgir, en même temps en des lieux
spécifiques, un arsenal d’objets et de comportements adéquats. Qu’en est-il des étudiants
japonais qui s’abandonnent à de petits sommes plusieurs fois dans la journée pendant leurs
8 Soliveres, Anne. 2001. Infirmières, le savoir de la nuit. Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Partage
du savoir ».
9 Bourgoin, France. (Danish Institute for International Studies), Communication au séminaire « Anthropologie
de la nuit » du 25 mars 2010.
10 Fourmaux, Francine. 2009. Belles de Paris. Une ethnologie du music-hall. Paris, Editions du Comité des
Travaux Historiques et Scientifiques.
11 Gwiazdzinski, Luc. 2002. La ville 24 heures sur 24. La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube.

5
cours ou s’appuient sur l’épaule du voisin dans le métro, introduisant, au pays du Soleil
Levant, la nocturnité du repos, procédé de survie… mal vu dans les amphithéâtres de la
Sorbonne. Mode ? Trait culturel ? Il n’est que de relire le jésuite portugais L. Fróis qui, au
XVIe siècle, compare le Japon et l’Europe et y décrit un contraste structurel d’habitus de la
nuit à partir d’un inventaire cocasse d’oppositions, tel celui qui s’offre à notre époque
moderne12.
Penser la nuit ne se réduit pas à organiser, telles que nous les voyons surgir de nos jours,
des promenades touristiques pour « la nuit de la chouette », « des chercheurs », « de l’eau »,
« des musiques », « des étoiles », ou à prôner « la nuit européenne des musées ».13 La nuit,
nous l’avons dit, est à la mode, sert de prétexte à l’invention de shows extravagants, à nommer
des parfums et s’emparer de mille et un produits de consommation. Comme s’il fallait se
rattraper d’un oubli. Mais elle est bien davantage. La nuit englobe des phénomènes des plus
divers et de tailles prodigieusement différentes. Elle est un enjeu majeur aussi bien pour le
fonctionnement d’un micro-organisme que pour la défense nationale. Et l’anthropologie n’a
qu’à se dépêcher pour suivre à rebours ce fil d’Ariane qui, loin cette fois, de nous faire sortir
du labyrinthe vers la lumière, nous emmène au cœur de la nocturnité, sous le règne du
Minotaure.
12 Fróis, Luís. 2003. Européens et Japonais. Traité sur les contradictions et différences des mœurs. Écrit par le
R.P. Luís Fróis au Japon, l’an 1585. Paris, Chandeigne.
13 Signalons, pour une information de dernière minute, que « La nuit des Maths » vient de se produire le 4 juillet
2015 à Tours.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%