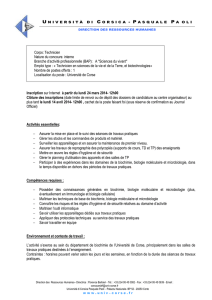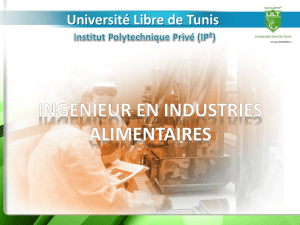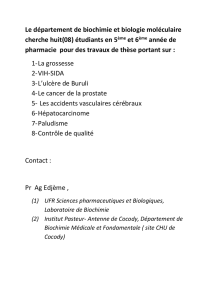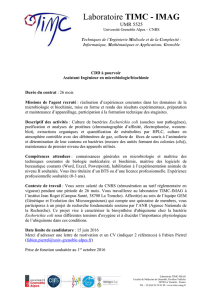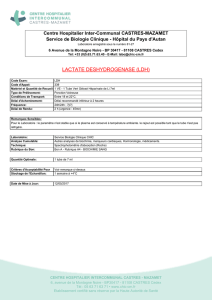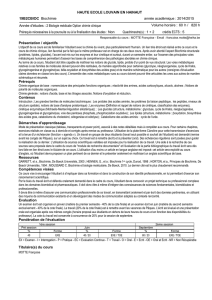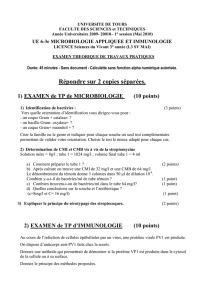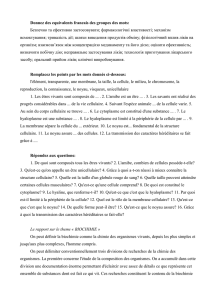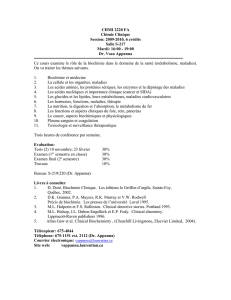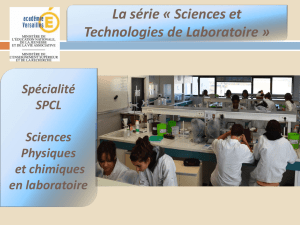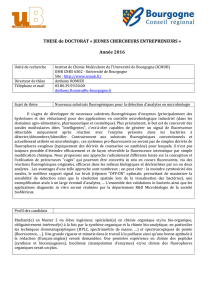génie biologique - cache.media.education.gouv.fr

Concours du second degré – Rapport de jury
Session 2010
AGRÉGATION
Externe
Biochimie génie biologique
Rapport de jury présenté par Monsieur François LASBENNES
Président de jury
Les rapports des jurys des concours sont établis sous la responsabilité des présidents de jury
Secrétariat Général
Direction générale des
ressources humaines
Sous-direction du recrutement

Sommaire
Composition du jury page 3
Renseignements statistiques page 4
Epreuves d’admissibilité
Composition de biochimie page 6
Composition de microbiologie page 9
Composition de biologie cellulaire et de physiologie page 11
Epreuves d’admission
Epreuve pratique de chimie page 14
Rapport sur l’épreuve de chimie page 37
Epreuve pratique de microbiologie page 43
Rapport sur l’épreuve de microbiologie page 61
Epreuve pratique de biochimie – physiologie page 65
Rapport sur l’épreuve de biochimie-physiologie page 85
Epreuves orales page 87
Rapport sur les leçons de biochimie page 88
Rapport sur les leçons de microbiologie page 89
Rapport sur les leçons de biologie humaine page 90
Rapport sur les études critiques de dossiers page 94
Rapport sur la chimie à l'oral page 96
Reflexions sur la session 2010................................................page 97
Annexes
Liste des ouvrages disponibles p 98

COMPOSITION DU JURY
Président
M. François LASBENNES, professeur des Universités, Université de Strasbourg ,
STRASBOURG
Vice-président
M. Michel GAVRILOVIC, inspecteur général de l’Education Nationale, Groupe Sciences et
Techniques Industrielles : Biotechnologies
Secrétaire général
Mme Florence RIVENET, professeur agrégée de BGB, TZR, Lycée Pierre-Gilles de Gennes
(ENCPB), PARIS
Membres
M. Xavier BATAILLE, professeur agrégé, Lycée Pierre-Gilles de Gennes (ENCPB), PARIS
M. Erwan BEAUVINEAU, professeur agrégé, Lycée Pierre-Gilles de Gennes (ENCPB),
PARIS
M. Christophe BELOIN, Chargé de recherche, Institut Pasteur, PARIS
Mlle Christine BENAYOUN, professeur agrégée de BGB, Lycée Pierre-Gilles de Gennes
(ENCPB), PARIS
Mme Hélène CARRIE, professeur agrégée, Lycée Pierre-Gilles de Gennes (ENCPB), PARIS
M. Fabien CEZARD, professeur agrégé, Lycée Pierre-Gilles de Gennes (ENCPB), PARIS
Mlle Jeanne-Laure DORMIEUX, professeur agrégée, Lycée d’Arsonval SAINT-MAUR-DES-
FOSSES
M. Frédéric DUCANCEL, Ingénieur de recherche, CEA D’études des protéines GIF-SUR-
YVETTE
M. Marc LANDRY, professeur des Universités à l'INSERM, BORDEAUX
M. Philippe LEJEUNE, Professeur des Universités, Institut national des sciences appliquées,
VILLEURBANNE
M. Daniel LONCLE, professeur agrégé HC, Lycée Pierre-Gilles de Gennes (ENCPB), PARIS
M. Alain MOREL, Professeur des Universités, Université ANGERS
M. Fabrice ROBLES, Professeur Agrégé
Mme Lucille TIGER YVERNAULT, professeur agrégée, Lycée Pierre-Gilles de Gennes
(ENCPB), PARIS

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES
Candidats inscrits…………………………………………………………….. 275
Candidats présents à l'épreuve d'admissibilité…………..………………… 72
Nombre de postes ………………………………………………………….… 10
Candidats admissibles………………………………...…………………….. 21
Candidats présents aux épreuves d'admission…………..……………….. 21
Candidats proposés pour l'admission ……………………………………… 10
Barre d’admissibilité ………………………………………………………….07,50
Barre d’admission …………………………………………………………….09,34
Epreuves d'admissibilité
Moyenne générale des candidats présents…………………………………06,22/20
Moyenne générale des candidats admissibles…………..…………………09,35/20
Biochimie
Moyenne des candidats présents……………………………………………05,76/20
Moyenne des candidats admissibles ……………………………………… 09,10/20
Note maximale ………………………………………………………………..15,50/20
Microbiologie
Moyenne des candidats présents …………………………………………..07,13/20
Moyenne des candidats admissibles ……………………………………… 10,36/20
Note maximale ………………………………………………………………..13,50/20
Biologie cellulaire et Physiologie
Moyenne des candidats présents …………………………………………..05,42/20
Moyenne des candidats admissibles ……………………………………… 08,60/20
Note maximale ……………………………………………………………….. 15,00/20
Epreuves d'admission
Moyenne générale des candidats présents ………………………………..09,81/20
Moyenne générale des candidats admis ………………………………….. 11,79/20

Travaux pratiques de biochimie-physiologie
Moyenne des candidats présents…………………………………………. 11,36/20
Moyennes des candidats admis ………………………………………….. 14,15/20
Note maximale ……………………………………………………………… 14,90/20
Travaux pratiques de microbiologie
Moyenne des candidats présents…………………………………………. 10,47/20
Moyennes des candidats admis ………………………………………….. 11,42/20
Note maximale ……………………………………………………………… 14,90/20
Travaux pratiques de chimie
Moyenne des candidats présents…………………………………………. 10,90/20
Moyennes des candidats admis ………………………………………….. 10,85/20
Note maximale ……………………………………………………………… 14,50/20
Leçon
Moyenne des candidats présents ………………………………………… 08,71/20
Moyennes des candidats admis ………………………………………….. 12,00/20
Note maximale ……………………………………………………………… 18,00/20
Epreuve critique de dossier
Moyenne des candidats présents ………………………………………. 08,71/20
Moyennes des candidats admis ………………………………………… 10,90/20
Note maximale ……………………………………………………………. 14,00/20
Ensemble du concours
Moyenne des candidats présents ……………………………………… 09,66/20
Moyenne des candidats admis …………………………………………. 11,18/20
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
1
/
112
100%