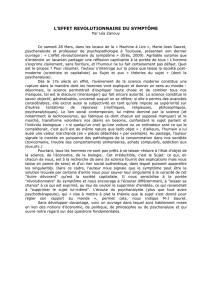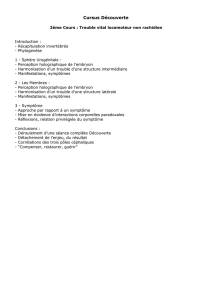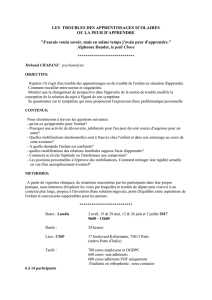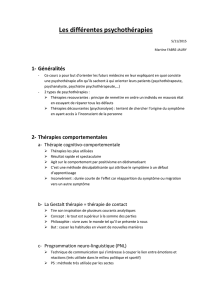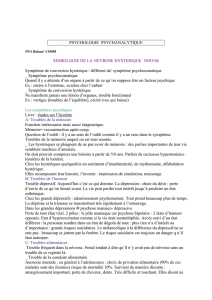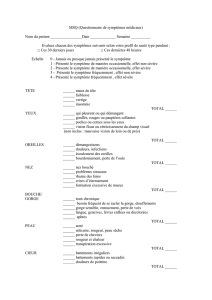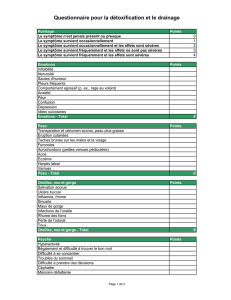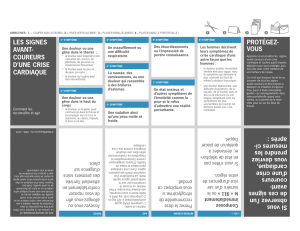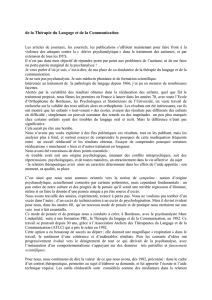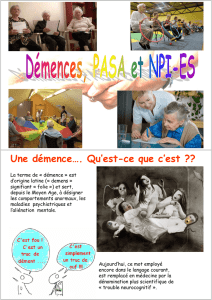communiquer des approches contradictoires en sciences de l

S
ciences-
C
roisées
Numéro 4 : La communication
Communiquer des approches contradictoires
en sciences de l’éducation
Bruno Goloubieff
Université de P
rovence
(Département des Sciences de L’éducation ; UMR A
D
EF)
goloubieff.bruno@ neuf
. f
r
Michel Vial
Université de P
rovence
(Département des Sciences de L’éducation ; UMR A
D
EF)
michel.vial@ univ-provence
. f
r
COMMUNIQUER DES APPROCHES
CONTRADICTOIRES EN SCIENCES DE
L’EDUCATION : UN POINT DE VUE PLURIEL
SUR LES CONCEPTS AU SERVICE DE LA
PROFESSIONNALISATION
Résumé : A partir d’un questionnement portant sur le statut du
symptôme en thérapie brève et en psychanalyse, il est tenté d’extraire les
fondements et les enjeux des deux approches pour entrevoir quelles
pourraient être leur possible complémentarité en terme de
professionnalisation. A travers la signification et l’utilisation de concepts
scientifiques est ainsi posée la question du pouvoir et des limites de toute
approche ainsi que leurs enjeux politiques et praxéologiques. Aussi,
croiser les approches, ce n’est pas se contenter de les opposer, mais faire
naître, à partir d’un point de vue pluriel, un autre questionnement issu de
la mise en tension de deux approches contradictoires.
Mots clés : symptôme, point de vue, posture, projet, débat,
contradiction, professionnalisation.
COMMUNICATING CONTRADICTORY APPROACHES
IN EDUCATIONAL SCIENCES: A PLURAL POINT OF
VIEW
ABOUT CONCEPTS APPLIED TO PROFESSIONAL
TRAINING
1

Abstract : After studying (a series of questions about the symptom
status in short therapy as well as in psychoanalysis, we have tried to
highlight the fundaments and stakes of each approach in order to define
how they could possibly complement in the professional training.
Through the significance and use of scientific concepts, we can wonder
about the efficiency and limits of any approach as well as its political
and praxeological stakes. Thus, using both approaches is not merely
opposing them but creating from a plural start another argument
emerging from the tension of two contradictory approaches.
Key-words : symptom, point of view, posture, project, argument,
contradiction, professional training.
2

Introduction
Aborder le thème de la communication par l’entremise des
sciences de l’éducation est une occasion de partir de termes, de notions
et de concepts identiques pour tenter de comprendre comment ils ont été
travaillés par différentes disciplines. L’intérêt est ici de questionner les
aménagements nécessaires à la transposition de concepts et d’idées
importées des sciences mères par les sciences de l’éducation pour y
construire une réflexion dans le champ de la professionnalisation.
1. Quel statut pour le symptôme en sciences de
l’éducation ?
1.1. Supprimer le symptôme ?
L’école de Palo Alto a construit son approche en mêlant des
principes empruntés à la cybernétique, à l’anthropologie et à la biologie.
Elle s’attache principalement aux effets de la communication sur le
comportement, notamment dans le champ de la thérapie brève. Elle peut
être qualifiée d’approche pragmatique. Elle a montré que la
communication a une influence sur le comportement et qu’il s’agit de
changer les interactions pour que le comportement change. Pour cela, le
problème doit être identifié comme récurrent, afin d’être stoppé et
empêcher le renforcement du symptôme. En prescrivant le symptôme
(Watzlawick, Beavin, Jackson, 1972), la thérapie brève1 va tenter
d’éliminer ce dernier. C’est sur ce point qu’il convient de revenir. La
suppression du symptôme pose un certain nombre de questions quant à
son statut. Loin de renier l’efficacité de la thérapie brève en terme de
réussite et de succès, c’est justement la visée d’efficacité liée à
l’intervention du thérapeute qui est à interroger, parce qu’elle tend à
considérer le symptôme comme élément nuisible. Or, il existe d’autres
points de vue sur le symptôme.
La psychanalyse, en particulier les travaux de Lacan (1966), lui
confère un tout autre statut. En cela, le symptôme est éminemment
respecté, parce qu’il fait partie du sujet. Il est le signifiant qui échappe au
contrôle du sujet. Il est le sujet-même chez Lacan, en ce qu’il le
représente, divisé à lui-même, en sa propre méconnaissance ; il le frappe
au coin de l’Autre, dans une altérité énigmatique qui lui pose problème
et souffrance. L’éliminer reviendrait à gommer ce qui parle à travers lui.
Ces deux écoles ne partagent pas le même point de vue quant à la
souffrance humaine et c’est ce qui les amène à se positionner
différemment quant à la façon de concevoir et de traiter le symptôme.
Pour l’école de Palo Alto, il n’y a pas d’inconscient. Elle ne s’intéresse
donc pas aux forces inconnues, ni à une clinique du sujet. Ce sont les
interactions qui sont traitées. L’apport de la thérapie brève se situe bien
au niveau de son savoir sur les effets du symptôme dans la
communication. En d’autres termes, elle connaît les effets d’une
communication pathologique et tente d’y remédier efficacement. On voit
1 Les principes de la thérapie brève ont largement dépassé le cadre thérapeutique
pour être utilisés ailleurs, c’est pourquoi une telle popularité requiert
d’interroger la pertinence de tels principes dans le champ de la
professionnalisation.
3

donc des axiomes très différents selon le champ adopté, axiomes que
nous éviterons d’opposer simplement, pour y trouver une possible
complémentarité selon les moments et le contexte.
La façon qu’a Lacan de considérer le symptôme est non pas de le
rejeter, mais de faire qu’à travers la cure, il soit assumé le plus possible.
Le symptôme en psychanalyse renvoie au principe de plaisir-déplaisir
(Freud, 1986) et à la jouissance qui en découle. Le symptôme exprime le
refoulement de la castration du sujet, en ce sens que ce dernier refuse le
manque né de la castration. A travers ce refoulement, le sujet veut se
vivre encore comme complet et absolu, mais cela l’isole parce que sa
jouissance est en même temps source d’angoisse, corrélée à la pulsion de
mort visant un retour à l’inorganique, par la recherche infinie et éperdue
du même état de plaisir et empêche ainsi une relation de sujet à sujet.
Elle tend à mettre les autres en position d’objets à son service2. Le
refoulement de la castration se complait dans une relation imaginaire de
sujet à objet. Une telle jouissance n’est pas acceptable socialement
(répréhensible). Pour cette raison, elle est la plupart du temps refoulée
(renvoie à l’interdit) pour permettre une vie sociale.
1.2. Une problématique de reconnaissance
Pourtant, le symptôme peut être vu sous diverses formes et
modalités déclinées, selon ce qu’il exprime, ce qu’il montre dans son
rapport au réel. Toutes ses expressions ne sont pas égales entre elles. Par
exemple, l’alcoolisme est considéré comme une maladie psychologique
et sociale et se trouve donc globalement rejeté ou/et traité. En revanche,
l’individu qui collectionne les timbres ou celui qui est l’objet d’une
obsession moins nocive pour l’entourage, c’est-à-dire socialement
tolérable3, n’encourra pas l’opprobre. Toutes ses déclinaisons du
symptôme semblent toucher le sujet dans sa double quête de
reconnaissance et d’expression de sa souffrance. S’il est vrai que l’idée
de sens à construire a souvent été mise en avant par les recherches en
sciences de l’éducation, la question de la reconnaissance du sujet nous
semble liée à la construction de sens. Se peut-il que la reconnaissance du
sujet se réduise à la reconnaissance de son symptôme ?
A cette question pourrait être objectée l’idée de suppression du
symptôme par la thérapie brève. S’il est établi que le symptôme est
supprimé, l’individu ne cesse pas cependant de vivre. Ceci ne contredit
pas pour autant notre questionnement. Bien au contraire, la suppression
n’interdit pas le déplacement du symptôme4, c’est-à-dire qu’il peut
prendre une autre forme, moins gênante pour l’interaction, ou du moins
plus discrète. La vie d’un sujet qui ne représente apparemment pas un
danger pour lui-même ni pour autrui n’interdit pas non plus la possibilité
2 En épistémologie génétique, les travaux de Piaget ont montré que le bébé
utilise des conduites de détours (signe d’intelligence) pour parvenir à ses fins.
La mère est utilisée en tant qu’objet (d’amour) pour la satisfaction de ses
besoins.
3 On peut envisager des modalités qui s’exercent dans divers catégories du réel,
tels que le rapport au savoir, le travail, la famille…, bref tout ce à quoi
l’individu peut consacrer du temps.
4 Peut-être s’agit-il du patient qui déplace son symptôme et le fait changer de
forme. L’idée de déplacement tient au fait que le symptôme peut investir une
autre facette de la vie du patient.
4

d’expression du symptôme. Il peut s’agir comme nous l’avons dit d’un
symptôme plus socialement acceptable, mais il peut aussi s’agir d’une
succession d’assujettissements à des activités, qui peuvent même
sembler ne pas avoir de liens entre elles5.
Dans cette perspective, tout sujet vivant charrie ses obsessions et
donc ses propres symptômes 6 plus ou moins dérangeant pour la société.
En l’occurrence, de grands écrivains et artistes ont fondé leurs œuvres
sur et à partir de leur symptôme. La différence se situe ici dans l’idée que
ces humains ont suivi l’inspiration que leur conférait le symptôme et
l’ont pleinement assumé à travers des formes sublimées7, sans que ce
dernier change forcément de domaine d’expression (peinture,
sculpture…). Dans cette autre façon de considérer le sujet, il s’agirait
d’assumer que le symptôme signe le manque qui le constitue en tant que
sujet parlant (et communiquant). En prenant une forme socialement
acceptable ou du moins tolérable, il offre au sujet la possibilité de
travailler à sa reconnaissance d’être inachevé.
2. Peut-on jouir socialement ?
2.1. Des symptômes socialement acceptables
La jouissance est socialement condamnable, en partie parce que
notre société est imprégnée, irriguée par la morale judéo-chrétienne8.
Pourtant, on peut se demander si la jouissance n’existe pas en prenant
des formes socialement plus acceptables. Aller sur la lune, par exemple,
si noble que fût un tel défi, n’en est pas moins l’expression d’une
jouissance collective du prestige de conquête de l’homme sur la matière,
tout en étant également une jouissance de la maîtrise d’une technologie.
Aussi, ce qui la distingue, c’est la forme qu’elle prend, le contexte et la
cause qu’elle sert, cause issue de l’appareil politique en place. Dans cette
optique la jouissance tout comme le symptôme accède à un autre statut
dès lors qu’il est partageable par convenance sociale. On pourrait donc
jouir à plusieurs, ce qui n’invalide pas pour autant l’idée d’isolement. Au
contraire, le pouvoir lié à la constitution d’un ordre procède également
d’un isolement. Bachelard (1986) le pensait lorsqu’il disait qu’une
communauté scientifique se développe en rupture avec le sens commun
tout en protégeant ses principes et théories des disciplines extérieures.
Ce passage du symptôme comme jouissance isolé à une forme
socialement partagée ouvre un questionnement sur le symbole. A la
dimension imaginaire du petit autre de Lacan, conscience moïque isolée
5 Par exemple, passer d’une obsession de la maîtrise d’une langue étrangère au
culte du corps comme symptôme, à interpréter pour devenir signifiant pour le
sujet.
6 Là où le symptôme peut se voir, l’obsession se vit davantage de l’intérieur, ce
qui peut faire du symptôme une manifestation comportementale de l’obsession.
L’obsession est un symptôme et, en tant que tel, il constitue un signe qui
demande à être interprété.
7 Le symptôme pourrait ainsi être assumé dès lors qu’il est reconnu socialement.
La sublimation qui fait appel à la transcendance, est un des trois principaux
destins de la pulsion que sont le refoulement, la sublimation et le fantasme,
selon Freud (Nasio, 2001).
8 Jouir est la plupart du temps considéré comme un pêché.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%